Discours préliminaire du traducteur, R. Tourlet
La plupart de nos critiques français, conservant à Pindare le titre de prince des poètes lyriques que lui donna Quintilien, applaudissent aux éloges qu'en avaient faits, avant celui-ci, Horace et Cicéron : le goût et le bon sens dont s'armèrent Boileau et madame Dacier, zélés partisans des anciens, eurent bientôt fait justice des déclamations de Perrault et de Lamotte, qui préféraient Chapelain à Homère ; qui ne voyaient dans les odes de Pindare que petits faits et grands mots, et dans ce chantre sublime, qu'un
| Grand inventeur d'objets mal enchaînés, Grand marieur de mots l'un de l'autre étonnés : Il s'entendait à faire une ode. Le caprice était sa méthode, Et son art, de tout hasarder. (LAMOTTE, liv. 1, fable 18, et liv. 3, fable 13) |
Le vrai mérite subjugue les suffrages et va droit à la postérité. Pindare, l'idole de la Grèce, en vénération parmi les Latins, commande encore l'admiration de l'Europe savante : son génie sera toujours à l'abri des atteintes de la satire et de la malignité. Je me bornerai donc à rappeler à mes lecteurs deux reproches que font, à ce poète, quelques littérateurs qui se disent de bonne foi :
1° Celui d'être obscur en beaucoup d'endroits de ses odes ;
2° Celui d'être brusque ou même peu heureux dans ses transitions.
La hardiesse du génie du poète et de la langue qu'il parlait, a fait gratuitement supposer le dernier défaut, que l'art du traducteur doit faire disparaître. Disons un mot du premier. Sans doute un auteur qui affecte d'être inintelligible ne mérite pas qu'on s'occupe de lui ; on regrettera peu de n'avoir pas en bon français ce ténébreux Lycophron que les Grecs eux-mêmes n'entendaient pas. Mais quand l'obscurité ne vient que de l'ignorance où nous sommes des localités et des moeurs d'un autre siècle, c'est à nous à franchir l'intervalle qui nous en sépare ; et si elle naît de la force de l'imagination ou de la sublimité des idées, c'est à nous encore à nous élever à la hauteur du génie : la prétention de le mettre au niveau de notre médiocrité serait aussi injuste qu'extravagante.
N'écoutons donc ni ceux qui déprécient Pindare pour se venger de la peine inutile qu'ils ont prise de l'étudier, ni ceux qui aiment mieux le supposer obscur que de chercher à l'entendre. Les uns sont mal nés pour la poésie ; les autres connaissent peu la langue des Grecs, ou dédaignent d'ouvrir les fastes de leur histoire, pour y puiser les détails nécessaires à l'intelligence de leurs poètes.
La mythologie, qui ne nous est point assez familière, peut laisser encore quelque obscurité dans plusieurs odes de Pindare. Le but de ma traduction est de lever cet obstacle vrai ou supposé, et d'écarter jusqu'à l'ombre des reproches dont je viens de faire mention. J'ai tâché d'atteindre, en notre idiome, à la sublimité du poète grec, de présenter ses idées dans leur force et dans leur ensemble ; d'aplanir les difficultés particulières, soit au texte et aux allusions qu'il renferme, soit aux faits dont il suppose la connaissance. Je désire que mon travail mette en quelque sorte le lecteur à portée de connaître et de juger le poète aussi sainement que s'il le lisait dans sa propre langue.
Maintenant je divise ce discours préliminaire en trois parties. La première comprendra l'abrégé de la vie du poète, ou les faits de son histoire dont la connaissance est venue jusqu'à nous ; la seconde, un précis historique des jeux de la Grèce, au moins ce qu'il est nécessaire d'en savoir pour entendre le texte que j'ai traduit : dans la troisième enfin, j'exposerai les principes qui m'ont guidé dans la traduction de ses odes ; et en même temps je donnerai un aperçu des travaux de ceux qui m'ont devancé dans la carrière.
PREMIERE PARTIE
Pindare naquit à Thèbes en Béotie, ou à Cynocéphale, village très voisin de cette ville. La plupart des anciens le nomment fils de Daïphante, quelques-uns fils de Scopélinus, ou même d'un certain Pagonidas. D'autres veulent ou que Daïphante ait porté différents noms, ou que sa veuve ait épousé successivement Scopélinus et Pagonidas, tous deux musiciens. La mère de Pindare est appelée Myrto ou Myrtis par les uns, Clidicé par les autres. Erotion est le seul frère de Pindare dont quelques écrivains nous aient transmis le nom. L'époque de la naissance de notre poète n'est pas mieux déterminée par les auteurs. Suidas la fixe à la première année de la soixante-cinquième olympiade (520 ans avant JC.). Il pense avec Eusèbe que ce poète était dans la force de l'âge (quarante ans), lors de la fameuse expédition de Xercès contre la Grèce, qu'on rapporte cependant à la soixante-seizième olympiade ; ce qui ne cadre qu'à quatre ou cinq ans près. L'opinion de Corsini, assez bien fondée d'ailleurs, qui place la naissance de Pindare, non à la première, mais à la troisième année de la soixante-cinquième olympiade, sans résoudre entièrement la difficulté, approche du moins de l'exactitude. Quoi qu'il en soit, Eschyle était né quelques années avant notre lyrique : celui-ci vivait en même temps que Simonide et Bachylide ; mais il était plus jeune que le premier, plus âgé que le second. Le poète Alcman l'avait précédé de cent cinquante années, Alcée de cent, Stésichore de cinquante.
Pindare avait reçu de la nature d'excellentes dispositions ; et ses parents le firent instruire de bonne heure dans la musique et la poésie, à l'école du célèbre Lasus, sous lequel il fit de rapides progrès. Son attachement au culte de ses pères était si connu que sa demeure, voisine d'un monument consacré à la mère des Dieux, passait pour un temple dont il se faisait gloire d'être ministre. La réputation de sa piété fut telle, même après sa mort, que les Lacédémoniens et, depuis, Alexandre le Grand, maîtres de Thèbes, respectèrent sa mémoire et épargnèrent sa maison. Il composa beaucoup d'hymnes en l'honneur des Dieux. Il fit aussi des drames, des dithyrambes, et même quelques ouvrages en prose. Nous n'avons de complet, à peu de choses près, de cet illustre poète, que des odes, sur ces jeux mémorables distingués par le nom des lieux où ils se célébraient.
Il eut de Timoxène, son épouse, un fils nommé Daïphante, et deux filles, Protomaque et Polymétis ou Eumétis.
Ses concitoyens le taxèrent à une amende pécuniaire pour avoir fait, dans une de ses poésies, l'éloge d'Athènes, rivale de Thèbes. Mais on ajoute que les Athéniens se firent un devoir de payer pour lui cette amende.
Il avait passé sa quatre-vingt-dixième année lorsqu'il mourut, dit Lenglet du Fresnoy, dans la troisième année de la quatre-vingt-huitième olympiade. Selon quelques auteurs, il était alors âgé de quatre-vingt-quatre ans seulement, et dans la quatre-vingt-sixième olympiade ; il ne vécut que cinquante-cinq ans, si nous en croyons Suidas, et soixante-six, d'après le rapport des scoliastes. Ces derniers citent cependant des écrivains qui placent cette mort à la quatre-vingt-sixième olympiade, et à la quatre-vingtième année de la vie du poète. Le savant Heyne (Dissert.9, tom. 2, p. 50 et 62) la fixe plus justement à la troisième année de la quatre-vingt-troisième olympiade, qui répond à la trente-cinquième pythique, avant JC. 446, Pindare étant alors âgé de soixante-quatorze ans ; ce qui cadre parfaitement avec l'époque de sa naissance, la cinq cent vingtième année avant l'ère vulgaire.
Les anciens s'accordent mieux sur une circonstance particulière de sa mort : il mourut, disent-ils, sur le théâtre, en se reposant sur les genoux du jeune Théoxène, son disciple, qu'il avait tendrement aimé.
Un trait de sa vie, rapporté par Elien, lib. XIII, cap. 25, mérite mieux d'être connu. A Thèbes, des juges partiaux ou ignorants avaient cinq fois couronné du laurier d'Apollon Corinne, femme auteur et rivale de Pindare. Celui-ci en appela au jugement de Corinne elle-même.
Il eut sans doute moins de ménagement pour Bachylide ; et les scoliastes croient avec raison que c'est contre celui-ci qu'il dirige certaines expressions dures, que nous retrouverons dans ses odes. Cependant il ne le nomme jamais, ce qui est au moins une preuve de discrétion. Il fréquenta les cours des rois de Syracuse et d'Agrigente. L'éloge qu'il nous a laissé d'Hiéron, dont l'histoire ne fait pas un portrait fort avantageux, doit s'entendre, dit-on, des dernières années du règne de ce prince ; ou peut-être était-ce, dans l'intention du poète, un moyen de lui donner de sages conseils. Les détails de localité qu'on remarque dans les odes de Pindare prouvent qu'il connaissait bien son pays , et même qu'il avait parcouru toute la Grèce.
Son ton emphatique lorsqu'il parle des richesses , et la chaleur avec laquelle il semble demander le salaire ou la rétribution de ses odes, l'ont fait soupçonner de cupidité. Mais en lisant attentivement les passages qui donnent lieu à cette inculpation, on voit qu'il n'emprunte de l'éclat du luxe, des richesses, toujours éblouissant aux yeux de la multitude, que des comparaisons pour rehausser son style. Au reste, l'exaction du salaire n'aurait pas été plus déplacée dans les moeurs de son siècle que ne le serait aujourd'hui la stipulation d'un orateur du barreau, ou l'ambition d'un auteur de rendre son travail productif. Il travaillait pour la gloire, sans doute ; mais les recherches, les voyages même qu'il fallait faire, pour avoir une connaissance particulière de la famille et de la ville des vainqueurs qu'il s'agissait de célébrer, nécessitaient des dédommagements peu onéreux à ceux qui les donnaient, et honorables à celui qui devait les recevoir. Lui reprochera-t-on aussi d'avoir senti la supériorité de son génie, d'en avoir tiré vanité, de s'être comparé à un aigle ? Mais alors il faudra faire le procès à Horace, à Boileau, à tous les favoris des Muses, dont les vers respirent plus l'enthousiasme que la modestie.
DEUXIEME PARTIE - Des Jeux olympiques, et des Jeux de la Grèce en général
L'origine des jeux de la course, de la lutte, du pugilat, etc., se perd dans la nuit des temps héroïques ou fabuleux. Ces jeux servaient comme de clôture aux pompes funèbres, ou marquaient d'autres événements mémorables. Leur but était d'accroître, par l'exercice, la force du corps qui, à défaut de civilisation, donnait une grande prépondérance dans les affaires publiques.
Hercule, l'un des dactyles de Crète, fonda, dit-on, les premiers jeux olympiques, quinze cents ans avant JC. ; Pélops, fils de Tantale et vainqueur d'Oenomaüs, roi de l'Eiide, les renouvela dans cette contrée, à l'exemple de son prédécesseur, vers l'an 1321, d'autres disent 1315, avant l'ère vulgaire. La célébration périodique de ces mêmes jeux dans la ville d'Olympie, et depuis dans celle de Pise, ne fut ordonnée par Hercule, thébain, fils d'Alcmène, que bien des années après, et en mémoire de sa victoire sur Augias, qui occupait le trône des Pélopides. Le silence d'Homère sur ces jeux olympiques prouve qu'ils furent quelque temps interrompus, ou même selon Strabon, lib. VIII, c.3, qu'ils n'existaient pas lors de la guerre de Troie, dans la forme qu'ils eurent depuis.
Iphitus, souverain d'un canton de l'Elide, vers l'an 884 avant JC., les rétablit d'après le conseil de Lycurgue ; mais ils n'eurent de périodes bien régulières que cent huit ou cent douze ans après lui, lorsque Corèbe l'Eléen remporta le prix de la course du stade. Cette première olympiade dut commencer au 14 juillet ; et le jour du couronnement des vainqueurs dut répondre au 19 du même mois de l'an 776 avant JC. Le nom de Corèbe fut le premier inscrit sur un registre public. On partit de cette olympiade pour distinguer les époques subséquentes de quatre en quatre ans révolus, en sorte que chaque cinquième année ramenait la célébration des jeux olympiques. D'abord un seul jour fut affecté exclusivement à cette cérémonie précédée et suivie de sacrifices. Mais à dater de la soixante-dix-septième olympiade, elle dura cinq jours entiers, depuis le 11 du mois hécatombéen, premier mois de l'année sacrée de ce pays, commençant avec la première lune nouvelle après le solstice d'été, jusqu'au 16 du même mois, jour où se proclamaient les vainqueurs couronnés de la main des huit juges élus par le sort, dans chacune des huit tribus des Eléens : dès lors le premier jour de ces fêtes fut destiné au pentathlon (quinquerce) ; les jours suivants, à d'autres jeux que terminait la course des chevaux et des chars.
Tous les prétendants devaient se rendre au xiste d'Elis, ville voisine d'Olympie, dix mois avant l'ouverture des jeux, pour s'y exercer et s'instruire sous la surveillance d'agents préposés à cet office. Le concours était interdit aux nations étrangères à la Grèce, et même aux villes grecques dont on voulait punir les habitants. La moralité qu'on exigeait des concurrents, et l'examen scrupuleux qui précédait l'admission, attestent qu'on ne voulait alors montrer au public la force et l'adresse, que réunies à la vertu.
Olympie, lien des combats solennels, était située sur la rive droite de l'Alphée, au pied d'une colline appelée Cronium, ou mont de Saturne. Là se voyait un temple dont Pindare cite les oracles, moins connus que ceux de Delphes en Phocide. En face et du côté du midi était le temple de Junon ; ce dernier et celui de Jupiter étaient renfermés. dans un bois nommé Altis, entouré de murs, et embelli de plus de mille statues représentant les vainqueurs. Quelques-unes de ces statues avaient jusqu'à vingt-sept pieds de hauteur. Pindare prenant quelquefois, par synecdoche, le contenant pour le contenu, donne au temple même le nom d'Altis. La ville d'Olympie ayant été détruite, fut rebâtie, dit-on, près de ses ruines, et prit le nom de Pise ; ou peut-être Pise et Olympie furent-elles la même ville, comme le veut M. Gail.
La carrière olympique se divisait en deux parties : le stade, qui servait pour la course à pied, et l'hippodrome. Celui-ci était séparé du stade d'un côté par une barrière, près des portiques ou remises d'où partaient les chevaux et les chars ; de l'autre, par une borne en face de laquelle était placée la statue du génie Taraxippus.
La lice entière avait environ quatre cent cinquante pas ou six cents pieds de long sur douze cents de largeur. Les courses à pied se faisaient dans cette partie de la lice qui commençait à la barrière des athlètes, et qui composait le stade proprement dit. L'entrée du stade ou de la lice, marquée d'abord par une simple ligne (gramme), le fut ensuite par une espèce de cordon en forme de bourrelet, semblable à celui qui borde nos bassins, nos fossés ou nos puits : c'était là que venaient se ranger les coureurs à pied ou à cheval. Un peu plus en avant était la barrière de bois. Au milieu de la lice s'asseyaient les Agonothètes, directeurs des jeux et distributeurs des couronnes ; un espace entre leurs siéges et l'autel ou la statue de Cérès-Chamine était destiné aux poètes, aux orateurs, aux musiciens, aux philosophes, aux historiens même, puisqu'Hérodote y lut les écrits qui nous restent de lui. Cependant les jeux pythiens paraissent avoir été plus spécialement consacrés aux talents et aux arts. Au-dessus et au-dessous de ces sièges, étaient des places réservées à des spectateurs distingués. Le peuple se tenait sur la colline. Enfin, tout au bout de la lice, se trouvait la borne où s'arrêtaient les coureurs à pied, et que tournaient les cavaliers pour revenir à la barrière. Dans le diaule, ou double stade, les coureurs retournaient par l'autre côté qui partageait la largeur ; dans le dolique ou la course longue, dont il est question dans la douzième olympique, ils parcouraient ainsi un espace beaucoup plus considérable. Voyez Burette, Mémoires de l'Académie ; voyez aussi la note sur la douzième olympique.
La course du simple stade fut, jusqu'à la quatorzième olympiade, le seul exercice en usage. Depuis, et jusqu'à la dix-huitième, on se contenta de la doubler ; mais à cette dernière époque s'introduisit le pentathle, ou quinquerce (exercice à cinq jeux), parce qu'on joignit au premier ceux du disque, du saut, du javelot et de la lutte. Le ceste ou pugilat ne fut reçu, pour les hommes, qu'à la vingt-troisième, et pour les enfants, à la quarante-unième. Le pancrace, qui réunissait la lutte au pugilat, avait commencé, pour les jeunes gens, dès la dix-huitième, mais, pour les hommes faits, à la trente-troisième ; pour les enfants, à la cent quarante-cinquième seulement.
Ces différents jeux étaient connus longtemps avant les époques que nous venons de fixer. Nous les retrouvons dans Homère et dans tous les auteurs qui ont décrit les temps héroïques ; mais ils ne furent introduits que successivement dans les jeux d'Olympie. La course armée, par exemple, n'y parut qu'à la soixante-cinquième.
La course des chars attelés de deux ou quatre chevaux eut lieu dans la vingt-cinquième olympiade ; celle de chars attelés de deux mules, la soixante-cinquième, mais abolie la quatre-vingt-quatrième, selon le P. Corsini ; la quatre-vingt-cinquième ou quatre-vingt-sixième selon le scoliaste. Celle de chars attelés de poulains fut introduite ou renouvelée, la quatre-vingt-dixième ou la quatre-vingt-dix-neuvième olympiade.
La course du cheval de main (equus celer desultorius) existait dès la trente-troisième ; celle avec deux chevaux entiers n'eut lieu qu'à la quatre-vingt-treizième et quatre-vingt-dix-huitième ; celle avec un poulain, la cent trente-unième ; et avec deux poulains, la cent vingt-huitième.
Dans le calpé, le cavalier assis sur une jument conduisait l'autre de la main, jusqu'à la borne où il sautait par terre, pour les prendre toutes deux en main. Cet exercice, admis la soixante-onzième olympiade, fut, dit-on, aboli la quatre-vingt-quatrième.
Cependant l'introduction de chacun de ces jeux n'est pas tellement fixe, qu'on ne puisse raisonnablement croire que quelques-uns d'entr'eux aient été seulement renouvelés aux époques dont on parle, et non établis pour la première fois. Voyez Pausanias (in Eliacis) ; Noël-Comte (Mytholog., lib. V); Corsini, du Faur, etc.
Lorsque la plupart de ces jeux furent définitivement introduits, on les partagea de manière que la course et le pentathle ouvraient la célébration des fêtes olympiques, et en occupaient les deux premiers jours. Les jours suivants étaient consacrés au pancrace, à la course des chevaux, et enfin à celle des chars diversement attelés.
Les juges ou agonothètes se rendaient à leur place, dès la pointe du jour, pour voir commencer la course des jeunes gens. Pausanias (Eliac., lib. 2) nous apprend qu'en effet cette course commençait avant le lever du soleil ; que vers midi elle était suivie du pentathle et des autres jeux plus importants. Platon assure formellement la même chose (de Leg. 1. 8 ).
Les spectateurs étaient rassemblés dès minuit ou dès la veille de ce jour mémorable ; aussi un ancien père de l'Eglise s'étonnait de la constance avec laquelle ils restaient depuis minuit jusqu'à midi, pour voir à quel vainqueur serait décernée la couronne : a medio noctis usque ad meridiem perdurare ut videant cui cessura sit corona.
Cependant on ne conclura pas de ces expressions que les jeux olympiques se célébrassent précisément pendant l'absence de la lumière : car outre que la lune était alors dans son plein, les deux crépuscules dans ces climats et en cette saison se touchaient de si près, que la nuit devait être presque nulle.
Il fallait une grande supériorité naturelle ou acquise pour disputer le prix dans ces jeux célèbres. Les athlètes qui se destinaient à y paraître, se préparaient dès l'enfance par une étude opiniâtre et par des travaux incroyables ; il s'agissait pour eux de se donner en spectacle à l'univers. Aussi vit-on dans ces combats des prodiges de courage et d'adresse. Ce que les historiens dignes de foi nous apprennent de la force d'un Milon de Crotone et de plusieurs autres athlètes, de l'agilité de ce coureur d'Alexandre, qui fit dans un jour douze cents stades ou soixante de nos lieues ; d'un autre à qui on érigea une statue, vers la quarante-sixième olympiade, pour avoir, à la course, devancé un lièvre et s'en être saisi ; mille traits de ce genre prouvent quelle devait être l'ardeur des concurrents et l'affluence des spectateurs. Les femmes grecques se distinguèrent aussi dans ces jeux. Elles n'en furent exclues qu'aux époques où les athlètes durent combattre tout nus.
Les olympionices ou olympioniques, vainqueurs proclamés, n'eurent d'abord que les honneurs d'une simple couronne d'olivier, distribuée solennellement par les juges vers la fin du cinquième jour. Pindare, dans son ode à Théron d'Agrigente (troisième olympique), célèbre cet olivier recueilli près des sources de l'Istros et transplanté au pied de la colline d'Olympie, pour y peupler le bois d'Altis. Si nous en croyons le scoliaste grec d'Aristophane dans Plutus, ce même arbre, qu'il qualifie de callistephanos (aux belles couronnes ), «se trouve dans le Pansthetius, à soixante stades du fleuve Ilissus. Ses feuilles ont une direction opposée à celle des autres espèces ; et ses branches inclinées, comme celles du myrte, sont faciles à ployer en couronnes. Il est bien entouré ; et des peines graves sont infligées à ceux qui oseraient y toucher. C'est là que les Eléens venaient y cueillir les branches destinées à former les couronnes olympiques». (Voy. Noël-Comte, pag. 425 ; Natal. com. edit. Francofurti, 1588.)
On peut conclure de ce passage et de quelques autres que nous citerons, 1° que l'olivier sauvage était cultivé et conservé ailleurs que dans les bois d'Olympie ; 2° qu'on l'avait transporté des bords du Danube à ceux de l'Ilissus ou Hilissus, fleuve de l'Attique, où l'on croyait sans doute qu'il devait plus aisément s'acclimater. Mais cet Ilissus qu'on lui choisit portait-il alors ce nom, ou ne le reçut-il qu'à l'époque mémorable que nous rappelons ? Un rapprochement que nous risquons de faire ici semble appuyer la seconde conjecture. En effet l'Istros, autrement le Danube, prend sa source vers la Forêt-Noire, au cercle de Souabe, principauté de Furstemberg ; de là, partageant la Souabe en deux parties, il commence à porter bateau à Ulm, où il reçoit, par sa rive droite, l'Iler et le Lech, traverse ensuite la Bavière, l'Autriche, la Hongrie, la Turquie d'Europe, et se jette dans le Pont-Euxin. Quoique nous ne connaissions point le Panstethius du scoliaste d'Aristophane, son Ilissus ressemble trop à l'Iler et au Lech, pour qu'on ne soupçonne pas que l'un de ces derniers ait donné le nom au premier.
Ajoutons qu'un ancien auteur, Timagète, cité par Noël-Comte (Mythol,1. 6, p. 595), dit expressément : « que l'Istros coule des montagnes celtiques, hyperboréennes ou riphéennes ; que ses eaux forment deux bras, dont l'un entre dans la mer Celtique, et l'autre dans le Pont-Euxin ; que, par l'une de ces embouchures, les Argonautes ont pu passer en Thyrrénie»). Le Danube formait effectivement, près de son embouchure, l'ancienne île de Kilia ; et si les Argonautes ont pu naviguer dans ces contrées, Hercule aurait aussi pu y aborder, remonter le Danube jusqu'à sa source, et en rapporter l'olivier sauvage. Les Grecs paraissent en outre avoir très bien connu les embouchures de l'Istros et du Borysthène (Dniéper.) Ils appelaient Celtes, Scythes et Hyperboréens, ou peuples du Nord, les habitants d'une partie de l'Allemagne, de la Moscovie et des Gaules, les Celtes, etc.
Mais voici une nouvelle preuve que l'Ilissus des Grecs dut prendre son nom d'un fleuve des Gaulois ou Allemands souvent confondus ensemble : c'est que Pausanias, faisant le recensement des fleuves de l'Attique, assure positivement que l'Eridan, qui se jette dans l'Ilissus, a reçu son nom d'un fleuve des Gaules.
«Les fleuves qui arrosent l'Attique, dit-il, sont l'Ilissus, l'Eridan qui porte le même nom qu'un fleuve des Gaules, et qui se jette dans l'Ilissus». (Pausan., Att., c. 19.) «Les géographes, dit M. Gossellin, tome 4 de ses Recherches sur la Géographie systématique et positive des anciens, s'accordent, depuis deux siècles, à reconnaître ce fleuve (l'Eridan) dans la Vistule, ou, pour parler plus exactement, dans une petite rivière nommée Raudaune ou Radanne, que reçoit ce fleuve près de Dantzick, à une lieue de la mer». Tout fait donc présumer que l'Ilissus et l'Eridan ont également reçu leurs noms de quelques fleuves germaniques, celtiques ou gaulois, sauf de légers changements dans l'inflexion, commandés par la diflrence des idiomes.
Maintenant à quelle famille appartenait cet olivier sauvage ? Il serait sans doute difficile de le fixer avec précision. Seulement il est présumable qu'il n'avait, avec celui que nous connaissons dans nos provinces du midi de la France et ailleurs, d'autre ressemblance que celle de la verdure constante de ses feuilles. Pour juger de la forme de ses feuilles et de sa tige, à défaut du témoignage de nos voyageurs modernes, ajoutons au texte du scoliaste précité, le passage rernarquable de Pausanias en ses Corinthiaques, chap. 22, p. 559 et 560, au premier volume de la traduction par M. Clavier. «En descendant à la ville d'Epidure, vous trouvez un champ planté d'oliviers sauvages : on le nomme Hyrnethium. Les Epidauriens statuèrent : que personne ne pourrait emporter chez soi, ni employer à quelqu'usage que ce fût les branches qui tomberaient, soit de ces oliviers sauvages, soit des autres arbres dont ce champ était planté. Non loin de Trézène, en avançant vers la mer Psiphéa, on trouve un olivier sauvage, nommé rachios streptos. Les Trézéniens donnent le nom de rachos à tout olivier qui ne porte pas de fruits, de quelque espèce qu'il soit. Ils nomment celui-ci streptos (tordu), parce que les rênes des chevaux d'Hippolyte s'y étant entortillées, son char fut renversé». Voilà les seuls renseignements que j'aie pu recueillir pour mettre les naturalistes sur la voie de rechercher l'espèce d'olivier destiné à embellir le triomphe des olympionices.
Dans la suite on ne se contenta pas de couronner d'olivier ces vainqueurs : on leur érigea des statues travaillées d'abord en bois de figuier et de cyprès, ensuite en bronze et en marbre. On leur apportait de riches présents ; et l'on finit par leur assurer une retraite honorable ou pension, dont Solon fut bientôt obligé d'arrêter, par une loi expresse, l'accroissement trop rapide, en la fixant à cinq cents dragmes, à peu près neuf marcs ou quatre cent cinquante francs de notre monnaie.
Rien n'égalait l'enthousiasme avec lequel on accueillait les oympionices après leur couronnement : leurs parents, leurs amis, leurs compatriotes, se pressaient autour d'eux, leur formaient un cortège, et les ramenaient en triomphe dans leur ville natale dont ils abattaient les murailles, pour les faire entrer par la brèche. Quid... Olympionices, hoc est apud Graecos prope majus et gloriosius quam Romae triumphasse. Cic. Orat. pro. Q. Flacco.
Pise ne fut pas la seule ville où se célébrèrent les jeux olympiques ; on en établit aussi à Athènes, et dans la suite à Smyrne, Alexandrie, Antioche, etc., surtout lorsque la guerre ou d'autres causes ne permirent plus de s'assembler en Elide. Une fois établis, ils rivalisèrent avec ceux d'Olympie, ou les remplacèrent.
Nous ne transcrirons pas ici le tableau ou la liste de tous les vainqueurs suivant l'ordre chronologique des olympiades. Ce tableau se trouve partout, et notamment dans l'Encyclopédie au mot Olympiade, et dans les Tablettes chronologiques de l'histoire universelle, par LENGLET-DUFRESNOY. Cependant les huitième, trentième et cent quatrième olympiades furent vacantes, selon quelques auteurs : ou plutôt le nom des vainqueurs ne fut pas porté sur le registre par les Eléens, qui regardaient comme nul le jugement auquel ils n'avaient pu présider pendant leurs dissensions avec les habitants de Pise.
Les critiques s'accordent peu sur le nombre des olympiades, depuis leur origine jusqu'à leur abolition entière. Scaliger veut qu'on s'arrête à la deux cent quarante-neuvième olympiade. Pausanias en comptait deux cent trente-cinq à l'époque où il écrivait. Censorinus (cap. xv de die natali) voyait commencer la seconde année de la deux cent cinquante-quatrième olympiade parmi les Grecs. Nunc apud eos ducentesima quinquagesima quarta olympias, ejusque annus hic secundus.
Théophane et Cedrénus témoignent que les jeux olympiques firent définitivement abolis à la fin du quatrième siècle de l'ère chrétienne, la seizième et dernière année du règne de Théodose l'ancien (l'an de JC. 395). D'après ce dernier calcul, la deux cent quatre-vingt-treizième olympiade aurait été la dernière. Au reste, à l'époque où elles furent abolies, on comptait déjà les années, soit par la date de la fondation de Rome, soit par les consulats, ou même par les règnes des empereurs d'Orient.
Ceux des lecteurs qui désireront des connaissances plus étendues sur quelques-uns des objets que nous venons d'esquisser, les trouveront dans les Voyages d'Anacharsis, dans les Mémoires de l'Académie, dans le dictionnaire de l'Encyclopédie, dans l'ouvrage de Pierre du Faur intitulé : Agonisticon seu de re athletica, etc. ; dans la préface de Sozzi ou du traducteur anonyme des Olympiques ; enfin chez les auteurs déjà cités ou qui seront cités dans les notes, sur chacune des odes que j'ai traduites.
TROISIEME PARTIE - Application des règles ou principes de traduction aux odes de Pindare ; notice sur les éditions et traductions de ce poète
J'ai déjà ébauché la théorie de l'art du traducteur dans ma préface sur la Guerre de Troie en quatorze chants, par Quintus de Smyrne, dit Calaber, que j'ai traduits pour ]a première fois en français et fait imprimer en l'an IX. Après avoir remarqué «qu'il n'y aura de traductions parfaites que quand il existera deux langues qui pourront se calquer l'une sur l'autre, qui auront toutes deux une égale richesse et des mots égaux en valeur, en force, en harmonie ; enfin quand il se trouvera des deux côtés les mêmes tours, les mêmes mouvements, le même ordre, etc.» J'ai ajouté, page VIII : «Les règles de l'art de traduire n'ont jamais été bien précisées, et les hommes de lettres qui se sont livrés à ce genre de travail ont suivi des routes contraires. Les uns, sous prétexte de traduire littéralement, n'ont présenté que le squelette d'un auteur auquel il aurait fallu donner la couleur de la vie, et la fraîcheur qu'il conserve dans la langue qu'il nous parle : le poète ou l'orateur qu'ils traduisent n'est plus qu'un personnage muet qu'on n'entend que par signes. C'est ainsi que les savants des deux siècles qui ont précédé le nôtre, ont mis en latin la plupart des auteurs grecs. C'est une pure translation des mots d'une langue à l'autre, où chaque terme a son correspondant, valeur nominale, sans aucun égard à la tournure et au génie différent des deux langues : d'où il résulte que ce qui est très beau en grec est absurde et souvent inintelligible en latin. Ces traducteurs serviles ont décrédité les auteurs qu'ils voulaient faire connaître : on ne jugeait de l'original que par une mauvaise copie. Ainsi Perrault qui, quoique académicien, ne savait pas le grec, pensait qu'Homère était beaucoup au-dessous de sa réputation, parce qu'il lisait Homère dans une traduction vicieuse.
D'autres traducteurs, pour n'être pas serviles, ont été infidèles, et nous ont donné, dans des paraphrases, leurs propres pensées, ou les écarts de leur imagination pour les idées de l'auteur qu'ils traduisaient. C'est ainsi qu'on a prétendu habiller à la française des auteurs anciens chez qui nous sommes tout surpris de retrouver nos locutions, notre style et nos moeurs, dont ils sont assurément très éloignés».
J'ai conclu que tout traducteur s'engage à rendre : 1° la pensée ou l'idée toute entière de l'original ; 2° les expressions, soit littérales, soit figurées, quand elles peuvent passer dans la langue en laquelle il traduit ; 3° le style simple ou sublime, négligé ou fleuri. J'ai ensuite opposé, pag. XII et XVII, des raisons et des exemples à l'autorité des écrivains qui permettent de supprimer une idée lorsqu'elle est, disent-ils, choquante chez nous et dans notre idiome, quoiqu'elle ne le fût nullement parmi les anciens et dans leur langue. J'ai fait voir que c'était le cas peut-être de pallier ou, si l'on veut, d'affaiblir l'idée, mais non de la supprimer pour mettre à sa place un équivalent ; car mettre un équivalent, si l'on entend par ce mot une beauté d'un autre genre, c'est faire dire au poète ce qu'il n'a point dit, etc.
Je vais, en donnant ici un peu plus d'étendue à cette théorie, acquitter la promesse que je fis en annonçant la traduction des odes que je publie aujourd'hui, ou plutôt je transcris ici en grande partie ce que j'ai inséré, dans le Moniteur des 2 et 4 pluviose an X (1801).
Le succès d'un traducteur dépend donc, 1° de la connaissance qu'il a du génie des deux langues qu'il doit rapprocher ; 2° de l'idée que lui-même se forme de sa propre tâche, je veux dire de la manière dont il croit devoir rapprocher ces langues.
On est d'accord sur la première condition exigée du traducteur. On veut qu'il possède tellement la langue qu'il traduit et celle dans laquelle il écrit, que des deux côtés la même pensée soit rendue avec une égale précision, en sorte cependant que chaque langue conserve son génie particulier. Ainsi une phrase française, correspondant à la même phrase en grec, doit avoir la tournure et le génie français ; autrement elle aurait un vice d'hellénisme, comme la tournure française, dans une phrase latine, serait un gallicisme, etc.
Mais il n'est pas aussi facile de s'entendre sur la seconde partie des devoirs du traducteur, ou sur le mode dont il doit faire correspondre les deux langues ; sur les changements qui lui sont permis ou défendus en ce genre ; en un mot, sur l'étendue de la liberté qu'il peut prendre.
Sozzi publia, en 1754, une traduction française des Odes olympiques, qu'on trouva trop servile. Vauvilliers, tombant dans un excès contraire, se donna, en traduisant trois ou quatre odes, le double tort d'user d'une liberté illimitée, et de vouloir la justifier par des principes arbitraires.
Chabanon prit un plus juste milieu dans sa traduction des Odes pythiques, imprimée en 1772 ; mais son travail est encore bien éloigné de la perfection à laquelle on peut raisonnablement prétendre. Peut-être aussi l'art de traduire serait-il plus facile, si l'on fixait mieux le sens des préceptes qu'on en donne.
On veut, par exemple, que le traducteur égale son modèle ; on veut retrouver en lui la hardiesse de l'auteur original, son éloquence, ses images, son ton, et jusqu'à sa physionomie. Mais sans doute cette première règle est subordonnée à l'analogie qui peut exister entre deux langues, et même entre les moeurs des peuples qui ont parlé ou qui parlent ces langues : car la même image, la même figure, dont les proportions paraîtraient justes dans une langue, serait peut-être gigantesque dans l'autre. Le même mot, noble par lui-même, en grec, ou ennobli par ceux qui l'avoisinent, peut être très ignoble en français. Une hardiesse naturelle à la langue de Pindare serait déplacée dans une langue beaucoup plus timide que la sienne.
Les savants éditeurs allemands du texte de Pindare, donné plus récemment par Heyne avec une version latine très estimée, concluent hardiment, de cette disparité, que nous ne pouvons traduire Pindare en notre langue : mais ne connaissant pas assez nos ressources en ce genre, ils ne peuvent être, des juges compétents. Je ferai voir bientôt que les morceaux les plus sublimes du prince des poètes lyriques, ne perdent rien dans une traduction française. Je me contente d'observer ici qu'une même expression, faible dans une langue hardie, peut être forte dans une langue timide, et par conséquent produire le même effet rélatif.
Vauvilliers prétend qu'une traduction littérale de Pindare est impossible et chimérique : mais il ne définit point ce que doit être une traduction littérale. Si l'on entend par traduction littérale le mot pour mot dans les deux langues, la similitude parfaite dans la construction et le mécanisme des phrases, alors il y a dans le terme un abus d'autant plus absurde, que la différence entre ces deux langues est plus grande. Une translation n'est pas une traduction ; en voici la différence : la translation conserve, avec le sens, le génie de la langue originale. La traduction adopte ce sens ; mais elle le rend suivant le génie de la langue de ceux à qui elle est destinée, de qui elle doit être entendre et goûtée. S'il faut entendre par traduction littérale une traduction fidèle, nous dirons encore contre Vauvilliers, qu'on peut traduire Pindare en français d'une manière très fidèle, et par conséquent digne de l'original. Si le texte de Pindare est un tableau original, qui nous empêche de le copier ? et si cette copie est fidèle, c'est-à-dire si la traduction de ce texte peut offrir, non seulement les principaux traits de ressemblance, mais les couleurs, l'expression, en un mot, l'ensemble de l'original, pourquoi ne nous flatterions-nous pas de posséder un jour Pindare en notre langue ? Le devoir du traducteur français se réduit donc ici, 1° à nous donner le véritable sens de l'auteur traduit ; 2° à faire passer dans notre langue, autant qu'elle en est susceptible, la sublimité, les grâces, tous les ornements du style original.
Maintenant, si quelqu'un dit que la langue française ne peut se prêter à ces deux fonctions, je ne balance pas de répondre, ou qu'il n'en connaît pas les ressources, ou qu'il n'entend pas la question dont il s'agit.
Cette réponse deviendra plus décisive par les passages que nous citerons, et par l'examen des difficultés qui peuvent embarrasser un traducteur. On demande, par exemple, s'il est permis à ce dernier de couper des phrases trop longues dans l'original, de supprimer ou d'ajouter des épithètes, d'user d'inversions, de traduire en prose des vers, etc., etc.... Je rappelle d'abord les deux règles générales qui viennent d'être exposées, et je conviens que tout ce qui ne les choque pas ne peut être interdit au traducteur ; il a rempli sa tâche, disons-nous, dès que l'idée qu'exprime l'original est rendue dans son vrai sens, avec les mêmes couleurs, les mêmes agréments, etc., parce qu'en effet ces conditions étant remplies, la lecture de la traduction fera naître les même idées et les mêmes sensations que la lecture de l'original. Hé ! pourquoi ne couperait-on pas des phrases trop longues dans l'original, lorsque les règles de la grammaire ne permettraient pas au traducteur d'en lier autrement les parties dans sa langue ? Le passif se rendra aussi bien par la particule on, surtout s'il s'agit d'exprimer chez nous le mépris ou l'indignation. Les monosyllabes grecs ei, kai, oun que l'on traduit trop uniformément par si, et, quoique, donc, etc., contenant souvent une interrogation au moins tacite, conserveraient toute leur force dans une interrogation formelle. Pourquoi encore ne pas suppléer par de courtes phrases incidentes à certaines particules grecques qui, n'ayant pas chez nous leurs correspondantes, nécessitent ou permettent l'addition, par l'espèce d'ellipse qu'elles forment dans l'original ? Sans cette liberté, les ouvrages philosophiques de Cicéron, où les particules, les conjonctions, etc., font tous les frais du dialogue, ne pourraient se traduire en notre langue.
Mais comment rendre des inversions dans une langue qui en souffre aussi peu que la nôtre ? Cette difficulté n'existe pas pour ceux qui connaissent parfaitement le français, où les inversions, quand on sait les faire cadrer avec la grammaire, peuvent sans contredit être aussi fréquentes et aussi commodes qu'en beaucoup d'autres langues. Cela est si vrai, qu'un homme qui parle bien cette langue peut presque toujours finir correctement sa phrase, de quelque manière qu'il l'ait commencée. D'ailleurs, si la langue française repousse des inversions trop marquées, alors des inversions plus faibles paraîtront assez hardies, et le but sera également rempli. Ajoutons que dans les cas où le tour grammatical se refuse à l'inversion, on a la ressource d'employer ce que nous appelons des figures de mots, comme répétitions, interrogations, apostrophes, etc. , contenues implicitement dans beaucoup d'inversions ; il doit encore être permis d'intervertir l'ordre des idées de l'original pour en adopter un autre qui cadre mieux avec l'ordre grammatical de la langue du traducteur... Si celui-ci ne peut rendre l'idée formelle et identique, le blâmera-t-on de se borner à rendre l'idée concomitante ou inséparable de celle-ci, comme la partie pour le tout, le char pour les coursiers du char lorsqu'ils y sont attelés, la victime au lieu de l'animal même immolé, surtout si celui-ci a été suffisamment désigné d'abord ?
Enfin, il est au choix du traducteur d'ajouter une épithète nécessaire à l'euphonie, à la transition, au sens même, lorsque le substantif seul ne rendrait pas complètement l'original ; il peut, pour les mêmes raisons, retrancher une épithète qui n'est qu'explétive dans l'original, ou qui n'y sert que pour la mesure des vers, lorsqu'en notre langue elle serait oiseuse, ou déparerait le style.
Tel est à peu près le cercle des libertés permises à tout traducteur. Mettre en principe, avec Vauvilliers, qu'on peut substituer d'autres métaphores à celles du poète, c'est à coup sûr excéder en ce genre les bornes de toute liberté ; c'est vouloir faire dire au poète ce qu'il n'a pas dit, et souvent ce qu'il n'aurait pas voulu dire [..].
La seule question qui nous reste, et qui est la plus facile de toutes à résoudre, est celte de la traduction en vers.
Peut-on traduire en prose un poème ou tout autre ouvrage en vers ? Je réponds : qu'il suit des principes ci-dessus énoncés, qu'en général on peut traduire des vers en prose très poétique, parce que, même en traduisant ces vers en prose, il est possible de remplir les deux conditions rigoureusement exigées. Je dis donc que des phrases peuvent être très poétiques, indépendamment de la mesure et de la rime ; les images, le mouvement, l'harmonie, le nombre, qui font l'essence de la poésie, peuvent tout aussi bien orner une belle prose ; et s'il s'agit de traduire Pindare, j'ose ajouter qu'il vaut mieux le traduire en prose qu'en vers français. On évitera d'ajouter à des difficultés déjà nombreuses, celles de la versification ; certes, il est plus aisé d'en surmonter quelques-unes, que de les vaincre toutes à la fois. Ce dernier effort du génie ne peut convenir qu'à des talents supérieurs.
Mais aussi je pense que les odes érotiques et bachiques d'Anacréon, que certaines idylles de Théocrite, où se trouve la récurrence des mêmes idées et des mêmes mots après un certain nombre de vers, seront mieux rendues en vers français qu'en prose ; en ce genre d'ailleurs notre langue est riche, et sa délicatesse même ne nuit point à sa richesse, puisqu'il lui suffit de dire peu pour faire entendre beaucoup. La langue française est celle de l'amour ; ses expressions sont douces, tendres, animées ; ses nuances sont fines, ses tournures variées : elle est vive, remplie de grâces, et ne manque ni de fraîcheur ni de coloris. Le poète n'aurait à craindre que l'équivoque qui blesserait le goût, et qu'il est facile d'éviter [...].
Je me borne à ces réflexions sur l'art de traduire ; je les crois vraies et solides. Si je n'en ai pas fait une application aussi heureuse que je l'aurais désiré, j'ai du moins tracé la route qui doit conduire à de plus grands succès.
Maintenant il me parait peu nécessaire de dresser un catalogue des différentes éditions du texte de Pindare, depuis l'editio princeps en 1513, jusqu'à la dernière et la plus répandue aujourd'hui, par Heyne, en 1798. Celui-ci ayant fait le recensement exact de toutes les éditions qui ont précédé la sienne, je puis me borner à indiquer les textes que j'ai suivis dans ma traduction, et les versions ou interprétations que j'ai consultées.
Je me suis beaucoup servi, dans mon travail, de la seconde édition du texte grec donnée par Henri Etienne en 1566, avec version latine. J'ai confronté ce texte avec ceux publiés par Benedictus en 1620, et par Heyne en 1798. Je n'ai pas toujours cité ces deux savants éditeurs, et souvent il m'arrive de ne pas partager leur opinion ; cependant j'ai lu, avec une attention toute particulière, leurs notes savantes et leurs versions ou paraphrases, ainsi que l'interprétation latine et les éclaircissements publiés antérieurement par Lonicerus (à Bâle en 1535). Dans les difficultés inséparables de mon travail, je me suis aidé aussi du texte grec de l'édition de Francfort, imprimée en 1542 (in-4°), avec l'ancienne interprétation et les scolies grecques.
Mais pour que ma traduction fût entièrement neuve, je n'ai voulu en lire aucune autre en notre langue, avant d'avoir fini la mienne. Je vais rendre un compte succinct de toutes celles en langues modernes que j'ai été à portée d'examiner depuis.
Les Français s'essayèrent, des premiers, à traduire Pindare ; mais ce fut à une époque où leur langue, encore informe, n'avait ni la précision, ni la flexibilité, ni l'harmonie nécessaires pour se rapprocher de celle du prince des poètes lyriques. Ronsard et ses imitateurs avaient introduit l'usage de mots composés et scientifiques , mais d'un goût faux et contraire au génie de notre langue ; ils croyaient l'enrichir, et le résultat de cette innovation fut d'augmenter sa pénurie. L'alliage ne donna qu'une monnaie factice, qui, comme celle du financier Law, diminuait de valeur à mesure qu'on la multipliait.
Dès qu'on s'aperçut de l'erreur, on s'empressa de fixer des bases avant d'accumuler des matériaux. Les règles une fois posées, la langue en devint plus timide ; mais bientôt on lui donna une marche plus assurée. Les règles grammaticales ne sont point des entraves au génie : elles en régularisent la force. On chercha donc à relever le style, en respectant les bornes qu'une saine méthode avait prescrites ; on apprit l'art d'arrondir les périodes et de varier les tours d'une phrase, sans fronder les principes reçus pour la construction des langues analogues. Nous eûmes enfin des poètes, des orateurs. Racine, Boileau, La Fontaine, Jean-Baptiste et J. J. Rousseau, Voltaire, etc., nous donnent une idée des ressources que nous trouvons dans notre propre langue, et du parti que nous en pouvons tirer. La seule qui nous manque est celle des substantifs et adjectifs composés, qui ajoutent beaucoup à l'énergie. Mais nous avons pour équivalents des tours neufs, des expressions hardies, qu'il suffit de placer à propos pour produire un effet heureux. Les inversions, quoique moins marquées comparativement à celles des langues transpositives, n'en sont souvent que plus sensibles dans notre idiome.
Les Italiens ont un autre genre d'obstacle à surmonter. Non seulement ils ne reçoivent point de mots composés, mais leurs sons mous et monotones se prêtent quelquefois mal à l'harmonie imitative, lorsqu'il s'agit de tracer des images grandes et terribles pour lesquelles nous avons du moins la ressource de notre e muet, de notre aspirée h, de nos doubles et triples articulations, de nos sons sourds, nasals, etc. Cependant on cite en italien plusieurs traductions plus ou moins estimées des odes de Pindare : 1° celle d'Adimari, en 1631. La versification en est belle, le ton bien soutenu ; mais on y chercherait en vain cette concision, cette touche mâle et nerveuse qui caractérise le poète grec, et à laquelle se refuse, jusqu'à un certain point, la langue du traducteur ; 2° celles de Gauthier, en 1762 et 1765, que le docte Heyne trouve calquées sur la précédente et sur la version latine ; 3° celle publiée en 1776 par Mazari, professeur de langue grecque au collège de Mantoue. On reproche à ce professeur d'être obscur lorsqu'il cherche à s'élever, prosaïque dans beaucoup d'autres endroits ; 4° celle de Jérocades, qui parut en 1790. Ses vers sont bien faits, le style en est surtout brillant et même un peu maniéré ; l'auteur s'écarte trop souvent de l'original.
Quoi qu'il en soit, ces traductions plaisent beaucoup aux Italiens, et par conséquent elles ne sont pas sans mérite.
La langue anglaise, plus mâle dans ses sons plus forte d'expressions que l'italienne, est en conséquence plus propre au genre de poésie lyrique qu'a suivi Pindare. Aussi les traductions de ce poète en anglais se rapprochent-elles beaucoup plus de l'original. On lit avec plaisir et l'on cite avec éloge celles de Cowley et de West, quoique incomplètes.
Mais la langue allemande, plus hardie encore, plus abondante en mots composés et en phrases nombreuses, permet une traduction de Pindare plus fidèle qu'en toute autre langue. Celle des Olympiques, par Frédéric Gedike, professeur à Berlin, passe pour la meilleure qui ait paru jusqu'à ce jour. Tel est du moins le jugement qu'en portent les savants d'Allemagne et même de l'Europe. Mon savant ami, feu Chardon de la Rochette, m'en avait communiqué une édition de 1777, avec ce zèle et cette aménité qui ajoutent un nouveau prix à de tels services.
La prose de Gedike, concise et cependant pleine de dignité, représente au naturel la marche fière et rapide du poète lyrique. Ses notes sont savantes et judicieuses.
J'ai dit pourquoi il était difficile que nous eussions Pindare en français. Les traductions faites avant que notre langue fût organisée ne sont pas supportables ; on ne lit plus ni celle de 1618 par Marin, ni celle de 1626 par la Gauzie, partie en prose, partie en vers.
Les odes ou fragments de Pindare, insérés dans les mémoires de l'académie des Inscriptions, ne répondent pas aux talents de leurs auteurs, Massieu, le Batteux et Sallier.
Gedike appelle avec raison la traduction de Sozzi une prose traînante et insipide : matte, wassrige prose. Il maltraite plus encore l'essai peu heureux de Vauvilliers sur Pindare. Heyne a été plus juste envers ce traducteur ; il convient au moins de son mérite grammatical. Seulement il le plaint d'avoir voulu rendre Pindare dans une langue qui, selon lui, est plus éloignée que toute autre de la hardiesse et de la sublimité du poète grec. Probamus doctoris viri studium, sermonis patrii amorem ; sed nollemus vanam consumi operam in transferendo eo poeta qui nullo modo alia lingua reddi potest, multo minus ea lingua quae omnium maxime a Pindarica vi, audacia et sublimitate, abhorret. Nous avons réfuté déja cette opinion de Heyne, qu'il n'aurait pas émise si hardiment, s'il avait mieux connu les ressources de notre langue ; mais peut-être juge-t-il un peu sévèrement les odes pythiques de Chabanon imprimées en grec et en français en 1772. Ce traducteur peut avoir affaibli son original et s'être parfois écarté du texte, mais il est faux qu'il ait entièrement dénaturé l'ordre et la marche des idées du poète.
Feu M. Gin, non moins fécond et infatigable en ce genre que ne le fut l'abbé de Marolles, a voulu ajouter à ses nombreuses traductions celle de toutes les odes de Pindare ; j'aurais mauvaise grâce à faire la critique de son ouvrage, que personne n'a recherché. Je ne connais pas d'auteur français qui ait rien tenté depuis en ce genre.
Bien loin de vouloir mettre ma traduction à l'abri de la critique des savants, je profiterai de leur censure comme je m'honorerai de leurs suffrages. Ils examineront et les règles que j'ai établies et la manière dont j'ai pu les suivre : car il y a loin encore du projet à l'exécution ; et malgré tous mes efforts, je n'ai peut-être approché du but qu'à mesure que j'avançais dans la tâche que je m'étais imposée. Du moins tel est le jugement que j'en ai porté moi-même, toutes les fois que j'ai relu et comparé les différentes parties de ma traduction.
Je n'ai point chargé mes notes sur le texte grec de trop de variantes et de corrections, quoiqu'il m'eût été facile à cet égard de m'enrichir aux dépens de Senedictus et de Heyne.
Enfin, pour ne pas couper mal à propos le sens et la liaison du texte français, je me suis bien gardé de séparer mes phrases par ces strophes, antistrophes, etc., dont la forme était sans doute adaptée au mètre des anciens Grecs et à la cadence de leurs choeurs, deux objets sur lesquels nous ne saurons jamais rien de satisfaisant. Si, à l'imitation de Pindare et quelquefois d'Horace, on plaçait le nom substantif dans une strophe et son adjectif, le verbe ou son complément, dans une autre, il en résulterait une suspension du sens permise dans certaines langues transpositives, mais intolérable dans nos langues analytiques.
Je dois cependant entretenir un moment mes lecteurs de la versification de Pindare. Ce poète y fait habituellement usage du dialecte dorien, dans lequel les h se changent en a ; il emploie au besoin les autres dialectes. Non seulement il lui arrive de couper ses phrases et de suspendre le sens en passant d'une strophe à l'autre, mais il coupe aussi les mots : en sorte que la moitié du mot finit un vers, et l'autre moitié commence l'autre vers.
Chaque ode est ordinairement et alternativement composée d'un nombre de strophes, d'antistrophes et d'épodes, proportionnées à la longueur de l'ode. J'ai dit ordinairement, car il en faut excepter, 1° la douzième pythique, composée seulement d'une strophe et d'une antistrophe ; 2° la deuxième néméenne, qui est divisée par stances de huit vers, ce que les Italiens nomment ottava rima ; 3° la neuvième néméenne, qui est en stances de douze vers ; 4° enfin la dernière des isthmiques, partagée en sections de vingt-deux vers chacune. Comme ces odes se chantaient au son de la lyre, on appelait strophe, si nous en croyons les scoliastes, la partie de l'ode durant laquelle les danseurs se mouvaient en cadence, de droite à gauche ; antistrophe, l'autre partie durant laquelle les danseurs revenaient de gauche à droite ; et l'épode, autrement le retour, marquait ou un repos on un mouvement que nous ne connaissons pas. La strophe et l'antistrophe s'accordent pour le rythme et la mesure des vers au lieu que l'épode suit des lois métriques diffférentes de celles de la strophe et de l'antistrophe. La coupe des chants par strophes, antistrophes et épodes, a été familière aux anciens lyriques, et surtout à Stésichore.
Pour ce qui regarde la quantité ou la composition métrique des vers de Pindare, on peut s'en former une idée par le tableau ci-après que nous transcrivons de l'édition de Francfort (1542), pour les deux premières olympiques seulement :
Exemples de la première olympique
La première strophe est composée de dix-sept vers, savoir :
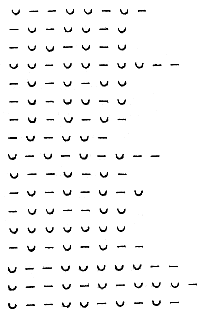 |
L'antistrophe est semblable pour le nombre et la mesure des pieds.
L'épode est de treize vers, dont voici le module :
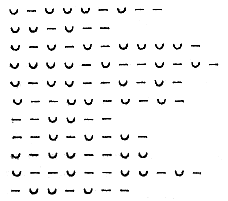 |
N. B. Les autres strophes, antistrophes et épodes sont semblables aux premières.
Ode de la deuxième olympique. - Strophe et antistrophe de chacune de quatorze vers.
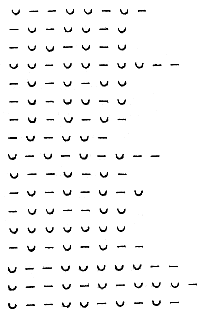 |
L'épode est de huit vers, ottava rima. (La seconde néméenne n'a ni strophe ni antistrophe ni épode ; elle est en stances de huit vers).
Epode de la deuxième olympique
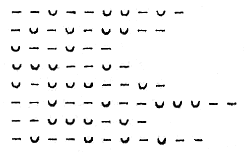 |
Les autres strophes, antistrophes et épodes, ressemblent aux premières de cette même ode, tant pour le nombre des vers que pour la mesure.
On remarque dans ces odes comme dans les autres, de la variation dans le nombre des syllabes qui composent un vers, et aussi dans le nombre des syllabes qui forment un pied métrique ; car il y a des pieds de deux, de trois, de quatre syllabes. Les pieds reçoivent divers noms, selon qu'ils sont plus ou moins composés. Ainsi, dit le scoliaste grec en traitant des mètres, le mot ceironomw formeun un choriambe composé d'une longue, deux brèves et une longue. Les Grecs ont singulièrement varié et multiplié le nombre et l'espèce des pieds. Je me dispense donc d'en donner la nomenclature. Les hellénistes Schmid, Paw, Heyne , Mingarelli, etc., ont beaucoup disserté sur la manière dont Pindare a entendu faire correspondre la mesure métrique des strophes et des antistrophes. De là des corrections proposées, tant pour l'euphonie que pour le sens.
Nul doute que la correspondance dans la mesure des vers ne contribuât beaucoup à l'harmonie du chant ou de la déclamation. Mais nous ne connaissons point assez les règles de la prononciation et de la prosodie grecques pour établir des règles à cet égard. On s'accorde assez à trouver dans certains vers, et même dans quelques phrases oratoires des Grecs et des Latins, plus d'harmonie que dans d'autres. Cependant, lorsqu'on en cherche la raison, on est surpris de voir que ce n'est pas toujours celle qui frappait les anciens. Ceux-ci nous donnent des textes dont ils admirent le rythme, et dans lesquels nous ne trouvons rien de saillant, ou du moins rien qui nous frappe de la même manière qu'eux. On longtemps examiné les passages de Longin (du Sublime, § 38), de Denis d'Halicarnasse sur la composition des mots, § XI et VIII ; de Quintilien (Orator instit., IX, 4), et une foule d'autres passages sur le rythme des anciens. Toutes les conséquences qu'on a pu en tirer se réduisent aux suivantes : 1° que ce rythme affectait spécialement la manière de scander en les prononçant, non seulement les vers, mais aussi les phrases d'un discours en prose ; 2° que ce rythme influait sur le mètre, au point d'allonger au besoin des sons brefs, ou de raccourcir des sons longs de leur nature ; 3° que la prononciation rythmique était déterminée par des accents qu'on a écrits depuis, mais qui ne l'étaient pas alors, quoique leur valeur fût bien connue et observée par l'usage ; 4° que l'accentuation n'était pas soumise aux mêmes règles que la quantité.
Quoi qu'il en soit, l'art de concilier entre elles les règles de l'accentuation et celles de la quantité est aujourd'hui un secret à peu près perdu pour nous. Ainsi, sans vouloir faire la critique des savants dont nous avons parlé, nous ne croyons pas qu'on puisse établir sur le système métrique de Pindare, d'Eschyle et des autres Grecs, des principes lumineux et des règles bien sûres.
Je termine ici mon discours préliminaire. J'ai voulu surtout y consigner ma pensée toute entière, tant sur l'art de traduire Pindare que sur la théorie générale des traductions. Si mes efforts, si mes écarts même peuvent conduire d'autres écrivains à des résultats plus plausibles, je n'aurai à regretter ni le temps ni les peines que m'a coûtées ce travail. En ce genre de littérature, l'insuffisance n'est point un déshonneur, surtout après que, par respect pour le public, on a employé toutes ses forces, et qu'on a mis à contribution les lumières des autres.