(Mantikê) Connaissance de la pensée «divine», celle-ci étant soit traduite au dehors par des signes symboliques perceptibles aux sens, soit révélée directement à l'âme par inspiration ou émotion psychique d'origine surnaturelle. La divination est essentiellement distincte de la connaissance ou prévision rationnelle, qui part d'un fait connu pour en découvrir soit les causes passées, soit les effets futurs. Celle-ci n'est que le produit naturel des facultés logiques ; celle-là suppose une communication établie entre l'intelligence humaine et la pensée divine.
Bien que les termes employés en grec et en latin pour désigner la divination en général ou les diverses méthodes divinatoires ne soient pas toujours rigoureusement synonymes, il n'y a pas de différences caractéristiques à noter entre les idées des Hellènes et celles des peuples italiques en ce qui concerne l'essence, les modes, les usages possibles de la divination. Il est même probable que l'étude de la divination dans l'antiquité classique nous met sous les yeux la série à peu près complète des conséquences engendrées par la foi à la réalité de ce commerce intellectuel avec le monde divin, et que l'histoire générale des religions ne fera plus que grossir le nombre des faits de détail, sans ouvrir de points de vue nouveaux. C'est qu'en effet la théorie de la divination repose sur un principe fort simple, commun à toutes les religions, et que, si les procédés pratiques peuvent être variés à l'infini, ils conduisent tous au même but. Il suffit, pour croire à la divination, d'admettre que les êtres surhumains peuvent communiquer avec les hommes, et que, le pouvant, ils le veulent. Pour y avoir recours, il ne faut que le désir de connaître ce qui, soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans l'avenir, ne peut être connu par le simple usage des facultés naturelles. Suivant l'idée qu'une religion se fait des rapports possibles entre les hommes et les puissances surnaturelles, la divination aura plus ou moins de ressources échelonnées entre la simple prière, qui confesse l'impuissance, et la magie [Magia] qui affirme la toute-puissance de l'homme ; mais toujours le problème à résoudre est posé dans les mêmes conditions. Il s'agit pour l'homme d'apprendre, par révélation émanée de puissances invisibles, ce que celles-ci savent et ce qu'il ne peut savoir sans elles.
La divination ainsi entendue est, au point de vue religieux, chose si raisonnable, si indispensable à l'action régulière de la Providence, que la réalité de ces communications surnaturelles semblait n'avoir pas besoin d'être démontrée et servait de point d'appui aux doctrines théologiques. Si l'on met à part les métaphysiciens comme Xénophane, qui trouvait la sollicitude providentielle incompatible avec l'immutabilité de l'Absolu ; Epicure, qui reléguait ses dieux dans les intermondes et faisait de leur indifférence la condition de leur béatitude ; un petit nombre de sceptiques qui s'attaquaient indistinctement à toutes les croyances et de moralistes, qui, comme Cicéron, voyaient dans la foi à la divination un élément de trouble, menaçant pour l'équilibre de la raison, on peut dire que tous les systèmes philosophiques de l'antiquité ont reconnu la possibilité, la réalité et la véracité de la divination ou révélation. Les stoïciens, en particulier, se signalaient par leur zèle pour la défense de cette cause. Ils démontraient, à la façon de Pascal, l'existence des dieux par l'accomplissement des prédictions, et prouvaient ensuite que la foi en la divination est la conséquence nécessaire de la foi à l'existence des dieux. A la fin du monde antique, tous les défenseurs de la vieille religion s'étaient approprié les arguments des stoïciens, et les textes révélés par les oracles ont joué un rôle dans la lutte des anciens dieux contre le Christ. Enfin, le christianisme répudie la divination païenne comme démoniaque, mais au profit de celle qu'il pratique à son tour. Les songes, les visions, les ravissements prophétiques sont oeuvre de mensonge quand ils viennent du démon, véridiques quand ils sont envoyés par Dieu. Sur ce point, il n'y a pas entre chrétiens et païens opposition de principes ; il ne s'agit que de déterminer de quel côté est la révélation véridique.
Il ne faut pas s'attendre à rencontrer, sous les lignes un peu flottantes des classifications qui vont être essayées, des idées précises, des attributions axes qui permettraient, par exemple, soit de réserver à un dieu suprême, confident ou moteur du Destin, le monopole de la révélation, soit de répartir les méthodes divinatoires entre les divinités, de façon que chacune d'elles eût une façon propre et personnelle d'exprimer sa pensée. Le polythéisme gréco-romain n'a jamais été qu'un assemblage de cultes nés en divers temps et en divers lieux : il eût fallu, pour le doter d'une théologie ordonnée et cohérente, le long effort d'une caste sacerdotale que suppléaient imparfaitement les poètes et les mythographes. Ceux-ci comme ceux-là n'ont pu qu'ébaucher des systèmes incomplets, incapables de rendre raison de l'infinie diversité des traditions locales et des habitudes préexistantes. Ce qu'on appelle parfois la «religion olympienne» est un produit de ce travail intellectuel, de cette aspiration plus ou moins consciente vers l'ordre et l'unité. Elle visait à concentrer toute science, toute puissance aux mains de Zeus, et à faire d'Apollon le dispensateur unique de la révélation émanée de Zeus. Mais, malgré la réelle influence qu'elle dut à sa notoriété littéraire et à la propagande faite par les oracles apolliniens, elle est loin d'avoir tenu dans la réalité la place qu'elle a prise dans la littérature et l'art. Elle se heurtait de toutes parts à des habitudes, des traditions, des incompatibilités qu'elle ne pouvait surmonter. On peut dire qu'en fait, il n'est pas de divinité si humble qui n'ait été jusqu'à un certain point autonome, qui n'ait gardé, au moins en certains lieux ou au moyen de certains rites, la faculté de communiquer avec les hommes et de tirer la révélation de son propre fonds. On ne peut pas davantage placer chaque méthode divinatoire sous le patronage exclusif d'une divinité qui en aurait fait son langage particulier et unique. Sans parler de l'imprévu, représenté par les prodiges, il est rare que même un procédé connu et régulier n'ouvre de relations qu'avec un seul type divin. De même, on rencontre des oracles placés sous la garantie d'une divinité définie et qui usent de plusieurs méthodes distinctes. C'est ainsi qu'à Dodone, le chêne, le bassin de bronze, la source, les songes, les «sorts» même, servaient à manifester la pensée de Zeus.
Cependant, à défaut de principes arrêtés, la pratique même a fait prévaloir certaines habitudes qu'on peut considérer comme des règles approximatives et qu'il sera bon de signaler à l'occasion. Un coup d'oeil d'ensemble permet de reconnaître que la révélation directe - celle que nous appellerons tout à l'heure «intuitive» - émane généralement des divinités chthoniennes, des forces occultes qui fermentent dans le sein de la grande Mère, tandis que le langage symbolique est employé par les divinités dont l'anthropomorphisme grec avait mieux réussi à faire des personnalités concrètes. Celles-ci se posent en face de l'homme comme des interlocuteurs dont il se sent bien distinct, alors même qu'elles l'approchent de plus près ; les autres l'attaquent par le dedans, s'insinuent, pour ainsi dire, dans sa substance : elles peuvent le «posséder», c'est-à-dire lui enlever le libre usage de ses facultés et jusqu'à la conscience de sa personnalité. Dans le langage symbolique, il y a comme des idiomes divers entre lesquels les dieux révélateurs ont manifesté leurs préférences. L'aigle, les «voix» aériennes, la foudre porteront les messages de Zeus ; les «sorts» seront plus particulièrement gouvernés par Hermès. Mais il faut se borner à ces indications sommaires, sous peine de voir les règles emportées par les exceptions. On se trouve en présence d'une masse confuse de faits qui ne se plient à aucune doctrine, parce qu'ils sont le produit d'une foule de circonstances locales, de croyances et d'initiatives rebelles à toute discipline.
Nous allons donc considérer la divination en elle-même et exposer brièvement ses méthodes, sans insister plus que de raison sur ses rapports avec les conceptions théologiques, et en marquant plutôt les rapprochements à faire que les différences à noter entre les usages des Hellènes, des Etrusques, des Romains.
Suivant une classification commode établie par les stoïciens, toutes les méthodes divinatoires peuvent se grouper sous deux rubriques principales. Si la révélation est manifestée par des signes extérieurs, fortuits ou convenus, qu'il faut observer, rapprocher et commenter pour en extraire le sens, la divination est «artificielle» (entechnos, technikê, artificiosa) ; si, au contraire, la révélation est communiquée directement à l'âme, qui la perçoit «sans art», c'est-à-dire sans effort et sans opération logique, la divination est dite spontanée (atechnos, adidaktos, naturalis). Comme la divination artificielle admet une certaine spontanéité, et la divination spontanée une certaine somme d'artifices, nous appellerons la première inductive, l' autre intuitive.
Dans quel ordre convient-il d'aborder ces deux catégories de méthodes divinatoires ? A ne consulter que l'ordre logique, la divination intuitive passerait avant l'autre, car l'induction dont se servent les méthodes «artificielles» est fondée sur des règles, et les règles sont une révélation primitive faite par les dieux aux fondateurs de la science divinatoire. Il en serait de même si on envisageait la grandeur, la fécondité, l'importance philosophique des idées mises en jeu. Les «devins» n'ont jamais été que de médiocres personnages, tandis que le prophétisme a dans l'histoire religieuse une place d'honneur : il a ou engendré ou légitimé bon nombre de religions nationales et servi de point d'appui à toutes les religions universelles. Cependant une étude bornée à l'antiquité classique et tenue près des faits doit commencer par la divination inductive, non seulement parce que la théorie en est plus simple et la pratique plus mêlée à la vie quotidienne, mais parce qu'elle a été réellement connue avant l'autre en Grèce et sans doute aussi en Italie. Dans le monde homérique, on rencontre plus d'un devin, mais pas un seul prophète. C'est que la divination inductive, à peu près dépourvue de merveilleux, est mieux adaptée au tempérament pondéré des peuples classiques, qui goûtaient peu les «fureurs» et le «délire» des prophètes. Ceux-ci sont venus du dehors, de l'Orient, patrie des mystiques.
DIVINATION INDUCTIVE
La divination inductive est l'interprétation raisonnée des signes extérieurs qui recèlent la pensée divine. On entend par signes (sêmeia, signa) des phénomènes symboliques que l'on suppose produits par une cause surnaturelle avec l'intention d'avertir et informer les observateurs experts en l'art de déchiffrer ces symboles.
Une première difficulté, c'est de discerner l'intention surnaturelle. Elle n'apparaît avec quelque netteté que dans les prodiges (terata, prodigia, ostenta, miracula, monstra), c'est-à-dire dans les faits miraculeux ou tout au moins extraordinaires. Mais l'idée de miracle intentionnel ou «prodige» ne prend elle-même une certaine précision que par le progrès de l'idée antagoniste, de la conception scientifique des lois naturelles. Aux temps primitifs où l'on concevait la vie de la nature comme menée non par des lois, mais par des volontés invisibles, tout pouvait être matière à interprétation. Aussi supposait-on que les dieux avaient révélé, par faveur spéciale, à quelques devins privilégiés le sens des signes dont ils comptaient se servir pour communiquer avec les hommes. Les devins de l'âge héroïque, Mélampus, Tirésias, Amphiaraos, Calchas (d'autres disaient Prométhée lui-même) étaient censés avoir créé le vocabulaire et la grammaire de la langue symbolique. L'art divinatoire, ainsi fondé et transmis par eux à leurs descendants ou à leurs disciples, tendit de plus en plus à devenir une science impersonnelle, pourvue de règles fixes et abordable à quiconque prenait la peine de l'étudier.
Mais il resta toujours dans cette science une large part faite à l'arbitraire et à l'imprévu. S'il était facile d'établir une fois pour toutes un rapport entre le signe et la chose signifiée, il était impossible de limiter le nombre des signes et surtout de distinguer par un critère infaillible les «signes» des phénomènes non susceptibles d'interprétation. Si la divination n'avait accepté comme signes que les «prodiges», elle eût simplifié sa tâche sans doute, mais elle eût renoncé à exercer une influence régulière sur la vie des individus et des peuples. Un prodige est, par définition, un fait exceptionnel, et ni les Grecs ni les Romains n'ont admis que les dieux aient eu besoin, pour manifester leur pensée, de déranger l'ordre naturel des choses. La plupart des signes sont donc des faits qui peuvent se présenter à chaque instant ; ils ne diffèrent des faits naturels que par l'intention que sait découvrir la science du devin. «Beaucoup d'oiseaux volent sous le regard du soleil, dit Eurymaque dans l'Odyssée, mais tous ne portent pas de présages». Il fallait, pour distinguer les signes des phénomènes insignifiants, ou un don surnaturel ou des règles précises. Les devins de l'âge héroïque passaient pour avoir reçu des dieux le don surnaturel ; leurs successeurs cherchèrent à formuler des règles.
Là où, comme chez les Romains, la divination inductive prit une place définie dans les institutions et s'obligea à n'user que de procédés certains, on eut recours à une règle fort simple, qui enlevait à la science divinatoire la majeure partie de ses ressources, mais garantissait les résultats acquis : c'était de n'admettre comme valables que les signes demandés et obtenus en vertu d'une convention préliminaire (signa impetrita). Ainsi les augures romains n'observaient les oiseaux que dans les limites du «temple» et à partir du moment où l'augure se déclarait prêt à noter les présages stipulés dans sa formule. Cette règle s'appliquait aisément à tous les cas où il s'agissait de consulter les dieux ; mais une foi réelle en la divination ne pouvait réduire les dieux à ce rôle passif et admettre qu'ils fussent muets tant qu'on ne les interrogeait pas. Leurs avertissements étaient, au contraire, d'autant plus pressants et plus utiles qu'ils étaient plus spontanés. Les augures de Bome eux-mêmes tenaient compte, dans une certaine mesure, des signes fortuits (signa oblativa) qui pouvaient troubler les rites de l'auspication [Augures, auspicia], et, dans les légendes concernant les vieux devins, prodiges et signes fortuits jouent le principal rôle. Réduire la divination à un certain nombre d'opérations expérimentales et exclure l'observation dans le champ illimité de l'imprévu, c'était la mutiler et l'avilir.
A côté donc des signes indubitables, qui sont les «prodiges» et les signes convenus d'avance, il reste un nombre indéfini de signes possibles, qu'aucun caractère intrinsèque ne permet de distinguer des mêmes phénomènes produits sans intention surnaturelle. Les soldats de Timoléon rencontrent des mulets chargés d'ache, et ils y voient un présage de mort, parce que l'ache sert à couronner les tombeaux ; mais Timoléon leur rappelle qu'on en tresse aussi des couronnes pour les vainqueurs aux jeux Isthmiques et en tire la conclusion qu'ils seront victorieux18. La rencontre d'une belette était, pour les gens timorés (deisidaimones), un avertissement inquiétant. On sait de combien de rapprochements imprévus était faite la divination «ominale» des Romains, la divination par symboles «domestiques» et «viatiques» (oikoskopika, enodia, ou ek sunantêmatos oiônismata, enodia sunantêmata) des Grecs. Et ce vaste champ d'observation dépassait les limites de la vie consciente ; il se prolongeait dans le domaine fantastique du rêve, qui pouvait non seulement reproduire tous les prodiges et signes fortuits constatés à l'état de veille, mais en allonger indéfiniment la liste.
C'était la part faite à l'arbitraire, à l'art des devins, l'aliment inépuisable de cette superstition contre laquelle les moralistes protestaient sans parvenir à tracer la limite qui devait, en matière de divination, séparer l'usage de l'abus. En Grèce, où la divination inductive fut de bonne heure livrée à l'initiative individuelle, les devins exploitèrent de préférence cette veine fertile et s'y créèrent des spécialités (teratoskopoi ou teraskopoi, sumbolomanteis, sumbolodeiktai) : à Rome, les augures tinrent les signes fortuits en dehors de la divination officielle et s'ôtèrent à ce sujet tout scrupule en décidant que c'est l'attention qui crée le présage et que les signes ne comptent pas pour ceux qui ne s'y sont pas arrêtés. En Etrurie, les haruspices [Haruspices] paraissent avoir fait un choix dans les signes fortuits et n'avoir interprété que les prodiges, dont ils savaient mieux que personne pénétrer le sens et détourner les effets par une «procuration» appropriée [Procuratio].
En résumé, les signes divinatoires peuvent se ranger en deux grandes catégories, les signes convenus, dont le sens est fixé d'avance par la convention elle-même, et les signes fortuits, dont le sens est à déterminer, ces signes fortuits se partageant eux-mêmes en deux séries parallèles et souvent contiguës, les prodiges, où l'intention surnaturelle est évidente, et les «symboles» ou «rencontres» ordinaires, qui n'ont de sens que si on a préalablement reconnu et accepté le présage.
En fixant les règles à suivre soit pour obtenir des signes convenus, soit pour interpréter les signes fortuits, les devins ont créé des méthodes divinatoires extrêmement diverses, mais dont chacune a sa logique intérieure. Une méthode est d'autant plus sûre qu'elle compte moins de signes fortuits ou que le sens des signes fortuits y a été mieux déterminé par une longue pratique. Les prodiges peuvent se répartir, suivant leur nature, entre les diverses méthodes, mais, à moins qu'ils ne reproduisent exactement des prodiges déjà observés, ils échappent à toute prévision, et par conséquent forment dans l'art divinatoire comme une partie réservée.
Il n'est guère possible d'instituer une classification raisonnée des méthodes : nous croyons suivre d'assez près leur genèse historique en les ordonnant d'après la nature de l'être ou objet matériel qui fournit les signes divinatoires. Pour transformer en signes les actes instinctifs des êtres vivants, il suffit que les dieux les dirigent. L'instinct est déjà, par définition, une sorte de poussée ou inspiration intérieure qui se met aisément au service des volontés surnaturelles. En outre, le symbolisme ayant attribué les espèces animales à des divinités déterminées, le choix du messager indique par lui-même l'origine du message. Aussi les principales d'entre les méthodes fondées sur l'observation des actes instinctifs des animaux et de l'homme paraissent remonter à une haute antiquité. La divination par les entrailles des animaux mène, par une transition naturelle, à la divination par les objets inanimés. Ici, l'action des dieux, ou la puissance des formules magiques qui se substitue à leur libre initiative, devient en quelque sorte plus visible, en raison de l'indifférence de la matière inerte qui leur sert d'instrument. Enfin, il faudra placer à part, et comme hors cadre, la divination astrologique, qui se réclame de principes étrangers aux idées des peuples occidentaux et a toujours gardé chez eux son caractère exotique.
- Divination par les actes instinctifs des animaux (ornithomancie, ichthyomancie, etc.)
Les dieux, ou du moins les plus nobles d'entre eux, étant censés résider dans les espaces célestes, il est évident que, de tous les animaux, les oiseaux étaient les plus aptes à leur servir de messagers, et, parmi les oiseaux, ceux qui ont le vol le plus hardi et le plus rapide. Ceux-là apportaient pour ainsi dire la révélation de sa source même. Aussi les oiseaux à présages (oiônoi, ornithes mantikoi, chrêstêrioi) furent-ils choisis à peu près exclusivement parmi les oiseaux de proie.
Au premier rang figure l'aigle de Zeus, l'oiônos par excellence et le principal acteur des «prodiges» homériques. Après lui, les rangs sont disputés et diffèrent suivant les pays. En Grèce, où il n'y avait point d'autorité sacerdotale pour arrêter le canon des oiseaux fatidiques, Apollon a pu avoir successivement ou simultanément pour messager l'autour (kirkos) et le corbeau (korax) - celui-ci capable d'alimenter à lui seul l'industrie de certains spécialistes (korakomanteis) ; - Athéna, le héron (erôdios), la corneille (korônê), la chouette (glaux) et la mouette (krex). On disait aussi que la corneille avait passé du service d'Apollon à celui de Héra. Dans le Latium, le pivert, consacré à Mars (picus Martius) et à Féronia (picus Feronius), fut peut-être à l'origine, avec l'orfraie (parra), compagne de Vesta, l'oiseau fatidique par excellence. Mais à Rome, les augures, suivant leur coutume, bannirent de leur art la variété avec l'arbitraire ; tout en conservant un certain nombre d'oiseaux dans le canon augural et en admettant même que l'apparition fortuite d'un oiseau quelconque peut être un présage, ils les adjugeaient tous à Jupiter, seul dispensateur des auspices.
L'espèce des oiseaux était déjà par elle-même une indication. Les raisons symboliques qui les avaient fait associer à telle ou telle divinité leur donnaient aussi un caractère favorable ou défavorable a priori. Il y avait des oiseaux de bon et de mauvais augure, soit par nature, soit par antipathie ou sympathie. A ce point de vue, les oiseaux se confondent avec tous les objets de rencontre fortuite et relèvent de la «symbolomancie». Mais la divination par les oiseaux (oiônistikê, ornithomanteia, augurium, disciplina auguralis), dont on rapportait l'invention à Tirésias, ne se contentait pas de constatations aussi sommaires. On nous dit que les devins grecs étudiaient dans les oiseaux fatidiques trois ou quatre points principaux : le vol (ptêsis), le cri (phonê, klaggai, boê), le siège (edra, kathedra) et l'action (energeia). Ils appréciaient la direction, la hauteur et la rapidité du vol, l'intensité et la fréquence du cri, la position du siège et la présence simultanée d'oiseaux sympathiques (sunedroi) ou antipathiques (diedroi), enfin l'attitude et les mouvements de l'oiseau observé. Les augures romains examinaient, suivant les espèces, tantôt le vol (alites), tantôt le cri (oscines).
Le sens de tous ces indices dépendait tout d'abord des rapports de distance et de position entre l'oiseau et l'observateur. Ici, l'art augural des Grecs était beaucoup moins précis que celui des Etrusques et des Romains [Haruspices, Augures]. Ceux-ci encadraient tout le champ d'observation dans les lignes d'un temple [Templum] orienté d'après les points cardinaux ; les Grecs paraissent s'être bornés à distinguer entre la droite de l'observateur, côté des présages heureux (dexios, aisios), et le côté gauche (aristeros, exaisios), répartition contraire à celle des Italiotes, qui, pour des raisons déduites ailleurs [Augures], mettaient les présages favorables à gauche.
Les règles d'interprétation étaient en général conformes à la logique qui régit les symboles et allégories. Un oiseau étant de bon augure, par nature ou par position, le présage devait être d'autant plus favorable que le messager céleste montrait dans ses mouvements plus de vigueur et de pétulance. Le devin de profession poussait l'analyse plus avant. Il pouvait observer si l'oiseau une fois posé remuait la patte droite ou la patte gauche, l'aile droite ou l'aile gauche, ou raffiner sur les inflexions de sa voix, comme ceux qui trouvaient au corbeau soixante-quatre cris différents. Ainsi que dans toutes les méthodes divinatoires, les règles étaient encombrées d'exceptions plus ou moins capricieuses. Pour la corneille, par exemple, il fallait renverser l'orientation usuelle du bonheur et du malheur. D'autre part, le sens du présage dépendait souvent de conditions inhérentes à la personne, à l'état, aux projets de l'observateur. La chouette était de bon augure pour un Athénien ; la mouette était redoutée le jour d'un mariage. Les actes symboliques de l'oiseau avaient, outre leur sens propre, une valeur relative empruntée aux circonstances. Le guerrier qui voit des oiseaux le précéder ou fondre devant lui sur leur proie reçoit du même coup un encouragement enveloppé dans une allégorie transparente.
Enfin, l'expérimentation pouvait s'assurer ou se substituer à l'observation pure et simple et créer des méthodes spéciales comme les auspicia ex tripudiis (pullaria) des Romains, les lancés d'oiseaux que paraissent avoir pratiqué les Etrusques ou l'alectryonomancie des Grecs.
En somme, ce que nous savons de l'ornithomancie grecque se réduit à peu de chose. Bornée à l'interprétation de cas fortuits dans Homère, éclipsée plus tard par la supériorité reconnue de l'extispicine, elle a été reconstituée artificiellement aux époques de décadence avec des rites de toute provenance. En Etrurie, la divination par les oiseaux n'a été pour les haruspices qu'une sorte d'accessoire [Haruspices]. C'est à Rome seulement qu'elle a pénétré dans la vie publique, et que, se bornant à l'observation de signes convenus envoyés par Jupiter seul, elle a gagné en précision tout ce qu'elle perdait en étendue [Augures, Auspicia].
L'ornithomancie n'est qu'une partie de l'art d'interpréter les actes instinctifs des animaux. Le reste formait un dépôt vague de traditions qu'on faisait remonter à Orphée et qui constituaient la divination «domestique» ou «viatique», cours de superstition bigote et triviale, à suivre chez soi ou en voyage. Si la révélation vient du ciel, elle peut aussi venir de la terre, mère commune des dieux et des hommes, divinité mantique par excellence. Aussi les animaux qu'on disait issus de la terre par génération spontanée, le serpent en première ligne, le lézard, la sauterelle, le rat, la souris, la belette, la taupe, l'araignée, etc., étaient particulièrement aptes à donner des présages. Plutarque n'exclut de cet office d'intermédiaires entre les dieux et les hommes que les poissons. Encore l'ichthyomancie asiatique n'était-elle pas inconnue des Grecs et avait-elle pénétré jusque dans le culte d'Apollon. Enfin, il est bon de dire que dans tous les sacrifices, surtout dans ceux qui servaient de prélude aux consultations près des oracles, l'attitude des victimes donnait des indications permettant de décider si les dieux rejetaient ou acceptaient le sacrifice, et de conclure de là au succès ou à l'insuccès de l'entreprise méditée. - Divination par les actes instinctifs de l'homme (clédonisme, divination ominale, palmique, etc.)
Mais l'être vivant dont les actes inconscients étaient les plus féconds en inductions divinatoires, c'était l'homme lui-même. Par un raffinement singulier, la divination «clédonistique» des Grecs, «ominale» des Romains, allait chercher dans la parole, acte volontaire par excellence, la révélation dont l'individu parlant n'avait pas conscience. Ce que les Grecs appelaient une klêdôn et les Romains un omen est une parole (phrase, mot isolé ou exclamation) qui est détournée de son sens et appliquée par celui qui l'entend à une préoccupation intime, ignorée de celui qui parle. Ainsi, quand les prétendants menacent Iros de le conduire «chez Echétos, fléau de tous les humains», ceux-ci ne pensent qu'au tyran d'Epire, mais Ulysse entend par là le roi des morts, et «se réjouit de la clédone». On connaît le fameux omen négligé par Crassus. Au moment où il s'embarquait à Brundisium pour l'Orient, un marchand de figues criait à tue-tête : «[figues] de Caunos (Cauneas)». Il aurait dû comprendre : «cave ne eas ; n'y va pas». La plupart des présages clédonistiques ou ominaux étaient tirés de la rencontre fortuite d'individus portant des noms significatifs.
La théorie du clédonisme est surchargée de subtilités casuistiques et de contradictions. Elle suppose d'abord que, pour donner un avertissement utile, quelque divinité, en Grèce Hermès, a provoqué l'émission de la parole clédonistique et suggéré à l'auditeur la révélation soudaine qui en jaillit. La théorie s'applique très bien quand les mots employés ont par eux-mêmes un sens indifférent ; mais on admettait, d'autre part, qu'il y a des paroles, et surtout des noms, de bon et de mauvais augure. Ces mots avaient donc une efficacité intrinsèque, analogue à celle des formules magiques et indépendante, en somme, du bon plaisir des dieux. Il en résultait qu'en bonne logique, les mots de mauvais augure n'étaient plus simplement l'indice, mais la cause de malheurs qui sans eux ne seraient pas arrivés. On croyait ainsi multiplier les chances de bonheur en prodiguant les noms heureux et les bonnes paroles (euphêmein, favere linguis) ou en adoptant dans les formules officielles et les textes juridiques des «euphémismes» pour exprimer même les idées les plus désagréables. On assure que les Romains, les jours de levée, de vote, d'adjudication publique, appelaient en tête des listes des noms heureux, et qu'ils ont changé les noms des villes grecques qui suggéraient à l'esprit d'un Latin des calembours fâcheux. Chez eux, toutes les mariées s'appelaient Gaia. On alla plus loin encore. Puisque l'omen se crée en fin de compte dans l'esprit de celui qui entend la parole omineuse, on jugea que celui-ci pouvait à volonté accepter ou écarter le présage, ou encore le transformer par une réplique immédiate. C'était le triomphe de l'esprit d'à-propos, mais cette façon de modifier le futur contingent n'est guère explicable par les procédés de la logique ordinaire. Au fond de ces prétendus raisonnements, il n'y a que la vieille et incurable foi à la vertu magique des mots.
Le clédonisme, bien que voué par essence aux présages fortuits, a servi de méthode courante à certaines officines divinatoires en Grèce. A Pharae en Achaïe, celui qui consultait Hermès Agoraeos posait sa question au dieu, puis sortait du temple en se bouchant les oreilles. A une certaine distance, il ôtait ses mains, et la première parole qu'il entendait était la réponse de l'oracle. L'oracle d'Apollon Spodios à Thèbes et l'oracle «des Clédones» à Smyrne devaient fonctionner à peu près de la même manière. Chez les Romains, la divination ominale prit une importance d'autant plus grande qu'elle constituait, ou peu s'en faut, toute la divination extra-officielle : seulement, elle ne resta pas bornée, comme le clédonisme grec, à l'interprétation de la parole ; omen finit par désigner un présage quelconque.
Du reste, la parole clédonistique ou ominale n'est pas le seul acte humain où puisse pénétrer la révélation à l'insu du sujet qui l'apporte. L'homme n'est pas exclu de la divination «par symboles», qui embrasse tous les êtres et objets connus. La rencontre d'un individu de tel métier ou de telle nationalité peut être un présage : à plus forte raison ses actes. Alétès, exilé de Corinthe, ayant demandé du pain à un bouvier, celui-ci lui tendit une motte de terre : le proscrit y vit le gage d'un retour prochain dans la terre natale. On en peut dire autant des mouvements et tics involontaires, les palpitations ou convulsions, particulièrement du sourcil (palmoi sômatos, salissatio membrorum), les bourdonnements d'oreilles (ôtôn êchoi, tinnitus aurium) et l'éternuement (ptarmos, sternutatio). C'est ce que les Grecs appelaient divination convulsive (palmikê ou peri palmôn mantikê). L'éternuement fut particulierement étudié et l'on en tira une ample moisson de présages applicables tantôt à l'éternuant, tantôt aux autres, suivant l'orientation, l'heure de l'accident, l'âge et le sexe de la personne, etc., toutes inductions fondées sur la conviction que tout ce qui n'est pas soumis en nous à notre volonté est à la merci des impulsions surnaturelles. - Divination par les entrailles (Extispicine)
Si l'animal vivant peut être un messager de révélation, son corps, quand il est offert aux dieux en sacrifice, à l'état de chair palpitante, est encore pour eux un moyen commode de dévoiler aux hommes leur pensée. La divination par examen des entrailles (ieroskopia, extispicium, haruspicina), qui était pratiquée dès la plus haute antiquité en Orient, en Egypte, à Cypre et en Etrurie [Haruspices], ne paraît pas avoir été connue d'Homère. Cette conclusion ressort de l'étude des textes homériques et à une époque postérieure, des oeuvres tragiques ou des monuments figurés qui transportent ces sortes de consultations dans l'âge héroïque. La légende vit d'anachronismes et l'art n'a cure d'érudition.
C'est ainsi qu'un vase grec représente Polynice pensif devant des entrailles suspectes, et qu'un miroir toscan nous montre Calchas absorbé par l'examen minutieux d'organes placés sur une table de dissection.

Etrangère à la société homérique, la divination par les entrailles était, au contraire, familière aux Hellènes du Ve siècle avant notre ère, et pratiquée avec un certain éclat par les Iamides d'Olympie. On en doit conclure que cette méthode fut accueillie par eux dans l'intervalle. A en juger par le peu que nous en savons, ils semblent avoir réduit la divination par les entrailles à l'inspection du foie (êpatoskopia), où ils distinguaient, comme les haruspices toscans, un grand nombre de régions diverses. L'espèce des victimes n'était pas indifférente. On cite comme innovation de l'Iamide Thrasybule la dissection des entrailles du chien. Les innovations de cette nature durent se multiplier par la suite. Il est question d'entrailles de poulets, de pigeons. La théorie n'interdisait aucune expérience, pas même celles qui furent faites, dit-on, par des émules des Barbares sur les entrailles humaines. Cependant les entrailles les plus souvent consultées furent toujours celles des victimes ordinaires, le bélier et le taureau.
L'interprétation des signes tirés des entrailles suivait dans chaque pays des règles différentes, et il n'est guère possible de formuler une doctrine générale qui serait comme la partie commune de ces rites divers. Pour donner une idée des ressources de la méthode, il suffira d'exprimer brièvement les procédés du rite toscan, qui sera étudié de plus près ailleurs [Haruspices].
Les haruspices étrusques ne disséquaient pas indifféremment toutes les victimes, mais seulement celles qui étaient spécialement destinées aux consultations (hostiae consultatoriae). Celles-ci se trouvaient préparées par l'action mystérieuse des dieux qui, invoqués au moment du sacrifice, imprimaient à l'instant même dans les entrailles les signes fatidiques. Le corps de l'animal était un temple dans lequel les influences divines se trouvaient réparties, et, pour qui possédait l'art à fond, il n'y avait point de région absolument négligeable. Cependant les présages se concentraient dans les principaux organes, à qui seuls convenait le nom d'exta. La liste des exta, peu à peu allongée par les exigences de la logique et surtout par le besoin de compliquer les problèmes afin d'en réserver la solution aux initiés, avait fini par comprendre six organes : le foie, les poumons, la rate, les reins, l'estomac et le coeur. On peut croire qu'à l'origine, le foie, considéré en tous pays comme le lieu d'élection des signes divinatoires fournissait à lui seul les éléments du pronostic cherché. Le foie constituait un temple spécial, orienté et divisé en régions. Cette assertion, qu'on aurait pu formuler a priori, est aujourd'hui appuyée sur une preuve palpable. W. Deecke a reconnu dans un objet de forme bizarre et couvert de protubérances coniques ou polyédriques, trouvé en 1877 à Plaisance, une représentation hiératique du foie.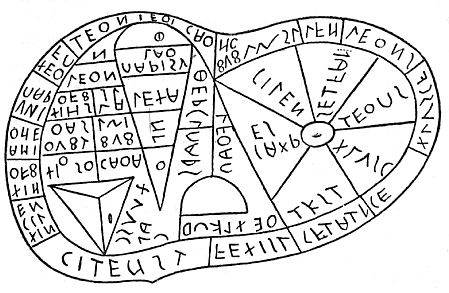
Vue en projection horizontale, cette plaque de bronze donne le contour, les subdivisions du temple hépatique, avec les noms des divinités qui y ont élu domicile. Nous savions déjà par les textes que dans une partie ou face de l'organe étaient localisées les influences favorables à l'observateur ou à ses commettants (pars familiaris, arnica) ; dans l'autre, les chances défavorables (pars inimica, hostilis). Le devin observait avec soin les fissures ou dépressions naturelles (fissura, limes), les saillies des extrémités (fibrae), et particulièrement celle qu'on appelait la «tête» du foie (caput, kephalê, lobos) ; le tout au point de vue de la couleur, du poli, de l'ampleur, de la fermeté, de la richesse en vaisseaux, etc. Nos renseignements ne portent guère que sur les cas exceptionnels ou prodigieux : «tête» absente, double, fissurée (caput caesum), foie double ou muni d'une double enveloppe ou d'une double vésicule biliaire ; mais nous savons que l'art divinatoire, d'accord avec le bon sens, considérait en général comme d'heureux présages les entrailles bien conformées, d'aspect florissant et plantureux.
Il fallait cependant qu'elles offrissent quelque particularité donnant prise à l'interprétation, faute de quoi elles étaient «muettes». Dans ce cas, comme aussi lorsque les intéressés persistaient à espérer une réponse favorable succédant à des signes menaçants, il fallait recommencer l'expérience, soit dans les mêmes conditions, soit avec des précautions nouvelles. Dans les consultations solennelles, pratiquées de préférence sur les bêtes à cornes (harvigae), les haruspices soumettaient les entrailles à une ébullition prolongée. Si, au cours de cette contre-épreuve, un organe important venait à se dissoudre (jecur extabescit, effluit), le pronostic était nécessairement fâcheux.
Bornée aux constatations courantes, la méthode était surtout commode à suivre en campagne, et c'est presque toujours auprès des généraux que nous trouvons les «hiéroscopes» grecs ou les haruspices toscans.
Ces auxiliaires n'étaient pas à dédaigner ; ils savaient trouver à propos les présages propres à relever le moral des soldats et glisser au besoin des «prodiges» dans les entrailles fatidiques. Les Romains ne pratiquaient dans les sacrifices qu'un examen sommaire, dans le but de savoir si les victimes étaient ou non agréées des dieux [Litatio] : quand ils voulaient une consultation divinatoire, ils la demandaient aux haruspices toscans.
La divination par les entrailles, vulgarisée par la concurrence des devins de tous pays et entretenue par la pratique constante des sacrifices, resta en vogue jusqu'à la fin du paganisme et confondit ses destinées avec celles des vieilles religions extirpées par le christianisme. On ne peut qu'indiquer en passant les combinaisons qu'elle était susceptible de former avec l'ornithomancie - dans les cas fortuits ou cherchés où les chairs des victimes étaient laissées à la portée des oiseaux de proie - et surtout avec l'astrologie, qui répartissait entre les divers organes les influences sidérales. - Divination par le feu (Empyromancie)
Avant que l'extispicine n'entrât ainsi dans les habitudes courantes, le sacrifice avait engendré une méthode divinatoire plus simple, du moins à l'origine, la pyromancie ou empyromancie (puromanteia, empuromanteia), dont les Grecs attribuaient l'invention à Amphiaraos et que l'on trouve représentée à Delphes par les Pyrcaoi, soi-disant issus du devin Pyrcon. Elle consistait à observer les incidents de la combustion du bois, des offrandes végétales ou animales, par le feu de l'autel.
Le nombre des signes observables était pour ainsi dire illimité, et il se créa dans la méthode empyromantique des spécialités comme la divination par la fumée (kapnomanteia), par l'encens (libanomanteia), par le vin des libations (oinomanteia), par la farine (aleuromanteia), par la semoule (alphitomanteia), par l'orge (krithomanteia), etc. On pouvait n'observer que les «pointes» ou langues de la flamme ou la direction de la fumée et les mouvements qui la détournaient du consultant ou la rabattaient vers lui ; d'autres reportaient leur attention sur le grésillement et les exsudations des chairs, particulièrement sur la façon dont se comportaient le foie ou la vessie, ou la queue, ou les omoplates (ômoplatoskopia) de la victime. Les plus habiles étaient ceux qui savaient réunir et combiner le plus grand nombre d'observations. Le gros de leur clientèle se contentait de procédés expéditifs et économiques. L'empyromancie pouvait se passer d'autel et de sacrifice ; les spécialités mentionnées tout à l'heure n'exigeaient qu'un grain d'encens, une pincée de farine, ou encore des rameaux ou feuilles (phullomanteia) d'arbres choisis, le laurier, par exemple, jetées sur un foyer quelconque. On parle aussi de poils (lachnoi) jetés sur le feu, et l'on comprend que l'expérience ait pu être faite avec des cheveux du consultant. C'est sans doute une scène de ce genre que représente une peinture de la maison de Livie.
De ces méthodes, la libanomancie, qu'on disait avoir été importée par Pythagore, était la moins triviale. Elle devenait tout à fait solennelle quand on la pratiquait, comme à Apollonie en Epire, sur des flammes sorties des entrailles de la terre. Les Orphiques lui préféraient, sans doute en mémoire de l'oeuf cosmogonique d'où ils croyaient le monde issu, la divination par les oeufs (ôoskopia, ôoskopikê, ôothutikê), sur laquelle avait écrit, dit-on, le stoïcien Hermagoras d'Amphipolis. On examinait de quel côté suait un oeuf placé sur le feu ; s'il venait à éclater et à couler, le présage était nettement défavorable. Peut-être faut-il reconnaître une consultation ooscopique dans la scène que reproduit la figure ci-jointe d'après une des fresques retrouvées dans un columbarium de la villa Pamphili.
La divination empyromantique ne vivait pas seulement d'expériences : elle tirait aussi parti des signes fortuits. Elle avait fait, par exemple, de la lampe un oracle domestique. «Tu as déjà pétillé trois fois, ma chère lampe, dit un poète de l'Anthologie, m'annonces-tu que la suave Antigone va venir partager ma couche ?» Les craquements des meubles (trismoi xulôn), produits non plus par le feu, mais par la sécheresse, étaient aussi utilisés comme présages. Il est inutile de suivre plus loin les modifications et déviations de la méthode ; elle n'était pas moins complaisante et féconde que les autres. - Divination par l'eau (Hydromancie)
Si le feu tirait de son origine céleste des qualités prophétiques, on sait et nous aurons occasion de répéter que l'eau est, par excellence, l'agent et le véhicule de la révélation. Les oracles les plus renommés puisaient leur inspiration dans les sources qui coulaient sous leurs trépieds. On peut donc s'attendre à rencontrer unie grande variété de rites hydromantiques. Laissant de côté ceux qui servent à la divination par enthousiasme, nous ne citerons ici que la divination par les sources (pêgomanteia) et la divination par le bassin (lekanomanteia).
Les expériences faites sur les sources sont tout à fait comparables aux expériences pyromantiques ; elles se ramènent presque toutes à ce programme : observer comment se comportent des objets jetés dans l'eau. A Epidauros Limera, on jetait dans la fontaine d'Ino-Leucothea des gâteaux, qui étaient censés acceptés quand ils enfonçaient, dédaignés dans le cas contraire. A Aphaca dans le Liban, Aphrodite dispensait d'une façon analogue les bons et les mauvais présages. Certaines sources servaient d'instruments d'épreuve pour distinguer les vrais serments des parjures : l'auteur du serment s'y risquait lui-même et en sortait sain et sauf ou y périssait. Tel était le célèbre étang volcanique des Paliques en Sicile, et sans doute la fontaine de Zeus Orkios, près de Tyane. On sait que les Olympiens eux-mêmes redoutaient de jurer par les eaux du Styx.
La lécanomancie est un procédé tout artificiel qui pouvait être varié de bien des manières. Un liquide homogène ou mélangé - de l'eau, du vin, de l'huile, etc. - étant versé dans un bassin et «enchanté» au moyen de formules magiques, on observait les reflets de sa surface, le groupement des bulles ou des taches qui s'y étalaient, les ondes qu'y déterminait la chute d'une pierre et autres incidents de ce genre. La magie pouvait aussi en faire un miroir où apparaissaient des figures évoquées, des représentations visibles de l'avenir. Une peinture de la maison de Livie paraît représenter une expérience de ce genre. Il suffisait de substituer au liquide un miroir métallique pour avoir la catoptromancie, qui pouvait ou remplacer les rites hydromantiques ou se combiner avec eux.
Mais cette magie orientale, qui savait fixer des esprits prophétiques dans l'eau, le bois, les pierres (lithomanteia), les statues, nous entraîne peu à peu loin des habitudes helléniques et nous fait sortir de la divination inductive, de celle qui ne fait pas «voir», mais permet de «deviner».
Nous la retrouverons cependant encore mêlée plus ou moins intimement aux rites cléromantiques. - Divination par les sorts (Cléromancie)
La cléromancie (klêromanteia, mantikê dia klêrôn, sortes, sortilegium) est un mode de divination expérimentale qui emploie comme agent révélateur un mouvement provoqué par l'homme et dirigé par le hasard, celui-ci étant considéré comme l'expression immédiate de la volonté divine.
Parmi ces expériences, il en est qui ne peuvent être classées qu'approximativement dans cette catégorie, comme l'axinomancie, qui consistait à observer les vibrations d'une hache plantée dans un poteau ; la sphondylomancie, où la rotation d'une boule, d'un fuseau, d'une vertèbre, donnait des présages ; la coscinomancie, où l'instrument du hasard était un crible tournant suspendu à un fil ou posé sur une pointe ; la dactyliomancie, qui interprétait les oscillations d'un anneau suspendu au-dessus d'un vase circulaire dont il venait frapper en divers points le contour. La plupart de ces procédés étaient, on le dit expressément pour l'axinomancie, d'origine orientale et relèvent de la divination «magique». Quelques uns, comme la sphondylomancie et la dactyliomancie, pouvaient être ramenés dans les conditions des expériences que nous énumérerons plus loin en disposant des lettres ou des mots sur le contour des engins mis en oeuvre.
La cléromancie, elle aussi, avait commencé en Grèce par des essais analogues, mais dégagés d'incantations magiques. Des cailloux de forme ou de couleurs diverses (lithobolia, psêphomanteia ou psêphobolia, thriobolia), des fèves noires et blanches (kuamobolia), des baguettes marquées d'entailles (rabdomanteia) ou des flèches (belomanteia), des osselets (astragalomanteia) ou des dés (kubomanteia), suffisaient, une question étant posée, pour obtenir des dieux, particulièrement d'Hermès, patron et garant de la cléromancie, une réponse positive ou négative. Sur une coupe de Douris, on voit des guerriers recourir en présence d'Athéna, probablement Athéna Skiras, à une sorte de «lithobolie» ou consultation cléromantique.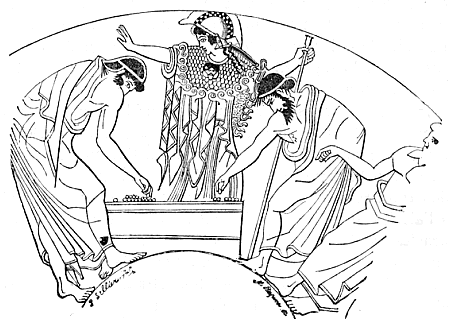
Ces divers «sorts» pouvaient être maniés suivant des rites variés, jetés sur le sol ou sur une table consacrée (trapezomanteia), agités dans une urne, posés sur une coupe débordante, lancés dans une source (pêgomanteia) ou un bassin hydromantique. Le tirage au sort était entré depuis si longtemps dans les habitudes que les expériences les plus vulgaires n'appartenaient plus, pour ainsi dire, à la divination. Mais l'antiquité et l'importance de la méthode sont attestées par les expressions restées dans les langues grecque et latine. Il est probable que le verbe chraô (d'où chrêsmos) a eu le sens d'«entailler» des baguettes ou des osselets avant l'acception de «prophétiser» ; on a dit de tout temps que la Pythie «tirait» (anairein) ses réponses comme on «tire» au sort et comme on «tire» les cartes aujourd'hui : quant aux Latins, ils n'avaient pas d'autre expression que sortes (d'où sortilegium) pour désigner toute espèce de divination expérimentale. Du reste, ces procédés primitifs pouvaient être perfectionnés et combinés avec des méthodes plus expressives. C'est ainsi qu'à Boura, en Achaïe, Héraclès donnait ses consultations par astragalomancie ; un tableau contenait les réponses correspondant aux points amenés
Nous touchons ici à ce que nous appellerons la cléromancie proprement dite, celle qui se sert de la parole écrite, adaptée à chaque cas particulier par le hasard. Entre cette cléromancie et la divination «cledonistique» ou ominale étudiée plus haut, il n'y a pour ainsi dire, que des différences matérielles. Le «sort» est à l'omen ce que l'écriture est au langage parlé. D'un côté comme de l'autre, la rencontre est fortuite, - encore que le champ des possibilités soit plus restreint dans la cléromancie - et c'est la correspondance établie entre la parole fatidique et une préoccupation intime qui produit la révélation. On pouvait, dans les méthodes cleromantiques, mettre à la disposition du sort soit des lettres séparées, soit des mots, soit des phrases.
Nous ne trouvons la cléromancie sous la forme la plus simple que dans les oracles ou «sorts» de l'Italie, généralement placés sous l'invocation de la Fortune. A Caere (l'Agylla pelasgique), les sorts étaient des tablettes pourvues de caractères et réunies en faisceau : il en était de même à Faléries. Il arriva que, le lien venant à se rompre, ces oracles parlèrent spontanément. On ignore comment étaient faits les sorts d'Antium. Ceux de Préneste, des planchettes de chêne portant les lettres de l'alphabet, étaient enfermés dans un coffre, d'où on les faisait tirer par la main d'un enfant. Mais ces oracles eux-mêmes finirent par délaisser leurs instruments trop primitifs et recoururent à la divination par phrases détachées (rapsôdomanteia) mise à la mode par les lettrés. Ces phrases étaient extraites de livres inspirés par les Muses, comme les poèmes d'Homère, d'Hésiode, de Virgile, ou des collections d'oracles qui circulaient à l'époque de la décadence. Au lieu de tirer au sort des extraits préparés d'avance, les possesseurs de livres pouvaient aussi les ouvrir au hasard et prendre pour réponse à leur préoccupation les premiers mots qui leur tombaient sous les yeux. Chacun pouvait avoir ainsi, en collaboration avec la Providence, son oracle à domicile. Les chrétiens n'eurent qu'à substituer la Bible aux livres profanes pour sanctifier la méthode et en user sans scrupules. Cette cléromancie littéraire échappa aux influences astrologiques et cabalistiques, qui firent dévier de leur simplicité originelle la plupart des autres façons d'interroger le sort. - Divination météorologique
Nous n'avons pas quitté jusqu'ici le théâtre ordinaire de la vie humaine : il reste à exploiter les espaces célestes (meteôra) vers lesquels l'ornithomancie attirait déjà nos regards. Là-haut brillent accidentellement les éclairs, les bolides, qui étaient ou pouvaient être des phénomènes prodigieux, et, d'une façon régulière, les astres.
La régularité étant chose contradictoire avec l'idée de «signe» fatidique, les Grecs n'ont pas imaginé l'astrologie, qui est fondée sur de tout autres principes, mais ils ont eu une divination météorologique interprétant les «signes de Zeus» (diosêmeiai), seul maître du tonnerre. Elle n'a pas été, entre leurs mains, très féconde. L'éclair ou le tonnerre retentissant à droite était à leurs yeux un présage favorable, et la voix du tonnerre était dans tous les cas un avis fort écouté, mais ils n'ont institué ni observation ni interprétation méthodique de ces phénomènes. Les Pythaïstes athéniens postés à l'autel de Zeus Astrapaios n'avaient qu'à attendre le premier éclair pour donner le signal du départ à la «théorie» pythique. Les éphores de Sparte observaient le ciel tous les neuf ans par une nuit sans lune, et mettaient les rois en interdit si une étoile filante traversait le ciel sous leurs yeux. Toujours la question est précise et la réponse ne peut avoir qu'un sens.
Les Romains ont fait une part aux «signes célestes» (signa ex caelo), c'est-à-dire aux foudres et éclairs, dans leur divination officielle [Augures], mais ils n'ont eu qu'à importer chez eux quelques principes formulés par la science fulgurale des Etrusques, qui sera analysée dans un autre article [Haruspices]. Ceux-ci admettaient un grand nombre de divinités fulminantes, disposées sur le contour de leur temple, et une quantité de foudres de sens différent suivant le point de départ et le point d'arrivée. Mais, chez eux aussi, la divination par les foudres vise son but ordinaire, qui est de connaître un détail contingent de la destinée afin de le modifier par des mesures appropriées [Procuratio, Prodigia]. - Divination mathématique
- Astrologie. - On entre dans un tout autre ordre d'idées avec l'astrologie judiciaire ou apotélesmatique. Ici, on ne cherche plus à entrer en communication avec un être supérieur, dont la bienveillance puisse révéler en temps utile les moyens d'échapper à une éventualité provisoire et conditionnelle. C'est le Destin lui-même que l'astrologue a la prétention de surprendre dans son laboratoire, sans autre aide ni intermédiaire que la logique irrésistible de la science des nombres. Dans ce royaume de la Nécessité, il n'y a plus de volontés libres que la prière ou des satisfactions offertes en temps opportun puissent fléchir ; les artisans de la destinée sont des forces qu'on peut croire indifféremment intelligentes ou aveugles, mais dont l'action n'est dirigée que par les lois fatales des mathématiques. L'astrologie avait donc l'ambition de remonter jusqu'aux causes premières et universelles et d'en déduire les conséquences applicables aux cas particuliers : mais ni les causes ni la chaîne qui les relie aux conséquences n'offrant de prise à l'ingérence des intéressés, cette science, qui fondait la certitude de ses déductions sur l'inflexibilité des lois cosmiques, devait d'autant plus renoncer à modifier l'avenir qu'elle croyait le connaître plus sûrement. Les clients de l'astrologie devaient s'assimiler la foi et la résignation des stoïciens, qui, adeptes zélés de la divination, ne voyaient en elle qu'un moyen d'adhérer par avance et en connaissance de cause aux décrets de la providence.
Il ne faudrait pas croire cependant que les astrologues aient aperçu et accepté du premier coup ces conclusions dernières de leur doctrine. Pour les Chaldéens, dont le nom est resté, dans toute l'antiquité, inséparable de l'astrologie, les astres étaient encore des dieux, et, comme tels, des êtres doués d'initiative, capables de modifier leurs volontés. A mesure qu'on eut une idée plus nette de la régularité de leurs mouvements, le fatalisme se substitua à la conception plus naïve des premiers âges, mais jamais assez complètement sans doute pour ne laisser en présence que la nécessité d'une part, la résignation de l'autre. Il restait toujours des possibilités, des conditions, des alternatives, et, dans les esprits les plus conséquents, une lueur d'espérance illogique s'ajoutait quand même au plaisir de savoir.
Le discrédit où, par suite des progrès de la science, - ou plutôt de l'esprit scientifique - l'astrologie est définitivement tombée ne doit pas faire oublier qu'elle a pris à tâche d'appliquer avec une précision rigoureuse ses axiomes arbitraires, que l'astronomie a profité de son labeur, et que les «mathématiques», qui ont gardé son nom, ont fait leurs premiers essais dans ses observatoires.
Les axiomes astrologiques peuvent se ramener aux quatre propositions suivantes : 1° Les astres ont, à un degré éminent, des qualités spéciales que leur action tend à reproduire dans les êtres terrestres ; 2° cette action se propage par effluves rectilignes et engendre les qualités émanées de la source ou leurs contraires, suivant qu'elle agit positivement ou négativement ; 3° un astre donné exerce son influence propre dans des sens différents et avec une intensité différente suivant la position qu'il occupe dans le ciel ; 4° Les influences sidérales s'exerçant simultanément, chacune d'elles est toujours engagée dans des combinaisons avec des influences concourantes on antagonistes qui en modifient les effets (sugkrasis).
Parmi les astres, les plus divins, les plus puissants, ceux qui ont le caractère personnels accentué et en même temps l'influence la plus variable par suite de leur mobilité, sont les planètes. Les étoiles fixes n'ont pas de caractère individuel ; l'astrologie n'a attribué de tempérament propre qu'aux groupes d'étoiles ou constellations et (en pratique, sinon en théorie), seulement aux constellations qui se trouvent sur la route des planètes. Il se peut que les prêtres chaldéens se soient contentés longtemps des combinaisons des planètes et que les influences zodiacales aient été introduites dans les problèmes astrologiques par les Egyptiens. Mais, le zodiaque étant le limbe gradué qui sert à mesurer la marche et les positions des astres mobiles, il était impossible que la rencontre des planètes avec les signes fût considérée comme une circonstance indifférente. L'astrologie cosmopolite, la seule qu'ait connue l'Occident, associait intimement les influences planétaires et celles des signes du zodiaque, sans se prononcer nettement sur ieur énergie respective.
Voici donc les éléments premiers de toutes les combinaisons géométriques et psychologiques de l'astrologie : les trente-six «décans», devenus en Grèce les douze signes du zodiaque, dont le tempérament est indiqué par leurs figures éponymes, et les cinq planètes (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne), dont le caractère est mieux marqué encore par leurs noms divins. Aux planètes s'ajoutent souvent le Soleil et la Lune, qui ont, un rôle à part et prépondérant. Les planètes occupent successivement tous les signes, mais chacune a dans le zodiaque une «maison» (oikos) où elle possède sa plus grande énergie, sans compter une quantité de sous-domiciles (oria); de façon que chaque degré du cercle zodiacal possède une action stellaire et une action planétaire superposées, celle-ci s'exercant même quand la planete n'y est pas actuellement présente. Enfin, les signes entre eux et les planètes entres elles s'associent par conjonction et opposition diamétrale, par aspects ou figures polygonales inscrites au cercle ; aspect trigone, tétragone ou quadrat, hexagone ou sextil. Ces associations, qui agissent comme des unités complexes ayant aussi un tempérament propre, sont d'autant plus harmoniques que le nombre des composants est plus restreint. Il ne faut pas oublier que ces influences déjà si complexes des signes et groupes de signes, des planètes et groupes de planètes, se modifient incessamment par le mouvement de la sphère, développant des effets tout opposés suivant que le point considéré est au lever ou au coucher, à la culmination supérieure ou inférieure. La machine cosmique ainsi montée contenait un nombre illimité de combinaisons possibles, et, par conséquent, si on applique ces influences à la vie humaine, de destinées individuelles réalisables.
Mais comment les influences astrales réglaient-elles la destinée de chacun ? Ce ne pouvait être en la dirigeant du dehors et jour par jour, car, comme elles étaient les mêmes pour tons les hommes, dans un temps et dans un lieu donnés, elles auraient mené tout le monde par les mêmes voies au même but. Il fallait donc que la destinée de chaque individu eût été fixée d'un seul coup, par une combinaison qui ne s'était pas encore produite et ne devait se reproduire pour personne autre jusqu'à la consommation de la grande année sidérale. Le moment fatidique où se crée ainsi la personnalité, avec la somme de biens et de maux qui y est attachée, était pour les astrologues le moment de la naissance. Le point du zodiaque qui y avait le plus de part, l'horoscope (poroskopos, ôrê ou moira ôronomos, ôroskopousa), était celui qui s'élevait à ce moment-là même au-dessus du plan de l'horizon. L'horoscope servait de point de départ à une division du cercle en quatre quadrants, en huit ou en douze lieux (topoi), qui représentaient les étapes de la vie et permettaient de dénombrer les influences échelonnées sur ce parcours. Certains astrologues, raffinant sur la méthode, ne se servaient de l'horoscope que pour trouver un autre point initial, le «lieu de la Fortune», à partir duquel ils comptaient douze sorts ou épreuves (athla), analogues aux «lieux», mais différemment situés. D'autres s'étaient avisés que la vie intra-utérine est déjà un chapitre de l'existence et cherchaient l'horoscope du moment non pas de la naissance, mais de la conception, ce qui les obligeait à construire une théorie physiologico-astrologique leur permettant de remonter de la naissance à la conception. Des éclectiques pensaient distinguer utilement, en disant que le moment de la conception était décisif pour la santé physique, et celui de la naissance pour les autres éléments de l'existence. Il y avait place au sein de l'astrologie pour une foule d'applications du principe initial : l'importance des astres et l'inéluctable fatalité de leurs «décrets».
Jamais doctrine n'exerça une pareille séduction sur les esprits capables de dialectique. Il ne lui a manqué, pour devenir une religion ou une philosophie universelle, que de parler au coeur et d'être intelligible au vulgaire. Les religions existantes durent composer avec elles, et elle prit d'assaut les systèmes philosophiques. Les autres méthodes divinatoires ne trouvèrent grâce devant ces raisonneurs superbes qu'en devenant astrologiques elles-mêmes : les influences sidérales furent réparties dans les entrailles des victimes, dans les caractères et les chiffres de la cléromancie, dans les cases du «temple» où les haruspices logeaient leurs foudres, etc. Les procédés naïfs qui se pliaient mal à ces exigences, comme la vieille ornithomancie, furent délaissés ou confinés dans les petites besognes que dédaignait la haute science. C'est qu'en effet, l'astrologie part d'une affirmation qui, étant donnée la conception antique de l'univers, paraissait bien vite indiscutable. La science moderne, en réduisant la Terre à n'être plus qu'un atome perdu dans l'espace, a discrédité les systèmes religieux ou philosophiques qui font converger vers elle et notre spèce toutes les actions cosmiques et toutes les attentions providentielles. Il n'en allait pas ainsi quand la Terre était le centre et l'appui de l'univers.
Les astrologues étaient d'accord avec le sens commun quand ils affirmaient que l'action des astres rangés autour de notre habitacle (êtres divins ou masses de feu subtil et vivifiant) se concentrait sur lui et ne pouvait manquer d'exercer sur tout ce qui s'y trouve une influence prépondérante. Ce principe était indémontrable, et par conséquent irréfutable. Le vice du raisonnement consistait à prétendre que l'on pouvait caractériser et mesurer l'influence en question. Mais la faiblesse de l'argumentation était ici dissimulée par la multiplicité des faits invoqués, des constatations expérimentales que les astrologues poursuivaient avec acharnement. Ils prenaient pour sujets d'expériences des existences déjà écoulées au besoin, celles des héros légendaires, et cherchaient à restituer «l'horoscope» de chacune d'elles, pour trouver ensuite dans la disposition des planètes et des signes les causes dont ils connaissaient déjà les effets. Leurs adversaires ne s'attaquaient pas volontiers aux principes ; ils ne leur objectaient que l'impossibilité de résoudre les problèmes posés, de tenir compte de toutes les influences concourantes et antagonistes, et ils prenaient par là le rôle désavantageux d'esprits vulgaires qui aiment mieux médire d'une science imparfaite que l'aider à se perfectionner.
Soutenue par tous les tenants du stoïcisme et du néo-platonisme, mollement attaquée par les sceptiques et mise à la mode par les persécutions du gouvernement impérial, l'astrologie était à l'apogée de son crédit quand elle entra en lutte avec le christianisme. Les docteurs chrétiens sentaient bien que le fatalisme astrologique allait à supprimer la Providence libre, mais, quand ils voulaient attaquer une science aussi cuirassée de certitude mathématique, ils se trouvaient à court de raisons. Clément d'Alexandrie se persuade que l'astrologie est véridique pour les païens, restés à l'état de nature, mais que la grâce du baptême fait passer les chrétiens sous le gouvernement de la Providence . Saint Ephrem ne peut admettre qu'un Dieu juste ait «établi des astres généthliaques, en vertu desquels les hommes deviendraient nécessairement pécheurs», mais il croyait au péché originel, qui rend aussi les hommes nécessairement pécheurs. Saint Augustin crut avoir réfuté les doctrines astrologiques, mais ses arguments techniques sont faibles, et sa doctrine sur le libre arbitre et la prédestination ne lui donnait pas le droit d'être sévère pour le fatalisme des «mathématiciens». En somme, le christianisme ne réussit pas à extirper l'astrologie, qui, proscrite comme instrument de divination, ne pouvait l'être comme science astronomique, et, pour bon nombre de chrétiens, les cieux, qui «racontent la gloire de Dieu», pouvaient bien aussi révéler ses desseins. - Morphoscopie astrologique (Chiromancie). - On a dit tout à l'heure que l'astrologie avait pénétré dans la plupart des autres méthodes divinatoires ; il en est quelques-unes qui lui appartiennent en propre. Dans les sciences compliquées, il se crée, à côté de la voie régulière, des sentiers de traverse, des procédés expéditifs qui abrègent la discussion des problèmes. Les astrologues se croyaient capables de restituer l'horoscope d'une existence commencée ou écoulée et d'en déduire à la manière ordinaire toutes les conséquences ; mais n'était-il pas plus simple de rechercher sur la personne du client les marques visibles des influences sidérales, et de raisonner sur ces causes secondes sans remonter aux premières ? On avait réparti entre les divers organes du corps humain, devenu un «microcosme», les influences planétaires et zodiacales ; il suffisait de les y étudier pour faire, à volonté, soit de la médecine astrologique, soit de la divination. Mais un pareil examen devait être difficile et risquait d'être importun : on pouvait abréger encore. Il suffisait de prendre pour objet de l'examen une partie maîtresse du corps. Le visage était tout indiqué pour cela, et la «métoposcopie» jouit d'une certaine faveur ; mais on trouva mieux. La main n'était-elle pas la cause, aux yeux d'Anaxagore, et, aux yeux d'Aristote, le signe de la supériorité intellectuelle de l'homme ? Sur la main, considérée comme le résumé du corps entier, un oeil exercé arrivait à saisir les traces des influences sidérales. Ainsi naquit la «chiroscopie» ou «chiromancie» astrologique, entée sur un art plus ancien et de prétention plus modeste, la morphoscopie (morphoskopia) ou physiognomonie (physiognômonia), qui tirait de l'examen du corps des inductions sur le caractère, et, par le caractère, sur la destinée.
La chiromancie est l'art de trouver dans la main les résultats des calculs qui, opérés sur le thème généthliaque, auraient mesuré la part de collaboration prise par chaque corps céleste à la destinée de l'individu observé. Pour simplifier, sans doute, la chiromancie ne s'occupait que des planètes ; elle assignait pour domicile à chacune un «mont» ou éminence correspondant autant que possible à la naissance d'un doigt, et appréciait le sens heureux ou défavorable, la direction, les combinaisons des influences, au moyen des lignes - lignes principales, secondaires, accidentelles - qui traversent, touchent et relient les domiciles planétaires. En appréciant la longueur, la profondeur, la couleur, les intersections et solutions de continuité des lignes, le chiromancien disposait d'un nombre de données suffisant pour deviner jusqu'aux détails et particularités de la destinée individuelle. - Divination arithmétique ou arithmomancie. - La chiromancie (détourne l'astrologie de son vrai chemin et ralentit son essor vers les abstractions mathématiques. Il y avait, au contraire, à côté de l'astrologie et jusqu'à un certain point solidaire de ses doctrines, une divination «mathématique» proprement dite qui spéculait uniquement sur les propriétés abstraites des nombres et planait pour ainsi dire au-dessus de la géométrie astrologique. Bien que les «mathématiciens» - astrologues et arithmétisants - fussent compris tous ensemble sous la dénomination populaire de «Chaldéens», la science ou divination mathématique proprement dite passait pour être venue de l'Egypte et avoir été importée en Grèce par Pythagore. Importée, mais non acclimatée, car elle n'a jamais eu de vogue qu'en Orient, aux mains des pythagorisants et, en dernier lieu, des gnostiques.
Il faut distinguer dans ces spéculations une partie générale, qui établit sur les principes une sorte de calcul des probabilités et ne s'applique qu'indirectement aux cas concrets. L'axiome premier, fourni ou accepté par les astrologues, est qu'il y a une puissance mystérieuse inhérente à certains nombres. Suivant les systèmes, la primauté s'attachait aux nombres 3 (comme contenant l'unité et la dualité, le plus petit nombre impair et le plus petit nombre pair), 7 (correspondant aux sept planètes), 9 (carré de 3). Avec ces nombres ou leurs multiples appliqués à la mesure du temps, on prétendait déterminer, dans la vie des individus ou des peuples, des époques ou des années de crise, dites «climatériques» (klimaktêres, klimaktêrikoi eniautoi). Ainsi, les partisans de la division septénaire considéraient comme climatériques les années correspondant au nombre 7 et à ses multiples ; les tenants des périodes novénaires raisonnaient de la même façon. Ceux-ci avaient l'avantage de rester dans la logique en plaçant la crise suprême d'une vie normale au carré de leur nombre premier, tandis que le carré de 7 donnait une limite évidemment inacceptable. Les éclectiques combinaient les divers systèmes pour leur donner plus de souplesse. On arrivait ainsi à distinguer parmi les années climatériques des époques particulièrement critiques correspondant aux produits de 7 par 3, de 9 par 3, de 7 par 9, ainsi qu'aux carrés de 7 et de 9.
S'il n'était pas difficile de plier nombre de faits à la doctrine des années climatériques, dont les médecins ne manquaient pas de faire usage pour établir leur pronostic, il n'était pas aussi aisé de la defendre sur un point important, qui lui valait de temps à autre des démentis. Comment une existence humaine pouvait-elle dépasser la limite extrême qui lui était assignée par les chiffres fatidiques ? Ceux qui croyaient le fait impossible reculaient la limite, ou en établissaient de différentes suivant les latitudes (klima) : les autres se contentaient de dire que, passé la limite, les individus oubliés par la mort ne comptaient plus parmi les vivants. La fixation d'un maximum pour la vie humaine avait une grande importance, parce que, suivant une théorie entrevue par les Grecs et développée par les haruspices toscans [Haruspices, Saeculum], ce laps de temps servait d'unité de mesure pour la vie des nations. Les Grecs n'arrivèrent pas à formuler un système, parce que les uns entendaient par «génération» (genea) la durée moyenne de la vie ; les autres, le temps nécessaire pour que le corps arrivé à sa maturité puisse se reproduire ; d'autres enfin, la plus longue durée possible de l'existence. Les haruspices entendaient par «siècle» (saeculum) la durée maximum de la vie, mais ils la supposaient variable, et, renonçant à la fixer une fois pour toutes, ils attendaient que des prodiges exceptionnels leur signalassent les époques où la fin d'un siècle ouvrait un siècle nouveau. Cette solution ingénieuse du problème ne pouvait évidemment être acceptée des astrologues et des mathématiciens.
Ces grands aperçus étaient comme des lois générales qui servaient à asseoir divers pronostics, mais ne se prêtaient guère à la divination usuelle, telle que l'exigeait la clientèle des devins. Les mathématiciens tirèrent plus de profit de leur divination arithmétique (arithmêtikê ou mathêmatikê) ou calcul des nombres premiers appliqué à la valeur numérique des noms. On a déjà vu, à propos du clédonisme grec et de l'omen latin, que les noms, considérés comme mots ayant un sens, ont une influence propre. Aux yeux du mathématicien astrologue, les noms contiennent en eux une fatalité immuable, qui réside dans leur valeur numérique. Il les décompose en lettres, qui sont en même temps des chiffres, et détermine par les nombres ainsi trouvés la vertu intrinsèque des noms. Dans les exemples dont nous disposons, cette vertu est estimée par voie de comparaison, c'est-à-dire ramenée à un rapport d'infériorité ou de supériorité vis-à-vis d'un nom rival. Ce rapport ne s'obtient pas par une simple addition des valeurs numériques attribuées aux lettres. Les mathématiciens se piquaient d'aller au fond des choses, et, pour eux, le «fond» (puthmên) d'un nombre se réduisait à la somme des unités de l'ordre le plus élevé que contînt ce nombre : unités simples, de 4 à 10 ; unités de dizaines, de 10 à 100 ; unités de centaines, de 100 à 1000. Il fallait donc additionner les fonds des nombres exprimés par les lettres et prendre pour valeur définitive du nom le fond du total. Certaines méthodes faisaient intervenir dans le calcul les nombres fatidiques 7 ou 9, et divisaient par l'un de ces nombres la somme des fonds, après quoi, le reste de la division - ou, à défaut de reste, le diviseur - était la valeur définitive du nom analysé. En opérant sur les noms des héros épiques, dont on connaissait bien la destinée, on avait trouvé les règles d'interprétation. Ainsi Hector, qui a pour dernier fond 1, a vaincu Patrocle, qui vaut 7. On en conclut que, de deux nombres impairs et inégaux, le plus faible est supérieur à l'autre. Sarpédon, qui vaut 2, ayant été tué par Patrocle, il est évident que, entre deux nombres inégaux, l'un pair, l'autre impair, le plus grand l'emporte. On avait découvert de la même façon que les nombres pairs et inégaux suivaient la règle des nombres impairs et inégaux, preuve admirable de la simplicité des lois du Destin. Entre nombres égaux, la règle paraît avoir été que l'agresseur l'emporte si les nombres sont impairs, et est battu dans le cas contraire. Il va sans dire que, une fois les règles établies, on avait imaginé toute espèce de procédés pour éliminer les exceptions, par exemple, en supprimant les lettres semblables ou doubles, assimilant entre elles les voyelles longues, évaluant différemment les voyelles, les demi-voyelles, les consonnes, changeant la valeur des lettres par recours à un autre système de numération, réduisant les mots à un anagramme.
Malgré tout, le procédé de comparaison entre deux noms propres n'offrait que des ressources limitées. On élargit le champ des prévisions en inventant l'équation arithmétique (isopsêphia). On arrivait ainsi à identifier un nom propre avec n'importe quel mot de valeur égale, par simple addition des lettres-chiffres composant l'un et l'autre mot. Il n'était même plus nécessaire de prendre pour point de départ cette valeur invariable du nom propre, qui forçait le calculateur à tourner en cercle autour de lui. La méthode se prêtait à l'interprétation de tous les signes imaginables. Un superstitieux avait-il rencontré une belette ? Le mathématicien pouvait lui prédire un procès, parce que les mots galê et dikê valent l'un et l'autre 42. On interprétait ainsi, à plus forte raison, les paroles ominales, les chiffres et les phrases de la méthode cléromantique ; c'était une main-mise des mathématiques sur la divination tout entière.
L'astrologie et les mathématiques nous ont amenés aux confins extrêmes de la divination inductive, ou plutôt hors de la divination proprement dite. Il n'y a plus là de commerce intellectuel avec la divinité vivante, plus de révélation dispensée à propos par un être supérieur pour permettre à l'homme de modifier avantageusement un avenir conditionnel, mais une sorte de science fataliste, qui se passe du concours divin et ne peut être utile qu'à la condition de demander à la magie les moyens de lutter contre le Destin lui-même. Cette science ne prétend plus seulement interpréter des signes, mais pénétrer jusqu'aux causes premières. Elle a pu faire admirer et craindre ses arcanes dans le monde méditerranéen, mais elle y a gardé son caractère exotique et n'a pu s'harmoniser avec les religions populaires. L'étude de la divination intuitive va nous ramener au point de départ, au colloque entre l'homme qui a besoin de révélation et la divinité qui la lui envoie.
- Astrologie. - On entre dans un tout autre ordre d'idées avec l'astrologie judiciaire ou apotélesmatique. Ici, on ne cherche plus à entrer en communication avec un être supérieur, dont la bienveillance puisse révéler en temps utile les moyens d'échapper à une éventualité provisoire et conditionnelle. C'est le Destin lui-même que l'astrologue a la prétention de surprendre dans son laboratoire, sans autre aide ni intermédiaire que la logique irrésistible de la science des nombres. Dans ce royaume de la Nécessité, il n'y a plus de volontés libres que la prière ou des satisfactions offertes en temps opportun puissent fléchir ; les artisans de la destinée sont des forces qu'on peut croire indifféremment intelligentes ou aveugles, mais dont l'action n'est dirigée que par les lois fatales des mathématiques. L'astrologie avait donc l'ambition de remonter jusqu'aux causes premières et universelles et d'en déduire les conséquences applicables aux cas particuliers : mais ni les causes ni la chaîne qui les relie aux conséquences n'offrant de prise à l'ingérence des intéressés, cette science, qui fondait la certitude de ses déductions sur l'inflexibilité des lois cosmiques, devait d'autant plus renoncer à modifier l'avenir qu'elle croyait le connaître plus sûrement. Les clients de l'astrologie devaient s'assimiler la foi et la résignation des stoïciens, qui, adeptes zélés de la divination, ne voyaient en elle qu'un moyen d'adhérer par avance et en connaissance de cause aux décrets de la providence.
DIVINATION INTUITIVE
L'induction divinatoire a à lutter contre deux causes d'erreurs ; la difficulté de distinguer les signes fatidiques des incidents ordinaires, et la difficulté d'interpréter ces signes qui cachent la pensée divine sous une forme symbolique. On pouvait concevoir la révélation arrivant directement à l'âme sans l'aide des signes extérieurs et prenant pour véhicule le langage humain. Tel a été le but poursuivi, sinon atteint en toutes circonstances, par les méthodes de la divination intuitive. Les stoïciens, nous l'avons dit, appelaient celle-ci spontanée ou naturelle (atechnos, adidaktos, naturalis), parce que l'âme y joue le rôle passif et souvent inconscient d'instrument récepteur.
On a déjà fait observer que l'interprétation des signes symboliques reposait sur des règles que l'on croyait avoir été révélées à l'origine aux grands initiateurs de l'âge héroïque. Logiquement, la révélation directe précède et garantit l'autre ; mais, bien que les héros d'Homère aient parfois des accès de clairvoyance ou même d'«inspiration» surnaturelle et que les songes aient été considérés de tout temps comme une source de révélation, on peut dire que la divination intuitive n'a commencé à devenir populaire que quand sa rivale était déjà en pleine décadence. L'activité que celle-ci exige de l'esprit convenait mieux au tempérament des Occidentaux ; l'autre dut son succès à des causes multiples, dont la principale est l'invasion des cultes orientaux.
- Divination par les songes ou oniromancie
La différence entre l'induction et l'intuition n'est pas si tranchée qu'il n'y ait place entre les deux pour un procédé mixte, où le raisonnement élabore les données fournies par révélation directe. Tel est le rôle de l'oniromancie ou divination par les songes (oneiromanteia), méthode encyclopédique et cosmopolite qui, en ce qui concerne l'observation des songes (oneiroskopia), accepte tous les principes de la divination intuitive, et, pour l'interprétation (oneirokritikê), reprend à son compte tous les procédés de la divination inductive
La mythologie grecque faisait des songes un peuple léger d'ombres enfantées par la Nuit ou la Terre, confinées durant le jour dans les régions ténébreuses de l'Erèbe et servant d'intermédiaires entre les hommes et les divinités chthoniennes. L'espèce d'orthodoxie imposée par la prédominance de la religion «olympienne» déposséda pour ainsi dire les divinités chthoniennes de leur privilège et mit les songes au service de Zeus. On supposait donc que ceux-ci sortaient de leur domaine à l'appel ou avec la permission de Zeus, sous la conduite d'Hermès oniropompe [Mercurius]. Véridiques ou trompeurs au gré du dieu qui les envoie, les Songes envahissent l'âme enchaînée par le sommeil et la bercent d'invincibles illusions. Les philosophes et les médecins avaient essayé de faire dans le phénomène du rêve la part des influences physiologiques et même des préoccupations de l'âme, ne reconnaissant pour «messagers des dieux» que les songes dont l'état du corps ou les passions de l'âme ne suffisaient pas à rendre raison. La divination oniromantique s'accommodait de toutes les théories. La distinction entre les songes naturels (enupnia, oneiroi phusikoi) et les songes envoyés par les dieux (theopemptoi, theopneustoi), loin d'être un embarras, était une ressource précieuse qui dispensait de recourir à la théologie naïve d'Homère, ou à ses portes de corne et d'ivoire, et expliquait d'une façon satisfaisante des insuccès dont la méthode n'était plus responsable. Tous les songes révélateurs étaient véridiques ; seulement, il fallait se garder de confondre avec eux les simples rêves. La tâche du devin onirocritique en devenait plus difficile sans doute, mais la difficulté rehaussait le prestige d'un art que certains délicats trouvaient trop simple et trop vulgaire.
Si les dispositions du corps ou de l'âme peuvent provoquer des songes naturels, elles ne sauraient être sans action sur les songes fatidiques. Pour que ceux-ci arrivent inaltérés à l'intelligence, il faut que le corps soit inerte et l'âme passive. Aussi y avait-il comme une hygiène des songeurs, un choix des aliments, des attitudes, et aussi des saisons et des heures. Au lieu d'attendre simplement les songes, on pouvait aussi les solliciter par la prière, les provoquer ou même en envoyer à d'autres personnes au moyen de recettes et de formules magiques. Sans faire intervenir la magie orientale, ceux qui avaient besoin de révélation pouvaient aller dormir dans des lieux particulièrement hantés par les songes, tombeaux de héros, temples de divinités «iatromantiques», devenus, par suite de ce privilège, autant d'oracles. C'est ce qu'on appelait l'incubation (egkoimêsis, incubatio), pratique qui tient une si grande place dans l'histoire de la médecine sacerdotale chez tous les peuples de l'antiquité [Aesculapius, Incubatio, Oraculum]. L'incubation avait sur le songe spontané l'avantage de faire connaître l'auteur et de préciser l'objet de la révélation demandée. Le songe pouvait donner d'emblée la révélation en langage humain, mais c'était là le cas le plus rare, et les paroles ainsi entendues étaient plus rarement encore exemptes d'obscurités. Le songe est ordinairement symbolique, et le nombre des symboles dont il dispose est illimité. Il y faut faire entrer tous les signes qu'interprètent les diverses méthodes de la divination inductive et tous les «prodiges» qui peuvent s'ajouter ou se substituer aux signes ordinaires. Le monde des rêves est peuplé de prodiges qui dépassent en incohérence les miracles les plus invraisemblables observés sur des réalités. Qu'on ajoute à toutes ces énigmes les formes de révélation propres à la divination intuitive en général et à l'oniromancie en particulier, l'interminable chapitre des allusions et allégories mythologiques, historiques, tous les caprices des réminiscences, toutes les associations d'idées rapprochées par le fil ténu et flottant du rêve, et l'on se fera une idée de l'ample matière sur laquelle s'exerce la sagacité du devin onirocritique. Aussi, en dépit des livres écrits sur la matière, depuis les tableaux et manuels (pinakia oneirokritika, pinakes agurtikoi, technai oneirocritikai) dont se servaient les devins de carrefour jusqu'aux traités en forme, comme celui d'Artémidore de Daldis, l'art d'interpréter les songes ne put être soumis à des règles précises, et le talent du devin consistait surtout à savoir improviser d'ingénieuses conjectures. En tout cas, les praticiens donnaient des classifications, qui sont comme la rhétorique du métier.
Etant donné un songe à interpréter, le devin le soumet à un examen préalable pour décider si c'est un simple rêve (enupnion) ou un songe révélateur (oneiros). Si le songe a été demandé par la prière (oneiroi aitêtikoi) ou obtenu par voie d'incubation, le diagnostic est facile ; autrement, il reste, quoi qu'on fasse, absolument arbitraire. Cette première difficulté surmontée, il faut se demander si le songe contient une révélation directe, c'est-à-dire une représentation visible (orama, visio) ou une désignation orale (chrêmatismos, oraculum) de l'événement futur ; auquel cas, on a affaire à un songe théorématique (theôrêmatikos), qui s'interprète sans effort et se réalise à brève échéance. C'est autour du songe allégorique (allêgorikos) que le devin déploie toutes les ressources de son art. Il doit d'abord déterminer à qui le songe s'adresse. On ne rêve pas que pour soi. Il y a des songes qui visent le songeur lui-même ou les personnes de sa famille (idia, propria) ; il en est d'autres qui concernent des personnes simplement connues de lui (allotria, aliena) ou des individus quelconques (koina, communia) ; d'autres enfin qui éclairent l'avenir de l'Etat (dêmosia) ou du Inonde entier (kosmika). L'adresse du songe se devine aux personnes ou objets mis en scène. Alors commence l'interprétation proprement dite. La manière la plus sûre d'interpréter les songes était de leur trouver des précédents connus et vérifiés ; aussi les traités d'onirocritique étaient avant tout des recueils d'exemples et des vocabulaires donnant la traduction de tous les symboles observés. Du reste, le devin profilait largement de l'expérience acquise par l'exercice des autres méthodes divinatoires, car les symboles avaient ou pouvaient avoir le même sens dans le songe que dans l'état de veille. Cependant, cette exégèse empirique n'était pas toujours possible, et le devin devait être capable de résoudre un problème sans précédents.
Avec l'habitude de l'allégorie et la connaissance des équivalents symboliques, on avait assez vite fait d'établir un rapport entre le signe et la chose signifiée. Mais il fallait tenir compte de toutes les circonstances qui pouvaient modifier la «qualité» et la «quantité» de ce rapport, circonstances inhérentes à la personne du songeur, à ses habitudes, sa profession, ses préoccupations, son âge, sa nationalité, etc. Suivant la «qualité» du songe, le rapport entre le signe et la chose signifiée peut être direct ou inverse, c'est-à-dire qu'un songe heureux par lui-même (kata to entos) peut être heureux ou malheureux dans son effet (kata to ektos), selon qu'il est en accord ou en antagonisme avec les circonstances qui constituent le milieu normal où vit le songeur. Ces circonstances, dont certains praticiens avaient dénombré jusqu'à 250, se ramènent à six éléments principaux (stoicheia) : la nature (phusis), la loi (nomos), la coutume (ethos), la profession (technê), le nom (onoma) et le temps (chronos). Pour les devins expéditifs, la nature de l'impression éprouvée par le songeur tenait lieu de toutes ces analyses. De même, le rapport de «quantité» peut être direct ou inverse, c'est-à-dire qu'un songe très compliqué (à supposer qu'il ne soit pas composé de parties qui doivent être interprétées isolément) (susthetos) et contenir beaucoup (polla dia pollôn) ou peu (oliga dia pollôn) de présages, de même qu'un songe très simple peut n'avoir qu'un sens restreint (oliga di'oligôn) ou faire allusion à des événements complexes (polla di'oligôn). Voilà comment le même songe devait être interprété diversement suivant les personnes, ou, s'il était revu plusieurs fois par la même personne, suivant les circonstances. Un homme rêve qu'il est décapité : mauvais présage d'ordinaire ; mais si cet homme est sous le coup d'une accusation capitale, le présage est heureux, parce qu'on n'est pas décapité deux fois. Celui-ci rêve qu'il perd son nez : on pourrait lui prédire qu'il sera bientôt déshonoré ou mort ; mais si c'est un parfumeur, il en sera quitte pour fermer boutique. Tel autre voit en songe un arc en-ciel : ce symbole présage un changement de temps, changement heureux si le songeur est dans la misère, malheureux s'il a lieu d'être satisfait de sa situation.
L'oniromancie repose sur une croyance si générale qu'elle a survécu à toutes ses déceptions. En Grèce, elle se défendit de son mieux contre les entreprises de la magie, qui prétendait procurer à volonté des songes heureux ou malheureux et détourner l'effet des songes funestes, comme elle résista aux injonctions de l'astrologie, qui voulait faire dépendre de ses combinaisons astrales la valeur et la véracité des songes. Les oracles médicaux, dirigés par des sacerdoces puissants, l'aidèrent à conserver son autonomie. On se fatiguerait à compter les dédicaces effectuées kat'onar, divo monitu, pour attester l'efficacité de ce genre de révélation. Du reste, si quelques sceptiques cherchaient à la discréditer, nul ne pouvait la mettre en interdit : elle échappait par sa nature même aux proscriptions qui atteignirent d'autres genres de divination plus bruyants et moins inoffensifs.
- Nécromancie
La divination par les songes confine pourtant et se rattache par des liens étroits à une méthode divinatoire dont le nom seul éveille de fâcheux souvenirs, la «nécromancie» (nekuomanteia, nekromanteia, psychomanteia, skiomanteia) ou révélation apportée par les ombres des morts. Celle-ci, qu'on disait importée de Perse et étudiée par Pythagore, repose sur les mêmes principes que l'oniromancie. On a vu qu'à l'origine, avant qu'une psychologie plus raffinée eût réduit les songes à n'être plus que des émotions de l'âme, on leur prêtait une réalité substantielle et une personnalité distincte de celle du songeur. Entre ces êtres impalpables, hôtes des régions souterraines, et les ombres des morts, il n'y a pas de différence spécifique : celles-ci, si la main des dieux ou la puissance des évocations magiques leur ouvre leur prison, peuvent jouer le même rôle que leurs congénères. L'épopée et le drame sont remplis d'apparitions nocturnes qui tantôt se comportent comme le songe, tantôt éveillent leur interlocuteur et se laissent entrevoir en fuyant, tantôt persistent dans une hallucination qui continue le rêve. Le procédé oniromantique de l'incubation a été d'abord pratiqué sur les tombeaux, et c'était bien l'ombre du mort que le croyant s'attendait à voir en songe.
Ainsi les premiers essais de la nécromancie appartiennent à la méthode oniromantique ; c'est à celle-ci qu'il faut adjuger toutes les apparitions d'ombres ou âmes survenues spontanément et pendant le sommeil. La nécromancie proprement dite commence aux «évocations» magiques (psychagôgia) qui suppriment l'un et l'autre de ces deux caractères, la spontanéité chez l'ombre, le sommeil chez le consultant.
Les progrès de la nécromancie ont suivi ceux des doctrines mystiques et magiques dont elle n'est qu'une application et une vérification. La foi en la survivance de l'âme a passé par les mêmes phases chez tous les peuples. Réservée d'abord aux héros, aux rois, aux hommes de race divine, l'immortalité a cessé peu à peu d'être un privilège aristocratique pour devenir la destinée commune de tous les humains. Abstraction faite des idées confuses que l'on retrouve au fond des cultes privés, ce spiritualisme démocratique a prévalu assez tard en Grèce, où l'on savait mettre à profit la vie terrestre et s'en contenter. Il y avait bien des siècles que tous les Egyptiens devenaient après leur mort des Osiris, lorsque les Grecs s'habituèrent à faire de tous leurs défunts des «héros». Ils s'accoutumèrent plus malaisément encore à considérer les âmes des morts (qui errent dans l'enfer homérique à l'état de formes vides, dénuées d'intelligence et de mémoire) comme dotées de prescience et informées des arrêts du Destin. Mais la croyance à l'immortalité de l'âme finit par imposer ses conséquences logiques ; les ombres mornes d'autrefois devinrent des «génies» puissants, actifs, passionnés, serviables à leurs amis, dangereux pour qui ne savait point les apaiser.
La divination nécromantique, toujours confinée dans un cercle restreint d'adeptes, ressentit l'influence de ces théories diverses. Au temps où l'âme passait pour être enfermée dans le tombeau, c'est là qu'il fallait aller la chercher. Quand les morts eurent une patrie commune, et c'est déjà le cas dans l'Odyssée, il se créa des oracles nécromantiques (nekuomanteia, psychopompeia), aux lieux qui passaient pour être des soupiraux d'enfer (Plutonia, Charonia), au lac Aornos en Thesprotie et au lac Averne, près de Misène, à Héraclée de Thrace, à Phigalie en Arcadie, au Ténare [Oraculum]. Enfin les ombres purent être évoquées en tous lieux.
De quelle façon les nécromants réussissaient-ils à produire l'hallucination qui devait résulter de leurs lugubres expériences (teletai, mustêria, inferna sacra) ? C'est une question qu'il faut renvoyer à l'histoire de la magie [Magia]. Ils prétendaient attirer les âmes par des libations et mixtures étranges versées dans une fosse, surtout par l'effusion du sang ; méthode vulgarisée par la fameuse «nécromancie» de l'Odyssée, qu'on trouve reproduite sur les monuments figurés.
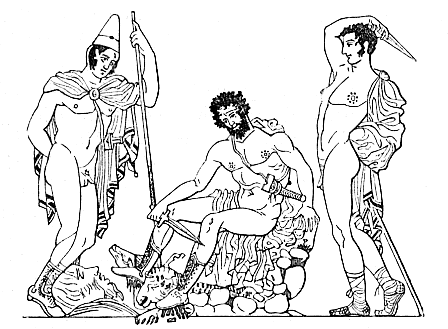
Il y avait des ombres dont la soif homicide exigeait du sang humain, et on parle souvent d'enfants égorgés dans ces affreux mystères. L'évocation d'une ombre sans son corps n'est pas le tout de l'art nécromantique ; si le magicien avait en sa possession le cadavre qu'elle avait quitté, il la forçait à y rentrer et savait arracher des révélations à l'individu momentanément ressuscité. L'opération réussissait d'autant mieux que la mort était plus récente. De là des violations de sépulture, ou encore des meurtres consommés dans le but d'appréhender l'âme au sortir de sa demeure. - Divination magique
La nécromancie, dont l'imagination populaire a dû sans doute grossir les méfaits, avait à sa disposition des procédés moins effrayants. Elle sut, comme le spiritisme moderne, flatter la curiosité sans terrifier ses clients. Le bassin hydromantique, dont il a déjà été question (cf. lekanomanteia) et que nous sommes exposés à rencontrer encore plus loin, était une mine inépuisable d'illusions. On y voyait défiler, au gré du magicien, des ombres, des génies, des dieux même. Le bassin pouvait être remplacé par un miroir (katoptromanteia), une glace (krustallomanteia), ou par d'autres artifices dont l'oeil des sceptiques a su parfois surprendre le secret, figures phosphorescentes dessinées sur les murs, pièces inflammables enlevées en l'air par un oiseau, etc. Tantôt ces fantômes prennent eux-mêmes la parole, ou un ventriloque la prend à leur place (eggastromantis) ; tantôt leur vue provoque chez quelque assistant un accès de délire prophétique. Une peinture de Pompéi paraît reproduire quelque épisode de cette nature. Panolka y voit Cassandre prophétisant devant Priam au cours d'un accès d'enthousiasme provoqué par un procédé hydromantique.
Nous allons à la dérive vers l'amas confus des superstitions magiques qui n'ont avec la divination que des rapports accidentels, mais serviront à expliquer la foi des Grecs à l'«enthousiasme». Comme on évoquait les âmes des morts, on invitait ou forçait à comparaitre les génies et les dieux. Bien avant que les néoplatoniciens ne pratiquassent leur fameuse «théurgie», le vieux Numa avait obligé Picus et Faunus à lui enseigner les moyens de faire descendre en terre Jupiter Elicius, opération qui coûta la vie à Tullus Hostilius. Orphée, Mélampus, Musée, Epiménide, les Dactyles de l'Ida, passaient pour avoir initié les Grecs à cet art de provoquer des entrevues avec les dieux, qui se montraient d'eux-mêmes aux héros d'autrefois. Les théurges, qui se croyaient bien différents des goêtai ou artisans de maléfices, avaient introduit dans ce commerce surnaturel une étiquette savante. Pour communiquer avec les néophytes du premier degré, les dieux entraient, à la mode égyptienne, dans des statues qui s'animaient ainsi et prophétisaient ; ils «possédaient» de la même façon des personnes vivantes (docheis, catabolici), pour se faire entendre des disciples du second degré. Les initiés au troisième degré voyaient pour ainsi dire les dieux par les yeux d'un théurge parfait qui les appelait à leur intention (klêtôr) : celui-ci, «devenu dieu» pour un instant, contemplait face à face (autopsia, klêsis autoptikê) ses hôtes divins, et même, de temps à autre, le dieu suprême. On cite parmi les divinités le plus souvent évoquées cette Hécate vagabonde qui apparaissait d'elle-même au clair de lune dans les carrefours. Les «oracles d'Hécate» occupaient une assez grande place dans la collection de textes révélés sur laquelle Porphyre comptait appuyer sa religion philosophique ou «théosophie».
Il est inutile d'établir des catégories dans ce chaos de fantaisies délirantes ; qu'il s'agisse d'ombres, de têtes ou de statues animées, de démons, de dieux, c'est toujours le même but, le contact avec le monde invisible, atteint par des moyens analogues, et nous pouvons considérer tous ces procédés magiques comme des variantes de la nécromancie, comprises plus tard sous la dénomination dérivée de «magie noire». Il nous faut maintenant revenir en arrière, vers une époque plus reculée et des conceptions moins extravagantes, pour étudier la divinat intuitive telle qu'elle s'est développée chez les peuples de l'antiquité classique, avant que l'intrusion de la magie orientale n'eût chassé de partout le sens commun. - Divination par enthousiasme ou chresmologie
Que les dieux aient pu frayer avec certains mortels privilégiés, surtout avec ceux dont ils voulaient faire les instituteurs de notre espèce, et qu'ils leur aient révélé en langage humain ce qu'ils jugeaient nécessaire de leur apprendre, c'est là une idée commune à tous les peuples et familière surtout à l'antiquité hellénique. En Grèce, l'anthropomorphisme supprimait toute entrave à ce commerce et lui ôtait pour ainsi dire son caractère merveilleux. On n'était pas embarrassé de concevoir comment Triptolème avait été instruit par Déméter, Erechthée par Athéné, Minos par Zeus, qui lui accordait une entrevue secrète tous les neuf ans ; comment Mélampus, Tirésias, Calchas, avaient appris des dieux les règles de la divination inductive. Mais l'anthropomorphisme, apothéose de l'homme, est bien près d'être la négation du divin : il dénote un affaiblissement marqué du sentiment religieux, qui a sa réserve et son aliment dans l'inintelligible. Au lieu de sentir partout la présence invisible des dieux, l'Hellène n'eut plus que des divinités concrètes, bourgeoisement logées dans des temples, qui pouvaient se promener par le monde et s'y montrer de temps à autre, mais ne le remplissaient pas de leur ubiquité substantielle. Il faut remonter plus haut pour rencontrer, sur le sol de la Grèce et de l'Italie, des idées religieuses plus fécondes, dont la vertu et les effets ont résisté à l'action stérilisante de l'anthropomorphisme.
Le fond des religions pélasgiques, si l'on entend par Pélasges les ancêtres ou prédécesseurs des Grecs et des Romains, était l'animisme, qui voit dans tous les phénomènes de la nature l'action de forces occultes, inséparables ou séparables, mais toujours distinctes des corps qu'elles meuvent. Ces esprits de la Nature peuvent se manifester à l'état de souffles, de «voix» (ossa, omphê, audê theou, phêmê theôn, vox, monitum) perçues soit par l'intermédiaire de l'oreille, soit directement, avec l'énergie d'une parole intérieure qui prend l'âme d'assaut. Les légendes romaines parlent fréquemment de ces voix, émanées le plus souvent des génies de la solitude, de Picus, de Faunus, de Silvanus et de leurs congénères. Les Grecs attribuaient au dieu pélasgique Pan, qui se survivait dans leur mythologie, le même rôle que les Latins à Faunus ; l'un et l'autre instruisent ou épouvantent à leur gré les mortels. L'oracle pélasgique de Dodone [Oraculum] n'était sans doute à l'origine qu'une forêt dans laquelle retentissait la voix du grand Zeus, apportée par le vent et l'orage. Même à l'époque historique, les Hellènes avaient encore l'habitude d'attribuer à Zeus, surnommé pour cette raison panomphaios, les voix intérieures ou pressentiments qui, sans origine connue, répandaient avec la rapidité de l'éclair la nouvelle d'un événement considérable.
Nous entrons ainsi, par une transition insensible, dans la divination par enthousiasme ou «chresmologie» (chrêsmologia, mantikê entheos, enthousiastikê, tehspiôdos, vaticinatio, divinatio per furorem). Ce souffle divin ou voix intérieure peut prendre tous les degrés d'intensité, depuis la sollicitation indistincte qui constitue le pressentiment et que le sujet peut confondre avec sa propre pensée, la poussée déjà plus vive qui lui fait proférer des paroles ominales, l'inspiration qui s'exhale en prophéties (chrêsmoi, logia, manteiai, manteumata, prophanta, theopropia, epithesmismoi, thesphata, tehspismata), jusqu'à la «possession» complète qui s'empare de l'âme et du corps et annihile l'initiative individuelle.
Chez les peuples italiques, dont les religions sont restées pauvres d'idées et dépourvues - autant qu'on en peut juger - de l'appui des corporations sacerdotales, les principes que l'on vient d'énoncer n'ont pas produit toutes leurs conséquences. Les «voix» extérieures se sont tues, et les voix intérieures se sont réfugiées dans le songe et les révélations capricieuses de la divination ominale. Les «oracles de Faunus» et les colloques avec les Lymphes (Nymphes) ne s'obtenaient guère que par voie d'incubation. Si les dieux italiotes avaient besoin d'un instrument, ils le prenaient de préférence parmi les animaux, qu'ils obligeaient non seulement à fournir les «présages» dont s'occupe la divination inductive, mais même à parler. Il serait imprudent de prendre à la lettre l'expression de Denys d'Halicarnasse et d'affirmer que le pivert de Mars prophétisait en langage humain à Tiora Matiene mais on rencontre à plusieurs reprises dans les annales de Rome la mention : bos locuta est. En Grèce, les religions primitives, sans se laisser complètement défigurer par l'anthropomorphisme, apprennent de lui à ne plus voir dans la Nature, à côté du divin, que l'homme, et à concentrer sur lui toute l'attention des dieux. C'est l'âme humaine que vont assaillir, ébranler, enivrer, les souffles émanés des espaces célestes, et surtout ceux qui sortent avec les sources vives du sein de la terre, réceptacle de toutes les forces cosmiques. Nous ignorons le détail des rites archaïques de Dodone, et l'on ne saurait dire de quelle façon les «voix» de Zeus sont devenues des frémissements et des murmures inspirant les prêtresses de Dioné [Peleiades] ; mais il est question dans une foule de légendes du pouvoir occulte des Nymphes et du délire qui s'emparait soudain de ceux qui venaient se désaltérer à leurs sources (numpholêptoi, lymphatici). Ce n'était point le caprice amoureux qu'auraient pu éveiller les gracieuses jouvencelles de la mythologie hellénisante, mais bien une «fureur» inconsciente, une frénésie qui pouvait élever l'âme jusqu'à la seconde vue ou la dégrader jusqu'à la folie. Les plus révérées de ces Nymphes, les Muses de Piérie ou de l'Hélicon, celles qui révèlent à leurs favoris «ce qui a été, ce qui est, ce qui doit être», font partie des plus anciens mythes helléniques ; l'anthropomorphisme n'a pu que les reléguer hors du monde réel et transformer leur intervention en figure de rhétorique. Les poètes, ces très raisonnables «nourrissons des Muses», firent oublier les enthousiastes obscurs, monomanes, déments hallucinés, épileptiques, que «possédaient» des nymphes moins lettrées ; et ce n'est que plus tard que l'imagination grecque en veine de mysticisme improvisa avec ces vieux souvenirs les types légendaires de Bacis et de Musée.
L'enthousiasme puisé aux sources hantées par les Nymphes serait resté sans doute à l'état de manifestation accidentelle de l'éréthisme nerveux, de «nymphomanie» au sens récent du mot, et n'aurait ajouté qu'un appoint insignifiant à la masse des superstitions populaires, sans le concours de circonstances qui lui ouvrit à Delphes une issue et comme un débit régulier, garanti, contrôlé, adapté enfin aux exigences de l'esprit national. Les Hellènes voulaient de l'ordre et de la mesure jusque dans le merveilleux, sans trop se demander si le merveilleux n'est pas incompatible avec la discipline qui le rend intelligible. Le Parnasse a été le lieu privilégié où le «délire des Nymphes» est devenu, à la suite de vicissitudes curieuses et sous un autre nom, un instrument officiel de révélation. C'est là le berceau de la «chresmologie» hellénique, qui, inconnue d'Homère et même des Homérides, a déjà un air d'antiquité quand elle apparaît dans l'histoire à l'état de monopole accaparé par les prêtres d'Apollon, seul et unique «prophète de Zeus».
Quand on analyse les légendes et les cultes groupés au «seuil de l'âpre Pytho», on distingue aisément plusieurs couches superposées dont on ne peut déterminer que par conjecture l'âge relatif. Celle qui recouvre et cache à demi toutes les autres doit être la plus récente. Si Apollon avait pris le premier possession de Pytho, on peut être assuré que ses prêtres n'y auraient point toléré l'intrusion d'autres souvenirs. Or, il y restait des traces et un culte de Poseidon, pourvu de rites divinatoires ; on y rencontrait Dionysos associé avec Apollon presque sur le pied d'égalité, et enfin, rattaché par un tissu de légendes aux faits et gestes des deux fils de Zeus, le culte des Nymphes, greffé lui-même sur le culte pélasgique de la Terre (Gaea ou Thémis).
Dans cette recherche des origines de la révélation chresmologique, on peut tout d'abord éliminer le culte de Poseidon, apporté là, comme le culte apollinien, par les marins de l'Ionie et de la Crète. Poseidon n'est pas un dieu prophétique ; ses prêtres n'usaient que des procédés les plus simples de la divination inductive, et sa domination a presque étouffé les «voix» fatidiques de la mer, celles de Téthys, de Glaucos, des Néréides. Le culte d'Apollon a pu discipliner l'enthousiasme révélateur, mais non le créer. Rien dans les légendes qui concernent le dieu lycien, fils de Léto, n'indique qu'il ait eu prise directement sur l'âme humaine. Il voit de loin et atteint de même, mais il ne frappe que les corps ; c'est la mort, et non le délire ou la folie, qu'apportent ses inévitables traits. Isolé comme l'astre qu'il personnifie, il ne fraye volontiers ni avec les hommes ni avec les divinités des sources vives ; c'est pourquoi ses ardeurs, amour ou colère, sont toujours funestes. Les Nymphes n'ont jamais été pour lui qu'un cortège d'emprunt.
Il n'en est pas de même de Dionysos, fils de la Terre et compagnon inséparable des Nymphes, des Hyades qui l'ont élevé, des Thyiades ou Ménades qui dansent autour de lui des rondes échevelées, des Muses mêmes, qui ont comme lui pour berceau la Thrace, pour demeures préférées les sommets de l'Hélicon et du Parnasse. Celui-ci [Bacchus] propage autour de lui l'exaltation mentale qui le caractérise, lui et son entourage, et qui devient allégresse bruyante chez ses amis, folie furieuse chez ses ennemis. Ivresse bachique, nymphomanie, enthousiasme prophétique, ne sont que des modes et comme des tonalités diverses d'une même vibration intérieure, la mania, qui dérange l'équilibre de l'intelligence et la soustrait à la direction de la volonté. C'est, à n'en pas douter, du culte dionysiaque associé à celui des nymphes ou sources locales que procède le délire des pythies de Delphes. A quelque système que l'on s'arrête concernant les origines de Dionysos, il est certain que son culte en Grèce est de beaucoup antérieur à la vogue dont il jouit, grâce au développement de l'orphisme, à partir du VIIe siècle avant notre ère. Il est non moins attesté qu'après la Thrace, où il s'identifiait avec son congénère phrygien Sabazios, après la Béotie, où les légendes locales le faisaient naître, le Parnasse était le principal centre de son culte. L'antre Corycien était plein de ses souvenirs ; on cite une Pytho parmi les Hyades ses nourrices ; on montrait son tombeau dans le temple de Delphes, sous l'«omphalos», non loin du trépied mantique ; il avait à Delphes ses servante, les Thyiades, qui représentaient ses nymphes préférées et célébraient tous les neuf ans, sans préjudice des «orgies» annuelles, la fête de l'heroïs en l'honneur de Sémélé ramenée des enfers par son fils Dionysos. Il n'en faut pas tant pour faire présumer qu'à Delphes, le «Zeus de Nysa» n'était pas un hôte de rencontre hébergé par Apollon, mais un premier occupant que celui-ci n'avait pu déposséder.
Ceci posé, on s'explique sans trop de difficulté, et surtout sans contradiction avec les caractères connus des types divins mis en cause, la genèse de l'oracle pythique, qui se confond avec l'avènement historique de la divination intuitive. Lorsque le culte d'Apollon fut, après celui de Poseidon et par la même voie, importé sur la plage de Crisa, le Parnasse était occupé par les divinités chthoniennes chères aux Pélasges, Gaea, les nymphes ses filles, et ce fils que les Hellènes connurent sous le nom de Zeus de Nysa (Dionysos). Peut-être se souvenait-on encore du temps où l'on sacrifiait sur la cime à l'époux de Gaea, dieu de la lumière (Zeus Lycios). Il est question d'une Lycoreia bâtie jadis dans la montagne au-dessus de Delphes par Deucalion, et on retrouve les descendants des Pélasges dans les Dryopes qui habitaient le versant du nord. Sur l'un et l'autre versant, à Amphicaea et à Pytho, Zeus et les divinités chthoniennes rendaient des oracles par des procédés analogues à ceux de Dodone. Une grotte, une source, un arbre baigné par les eaux vives et offrant ses rameaux aux souffles célestes, c'en était assez pour recueillir et fixer l'inspiration prophétique, qui se communiquait à l'âme, soit pendant le sommeil, par voie «d'incubation», soit à l'état de veille, par des «voix» (omphê, phêmê) ou par exaltation nymphomanique. On peut croire que ce dernier mode de révélation était le plus goûté des adorateurs de Dionysos, qui le premier, dit un scoliaste, «monta sur le trépied prophétique de Pytho pour y révéler l'avenir». Le monument ci-joint, où l'on voit le trépied associé à une scène d'orgie dionysiaque, vient à l'appui de la tradition recueillie par le scoliaste.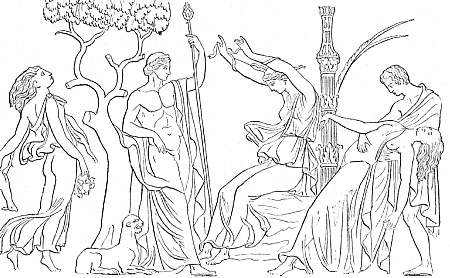
Que l'on suppose maintenant, d'accord avec le sens général des légendes, Apollon installé comme «Delphinien» sur le rivage du golfe et supplantant sous ce vocable Poseidon, puis mis en possession de Pytho par la conquête dorienne, il a dû nécessairement se faire une sorte de compromis entre les cultes rivaux. Ce qui faisait le prix de Pytho, c'était précisément le privilège attaché aux sources de Telphuse, de Castalie ou de Cassotis, et qui prédestinait ce lieu à être «l'oracle des hommes». Ce privilège fut désormais attribué à Apollon, et les prêtres du nouvel occupant s'efforcèrent de faire oublier que l'oracle avait pu avoir d'autres maîtres. Dans la tradition courante, Apollon en est le fondateur ; mais cette tradition ne saurait rendre compte ni des motifs qui conduisirent le dieu à Pytho, ni du rôle essentiel et prépondérant que jouent dans le fonctionnement de l'oracle la source et les extases de la Pythie. La Pythie est une bacchante ; les effluves qui l'inspirent viennent de la Terre, des Nymphes et de Dionysos. Le sacerdoce apollinien, une fois la primauté de son dieu assurée, s'accommoda des souvenirs laissés par les cultes antérieurs. Daphné, type légendaire des prêtresses de Gaea, devint la première Pythie et le premier amour d'Apollon ; les Deucalionides de Lycoreia, honorés du titre de «saints», eurent place dans la corporation sacerdotale, comme la pierre de Zeus (omphalos) dans le nouveau temple ; on accueillit de même les Thracides et les Thyiades de Dionysos avec leur dieu, resté assez populaire dans la région pour balancer et bientôt dépasser l'influence d'Apollon lui-même. Il n'est pas jusqu'à Poseidon qui, bien que désintéressé, dit-on, par la cession de Calaurie, n'ait eu son autel dans le temple apollinien.
Tous ces cultes juxtaposés continuaient à vivre de leur vie propre, chacun collaborant avec ses rites spéciaux à l'activité de l'oracle. On rencontre à Delphes des traces non équivoques des méthodes divinatoires les plus diverses. Le culte d'Apollon était probablement le seul qui n'eût pas de rites divinatoires en propre ; ses prêtres se bornaient à jouer le rôle d'interprètes (prophêtai), c'est-à-dire à élucider et garantir les révélations fournies par les organes des divinités locales. Sous leur direction, les procédés les plus vulgaires tombèrent peu à peu en désuétude, et ils firent prévaloir comme source unique de la révélation apollinienne le mode le plus saisissant et le plus mystérieux, qui se trouvait être aussi le plus pompeux et le plus théâtral. La prêtresse de Gaea, la possédée des Nymphes et de Dionysos, portée par un trépied au-dessus de l'antre d'où sortaient les effluves telluriques, fut regardée parla Grèce entière comme l'instrument d'Apollon, prophète de Zeus. Les paroles ou les cris inarticulés qui sortaient de sa bouche étaient traduits par les prophètes en hexamètres qui n'avaient pas besoin d'être clairs pour être admirés.
Ce n'est pas ici qu'il convient de retracer l'histoire de l'oracle de Delphes [Oraculum] ; on n'a fait que chercher dans ses origines l'origine de la divination enthousiaste ou chresmologie. En résumé, tout porte à croire que celle-ci, après une période d'essais auxquels manquait la direction d'un institut organisé, s'est dégagée des cultes archaïques accumulés à Pytho et y a pris, dans la pratique comme dans la théorie, la forme régulière qui convenait à l'esprit national.
La théorie accréditée par les prêtres de Delphes était même trop simple pour leur assurer le monopole auquel ils aspiraient. Si la Pythie n'était que l'instrument d'Apollon, rien n'empêchait le dieu d'en avoir d'autres dans ses divers sanctuaires et même de promener son inspiration en tous lieux. C'est ainsi que se multiplièrent les oracles apolliniens à rites enthousiastes, transformés comme celui de Delphes ou créés de toutes pièces (Abae, Tégyre, Acraephia, Argos, Milet, Colophon, Hylae, etc.), et que la divination chresmologique finit par s'affranchir de toute attache locale, reprenant avec les sibylles et les chresmologues errants toute la liberté compatible avec la théologie spiritualiste des prêtres d'Apollon.
Les chresmologues libres n'ont guère fait parler d'eux que dans les confréries orphiques et les cercles d'érudits. La plupart d'entre eux, comme les prophètes-législateurs Minos «confident novénaire de Zeus», Rhadamanthys et peut-être Lycurgue, comme les «nymphomanes» Bacis, Musée, Mélésagoras d'Eleusis, Euclos de Cypre, Lycos le Pandionide, et les thaumaturges orphiques ou hyperboréens, Orphée, Abaris, Zamolxis et autres, sont des personnages mythiques déposés sur les confins de la légende et de l'histoire par le flot des superstitions étrangères. Ceux d'entre eux qui semblent appartenir au monde des réalités, comme Aristéas de Proconnèse, Anacharsis, Epiménide, Pythagore, ont une biographie surchargée de miracles.
La chresmologie sibylline, non moins merveilleuse et apocryphe dès l'origine, a eu une tout autre fortune. Elle a joué dans l'histoire des Romains d'abord [Quindecemviri sacris faciundis], plus tard dans la lutte des religions monothéistes contre le paganisme gréco-romain, un rôle considérable, et nous possédons encore d'amples débris de l'oeuvre des versificateurs peu scrupuleux qui faisaient circuler leurs menaces et leurs prédications sous le nom de la Sibylle. Ce sujet mérite d'être étudié à part [Sibyllae, Sibyllini libri] : on se contentera d'indiquer ici le point précis par où il tient à l'histoire des rites mantiques.
Que la Sibylle soit un être mythique, dont la légende a multiplié les décalques et transporté en divers lieux l'habitacle, c'est ce dont il n'est guère possible de douter. Quelle que soit l'étymologie de leur nom générique, il n'est pas difficile de reconnaître dans ces hôtesses mélancoliques de grottes sombres, réduites à l'état de «voix» prophétiques, des génies de l'ancienne religion animiste, des Nymphes longtemps oubliées, puisque Héraclite est le premier qui nous parle d'elles, et ressuscitées, pour ainsi dire, par l'effet de circonstances que nous pouvons nous expliquer d'une façon plausible.
Au temps où on ne parlait que d'une Sibylle, on plaçait la patrie de cet être abstrait sur le mont Ida, ou à Gergis, ou à Marpessos, ou encore à Erythrae, c'est-à-dire dans une région hantée par les souvenirs de Troie, ceux-ci mêlés à des incidents célèbres de la biographie d'Apollon, protecteur des Troyens, amant et persécuteur de la Priamide Cassandre. Non loin d'Erythrae, à Colophon, les traditions de l'oracle apollinien de Claros parlaient de Manto, fille de Tirésias, prise à Thèbes, vendue aux prêtres de Pytho et exilée en Asie par ordre d'Apollon. La Sibylle est tantôt fille, tantôt soeur, tantôt amante, esclave et victime d'Apollon : quels que soient les rapports établis entre la nymphe et le dieu, on sent qu'entre eux l'hostilité l'emporte et qu'ils représentent des traditions antagonistes artificiellement associées. Il semble qu'avec les vestiges du culte archaïque des Nymphes, d'une part, d'autre part le culte d'Apollon, entre les deux, comme trait d'union, les types épiques et depuis longtemps populaires de Manto et de Cassandre, on a tous les éléments nécessaires à la genèse du type sibyllin, pour peu qu'on ajoute un motif historique ayant provoqué le rapprochement et la fusion de ces éléments hétérogènes, analogues de tout point à ceux que nous avons vus se combiner à Pytho.
Ce motif historique pourrait bien n'être autre que la régénération de l'oracle pythique, devenu apollinien et dorien. On sait à quel point le patriotisme étroit des cités et des tribus était jaloux et prompt aux revendications, retouchant, pour se satisfaire, et la mythologie et l'histoire. Que l'on compte, pour s'en faire une idée, les berceaux de Zeus, de Dionysos, d'Apollon, et les patries d'Homère ! Il est fort probable que la vogue naissante de l'oracle dorien de Delphes, qui exerçait déjà une sorte de suzeraineté sur les mantéions de l'Asie Mineure, provoqua chez les aînés de la race, Eoliens et Ioniens, une sorte de réaction. On fit circuler de toutes parts des oracles versifiés, inconnus la veille et remontant, au dire des intéressés, à une époque où les pythies n'existaient pas encore et où peut-être Apollon lui-même, c'est-à-dire son culte, n'était pas né. La Béotie mettait en avant Bacis ; Athènes, Musée et quantité de prophètes orphiques. L'Asie Mineure, où les légendes du «cycle» troyen étaient encore en pleine végétation, se découvrit une Sibylle qui ressemble singulièrement à Cassandre et à Manto. Avec le temps, le voile jeté sur ces origines suspectes s'épaissit ; on put y mêler en toutes proportions les légendes apolliniennes et ménager une conciliation entre le dogme qui réservait à Apollon les confidences de Zeus et l'autonomie de la révélation sibylline. Celle-ci garda cependant son caractère distinct. Tandis que les mantéions apolliniens donnaient des consultations au jour le jour, en réponse à des questions précises et souvent mesquines, la voix de l'insaisissable sibylle ne s'adressait à personne en particulier : elle planait, orageuse et chargée de menaces, au dessus des cités et des peuples. Guerres, pestes, tremblements de terres, larmes et gémissements, les sibyllistes, usant du ressort tragique pour attirer l'attention, ne parlaient guère d'autre chose. Il n'est pas bien certain qu'ils aient trouvé alors beaucoup de créance, mais on s'habitua peu à peu à retrouver après coup dans leurs hexamètres l'annonce des malheurs éprouvés. Leurs successeurs juifs et chrétiens restèrent fidèles à cette méthode qui, après avoir fait de la Sibylle un des pouvoirs dirigeants de Rome, lui vaut encore aujourd'hui l'honneur de figurer dans une séquence célèbre de la liturgie catholique.
Ainsi, chresmologues libres et sibylles n'ont été, suivant toute apparence, que le produit d'un épanouissement tardif de l'antique révélation des «Nymphes», épanouissement provoqué lui-même par l'éclosion de la mantique enthousiaste à Delphes. Les pythies réelles et tangibles ont suscité les prophètes légendaires et les introuvables sibylles.
Maintenant, à quelle époque convient-il de placer ce grand mouvement religieux qui part de Delphes et s'étend sur tout l'habitat des Hellènes ? Pour approcher d'une solution plausible, il faut écarter en bloc toutes les légendes et s'en tenir aux faits, dût-on n'en tirer que des témoignages négatifs. Rappelons que ni Homère, ni Hésiode, ni même l'auteur de l'hymne homérique A Apollon Pythien, ne connaissent les pythies et sibylles en délire, bien qu'Homère soit le compatriote des sibylles, qu'Hésiode habite au pied du Parnasse et que l'hymnographe célèbre la fondation de l'oracle pythique, le «premier» de tous les oracles apolliniens. Au temps d'Homère, Pytho est un riche sanctuaire où Agamemnon est allé consulter Apollon, mais le poète ne fait aucune allusion aux rites spéciaux de l'institut. Hésiode sait qu'on y conserve la pierre avalée et revomie par Kronos, c'est-à-dire un symbole de Zeus. Les hymnographes fournissent la matière d'inductions plus précises. Leur Apollon prophétise «par le laurier» ; il connaît la pensée de Zeus par la «voix» de Zeus ; sa «voix» (omphê) ne trompe pas ceux qui viennent l'interroger sur la foi d'oiseaux véridiques : enfin, détail curieux, il connaît, dans un vallon du Parnasse, des Nymphes qui prophétisent quand elles sont ivres de miel, mais il les a délaissées et abandonnées à Hermès. De ces détails rapprochés, il paraît résulter qu'au VIIIe siècle avant notre ère, date approximative des hymnes précités, l'oracle de Delphes s'en tenait encore aux rites archaïques, aux «voix» de Zeus perçues dans le frémissement du laurier et interprétées par les prêtres d'Apollon. Au VIIe siècle, au contraire, s'il en faut croire Hérodote, les consultants en rapportaient des réponses dictées par la Pythie. C'est donc dans l'intervalle qu'a dû être inaugurée ou plutôt restaurée la mantique enthousiaste, legs jusque-là dédaigné des cultes chthoniens. Quant aux prophéties sibyllines, rien n'empêche d'admettre qu'elles datent d'une époque postérieure. Elles étaient sans doute bien nouvelles encore quand on porta à Rome celles de la sibylle d'Erythrae ou de Cumes, au commencement ou à la fin du VIe siècle avant JC, et quand Héraclite y cherchait une confirmation de ses théories sur la mantique. Ainsi tombe toute cette fantasmagorie de perspectives lointaines qui font reculer jusque dans les brumes de l'âge préhistorique les origines de la chresmologie ou divination enthousiaste, telle que l'a connue la Grèce.
HISTOIRE DE LA DIVINATION
L'histoire de la divination gréco-romaine se compose de particularités, dont bon nombre ont trouvé place dans l'exposé des méthodes, et d'aperçus plus larges qui font corps avec l'histoire générale de la civilisation classique. On se bornera à tracer ici un canevas qu'il ne saurait être question de remplir.
C'est dans l'âge héroïque (ou même, avec Prométhée, plus loin encore) que les Hellènes plaçaient les grands initiateurs, ceux qui avaient appris des dieux et posé les règles de l'induction divinatoire. Ces devins légendaires se groupent en familles, au sein desquelles apparaît l'hérédité des facultés prophétiques, privilège calqué sur celui des familles sacerdotales et bientôt caduque comme lui. La plus cohérente de ces lignées de devins est celle des Mélampodides, qui commence au prophète pylien Mélampus et, par Mantios et Antiphatès, Polyphidès, Théoclyménos, Polyidos, Amphiaraos, se continue jusqu'à Amphilochos et Mopsos, se mêlant sur le parcours à d'autres généalogies. Les tragiques ont fait une plus grande réputation encore au devin cadméen Tirésias, qui transmet son art à sa fille Manto, rattachée elle-même par son fils Mopsos à la dynastie des Mélampodides. C'est un Mopsos encore, celui-ci d'origine thessalienne, qui est le devin officiel des Argonautes. On lui associe d'ordinaire Idmon d'Argos, père de Thestor et aïeul de Calchas. Avec Calchas, nous entrons dans le cycle troyen, où figurent, du côté des Troyens, Hélénos, Cassandre, Oenone, Eurydamas, Mérops de Percote, Ennomos de Mysie ; du côté des Achéens, l'unique et «infaillible» Calchas. Une légende railleuse se plut cependant à humilier cette infaillibilité, qui vint se heurter contre celle du Mélampodide Mopsos, fils d'Alcméon et de Manto.
A côté de ces devins célébrés par les poètes se placent, éclairés d'un jour plus pâle, la légion d'oekistes et d'éponymes fabriqués par les logographes avec les menus débris des traditions qu'ils se chargeaient d'expliquer : Parnassos, Delphos, Pyrcaon, Python, Crétas, Castalios, Daphné, Phémonoé, dans la région de Delphes ; Crios, Carnos, Hécatos ou Hecas en Laconie ; Pythaeys en Argolide ; Iamos, Clytios, Tellias en Elide ; Isménos, Ténéros, Péripoltas en Béotie ; Branchos, Claros, Telmissos en Asie-Mineure ; Cinyras et Tamiras à Cypre ; Galéos ou Galéotes en Sicile. Les Grecs avaient, pour expliquer l'origine de toutes choses, un procédé fort simple : une étymologie personnifiée devenait un héros, fils d'un dieu quelconque, qui avait fondé les familles, les rites, usages et coutumes dont il s'agissait de motiver l'existence.
Lorsque s'ouvre l'ère historique proprement dite, vers le vue siècle avant notre ère, les représentants de la divination inductive ne jouent plus qu'un rôle effacé. Ceux qui se réclament d'un privilège et de secrets héréditaires, comme les Iamides 281, Clytiades 252 et Tclliades 253 éléens, les devins acarnaniens qui se vantaient, ainsi que les Clytiades, de descendre des Mélampodides 285, les Cinyrades et Tamirades de Cypre et les Telmessiens, peuvent seuls lutter contre la vogue croissante des oracles, qui accaparent la clientèle des cités. Les devins libres sont encore employés à vérifier la validité des sacrifices officiels 286 ou à commenter les réponses rapportées des mantéions par les théores 286, mais ils n'interviennent plus guère dans les affaires publiques qu'à titre de conseillers des généraux en campagne ou des fondateurs de colonies 287, rôle rarement glorieux, souvent équivoque. La majeure partie des devins libres constitue une foule innommée qui débite ses prédictions dans les carrefours.
Depuis le temps de Solon jusqu'au siècle d'Alexandre, l'hégémonie appartient aux mantéions ou oracles (manteia, chrêstêria) desservis par des corporations sacerdotales, particulièrement au plus révéré de tous, l'oracle de Delphes, centre de la divination enthousiaste [0racula]. Celui-ci éclipse ses rivaux et tend à accréditer dans la Grèce entière son dogme, qui pourrait se résumer ainsi : «Zeus est le seul confident du Destin, Apollon le seul confident de Zeus, et la Pythie le seul organe d'Apollon». Sous son influence, toutes les légendes de l'âge héroïque sont retouchées de façon à établir le privilège mantique d'Apollon. On cite des oracles rendus à Pytho aux plus anciens héros ; devins d'autrefois, chresmologues, sibylles, deviennent, bon gré, mal gré, tributaires de l'inspiration apollinienne. Les traditions contraires s'affaiblissent ; les prétentions rivales se découragent ; les oracles qui se réclamaient d'autres divinités ou acceptent, avec le dieu et les rites de Pytho, le rôle de succursales du grand institut de Delphes, ou se survivent dans l'isolement, comme l'antique Dodone, qui était restée ce que Pytho avait été autrefois.
Cependant, si l'oracle de Delphes, secondé par la diète amphictyonique qui y avait élu domicile, garda désormais sa primauté, il ne put fixer longtemps ni la foi ni même l'estime des Hellènes. Fractionnée en cités indépendantes et jalouses, la Grèce antique n'acceptait pas plus le joug d'une doctrine religieuse que la domination d'un homme, d'une cité ou d'une «amphictyonie». La persistance des traditions locales d'abord, l'invasion des cultes étrangers ensuite, tinrent constamment en échec les ambitions des prêtres de Delphes. Du reste, ceux-ci n'étaient pas à la hauteur du rôle auquel ils semblaient aspirer. Egoïstes et cupides, ils ont pu allumer trois «guerres sacrées», dont la dernière hâta l'asservissement de la Grèce par les Macédoniens, accumuler dans leur temple, transformé en une sorte de banque internationale, l'or des Hellènes et des «Barbares», lever la dîme (chrusoun theros) sur les colonies dont les fondateurs étaient venus demander l'investiture à Delphes : ils n'ont laissé derrière eux aucune idée, religieuse, patriotique ou morale, dont la civilisation leur soit redevable. Même les fameuses et banales «sentences de Delphes» ont été attribuées aux «Sages» de la Grèce plutôt qu'aux prêtres d'Apollon.
Les conquêtes d'Alexandre firent brusquement dévier le développement de la civilisation hellénique. Les Grecs, asservis et mis de toutes parts en contact avec les Orientaux, perdirent les plus précieuses de leurs qualités natives, le sens de la mesure, le goût des réalités opposé aux sollicitations du mysticisme, l'art d'embellir la vie et de s'en contenter. Pendant qu'une élite de beaux esprits occupait ses loisirs à philosopher et arrivait, sauf exception, au scepticisme, qui est le dernier mot de la philosophie, le vulgaire s'approvisionnait au hasard de superstitions nouvelles. Cybèle et Attis, Astarté et Adonis, Sabazios, et surtout Isis et Sérapis, lui apportaient des promesses et des émotions jusque-là inconnues. Les «métragyrtes» de Cybèle grossirent le nombre des débitants de prophéties et de recettes cathartiques ; le nom de Sérapis servit d'enseigne à des oracles médicaux qui firent concurrence à ceux d'Asclépios. Tous les instituts mantiques qui ne purent se convertir en officines médicales tombèrent dans une irrémédiable décadence. Il n'y avait plus de clientèle pour les oracles à l'ancienne mode, ceux qui remettaient des énigmes solennelles aux théores des cités et aux ambassadeurs des potentats. Les cités n'étaient plus des Etats, et les grands personnages avaient leurs astrologues.
L'invasion de l'astrologie fut un événement aussi considérable dans l'histoire de la divination que l'avait été en son temps celui de la mantique enthousiaste. Cette science aux allures dogmatiques était l'exact contrepied de la folie divine qui avait été jusque-là le moyen le plus vanté de pénétrer les arcanes de l'avenir. Elle séduisait les esprits vigoureux par la grandeur austère de ses théories sur la solidarité des diverses parties de l'univers et la rigueur apparente de ses déductions, en même temps qu'elle mettait à la portée du vulgaire ses hémérologes, précurseurs des almanachs modernes, où se trouvaient cataloguées les influences heureuses ou funestes, les indications et contre-indications attachées à chaque jour de l'année. Elle tendait à se subordonner toutes les autres méthodes divinatoires, ou, pour mieux dire, tout l'ensemble des connaissances humaines. Mais son triomphe même attira sur elle l'attention des gouvernements, qui se mirent à redouter les conséquences pratiques de ces spéculations sur les destinées des individus et des peuples. Un conflit s'éleva entre les maîtres du présent et ceux qui prétendaient disposer de l'avenir, et la défiance provoquée par les hardiesses de l'astrologie s'étendit bientôt à la divination tout entière.
Ce n'est pas en Grèce qu'a pu commencer le conflit dont nous allons indiquer les diverses phases. Les devins libres étaient à la dévotion de ceux qui les employaient, individus ou cités, et les oracles, même les plus fameux, n'avaient sur les affaires publiques qu'une action intermittente et négligeable, réglée d'ailleurs par le degré de confiance que les magistrats voulaient bien leur témoigner. L'oracle de Delphes eut des amis et des ennemis dans les cités grecques, mais il ne pouvait avoir de surveillant ou de maître tant que la Grèce demeura morcelée en une foule de communes indépendantes. Sous la domination des Macédoniens et des Romains, il était en pleine décadence et sut vieillir en paix.
La divination ne fut mise en tutelle qu'à Rome et dans l'empire romain. Dès l'origine, la divination officielle, représentée par les augures, fut réduite à un petit nombre de formalités où la divination proprement dite n'avait pour ainsi dire plus rien à voir [Augures, Auspicia]. Les suppléments d'information demandés soit aux livres sibyllins, soit à la science des haruspices, furent contrôlés de près par le Sénat, qui s'était réservé le droit de provoquer les consultations de cette nature. A l'égard des haruspices, il y avait moins à craindre l'engouement que l'hostilité de l'opinion publique : le peuple romain se méfiait de l'ingérence des Toscans dans ses affaires. On racontait qu'au temps de Tarquin, l'haruspice Olenus Calenus faillit confisquer au profit de l'Etrurie les brillantes destinées du Capitole, et on cite un cas d'haruspices mis à mort pour avoir essayé de tromper le peuple romain. On sait, au reste, de quel air méprisant le père des Gracques les apostropha un jour en plein sénat. Quand les Toscans furent devenus des Romains, ces défiances patriotiques n'eurent plus de raison d'être : mais on ne prenait plus guère au sérieux ces gens qui, disait Caton, ne pouvaient se regarder sans rire. Quant aux prophéties sibyllines et autres, le Sénat les mit sous clef ; les livres sibyllins dès le début, les autres par suite de mesures prises en temps opportun. C'est ainsi qu'en 213 avant JC., il chargea le préteur urbain M. Atilius de saisir tous les recueils de prédictions et formulaires de prières circulant dans le public, et fit porter aux archives de l'Etat, à côté des livres sibyllins, les carmina Marciana, provenant d'un légendaire «prophète de Mars». En ce qui concerne les oracles proprement dits, les Romains n'en usaient guère. Celui de Delphes fut consulté par eux au temps de Tarquin le Superbe, au cours du siège de Véies et après la bataille de Cannes ; mais ils se bornèrent depuis à le protéger. Le Sénat eut soin de ne pas laisser prendre aux oracles ou «sorts» d'Italie le rôle de conseillers qu'on avait accidentellement déféré à celui de Delphes. En 241, défense fut faite au consul Q. Lutatius Cerco d'aller consulter les sorts de Préneste, le Sénat estimant que «la République devait être administrée sous les auspices nationaux et non sous ceux de l'étranger». Cependant on peut dire qu'en thèse générale, les Romains ne cherchèrent pas à fermer les officines divinatoires où les consultations étaient publiques et pouvaient être aisément surveillées. Ils réservèrent toutes leurs rigueurs pour la divination libre, clandestine, et par conséquent dangereuse pour les pouvoirs établis.
Sous la République, le gouvernement se borna à user de temps à autre de son droit d'expulsion vis-à-vis des étrangers. Ceux-ci étaient seuls alors à se livrer à ces pratiques malsaines, au premier rang desquelles figure l'astrologie. En 139, le préteur pérégrin Cn. Cornélius Dispallas chassa les «Chaldéens» de Rome et leur enjoignit de quitter l'Italie dans les dix jours. Les Chaldéens en furent quittes pour se cacher un instant, et eurent tout le bénéfice d'une mesure qui grandissait leur rôle. Il n'est guère d'ambitieux qui depuis lors n'ait eu recours à leurs conseils ; il se trouva même des Romains, comme L. Tarulius Firmanus et P. Nigidius Figulus, pour leur demander des leçons. Dans la période d'agitation et d'anarchie qui va des Gracques à Auguste, toutes les «superstitions», même les plus mal famées, eurent le champ libre ; la police laissait tranquillement App. Claudius Pulcher et P. Vatinius se livrer à des expériences nécromantiques que l'on disait abominables.
Le régime impérial une fois constitué, il n'en alla plus de même. Dès l'an 33 avant notre ère, Agrippa, en sa qualité d'édile, avait chassé de la ville les «astrologues et les magiciens». Auguste commença par retirer de la circulation plus de deux mille recueils de prophéties grecques et latines et profita de l'occasion pour expurger les livres sibyllins reconstitués au temps de Sylla, après l'incendie du Capitole en 83. Il hésita cependant à prendre à l'égard des devins libres les mesures répressives que lui conseillait Mécène : vers la fin de sa vie seulement, il fit défense aux devins de donner des consultations à huis clos et de prédire les décès. Tibère fut moins accommodant. Le procès de Drusus Libo (16 ap. JC.) ayant mis en évidence l'influence que pouvaient prendre les charlatans sur un esprit faible, le Sénat décréta l'expulsion des astrologues et magiciens ; deux d'entre eux, qui étaient sans doute citoyens romains, furent mis à mort. L'émotion provoquée dans le public, en l'an 19, par une prophétie sibylline décida Tibère à soumettre à une nouvelle épuration «tous les livres contenant quelque prédiction». Par la suite, il interdit encore une fois les consultations secrètes, et songea même à supprimer les «sorts» de Préneste. Sous Claude, à la suite des procès de Lollia (49) et de Scribonianus (52), nouveau sénatus-consulte «sévère et impuissant», qui expulse d'Italie les astrologues. Les expulsions recommencent sous Vitellius, Vespasien, Domitien, ce qui édifie suffisamment sur leur efficacité. Les Chaldéens devinrent tout à fait à la mode ; la proscription, sans gêner sérieusement leur commerce, le rendit plus lucratif.
Cependant, les sénatus-consultes et les édits impériaux constituaient une législation pénale qui pouvait être à tout instant invoquée par les jurisconsultes et appliquée par les tribunaux. Les devins n'étaient plus seulement livrés à l'arbitraire de la police : leur industrie prenait rang parmi les professions illicites, et les peines portées contre eux n'étaient rien moins qu'anodines. «En ce qui concerne les vaticinateurs, qui se prétendent inspirés par la divinité, dit le jurisconsulte Paul, on a jugé à propos de les chasser de la cité, de peur que, la crédulité humaine aidant, les moeurs publiques ne fussent corrompues et entraînées à espérer certaines choses, ou que tout au moins les imaginations populaires n'en fussent troublées. Quiconque consulte sur la vie du prince ou sur l'Etat en général les mathématiciens, sorciers, haruspices, vaticinateurs, est puni de mort avec celui qui lui aura fait la réponse. Chacun fera bien de s'abstenir non seulement de la divination, mais de ses théories et de ses livres. Que si des esclaves consultent sur la vie de leurs maîtres, ils sont condamnés au dernier supplice, c'est-à-dire à la croix ; si au contraire on les a consultés et qu'ils aient répondu, ils sont envoyés aux mines ou déportés dans une île». Cependant, en pratique, le pouvoir se montrait hésitant : il voulait tantôt interdire, tantôt discipliner la divination, et, dans l'un et l'autre cas, il laissait voir qu'il considérait devins et magiciens non pas comme des imposteurs, mais comme des dépositaires de secrets redoutables. Les empereurs ne voulaient, au fond, que soustraire ces secrets à la connaissance du public et les réserver pour eux-mêmes. Auguste, Tibère, Vespasien, avaient leurs astrologues familiers. Marc-Aurèle punit un jour un illuminé qui faisait les affaires d'Avidius Cassius, mais il consultait Alexandre d'Abonotichos, faisait rédiger par Julien le Chaldéen un manuel d'astrologie militaire à son usage et laissait croire que la magie avait opéré le miracle de la «légion fulminante». Septime Sévère, qui était un adepte de l'astrologie, pourchassait les livres de magie ; Alexandre Sévère instituait des professeurs officiels d'astrologie et d'haruspicine ; Dioclétien proscrivait à la fois l'astrologie et la magie.
Avec les empereurs chrétiens, la répression devient plus énergique et est plus régulièrement menée. A la raison d'Etat s'ajoute une hostilité avouée contre l'ancienne religion. Si l'on fait abstraction de l'astrologie, qui s'accommode ou se passe de toutes les religions, on peut dire que toute la popularité conservée ou regagnée par la divination depuis l'invasion du mysticisme oriental, depuis la «défaite du bon sens», tournait au profit de l'hellénisme. Les philosophes eux-mêmes l'avaient compris : il n'y avait plus de sceptiques comme Sextus Empiricus, Favorinus, Lucien, ou de cyniques comme Oenomaos de Gadare pour nier l'efficacité des recettes divinatoires : la démonologie néo-platonicienne approvisionnait d'arguments les défenseurs de la révélation dispensée par toutes les méthodes imaginées et imaginables.
La divination était donc comme le rempart derrière lequel s'abritaient pêle-mêle les croyances polythéistes et les systèmes philosophiques rebelles à la nouvelle foi. Ce qui envenimait la querelle, c'est que le christianisme ne pouvait triompher de ses adversaires avec les seules armes de la logique, attendu qu'il partageait leurs idées sur les points en litige, qu'il croyait comme eux aux myriades de génies échelonnés entre ciel et terre et au pouvoir surnaturel des formules magiques. Les chrétiens ne niaient pas la réalité, ni même d'une façon absolue la véracité des révélations obtenues par la mantique païenne ; seulement ils y voyaient l'oeuvre des mauvais génies ou démons, êtres capables de tout, même de dire la vérité, pour faire échec au vrai Dieu et à ses anges. La mantique intuitive, songes, enthousiasme, extase, possession de l'âme par l'Esprit, échappait tout particulièrement aux prises de la dialectique chrétienne, car la théologie nouvelle n'expliquait pas autrement l'inspiration des prophètes hébreux (ou même des sibylles) et les miracles psychologiques, l'irruption soudaine de la foi, le don de prophétie, le don des «langues», qui édifiaient les premières communautés chrétiennes. Le christianisme entendait même conserver ce privilège de l'inspiration divine obtenue par la prière, et en user indéfiniment pour développer son dogme et sa morale. Aussi les mêmes arguments servaient aux deux parties et les injures tenaient plus de place dans la polémique que les raisons. C'était un débat que la force seule pouvait trancher ; or, depuis Constantin, la force était aux mains des chrétiens.
Constantin discerna du premier coup le point précis où la raison d'Etat se confondait avec l'intérêt de la religion chrétienne. Le sacrifice, qui est l'essence de tout culte, était, aux mains des païens, un instrument de divination que l'on ne pouvait leur enlever sans porter atteinte à la liberté des cultes garantie par l'édit de Milan (313). Constantin commenca par interdire les consultations d'entrailles à domicile, sous peine de mort pour l'haruspice, de déportation pour son client. Comme tout sacrifice non public eût été nécessairement incriminé, il en résulta que le culte privé fut prohibé du même coup. Restaient les consultations faites aux autels publics, c'est-à-dire sous l'oeil de la police ; celles-ci ne devaient pas être bien recherchées, et l'empereur pouvait user pour son compte du ministère des haruspices sans risquer d'avoir trop d'imitateurs. Les consultations officielles des magistrats furent supprimées quelques années plus tard. D'autre part, Constantin montrait le respect qu'il professait pour les oracles en dépouillant ceux de Dodone et de Delphes, en détruisant ceux d'Aphaca et d'Aegae. En revanche, les astrologues, qui n'étaient d'aucun parti, paraissent ne pas avoir été molestés : ils s'ingéniaient, du reste, à détourner les rigueurs en professant que la destinée des princes n'est pas soumise aux astres et ne peut être prévue par aucune méthode divinatoire.
Constance achève l'oeuvre de son père en proscrivant les sacrifices publics. La révolte de Magnence (350-353) lui fournit un prétexte de plus pour frapper sans merci tous ceux que les délateurs accusaient d'avoir consulté les devins ou les oracles sur les affaires de l'Etat. Vers la fin de son règne, Constance fulminait à tort et à travers contre les sacrifices, les magiciens et devins, augures, haruspices, mathématiciens, interprètes de songes, et menaeait de faire des exemples terribles sur ses propres courtisans. L'avènement de son successeur Julien (361) provoqua un brusque revirement. Julien ne se contentait pas d'être personnellement expert dans l'art divinatoire ; il voulait encore rendre à l'ancienne religion son plus beau titre de gloire en réveillant les oracles assoupis et ouvrant toutes grandes toutes les sources de révélation. Mais la mort vint pour lui plus tôt que ne l'avaient prévu les oracles et les haruspices. Ceux-ci durent s'estimer heureux que ni Jovien ni Valentinien ne fussent disposés aux représailles. Valentinien permit même expressément l'usage discret de l'haruspicine. Malheureusement pour les devins, le procès de Furtunatianus et Hilarius en 371 attira sur eux la colère de Valens, qui était saisi, après tant d'autres, de l'absurde envie de tuer son successeur.
Avec Théodose commence la proscription continue et enfin efficace. Les édits se succèdent, pressés et pressants. En 381, interdiction des sacrifices publics accompagnés de consultations divinatoires ; en 385, l'exercice de l'haruspicine est nominativement désigné comme crime capital ; en 391, défense de mettre le pied dans les temples et d'y offrir des sacrifices ; en 392, les consultations d'entrailles sont assimilées aux crimes de lèse-majesté, et l'emploi de l'encens, suspect à cause des rites libanomantiques, entraîne la confiscation des lieux où il aura été constaté. En même temps, les zélateurs chrétiens, devançant d'abord, puis exécutant les édits impériaux, démolissaient les temples et dispersaient les corporations sacerdotales qui pouvaient encore y être attachées.
Le monde antique a pris fin. La surface des choses est changée ; mais le fond reste le même. Quelque idée qu'il se fasse du divin, l'homme ne conçoit pas de Dieu sans providence et de Providence sans révélation. Les mêmes causes qui avaient engendré la divination antique l'ont fait survivre à la disparition de ses rites les plus vantés. Songes, visions, illuminations soudaines, rencontres fortuites, «sorts» tirés de l'Ecriture, tombeaux fameux et lieux de pèlerinage rappelant les oracles d'autrefois, surtout les oracles médicaux, rien ne manque à la divination chrétienne, entrée en pleine possession de l'héritage qu'elle croit avoir répudié.
Article d'A. Bouché-Leclercq