LVIII - La monarchie |
III - CLEMENCE DE CESAR ; DICTATURE ; ETENDUE DE SES
POUVOIRS ; CONTINUATION DES REFORMES ; SES PROJETS
On s'attendait à ce que César punît beaucoup après avoir été tant outragé, et Cicéron, qui avait toujours douté de sa clémence, croyait que la tyrannie éclaterait dès que le tyran serait sans crainte. Mais, à la hauteur où César s'était élevé, les haines, les souvenirs des partis, ne montaient pas jusqu'à lui ; le vainqueur de Pharsale, le neveu de Marius avait fait place au représentant du monde romain dont toutes les gloires devenaient, comme Rome elle-même, son patrimoine. Il relevait les statues de Sylla ; il replaçait celle de Pompée sur la tribune aux harangues, comme il avait jadis rétabli au Capitole les trophées du vainqueur des Cimbres, et il pardonnait à Cassius qui avait voulu l'assassiner, au consulaire Marcellus qui avait provoqué la guerre contre lui, à Quintus Ligarius qui l'avait trahi en Afrique. Toutefois, comme précaution temporaire, il avait interdit aux pompéiens, par une lex Hirtia, l'accès des magistratures. |

Temple dédié à la
Clémence
|
Pour son pouvoir, César ne chercha pas non
plus des formes nouvelles. Sylla, croyant que la
république pouvait être sauvée par des
lois, avait remanié toute la constitution, sans rien
changer à la véritable situation de l'Etat ;
César, qui fondait un régime nouveau, parut
conserver intactes les anciennes lois. Le sénat, les
comices, les magistratures, subsistèrent comme par le
passé ; seulement il concentra en lui seul l'action
publique, en réunissant dans ses mains toutes les
charges républicaines.

César dictateur à vie |
L'instrument dont César se servit pour donner
une sanction légale à son pouvoir fut le
sénat. Jadis, après le triomphe, le
général déposait son titre
d'imperator et l'imperium, qui comprenait
l'autorité absolue sur l'armée, la
compétence judiciaire et le pouvoir administratif ;
par décret du sénat, César conserva l'un
et l'autre pour sa vie durant, avec le droit de puiser
librement dans le trésor. Sa dictature, sa
préfecture des moeurs, furent déclarées
perpétuelles ; et le consulat lui fut donné
pour dix ans, mais il ne l'accepta pas. A la puissance
exécutive le sénat voulut joindre le pouvoir
électoral, en lui offrant le droit de nommer à
toutes les charges curules et plébéiennes. Il
ne se réserva que le privilège de pourvoir
à la moitié des magistratures, bien sûr
que personne n'oserait briguer les autres sans son
agrément. Le sénat avait imposé aux
élus l'obligation de jurer, avant leur entrée
en charge, qu'ils n'entreprendraient rien contre les actes du
dictateur, ces actes ayant force de loi. On lui donna encore
l'inviolabilité légale des tribuns, et, pour
l'assurer, des chevaliers, des sénateurs, offrirent de
lui servir de gardes ; le sénat tout entier fit le
serment de veiller à sa sûreté.
A la réalité du pouvoir on ajouta les signes
extérieurs. Au sénat, au théâtre,
au cirque, sur son tribunal, il put siéger, avec la
robe royale, sur un trône d'or, et son effigie fut
empreinte sur les monnaies où les magistrats romains
jusqu'alors n'avaient osé graver que leur nom. On alla
jusqu'à parler d'hérédité, comme
en une monarchie régulière. Le titre
d'imperator et le souverain pontificat furent
transmissibles à ses enfants légitimes ou
adoptifs ; et comme il n'en avait pas, un poète
à la tête légère songea, dit-on,
à proposer une loi qui permît à
César d'épouser toute femme qui
paraîtrait en état de lui donner un fils. On
voulait placer son image dans le temple de Quirinus avec
cette inscription : Theos Anikêtos, Au dieu
invincible, et en élever un autre à la
Clémence, où sa statue serait mise à
côté de celle de la déesse, toutes deux
se tenant par la main. César ne se trompait pas sur la
secrète perfidie qui inspirait ces
lâchetés et il en faisait le cas qu'elles
méritaient. Mais ses ennemis y trouvaient de nouveaux
motifs pour haïr le grand homme qui les avait
sauvés.

César grand pontife |
En résumé, comme dictateur à
vie, il avait la puissance exécutive et la libre
disposition du trésor ; comme imperator,
l'autorité militaire. La puissance tribunitienne lui
donnait le veto sur le pouvoir législatif ; prince du
sénat, il dirigeait les débats de cette
assemblée ; préfet des moeurs, il la composait
à son gré ; grand pontife, il faisait parler la
religion selon ses intérêts et surveillait ses
ministres. Il disposait donc des finances, de l'armée,
de la religion, du pouvoir exécutif, d'une partie de
l'autorité judiciaire, de la moitié du pouvoir
électoral, et indirectement de presque toute la
puissance législative. Ajoutez que ces
prérogatives n'étaient limitées ni dans
le temps, puisqu'il les avait à vie, ni dans l'espace,
puisqu'il les exerçait partout, même à
Rome, et qu'il n'avait point de collègue dont
l'intercession pût arrêter ses actes.
Par cette concentration aux mains de César de tous les
pouvoirs publics, les anciennes magistratures ressemblaient
à ces images des aïeux conservées dans
l'atrium des maisons consulaires : belle apparence, grands
souvenirs, mais formes vides et sans vie. Le sénat
était de même tombé du rôle de
conseil souverain de la république à celui d'un
comité consultatif que le maître oubliait
souvent de consulter. La guerre civile l'avait
décimé ; César y nomma de braves soldats
: même des fils d'affranchis, qui l'avaient bien servi,
et bon nombre de provinciaux : des Espagnols, des Gaulois de
la Narbonnaise depuis longtemps romains, et il avait tant de
services à payer, que son sénat compta
jusqu'à neuf cents membres. L'orgueil des nobles se
vengea par des railleries. Les Gaulois, disait-on, ont
changé leurs braies contre le laticlave ; et des avis
affichés dans les rues invitaient le peuple à
ne pas montrer aux nouveaux pères conscrits le chemin
de la curie. Mais ces sénateurs étaient dociles
; ils faisaient sans objections tout ce que voulait le
maître, plus qu'il ne voulait ; ils ne s'offensaient
pas que des sénatus-consultes,
délibérés par César tout seul, ou
par le conseil privé qu'il réunissait en son
logis, fussent promulgués en leur nom. Un jour
Cicéron reçut les remercîments d'un
prince d'Asie qui, disait-il, lui devait son titre, et dont
Cicéron ignorait jusqu'à l'existence. Il en
rit, car il s'était fait lui-même au temps ; et,
à demi consolé par la royauté qu'il
avait toujours, celle de l'esprit, il ne laissait percer ses
regrets qu'en de malignes plaisanteries. Ce rôle de
frondeur spirituel plaisait à César ; il le
délassait de l'adulation. Chaque matin on lui
apportait les bons mots de Cicéron, et il en faisait
un recueil. Un jour il s'invita à dîner chez lui
et fut charmant, dit son hôte ; mais la conversation
resta toute littéraire. Malgré son goût
pour l'esprit, l'ancien consulaire, qui s'était
toujours cru un homme d'Etat, fut piqué de n'avoir pas
entendu un mot d'affaires sérieuses.
Un jour le sénat vint en corps, dans le temple de
Venus Genitrix, lui présenter des décrets
rédigés en son honneur. Le demi-dieu
était malade et n'osa quitter son siège.
C'était une imprudence, car on répandit le
bruit qu'il n'avait pas daigné se lever. En traitant
ce sénat avec quelque dignité, il eût
réussi peut-être à le faire
considérer comme le représentant légal
du peuple, et il eût donné plus
d'autorité à sa propre puissance. Auguste ne
fera pas cette faute.
Il avait déjà augmenté le nombre des
membres des collèges sacerdotaux, celui des
préteurs, des questeurs et des édiles ; il ne
pouvait nommer plus de deux consuls ; mais la théorie
nouvelle des consuls substitués lui permit de donner
en un an cette haute charge à plusieurs. Le consul
Fabius mourut le 31 décembre 45 ; il ne restait plus
que quelques heures pour que l'année finît ; il
lui nomma néanmoins un successeur. Quel consul
vigilant ! s'écria Cicéron : pendant
toute sa magistrature il n'a pas dormi ! Il fit plus, on
put se parer des insignes prétoriens et consulaires
sans avoir exercé ces charges.
Il restait à peine quelques patriciens ; jamais consul
ni dictateur n'en avait fait ; c'était un droit royal,
presque divin : César en créa, privilège
en apparence très important, mais sans
caractère politique, car il servit seulement à
empêcher que, par l'extinction rapide des anciennes
gentes, certaines fonctions religieuses courussent le
risque de n'être plus remplies. Son neveu, le jeune
Octave, reçut alors ses lettres de noblesse ;
Cicéron, le bourgeois d'Arpinum, céda à
la tentation et prit les siennes. Le triomphe même
perdit son caractère de haute récompense
militaire. Un général en chef pouvait seul
l'obtenir : il l'accorda à des lieutenants.
C'était une infraction religieuse, car un lieutenant
combattait sous les auspices de son chef. Mais César,
qui ne croyait ni aux auspices ni aux dieux, croyait au
talent et donnait la récompense à qui l'avait
méritée. Il ne respectait pas plus au Forum les
vieilles prescriptions religieuses. Un jour on avait pris les
auspices pour l'assemblée des tribus, il fit
réunir les centuries.
Le peuple avait toujours ses comices ; il faisait des lois,
il donnait des charges ; extérieurement il
était encore le pouvoir souverain : mais la vie
manquait à ses assemblées, car les candidats
savaient bien que c'était la faveur de César
qu'il fallait gagner plutôt que celle du peuple. On en
avait vu naguère aller jusqu'en Espagne briguer un
regard du dictateur.
Une innovation importante fut l'institution des legati pro
praetore. Jusqu'alors les tribuns légionnaires
commandaient à tour de rôle, chacun pendant deux
mois, la légion entière ; le légat en
devint le chef permanent. C'était une concentration
nécessaire du commandement, et ces légats
à la nomination de l'imperator lui
répondaient mieux de l'exécution de ses ordres,
de la discipline et de la fidélité de
l'armée.
Les Romains étaient de grands bâtisseurs ; leur
nouveau maître partageait ce goût. Le Forum, au
pied dut Capitole, était le vrai centre de la ville :
c'est là que, durant six siècles, le coeur de
la vieille Rome avait battu et qu'avaient été
élevés ses plus somptueux édifices ;
César en éloigna les comices, qui furent
relégués au Champ de Mars, dans les Septa
Julia, immenses portiques qui pouvaient abriter
vingt-cinq mille personnes ; et il renvoya les plaideurs au
forum Julien qu'il leur bâtit, en mettant au milieu le
temple tout en marbre blanc de Venus Genitrix, l'auteur de sa
race. Du Forum ainsi rendu libre, il voulait faire la place
la plus magnifique de l'univers, mais déjà ses
jours étaient comptés.
Il nous reste un monument considérable de la
législation de César, la loi municipale dont le
nom revient si souvent au Digeste et qui, malgré son
état fragmentaire, montre combien ce puissant esprit
sentait le besoin de fournir aux cités les
éléments d'une organisation commune pour former
d'elles un tout homogène. Cette loi n'est point faite
dans un intérêt de parti, car pour César
il n'y a plus d'autre parti que celui de l'Etat. Il laisse
aux villes leurs libres élections et leur juridiction
propre ; il exclut de leur sénat tout homme dont
l'honorabilité ne serait pas entière, et il ne
le fait point par décisions arbitraires contre des
personnes, mais en déterminant à l'avance les
cas d'indignité ; il leur prescrit les mesures
d'édilité réclamées par
l'hygiène publique ; enfin, il leur impose
l'obligation d'un recensement quinquennal, qui fournira une
base certaine pour la répartition des taxes locales.
En prescrivant l'envoi, à Rome, des résultats
de cette opération, il donne le moyen d'assigner
à chaque Italien la centurie où il devra voter
: mesure d'ordre ; et peut-être ouvre-t-il aux
municipes un recours pour arrêter des abus qui se
produisaient dans l'administration de leurs finances : mesure
de justice.
Contre le pouvoir absolu des rois, les modernes ont le
système représentatif. Contre le despotisme des
empereurs, les Romains eurent longtemps les libertés
municipales, qui étaient à peu près
efficaces pour la bonne gestion des affaires de la
cité, parce que, dans le haut empire, les princes
gouvernaient et n'administraient pas. La lex Julia,
qui a certainement servi de modèle à beaucoup
de législations dans les colonies et municipes, fut
donc pour les peuples un bienfait, puisqu'elle aida au
développement de la grande vie municipale qui, durant
plus de deux siècles, fit la prospérité
des provinces.
Elle a un autre caractère : elle marque la
révolution qui s'opérait. Faite pour l'Italie,
elle le fut aussi pour Rome, de sorte que la ville où
l'oligarchie avait voulu enfermer la république
entière, d'où le sénat devait
régenter à jamais l'Italie et les provinces,
devenait un municipe italien. Rome restait la
résidence de l'imperator, des magistrats et des
collèges sacerdotaux, la cité aux palais de
marbre et aux statues d'or ; elle demeurait la capitale de
l'empire, mais elle n'était plus la cité
souveraine. Les Italiens avaient les mêmes droits que
ses citoyens, avec des institutions analogues ; beaucoup de
provinciaux sont déjà dans la même
condition ; et quand César est en Espagne, en Afrique
ou en Asie, le gouvernement tout entier y est avec lui. La
transformation que, depuis les guerres du Samnium et de
Pyrrhus, nous jugions nécessaire est donc en voie de
s'accomplir. La base qui porte la fortune romaine s'est
élargie, comme il était nécessaire pour
que celle-ci durât, et le pouvoir s'est
concentré, comme il le fallait, pour que
l'intérêt des gouvernés se confondit
enfin avec celui du gouvernant.
Si, à ces lois, on en ajoute une, de
Sacerdotiis, qui est perdue, mais que mentionne une
lettre de Cicéron, et dont on retrouve une disposition
dans les bronzes d'Osuna, on verra que César avait
compris l'ensemble des institutions romaines dans son vaste
plan de réformes.

César - Statue trouvée à Cumes |
Tout était donc changé au fond, mais, à regarder de loin, il semblait que bien peu de choses fussent nouvelles. La royauté de César rappelait celle de Pompée, de Sylla, de Marius, même de C. Gracchus. Point de cour, point de gardes autour du maître ; il habitait la Regia, demeure du souverain pontife, où il vivait au milieu de quelques amis dont il avait éprouvé depuis longtemps la fidélité : Lépide et Marc Antoine, auxquels il avait confié Rome, et l'Italie durant sa première guerre d'Espagne ; Hirtius, le rédacteur du huitième livre des Commentaires de la guerre des Gaules ; C. Oppius et le Gaditain Cornelius Balbus, les confidents de ses plus secrètes pensées ; le chevalier romain Mamurra, son habile ingénieur, praefectus fabrum, etc. Des affranchis expédiaient les dépêches, dont un ordre clair et précis leur avait donné la substance. Ce gouvernement de soixante millions d'hommes tenait en quelques chambres. |
La haute noblesse restait à l'écart,
non des honneurs, mais du pouvoir : aussi n'oubliait-elle ni
Pharsale ni Thapsus. Elle aurait consenti à
obéir, à la condition d'avoir l'air de
commander. Cette obéissance déguisée
est, pour un gouvernement habile, plus commode que la
servilité publique. Avec quelques concessions faites
à la vanité, on obtient une possession
tranquille du pouvoir. Ce fut la politique d'Auguste, mais ce
n'est pas celle des grandes ambitions ni de l'homme d'Etat
véritable. Ces mensonges laissent tout en question ;
rien ne se règle, rien ne se fonde ; et César
voulait fonder un gouvernement qui fît sortir un ordre
nouveau du chaos des ruines. Si l'on ne donne pas trop
d'importance à de simples anecdotes, il aurait
souhaité le bandeau royal. Le consulat, la dictature,
la préfecture des moeurs, tout cela, même
à titre perpétuel, paraissait être encore
la république ; le titre de roi eût
commencé la monarchie, l'hérédité
dans le pouvoir, l'ordre dans l'administration,
l'unité dans la loi. Il est difficile de ne pas croire
que César ait considéré comme
l'achèvement rationnel de la révolution qu'il
opérait, la constitution d'un pouvoir monarchique. Par
là s'expliquerait la constance de ses amis à
lui offrir un titre odieux à ces Romains, qui
étaient tout prêts à accepter le
monarque, mais non point la monarchie. Un matin on vit sur
ses statues des couronnes de laurier entrelacées du
bandeau royal. Deux tribuns les enlevèrent et firent
emprisonner ceux qui les avaient déposées. Un
autre jour qu'il venait de célébrer, sur le
mont Albain, les féries latines, parmi les cris qui le
saluèrent à son passage, on entendit celui de
roi. Je ne m'appelle pas roi, dit-il, mais
César. Les tribuns firent encore saisir le
coupable. Cette fois César s'offensa de ce zèle
importun ; il les accusa dans le sénat d'avoir
prévenu sa justice, et ils furent destitués
malgré leur inviolabilité. Personne ne se
trompa sur le motif de cette colère. Aux fêtes
des Lupercales, 15 février 44, le dictateur, la
tête ceinte d'une couronne de laurier, était
assis dans sa chaise d'or, sur la tribune aux harangues.
Antoine, alors consul désigné, lui
présenta un diadème, en lui disant :
Voilà ce que le peuple romain t'envoie. La
foule restait silencieuse, César écarta de la
main le bandeau, et les applaudissements
éclatèrent. Une seconde fois il le repoussa ;
ce furent des trépignements de joie sur tout le Forum.
Jupiter, dit César, est le seul roi des
Romains ; c'est à lui qu'appartient ce
diadème. Et il le fît porter au Capitole.
Dans les Fastes, il commanda d'écrire que le peuple
romain, par un de ses consuls, lui avait offert la
royauté, et qu'il l'avait refusée. Mais en
même temps le bruit courait que les livres sibyllins,
consultés, avaient répondu que les Parthes ne
seraient vaincus que par un roi.
Pour arriver à ce titre royal, couronnement de tous
les autres, ou mieux, pour couvrir ce pouvoir gagné
dans la guerre civile par de la gloire acquise dans une
guerre nationale, il fallait monter encore ; cette grandeur
nouvelle, il ira la chercher en Orient. De graves
événements se passaient dans la vallée
du Danube. Un chef habile, Byrébistas, aidé du
grand prêtre de Zalmoxis, venait d'opérer, chez
les Gètes, une révolution politique et
religieuse. Il avait réuni toutes leurs tribus en un
corps de nation, fait arracher les vignes du pays, pour
condamner son peuple à la sobriété, et
soumis à la plus sévère discipline ces
hommes qui croyaient aller à une immortalité
bienheureuse en allant à la mort dans les combats.
Déjà il avait franchi le Danube à la
tête de deux cent mille hommes. Des villes
étaient réduites en cendre, des multitudes
d'hommes, de femmes et d'enfants étaient
emmenées au pied des Carpates pour cultiver les champs
de leurs nouveaux maîtres ; la Thrace, la
Macédoine et l'Illyrie tremblaient. Arrêter
cette invasion n'était pas le projet insensé
qu'on a prêté à César de subjuguer
tout le monde barbare. C'était combattre un nouvel
Arioviste plus redoutable que le premier, et, par sa
défaite, garantir la frontière du Danube, comme
la défaite des Suèves avait garanti celle du
Rhin.
En Asie, d'autres motifs l'appelaient. Il lui appartenait
d'effacer la seconde humiliation militaire de Rome,
après avoir effacé la première ; de
venger Crassus, de reprendre, dans Ctésiphon vaincue,
les aigles des légions, et de rouvrir le chemin de la
patrie aux Romains captifs des barbares. Cette guerre
était populaire à Rome. Quand César
revint de Munda, Cicéron, qui est souvent un
écho, prépara une lettre où, le
félicitant de ses succès en Espagne, il lui en
promettait de plus grands à l'autre
extrémité du monde. Les nobles trouvaient leur
compte à cette expédition durant laquelle la
flèche d'un Parthe ferait peut-être ce que
n'avait point fait l'épée d'un Gaulois ; et
l'on n'outrage pas les sentiments intimes de Cicéron,
en supposant que cette pensée homicide, qui lui
était venue plus d'une fois, s'était
glissée sous ses brillants éloges, comme
l'aspic de Cléopâtre se cacha sous des fleurs.
Mais cette guerre souriait au mâle génie de
César, à ses instincts de soldat, à ses
idées de politique. Cette oeuvre accomplie, le
glorieux capitaine dont le cheval aurait bu aux eaux du
Danube et du Tigre, comme il avait bu à celles de la
Tamise et des rivières africaines, serait revenu
ceindre dans sa Babylone de l'Occident la couronne
d'Alexandre, ou, sans elle, faire reconnaître de tous
la nécessité, pour un si vaste empire, d'un
gouvernement monarchique, quelque nom que prît le
monarque. Alors, maître paisible du monde, il fera
couper l'isthme de Corinthe, dessécher les marais
Pontins, percer la montagne qui enferme le lac Fucin, et
jeter par-dessus l'Apennin une grande route de l'Adriatique
à la mer de Toscane. Rome, la capitale de l'empire
universel, sera agrandie de tout l'espace que lui donnera le
Tibre détourné de son lit, à partir du
pont Milvius, pour couler à l'ouest du Janicule. Dans
la plaine vaticane, un temple colossal de Mars ; au pied de
la roche Tarpéienne, un immense
amphithéâtre ; à Ostie, un port vaste et
sûr.
Mais ce seront là ses moindres travaux. Préoccupé du besoin d'organiser cet assemblage de nations que l'épée a réunies et que la loi sépare, il veut rassembler et coordonner en un seul code les lois romaines, afin d'en faciliter et d'en répandre partout l'intelligence. Déjà un de ses familiers, le savant jurisconsulte Aulus Ofilius, a entrepris une codification des édits prétoriens, et lui-même a fait rédiger, pour toute l'Italie, la loi municipale que les cités provinciales vont copier. Pour garantir les provinces contre les exactions sénatoriales, il interdit aux sénateurs d'y paraître sans commission officielle, et il paye les gouverneurs, pour qu'ils ne se payent pas eux-mêmes en continuant les exactions d'autrefois. Il s'est souvenu qu'un consul de son nom et de sa race a donné la cité romaine aux Italiens ; et si les temps ne sont pas venus d'appeler au même droit tous les sujets, il multiplie du moins au milieu d'eux l'élément romain : quatre-vingt mille colons ont porté au delà des mers les coutumes et la langue de Rome. La Sicile entière va obtenir le jus Latii ; la civitas est conférée aux Transpadans, à la légion de l'Alouette, à tous ceux qui l'ont fidèlement servi, même à des Juifs. Aux bords de la Loire, de la Seine et du Rhône, quantité de Gaulois portent son nom, et une de ces familles construit peut-être déjà, en son honneur, un charmant édifice, le mausolée des Jules, qui rappelle leur reconnaissance et ses combats. |
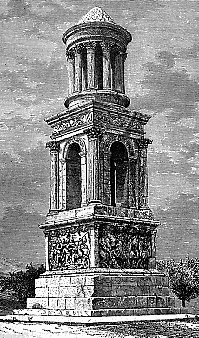
Mausolée des Julii - Glanum |
Il a des récompenses pour ceux qui lui ont
été utiles à la guerre ; nombre de
provinciaux sont entrés dans son sénat ; il en
a aussi pour ceux qui sont utiles dans la paix : il donne la
cité aux médecins étrangers et aux
professeurs d'arts libéraux établis à
Rome, c'est-à-dire à la noblesse de
l'intelligence, comme le sénat l'avait autrefois
accordée à la noblesse des municipes du Latium.
On voit, par un fragment de Gaïus (I, 33), que le jus
quiritium était assuré au provincial qui
consacrait une partie de son patrimoine à construire
un édifice public. Cette loi, qui a couvert le monde
romain de monuments, a paru empruntée à la
lex Julia de César : du moins elle était
digne de lui.
Durant la guerre d'Afrique, il avait vu en songe une grande
armée en pleurs qui semblait lui redemander une patrie
; à son réveil, il avait écrit sur ses
tablettes les noms de Corinthe et de Carthage. Ces deux
villes en ruine attestaient les vengeances du sénat :
il les avait relevées. Ainsi les grandes injustices
sont réparées, les liens se multiplient, le
rapprochement s'opère. Depuis longtemps les
divinités des peuples de civilisation
hellénique ont reçu le droit de cité
romaine ; les écrivains qui ont fait la gloire des
nations étrangères vont à leur tour
l'obtenir. Varron a mission de réunir dans une
bibliothèque publique tous les produits de la
pensée humaine, pour que Rome soit aussi la
métropole de l'intelligence. Le tour des peuples
viendra, après celui de leurs dieux et de leurs grands
hommes.
A cette haute pensée de réparation et
d'unité se rattachent : la réforme
monétaire, qui fit de l'aureus de César
la pièce la plus commode pour les transactions
commerciales et l'étalon de la valeur sous l'empire ;
la réforme du calendrier, si habilement accomplie que,
sauf une modification légère, le calendrier
Julien nous sert encore ; enfin l'ordre donné à
trois géomètres grecs de parcourir l'empire
pour en mesurer les distances et en dresser le cadastre :
travail préliminaire d'une réorganisation de
l'administration provinciale et financière.
Pour accomplir de telles choses, il fallait du temps, et
César avait perdu plus d'un quart de siècle
à monter au premier rang. Mais il n'était
âgé que de cinquante-sept ans. Il avait donc
encore assez d'années devant lui pour qu'il pût
espérer conduire à terme ses grands desseins.
Les préparatifs de la guerre contre les Parthes
étaient achevés ; il avait distribué
pour trois ans (44-42) les charges et les provinces ; Antoine
était son collègue au consulat, et il avait
promis à Dolabella d'abdiquer en sa faveur, quand il
partirait pour l'Asie. Hirtius et Pansa devaient avoir les
faisceaux en 43 ; Decimus Brutus et Numatius Plancus en 42.
Brutus et Cassius étaient préteurs.
Lépide allait céder à Domitius Calvinus
la charge de maître de la cavalerie, pour prendre le
gouvernement de la Narbonnaise et de l'Espagne
citérieure. Asinius Pollion recevait celui de
l'Ultérieure ; les autres provinces étaient
également distribuées. Seize légions
avaient passé l'Adriatique, et le jeune Octave, son
fils adoptif, l'attendait à Apollonie ; quelques jours
encore, et César se retrouvera, au milieu de ses
vétérans fidèles. On répandit le
bruit qu'avant de quitter Rome il voulait tenter un dernier
effort sur le sénat, et que, dans la séance
indiquée pour les ides de mars, il serait
discuté si César, restant dictateur en Italie,
ne pourrait pas, dans les provinces, porter la couronne,
comme roi des nations soumises. Ce jour des ides qui devait,
au sens des derniers républicains, fonder à
jamais la tyrannie, ils le choisirent pour en faire celui de
l'expiation.
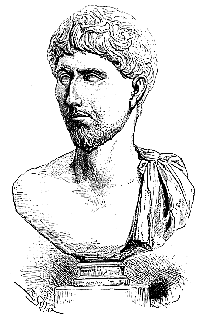
Lépidus - Musée du Vatican |