
Bas-relief assyrien des jardins de Ninive - 668-625 av.JC - British Museum, Londres
Ninive et Babylone
C'est un fleuve qui a fait l'Egypte. On peut dire que c'est un chemin qui a fait les grands empires de Ninive et de Babylone.
Lorsque l'histoire, à force de patientes recherches, sera parvenue à découvrir les raisons des choses, - si toutefois un tel idéal est réalisable pour les forces humaines, - alors on saura peut-être pourquoi la civilisation partit du centre de l'Asie, pourquoi elle suivit cette marche permanente et inflexible d'Orient en Occident, pourquoi, toujours plus vive aux extrémités, elle s'est insensiblement éteinte vers le point de départ. Ce sont là des lois inexplicables dont nous osons à peine poser les problèmes, et que nos travaux contribuent peu à peu à résoudre, bien lentement au gré de l'impatience humaine.
Si antique que soit l'Egypte, personne n'oserait dire que les empires de la Chaldée ne soient pas plus anciens encore. Dans les premières migrations qui remuèrent, au début des temps historiques, les peuples mobiles de l'ancien continent, il se trouva que dans cette région de la Mésopotamie, des éléments de stabilité ne tardèrent pas à fixer une partie de cette masse flottante.
C'était un chemin : on y passait. C'était une vallée, un éden, on s'y arrêtait. Ainsi, là, peu à peu, comme émergèrent de la face des eaux les masses solides des premiers continents, s'agrégèrent et se fixèrent les tribus nomades ; et sur leur masse s'élevèrent les premiers empires.
Voici dans quels termes les plus vieilles légendes racontent leur fabuleuse origine : «Tout d'abord, il y eut à Babylone une grande multitude d'hommes de races diverses qui avaient colonisé la Chaldée. Ils vivaient sans règle à la manière des animaux.
Mais dans la première année apparut, sortant de la mer Rouge, en un endroit où elle confine à la Babylonie, un animal doué de raison, nommé Oannès. Il avait tout le corps d'un poisson, mais par-dessous sa tête de poisson, une autre tête qui était celle d'un homme, ainsi que des pieds d'homme qui sortaient de sa queue de poisson : il avait une voix humaine, et son image se conserve encore aujourd'hui.
Cet animal passait la journée au milieu des hommes sans prendre aucune nourriture ; il leur enseignait la pratique des sciences, des lettres et des arts de toutes sortes, les règles de la fondation des villes et de la construction des temples, les principes des lois et de la géométrie. I1 leur montrait les semailles et les moissons, en un mot il donnait aux hommes tout ce qui contribue à l'adoucissement, de la vie. Depuis ce temps rien d'excellent n'a été inventé. Au coucher du soleil ce monstrueux Oannès se plongeait de nouveau dans la nier et passait la nuit sous les flots : car il était amphibie. Il écrivit sur l'origine des choses et de la civilisation un livre, qu'il remit aux hommes».
Longtemps après l'apparition d'Oannès commença le règne d'une première dynastie semi-héroïque. Elle ne dura pas moins de six cent quatre-vingt-quinze mille deux cents ans, et elle se termina au déluge. Ce cataclysme, d'après les vieilles traditions assyriennes, était arrivé du temps du roi Xisouthros. Celui-ci, comme Noé dans le récit biblique, fut averti par Dieu, construisit une arche, flotta sur les eaux déchaînées. Après avoir, comme le patriarche dont il est le type, lâché la colombe et le corbeau, il aborda enfin aux monts d'Arménie, et fut la source de la nouvelle race des hommes.
Cette race, race de géants, construisit Babel. C'est la Bible qui nous apprend ensuite l'histoire de ses anciens rois : «Au nord régna Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Eternel ; c'est pourquoi l'on dit jusqu'à ce jour : Comme Nimrod le puissant chasseur devant l'Eternel. Et le commencement de son règne fut Babel, Erekh, Accad, et Calnêh au pays de Sennaar».
Ce que l'on a pu démêler de plus clair parmi tant de renseignements incomplets ou contradictoires, en s'aidant des plus anciens documents fournis par les monuments archéologiques et ethnographiques nouvellement rassemblés, c'est que des peuples descendus du nord de la Chaldée et de race Touranienne, se mêlèrent en Mésopotamie avec des peuples venant du sud, où ils étaient depuis longtemps établis, et nommés Koushites.
Entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate qui, par le sud et par le nord avaient servi de chemin à ces deux occupations diverses, une contrée basse, fertile, humide, facile à arroser, facile à cultiver, facile à défendre ; une terre portant naturellement le froment et les arbres fruitiers, en particulier l'utile palmier ; une situation avantageuse, centrale, non loin de la mer et non loin de la montagne, arrêta de bonne heure l'humeur vagabonde de nos antiques aïeux.
Autour d'un premier noyau établi au point même où les deux fleuves rapprochent le plus leurs eaux dans leur cours moyen, se rangèrent successivement, alliés ou soumis, des peuples de races diverses. Au milieu de toutes ces hordes, incessamment menacées par les attaques des peuples étrangers qui voulaient ou le passage ou la place elle-même ; au-dessus de tribus d'origines diverses et toujours portées à la révolte et aux luttes intestines, les nécessités de l'existence, non moins que la nature d'esprit particulière aux peuples de l'Asie, établirent vite le pouvoir monarchique.
Le monarque fut comme la clef de voûte de tout le système, le grand défenseur, le grand protecteur, le représentant de la Divinité, une sorte de Dieu lui-même. Il se trouva, par la nature même de son pouvoir, forcé de couvrir de mystère et d'envelopper dans un secret hautain et redoutable, une puissance que, dans l'intérêt du salut public, il fallait immense. Tout le troupeau des peuples pouvait vivre en paix, s'appliquer à la culture, aux arts, sous la protection sombre du roi enfermé dans son palais, au milieu de ses eunuques guerriers, de ses prêtres magiciens et de ses astronomes, qui, veillant sans cesse au sommet des observatoires septicolores, lisaient dans les astres la volonté des dieux.
Si quelque bruit d'armes se faisait entendre aux frontières ou dans les provinces, le roi sortait de son repaire. Il se mettait lui-même à la tête de ses soldats. Il marchait avec eux soit à pied, soit à cheval, au milieu des contrées les plus âpres et des dangers les plus redoutables ; il commandait la bataille, sa vaillance décidait souvent de la victoire, et sa cruauté présidait au massacre. Puis ayant assuré le salut de l'empire, il revenait, précédé et suivi de longues files de prisonniers : captifs que l'on emploiera dans les grandes constructions d'irrigation ou de canalisation, femmes en pleurs traînant leurs enfants après elles, animaux domestiques et animaux sauvages, tentures, armes, vases, trophées de toutes sortes, jusqu'aux dieux du peuple vaincu, que le dieu vainqueur, le Nabuchodonosor, emportait dans sa victoire et étalait dans son triomphe.
A de tels empires, il fallait des capitales taillées sur leur modèle. Ce n'étaient pas ces villes pharaoniques, ouvertes à tout venant, couvertes de temples et d'obélisques, entourées de tombeaux, habitées par des prêtres et des cultivateurs, villes de paix, de travail et de prière. Il fallait des villes militaires avant tout.
Il fallait qu'entourées d'un bon mur, ceinte d'un fossé large et profond, baignées par les eaux du fleuve, elles pussent quand les hasards de la guerre amenaient l'ennemi devant elles, recevoir dans leur sein une population immense, la protéger, la nourrir, et attendre que la longue résistance lassât l'ennemi, ou que la fortune des combats délivrât de son étreinte.
Il fallait autre chose encore. Car si le roi faisait beaucoup pour le peuple, il convenait que le peuple fît pour le roi plus encore. Du milieu des maisons faites en terre séchée au soleil, et couvertes de paillassons, bonnes assez pour la populace, s'élevaient de place en place, formant de véritables quartiers, et comme des villes dans la ville, les palais des rois.
Le plus souvent même, comme si le monarque eût eu quelque défiance de ses sujets et qu'il eût voulu conserver une porte ouverte sur la campagne, le monument était à cheval sur la muraille extérieure, un côté pénétrant dans la ville, l'autre s'étendant sur la plaine. Le tout était surélevé sur une énorme colline artificielle faite de main d'homme et dont la seule construction avait conté bien des sueurs. On ne pouvait parvenir à la plate-forme supérieure que par un chemin construit en pente, où chars et cavaliers pouvaient marcher de front, mais qu'il était facile de fermer en un clin d'oeil et de rendre inaccessible. Sur le plateau s'étendait le palais du Roi, salles du trône, sérails, harem, écuries et dépendances de toutes sortes. Une seule et même entrée donnait accès dans ce dédale de cours et de chambres au fond duquel se cachait la majesté royale.
Chaque prince puissant ou victorieux construisait ainsi sur un plan uniforme le palais qui devait conserver son nom et sa mémoire, et dont les murs couverts de bas-reliefs racontaient ses exploits. Tout dans l'édifice, depuis la moindre brique jusqu'aux statues colossales des taureaux à têtes d'homme, veillant aux portes, tout était consacré à la seule louange du constructeur et à ses sanglants travaux. Guerres et chasses étaient toute sa vie et faisaient toute son histoire. Les dieux eux-mêmes négligés ici, ne formaient en quelque sorte que l'accessoire, et leur présence ne servait qu'à ajouter un nouveau relief à la gloire de celui qui les représentait sur la terre.
Dans ces villes si avantageusement situées, tout l'effort des intelligences et des bras s'appliquant à satisfaire les moindres désirs, les fantaisies et les caprices du despote, des progrès importants se manifestèrent rapidement par tout le domaine des arts et du luxe. Les artistes indigènes s'attachèrent en particulier à représenter fidèlement les diverses actions et les exploits des armées royales. Dans cet effort, ils parvinrent à se dépouiller rapidement de la naïveté primitive, et surtout de la convention archaïque, qui - par une loi des plus curieuses de l'intelligence humaine, - se trouve toujours au début du développement artistique d'une nation.
Les bras ne manquaient pas : le peuple lui-même en fournissait un grand nombre, que les captifs faits dans chaque campagne augmentait régulièrement. Ces captifs eux-mêmes instruisaient l'Assyrie dans les arts et les pratiques inventés par eux ; et ce pays profitait ainsi du labeur des contrées voisines.
Ces diverses causes expliquent la rapidité, la variété et la perfection relative des résultats obtenus par les peuples de la Chaldée.
Ils furent bientôt à leur tour les agents de la civilisation et les instructeurs du monde. Dans leurs conquêtes ils répandaient ces arts que leurs conquêtes avaient rassemblés chez eux. Les riverains de la mer Occidentale (Méditerranée), comme les peuples de l'Est et du Nord (Mèdes et Perses), s'instruisirent à leur école. Jusqu'en Syrie, jusqu'en Asie Mineure, jusqu'en Europe pénétrèrent leur influence et leurs modèles. Si nous en croyons M. Layard, c'est aux ornements Assyriens que les anciens Grecs empruntèrent les types de leurs plus charmants motifs d'architecture. L'influence de la magie chaldéenne sur la mythologie des Hellènes est aujourd'hui hors de doute. Il suffit de voir, au musée du Louvre, leur Hercule dompteur de lions et écraseur de serpents, leur Jupiter à ailes d'aigle, pour être persuadé de l'analogie.
Dans une autre région et chez un autre peuple l'influence assyrienne ne fut pas moins considérable. Dix fois les puissants monarques de l'Asie centrale mirent le pied en passant sur la nation toujours rebelle des Juifs du Jourdain ; dix fois ils prirent leur ville, la ruinèrent. Ils les entraînèrent captifs sur les rives de l'Euphrate. Ils les écrasèrent d'énormes travaux, et de charges onéreuses. Toujours le peuple tenace survécut à de si nombreuses ruines.
Mais l'influence du vainqueur se grava bien profondément dans les moeurs et les oeuvras du vaincu. N'est-ce pas sur l'arbre mystique des Ninivites que fut calqué le chandelier à sept branches ? Le trône de Salomon, ce «grand trône d'ivoire, orné d'or dont les bras étaient deux lions», n'a-t-il pas bien du rapport avec ces beaux trônes retrouvés par M. Layard dans les fouilles de Ninive ? Les veaux d'or tant haïs des prophètes hébreux, n'avaient-ils pas bien de l'analogie avec ces taureaux chaldéens symboles de la force divine par excellence, et le temple rebâti de Jérusalem ne devait-il pas se ressentir quelque peu de l'étude que les architectes juifs avaient pu faire, sur les lieux, des somptueux palais qui bordaient les rives du Tigre et de l'Euphrate ?
Aussi, les antiquités grecque et hébraïque, témoins parfois inconscients de ces incontestables ressemblances, s'inquiétèrent de bonne heure de l'histoire ancienne et des moeurs présentes de cet aîné de tous les peuples. Hérodote écrivit une histoire de l'Assyrie, malheureusement perdue aujourd'hui. La Bible est en quelque sorte bourrée d'allusions à ces redoutables voisins des Hébreux. Ctésias, qui habita à la cour des rois Perses, écrivit, sur leurs prédécesseurs, un livre dont il ne nous reste que des fragments. Bérose, Abidène, Mégasthène, Alexandre Polyhistor, Diodore de Sicile, Strabon, travaillèrent sur le même sujet.
Malheureusement, les renseignements que devaient contenir tant d'ouvrages importants n'avaient pas survécu à ce grand naufrage du moyen âge, dans lequel ont sombré tant de précieux restes de l'antiquité. C'est à peine si quelques fragments vagues et décolorés pouvaient faire apprécier l'étendue de la perte. Désastre plus déplorable encore ! Depuis longtemps les moindres traces matérielles de l'existence de ces anciens empires avaient complètement disparu.
Des capitales les plus considérables et les plus renommées, il ne restait même pas des ruines. Les patients érudits qui rassemblaient péniblement ce que les écrivains grecs et latins nous disaient de la Chaldée, dissertaient stérilement sur le site de Babylone, de Ninive, sur l'étendue de la ville, sur l'histoire légendaire de leur empire.
Devait-on rester toujours dans une telle ignorance ? En 1836, un résident anglais, M. Rich, après avoir étudié avec soin la contrée, crut pouvoir signaler au monde savant l'existence de ruines Assyriennes, dans deux monticules ou collines artificielles, élevées aux environs de Mossoul, sous les villages de Koyundjick et de Nebbi-Younos (tombeau de Jonas). Pour lui, ces ruines n'étaient autres que celles de Ninive. Des cylindres couverts d'inscriptions, des briques gravées, qu'il réunit en grand nombre dans cette région, quelques coups de bêche qu'il donna en cet endroit le confirmaient dans cette opinion.
Cinq ou six ans plus tard, M. Botta était nommé résident français à Mossoul. Il partit avec le projet de s'occuper de l'ancienne histoire des pays où il allait séjourner. Le savant, membre de l'Institut, M. Mohl, appela son attention sur les détails donnés par M. Rich, et, du fond de son cabinet, il put, à l'aide de l'étude attentive des documents anciens, indiquer l'endroit où, selon lui, devaient se trouver les restes de l'ancienne capitale.
A peine arrivé dans le pays, M. Botta, à ses risques personnels, et malgré les difficultés que souleva immédiatement l'administration turque, ouvrit des tranchées dans les monticules qui, sur la rive gauche du Tigre, semblaient, d'après les récits populaires, renfermer des ruines antiques. Son attente fut trompée tout d'abord. II s'était attaqué au monticule de Koyundjick qui, nous le savons maintenant, pouvait lui fournir une ample moisson ; mais l'inexpérience où il était des recherches de cette nature fit que les travaux furent mal dirigés. Il ne trouva que des débris insignifiants, et il était sur le point d'abandonner l'entreprise. Cependant le bruit de ses recherches se répandit rapidement dans le voisinage. Un teinturier chrétien lui apporta quelques briques couvertes d'inscriptions cunéiformes, et lui offrit de lui en procurer un nombre plus grand encore, «tant qu'il voudrait». M. Botta, d'abord incrédule, envoya vers la demeure de ce brave homme quelques ouvriers intelligents ; ils firent des fouilles et découvrirent des pans de mur, des bas-reliefs.
A leur retour, M. Botta était à peine convaincu de le véracité de leurs récits et craignait encore une désillusion. Cependant, il se transporta en toute hâte sur les lieux, c'était près du village turc de Khorsabad. Il se trouva en présence des premières ruines de Ninive.
Plein de joie cette fois, et plein d'espoir, il poussa activement ses recherches et délaissa presque absolument les fouilles de Koyundjick. Peu à peu, des pans de mur couverts de bas-reliefs, des fondations importantes, des formes de palais apparurent à ses yeux ravis. Sans retard, il annonça à l'Europe la bonne nouvelle dans des lettres adressées à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Sur un rapport de cette illustre compagnie, le gouvernement français s'émut ; on envoya des secours au hardi explorateur. Les voeux des savants et du public s'attachèrent à ses travaux et les encouragèrent. En peintre habile, M. Flandin, lui fut adjoint, pour dessiner les monuments que l'on découvrait de jour en jour.
Ainsi apparut peu à peu l'un des palais les plus importants des rois de Ninive, la demeure du roi Sargon, l'édifice connu dans la science sous le nom de Khorsabad.
Cependant, de loin, un Anglais, M. Layard, suivait avec attention les travaux de M. Botta. Lui-même avait parcouru cette plaine couverte de monticules d'apparence singulière ; lui-même avait songé à en interroger les profondeurs ; il avait encouragé M. Botta dans ses travaux, et ne désespérait pas de devenir bientôt son heureux rival. La découverte de Khorsabad, confrontée avec les récits des anciens le confirma de plus en plus dans l'idée qu'il avait conçue déjà que Ninive s'étendait sur toute la région et que les autres tertres environnants valaient la peine d'être fouillés à leur tour.
Il demandait depuis longtemps au gouvernement anglais de l'aider à entreprendre ces recherches.
A ce moment même arrivait à Paris et était déposée au Louvre la première série des antiquités assyriennes envoyées par M. Botta, entre autres ces deux magnifiques taureaux à tête d'homme, que l'on avait transporté par les mêmes moyens dont s'étaient servis autrefois les Assyriens, et que l'on trouva reproduits sur les bas-reliefs.
L'orgueil national anglais se réveilla cette fois, et le gouvernement britannique consentit à se charger des frais de toutes les fouilles que M. Layard proposait d'entreprendre.
En arrivant à Mossoul, M. Layard n'hésita pas sur 1éendroit où il devait commencer ses travaux. Il avait été frappé déjà de la configuration de la colline de Nimroud, située à vingt et quelques kilomètres au sud de la ville arabe. Ce fut là qu'il se dirigea aussitôt.
Profitant de l'expérience acquise par les premières recherches de M. Botta, il put immédiatement attaquer la colline sur un point favorable, et bientôt il rencontra à son tour, des chambres, des palais, des murs, enfin tout une ville assyrienne.
Mais ici, il ne s'agissait pas de Ninive, comme on l'avait cru tout d'abord, et comme on le crut quelque temps encore. C'était plutôt Calach, ville ancienne dont parle la Bible. D'autres savants ont identifié ces ruines avec celles de Larissa, que Xénophon décrit en ces termes : «Là, fut une grande ville, qui s'appelait Larissa ; autrefois les Mèdes l'habitaient. La largeur du mur était de 20 pieds, la hauteur de 100, le pourtour était de 2 parasanges ; il était bâti de briques cuites ; il avait, au-dessous, un soubassement de pierre de 25 pieds.
Le roi des Perses, quand les Perses enlevèrent l'empire aux Mèdes, l'assiégea et ne pouvait pas s'en rendre maître. Un nuage obscurcit et fit disparaître le soleil, jusqu'à ce que les hommes eussent abandonné la ville, qui fut prise alors. Auprès de cette ville est une pyramide en pierre d'un plèthre de largeur et de deux plèthres de hauteur. Sur cette pyramide beaucoup des barbares s'étaient réfugiés des villages environnants».
Ce qui appuie surtout l'identification des ruines de Nimroud avec Larissa, c'est précisément la présence d'une pyramide analogue à celle dont parle Xénophon.
Sans entrer dans la discussion soulevée à ce sujet, nous nous contenterons d'ajouter que les découvertes faites à Nimroud fournirent à la science les plus utiles renseignements sur l'histoire d'Assyrie antérieure au roi Sargon fondateur de Khorsabad ; à l'archéologie un complément utile et souvent nécessaire des études faites sur d'autres points. Enfin cette première découverte, riche en résultats de premier ordre, encouragea M. Layard et ouvrit à la science un champ bien vaste, puisqu'elle faisait espérer que de pareilles trouvailles seraient faites dans tous les monticules artificiels dont la rive gauche du Tigre était parsemée.
M. Layard fut le premier qui mit à profit ces heureux pronostics. Comme les fortes chaleurs de l'été le forçaient à suspendre les fouilles de Nimroud, et qu'il se trouvait à Mossoul, il résolut de reprendre les travaux de Koyundjick que M. Botta avait à cette époque presque entièrement abandonnés.
Le consul français, nous l'avons dit, avait débuté, dans la série de ses recherches, par cette colline située en face de Mossoul, sur l'autre rive du Tigre. Mais il avait obtenu peu de résultats, car il ne savait point encore que les édifices assyriens étaient tous élevés sur un monticule construit de mains d'hommes et que c'était à une certaine hauteur qu'il fallait chercher. M. Lavard ne se laissa pas décourager par cet insuccès, et tandis que M. Botta abandonnait décidément Koyundjick pour s'appliquer uniquement à l'entreprise de Khorsabad, le consul anglais persévéra. Il trouva bientôt quelques débris, mais non pas assez pour le satisfaire. Les travaux de Nimroud qu'il reprit à cette époque arrêtèrent alors ceux de Kovundjick.
Quand il y revint l'été suivant, son expérience s'était accrue ; ses réflexions avaient mûri sa conviction ; son plan était mieux arrêté. Les recherches cette fois furent couronnées de succès, et une nouvelle série d'édifices qui, comme Khorsabad, portaient des traces de la ruine par le feu, fut exhumée peu à peu. Le palais découvert par M. Layard était celui de Sennachérib, fils de Sargon. Il était situé à l'extrémité sud du tumulus de Koyundjick. Les formes de son architecture étaient semblables à celles des palais de Khorsabad et de Nimroud. Les inscriptions, il est vrai, y étaient rares ; mais elles acquéraient un grand prix, aux yeux de la science, par la mention qu'elles faisaient des campagnes du monarque contre les Juifs et les autres peuples de la Syrie. C'est aussi dans une des salles de ce palais que l'on rencontra les mémorables archives du roi Sardanapale, dont la lecture fournit à l'histoire de l'Asie centrale nombre de détails curieux.
Plus tard (1852), vers le centre et le nord de cette même colline de Koyundjick, MM. H. Rassam et Loftus continuant les recherches de M. Layard, découvrirent le palais de Sardanapale V, fils d'Assarhaddon. Ce palais de construction plus tardive que ceux que nous avons indiqués jusqu'ici offrait le type d'une nouvelle évolution dans l'art assyrien. Si les plans d'ensemble étaient les mêmes, il y avait dans les détails une recherche, une minutie qui s'écartait des grandes lignes affectées par les monuments plus anciens. Cependant là encore le goût des artistes conserve une pureté qui permet de mettre leurs oeuvres à côté des plus remarquables produits de l'art Ninivite.
Dans les ruines de Koyoundjick, on rencontra une inscription qui ne laissait aucun doute sur le nom à donner à ces ruines. C'était bien Ninive, et même une Ninive déjà rebâtie que l'on avait sous les yeux. Car c'est ainsi que s'exprime Sennachérib :
«Sennachérib, roi puissant, grand roi, roi des légions, roi d'Assyrie, roi des quatre contrées, favori des grands dieux, Assour et Istar m'ont confié la garde des peuples. Pour humilier les ennemis de l'Assyrie, j'ai contraint mes adversaires à marcher dans l'adoration sublime des dieux. Depuis le commencement jusqu'à la fin, je me suis fait obéir par mes armées ; j'ai soumis à mes lois tous les princes qui habitent les coins des quatre régions. Ils se convertirent à la piété.
Puis je dis : Ninive est la ville de ma royauté ; j'en ai renouvelé les demeures, restauré les rues. J'ai changé le camp royal, et je l'ai fait reluire comme le soleil. J'ai fait l'enceinte et le boulevard en entier, et j'en ai fait mention dans les inscriptions. Jusqu'à 100 grandes mesures j'ai fait élargir les fossés ; à plusieurs reprises j'ai employé les journées de mon armée royale à faire transporter les tables des carrières... Je mesurai 62 grandes mesures à partir de mon camp royal jusqu'à la grande porte des façades. Que celui des habitants de cette ville qui change une ancienne maison en bâtisse une nouvelle. Que celui qui touche aux fondations de ce palais soit écrasé par les décombres».
Après des découvertes aussi précieuses, que complétaient encore les fouilles de Nebbi-Younès, de Sippara, de Calah-Sergat, et de bien d'autres monticules de cette contrée qu'un voyageur compare à une Suisse archéologique, les fouilles en Mésopotamie se trouvèrent bientôt à l'ordre du jour. On ne désespéra plus de rencontrer les restes d'autres villes voisines de Ninive et dont la renommée était tout aussi considérable. Babylone bientôt attira le regard.
Des voyageurs instruits, Nieburh, Rich, Ker Potter en avaient déjà exploré les ruines. Ils avaient donné sur leur situation quelques détails précis et intéressants. M. Layard, à son tour, s'en occupa activement. Un autre Anglais, sir Henri Rawlinson, le premier déchiffreur des caractères cunéiformes, y porta ensuite toute son attention. Il en explora les restes, les rapprocha des textes anciens, lut bon nombre d'inscriptions et mit enfin en pleine lumière les principaux résultats que l'on pouvait obtenir.
Le gouvernement français, à son tour, ne resta pas en arrière. Un illustre assyriologue, M. Oppert, aidé de MM. Fresnel et Thomas, l'un homme de science, l'autre artiste de talent fut envoyé en Mésopotamie (1852-1855). L'expédition parcourut toute la contrée, s'enquit d'abord à Ninive des résultats acquis et de la méthode suivie dans les fouilles, puis gagna le cours de l'Euphrate, descendit jusqu'à Babylone, au lieu voisin de la ville turque de Hillah, et là commença ses recherches et ses vérifications. De cette expédition, dont les travaux ont été contrôlés et complétés par les études des Lenormant, des Rawlinson, des Layard, des Menant, des Renan et des Maspero, date la véritable théorie archéologique et historique relative aux fouilles babyloniennes.
Combien cette autre capitale ne devait-elle pas attirer les efforts, les investigations de la science ! N'était-ce pas «cette reine de l'Orient» qui avait hérité de la fastueuse puissance de Ninive livrée aux flammes ? N'était-ce pas la ville des Sémiramis et des Nabuchodonosor, celle qu'avait prise Cyrus et qu'avait pillée Xerxès ?
«N'était-ce pas là, comme dit Nabuchodonosor lui-même, cette grande Babylone dont j'ai fait le siège de mon empire, que j'ai bâtie dans la grandeur de ma puissance et dans l'éclat de ma gloire ?»
Quelle curiosité anxieuse ne devait pas naître dans l'esprit à l'idée de fouiller pour la première fois, après tant de siècles, les débris d'une ville dont les monuments comptaient parmi les Merveilles de l'ancien monde ! Peut-être allait-on rencontrer quelque pan de ces anciens murs sur lesquels six chars pouvaient passer de front. Peut-être quelque arbre centenaire, débris des fameux jardins suspendus, ombrageait encore leurs ruines effondrées. Peut-être enfin la terre avait-elle conservé quelque chose de cette fameuse tour de Babel, le lieu où «les langues s'étaient confondues», et dont la destruction avait été le signal de la dispersion des peuples sur la surface de la terre. Tant de souvenirs, tant de traditions, tant de légendes... et tant de rêves allaient-ils enfin trouver une base réelle ; la terre allait-elle s'ouvrir pour raconter à son tour ces antiques histoires ?
On pouvait craindre de n'obtenir que des résultats négatifs. Babylone, en effet, n'avait jamais été absolument abandonnée pendant l'antiquité et le moyen âge. Sur les ruines anciennes de destruction facile, car elles aussi consistaient en matériaux d'argile, sur ces ruines et à côté de ses ruines, des villes, des villages s'étaient bâtis, qui s'étaient ruinés à leur tour. Séleucie et Ctésiphonte s'étaient, on le savait, construites tout entières à ses dépens. Du temps de saint Jérôme, les rois Parthes avaient fait de son enceinte un parc pour chasser les bêtes féroces. La ville arabe de Hillah avait si bien mis à profit le voisinage de cette mine abondante en matériaux tout préparés, que M. Oppert reconnaissait par dizaines, sur les murs de sa chambre à coucher, des traces d'inscriptions babyloniennes.
Devait-on craindre que les paroles de la Bible ne fussent accomplies à la lettre et que de l'orgueilleuse cité, il ne restât plus pierre sur pierre ? «Là se coucheront les animaux du désert ; leurs demeures seront habitées par des chouettes, les chacals crieront ainsi que les chiens dans les maisons de leurs voluptés !»
Il faut avouer qu'une partie de cette prédiction se trouva réalisée et que les résultats obtenus furent loin d'être aussi satisfaisants que les découvertes faites à Ninive. Babylone a énormément souffert. Je ne sais même si l'on peut dire que l'on ait trouvé sur son emplacement autre chose que des masses informes et sans traces des arrangements anciens ; plutôt de quoi soulever de nouveaux doutes que des faits certains apportés pour résoudre les anciennes conjectures.
Au point de vue archéologique, les fouilles de Babylone ont été presque nulles ; un énorme lion en basalte d'un travail médiocre, quelques restes de murs et de canaux, quelques crampons de bronze, ce fut là tout le butin sur lequel dut s'ingénier la sagacité des érudits. «Aujourd'hui, dit M. Raoul-Rochette, la plaine où fut Babylone est couverte, sur une étendue de dix-huit lieues, de débris, de monticules à demi renversés, d'aqueducs et de canaux à demi comblés. Ces décombres se sont mêlés à un tel point, qu'il est souvent impossible de reconnaître la place et les limites certaines des édifices les plus considérables. La désolation y règne dans toute sa laideur. Pas une habitation, pas un champ cultivé, pas un arbre en feuilles ; c'est un abandon complet de l'homme et de la nature. Dans les cavernes formées par les éboulements ou restes des antiques constructions habitent des tigres, des chacals, des serpents et souvent le voyageur est effrayé par l'odeur du lion».
Heureusement l'abondante moisson d'inscriptions trouvées dans les ruines de la ville put compenser en quelque chose l'insuffisance des résultats que les vovageurs s'étaient donné tant de peine à réunir. Si l'on ne rencontrait pas les palais, on put au moins prétendre à fixer leur ancien emplacement et l'on put dire quelque chose sur l'histoire des rois qui les avaient élevés.
C'est ainsi que l'on put déterminer, d'après des traces de talus anciens, la position ancienne et l'étendue de Babylone.
A l'endroit dit El-Kasr (le château) ou Mudjelibeh (la ruine) on retrouva les restes du palais que Nabuchodonosor fit, selon Bérose, élever en dehors de celui de ses pères. Ce palais était fait de briques cuites et souvent vernissées. On trouva même, chose extrêmement remarquable, des traces de peintures à l'encaustique.
Au milieu de ces ruines, à l'endroit le plus élevé et le plus aride, se dresse un arbre gigantesque, le seul végétal considérable de toute la contrée. Sa vieillesse, l'isolement où il se trouve, la manière dont il a pousse sur un terrain si ingrat, ont fait naître à son sujet bien des légendes.
Les Arabes racontent que lorsque Ali livra la bataille de Hillah il se trouvait sur cette hauteur. Là il aurait fait sortir de terre ce superbe tamarix en enfonçant son bâton, pour s'abriter des rayons du soleil. Sur cette légende des voyageurs ont renchéri encore. Ils ont voulu reconnaître dans cet arbre quelque survivant de ceux qui décoraient les jardins suspendus de Babylone. Il est inutile d'insister sur ce qu'il y a d'invraisemblable dans l'existence d'un arbre de 2500 ans. Constatons simplement que les jardins suspendus étaient en un autre endroit plus voisin du Tigre.
Le château dont les ruines se trouvent maintenant à El-Kasr, était autrefois le centre même de Babylone, l'acropole ou l'arx. Deux enceintes l'entouraient ; des jardins, des cours, des dépendances de toutes sortes s'y rattachaient ; des aqueducs y conduisaient les eaux. On trouva des briques gravées constatant l'existence de ces anciens bâtiments. La plus importante de toutes ces inscriptions et la plus générale disait :
«Nabuchodonosor, roi de Babylone, restaurateur de la pyramide, et de la tour, fils de Nabopolassar, roi de Babylone, moi.
Je dis : J'ai construit le palais, le siège de ma royauté, le coeur de Babylone dans la terre de Babylone ; j'ai fait poser les fondations à une grande profondeur au-dessous du niveau du fleuve. J'ai relaté sa construction sur des cylindres couverts de bitume, et sur des briques.
Avec ton assistance, ô dieu Mérodach, le sublime, j'ai bâti ce palais indestructible. Que ma race trône à Babylone, qu'elle y élise sa demeure, qu'elle y septuple le nombre des naissances. Puisse-t-elle, à cause de moi, régner sur des peuples de Babylone jusqu'en des jours reculés !»
Un peu au sud de El-Kasr, et réunis peut-être à lui par une même enceinte, s'étageaient graduellement les fameux jardins suspendus, au lieu nommé maintenant Tell Amran ibn Ali.
La hauteur du tumulus actuel est d'environ 50 mètres. Au pied se creuse un grand ravin, dans lequel M. Oppert reconnut l'ancien lit de l'Euphrate. Au sein de la colline, on rencontra un grand nombre de tombeaux anciens mais fouillés déjà, et qui ne pouvaient guère remonter â une date plus haute que l'empire des Parthes.
Sur les jardins, l'antiquité nous a laissé de nombreux renseignements. Le plus explicite de tous les auteurs qui en ont parlé est Diodore de Sicile : «Il y avait, dit-il, près de l'Acropole, le jardin dit suspendu, qui n'était pas l'oeuvre de Sémiramis, mais celle d'un roi syrien postérieur, qui le fit construire pour complaire à sa maîtresse. Celle-ci étant, à ce qu'un dit, Perse d'origine, demanda, dans son désir de voir des prairies accidentées, que le roi imitât par une plantation artificielle le caractère spécial du pays de la Perside.
Le jardin s'étend de chaque côté, environ de quatre plèthres ; il présente une montée accidentée et des édifices qui s'y tiennent les uns aux autres en offrant ainsi une mise en scène théâtrale. Au-dessous des montées artificielles, il y avait des arcades pour supporter à la fois la pesanteur de la masse du jardin, et les arcades hautes étaient plus longues et avançaient sur celles qui étaient bâties dessous. La dernière voûte, la plus élevée, avait 50 coudées de hauteur ; au-dessus d'elle se trouvait la plus haute plate-forme dont l'élévation égalait celle de l'enceinte crénelée. Puis les piliers étaient construits avec une grande solidité ; ils avaient 22 pieds d'épaisseur, et chacun était séparé de l'autre par un intervalle de 10 pieds.
Les étages étaient couverts par des poutres en pierre qui mesuraient, avec la partie qui dépassait, 16 pieds de longueur et 4 de largeur. L'étage ainsi construit avait sur ces blocs de pierre un parquetage de roseaux mêlé de beaucoup d'asphalte, ensuite une double couche de briques reliées avec du plâtre. Cette troisième structure était garantie par une couverture en plomb afin que l'humidité de la terre apportée ne pénétrât pas dans les profondeurs. Sur cette base on avait accumulé une masse de terre suffisante pour contenir les racines des plus grands arbres.
Toute cette surface, en forme de plancher aplani, était remplie d'arbres qui pouvaient enchanter le spectateur par leur grandeur et leurs autres agréments. Les tunnels eux-mêmes recevaient la lumière par les voûtes qui leur étaient superposées ; ils avaient des emplacements en grand nombre et offraient beaucoup de variété pour que les rois pussent y séjourner. Au niveau de la vue la plus élevée, il y avait un édifice ayant des tranchées perpendiculaires et des machines pour porter l'eau à la hauteur : on tirait par ces moyens une quantité d'eau du fleuve, sans que personne au dehors pût s'en apercevoir. Ce jardin, comme je l'ai annoncé plus haut, était d'une construction plus récente».
D'après cette description, que Diodore emprunta lui-même à des auteurs plus anciens, on peut s'imaginer facilement l'aspect à la fois singulier et délicieux que devait offrir l'ensemble de la construction. Les jardins en forme de colline s'élevaient graduellement vers l'intérieur des terres. Leur pied baignait dans le fleuve. Sous la construction colossale des piliers et des voûtes qui en soutenaient la masse, des chambres étaient disposées et pouvaient servir d'habitations royales. La dernière plate-forme, celle qui couronnait l'oeuvre, pouvait avoir à peu près l'étendue de la grande cour du Louvre.
Il va sans dire, qu'aujourd'hui, l'ensemble de la construction s'est effondré. Ce monument fait, à force de bras, pour satisfaire un caprice de femme, était à la fois la plus hardie et la plus étonnante, mais aussi la plus déraisonnable et la plus fragile de toutes les oeuvres de l'homme.
Aussi l'ensemble de la ruine actuelle ne présente plus que de vagues points de ressemblance avec les descriptions que nous ont laissées les anciens. La sécheresse et les inondations, les racines des arbres vivants et la chute des arbres morts, les bouleversements naturels et les destructions voulues ont suffi pour tout changer, tout confondre.
Chose curieuse, on n'a retrouvé jusqu'ici, dans les ruines de Babylone, aucune trace assyrienne de l'existence des jardins suspendus. Ce n'a donc été que par des conjectures tirées des auteurs anciens et de l'état actuel des lieux qu'on a pu aboutir à une identification qui, d'ailleurs, est encore aujourd'hui discutée par plusieurs savants.
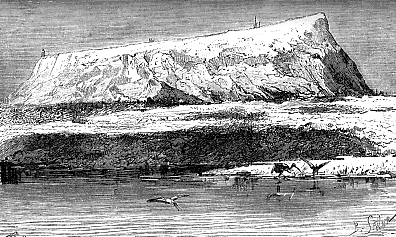 |
Au nord des monticules d'El-Kasr et de Tell Aram dont l'ensemble formait la Cité royale par excellence, une masse de ruines importantes et d'une forme toute particulière attirait l'attention des visiteurs. Le nom seul de cette ruine suffisait pour éveiller la curiosité : les Arabes l'appellent Babil. Déjà Rich avait fait des fouilles en cet endroit. M. Layard avait, non sans succès, percé quelques tranchées et avait atteint des formes de chambres et des murs ruinés. M. Oppert reprit les recherches. Comme ses prédécesseurs il trouva des pierres, des briques et même des verreries.
Mais tout cela ne présente point encore de résultat complet. Il faut se contenter jusqu'ici, en attendant qu'on puisse fouiller jusqu'au centre même de la masse, d'étudier la forme générale de cet énorme terrassement et d'essayer de rapprocher l'état actuel, des descriptions que nous ont laissées les anciens auteurs. Pour les uns c'est le temple de Jupiter, le Bel des Assyriens ; pour d'autres c'est le tombeau de Bélus, le sépulcre du dieu immortel, l'endroit même où les prétres chaldéens rendaient leurs oracles et sur lequel s'acharna la fureur destructive de Xerxès. La forme générale de l'édifice était, suivant M. Oppert, celle d'une pyramide très élancée. Sur la plate-forme qui la couronnait, trois statues divines appelaient l'attention et la vénération des adorateurs du dieu national assyrien.
Si nous ajoutons à ces différentes ruines la mention de quelques autres moins importantes comme El Homeira où l'on trouva beaucoup de poterie et de verrerie ; un tumulus où l'on crut reconnaître les restes du tombeau d'Hephestion, construit par Alexandre ; les traces des quais, arrangés de façon à arrêter la violence des inondations, et celles des murs d'enceinte de l'Acropole, il ne nous restera plus qu'à insister un instant sur deux derniers vestiges, dignes à eux seuls d'attirer toute l'attention des chercheurs et des curieux : ceux des murs d'enceinte de la ville et de la Tour de Babel.
Les restes de ces fameux murs d'enceinte que l'antiquité grecque plaça au nombre de ses merveilles, sont reconnaissables encore aujourd'hui dans une série de tumulus, désignés par les Arabes sous les noms de Abou Bezzoum (collines aux Chats), Toloul Soufar (les collines jaunes) et Tell Zawiyeh, (collines du coin). Du moins c'est l'identification qu'a proposée M. Oppert, et elle répond, d'une manière très satisfaisante, aux renseignements que nous ont fournis les auteurs grecs et latins, confirmés par la lecture des inscriptions assyriennes.
Ces murailles immenses formaient une double enceinte dans la forme d'un carré très exact. La première de ces enceintes embrassait un territoire grand comme le département de la Seine ; dans la seconde, la plus petite, la ville de Londres eût tenu à l'aise. L'enceinte extérieure portait le nom d'Imgur Bel (que Bel le protège) ; la seconde le nom de Nivitti Bel (le séjour de Bel).
C'est ce qu'atteste la précieuse inscription de Nabuchodonosor.
«Imgur Bel et Nivitti Bel, voilà le grand mur de Babylone que Nabopolassar, roi de Babylone, le père qui m'a engendré, commença sans en achever la magnificence. Il fit les creusements ; deux fossés énormes furent construits, dont il limita les bords par du bitume et des briques. Il fit des fossés concentriques et il entoura de digues les bords de l'Euphrate ; mais il n'accomplit pas son oeuvre. Pour moi, je fis mesurer Imgur Bel, le grand mur de Babylone, l'inexpugnable, qu'aucun roi n'avait fait avant moi : 4000 mahargagars (72 000 pieds ou 120 stades, c'est le côté du grand carré de Babylone), voilà la superficie de Babylone. Je fis en guise de refuge inexpugnable, ce mur, le boulevard du soleil levant de Babylone. J'exécutai les creusements et les bords, je les bordai en bitume et en briques. Un autre grand mur, je le bâtis en deçà de celui-ci comme un renfort, je l'entourai de grandes portes».
Et, dans une autre inscription également traduite par M. Oppert, il ajoute ces détails intéressants :
«Babylone est le refuge du dieu Mérodach. J'ai achevé Imgur Bel, sa grande enceinte. Dans les seuils des grandes portes j'ai ajusté les battants en airain, des rampes et des grilles très fortes. J'ai creusé ces fossés, j'ai atteint le fond des eaux, j'ai construit les bords de la tranchée en bitume et en briques. Voulant préserver plus efficacement la pyramide et la défendre contre l'ennemi, et contre les attaques qui peuvent être dirigées sur Babylone l'impérissable, je fis construire en maçonnerie, dans les extrémités de Babylone, une seconde grande enceinte, le boulevard du soleil levant, qu'aucun roi n'avait fait avant moi. Je fis creuser les fossés et je consignai sur des barils la construction de ses bords. Tout autour je fis couler de l'eau dans cette digue immense de terre. A travers ces grandes eaux comparables aux abîmes de la mer, je fis faire un conduit ; j'ai fait murer ces grands fossés avec des briques, j'ai fait construire ce mur pour garantir les produits de la plaine de Babylone ; j'en ai fait un refuge pour les contrées de Soumir et d'Accad».
Telles furent, si nous en croyons le constructeur lui-même, ces murailles célèbres qui contenaient une enceinte assez grande pour suffire à la nourriture des populations assiégées. Aristote compare quelque part la grandeur de Babylone à celle du Péloponèse. Ce n'est point là une ville, dit-il, c'est plutôt une province. Quand Cyrus vint mettre le siège devant la capitale de la Chaldée il ne put s'en emparer qu'en dérivant le cours de l'Euphrate. Le mur solidement bâti et la ville bien approvisionnée lui eussent peut-être, sans cette hardie et coûteuse entreprise, résisté indéfiniment.
Quand Hérodote visita la contrée, ces murs existaient encore en partie. Il les décrivit à son tour. Le récit du Père de l'Histoire, sur lequel se bâtit toute la légende postérieure est bon à rapprocher des renseignements que nous a donnés l'inscription et que les études faites sur le terrain ont permis de vérifier.
«En Assyrie, dit Hérodote (I, ch. 178 et suiv.), il y a beaucoup de grandes cités entre lesquelles s'est trouvée Babylone, la plus fameuse et la plus forte de toutes après la destruction de Ninive. Cette ville est assise en une grande plaine, sa forme est carrée et porte à chacun des quatre fronts, cent vingt stades. Voilà quant à son enceinte. Au regard de l'architecture il faut que j'affirme que sur ce point c'est la plus belle ville que j'aie jamais vue, car premièrement elle est ceinte d'un fossé large et profond, et qui est plein d'eau ; la muraille est haute de deux cents coudées royales sur cinquante d'épaisseur : la coudée royale est plus grande que la moyenne de trois doigts.
Mais il convient de dire en quoi a été employée la terre qu'on a tirée du fossé et de quelle matière a été faite la muraille. A mesure qu'ils fouillaient ils`convertissaient la terre en briques, lesquelles ils cuisaient après en avoir moulé une grande quantité. Pour mortier, ils usaient de la vase ou limon nommé asphalte, lequel ils faisaient chauffer avant de le mettre en oeuvre. Ils maçonnèrent premièrement les bordures de la douve du fossé jusqu'à trente couches de briques entre lesquelles ils mettaient des lits de joncs cousus et entrelacés. Ils bâtirent après la muraille de mêmes matières. Sur le haut de celle-ci, près des entablements, ils firent des petites loges et échauguettes à l'opposite l'une de l'autre, laissant entre deux un espace pour la largeur d'un chariot. Cent portes percent cette muraille, lesquelles sont toutes de métal ainsi que leurs pivots, tourillons et architraves.
Le fleuve Euphrate divise la ville en deux parties, lequel coulant des montagnes d'Arménie se trouve large et profond et coule vers la mer Rouge avec une grande force. De l'un et l'autre bord la muraille jette ses arêtes bien avant dans celui-ci, auxquelles se relient des douves faites de briques, qui règnent le long de chaque bord. La ville est pleine de maisons à trois et quatre étages, elle est divisée par des rues droites et autres de telle sorte que celles qui la traversent aboutissent à la rivière : chaque rue a une poterne d'airain dans la muraille de la douve. Il y a autant de portes que de rues : elles sont toutes également d'airain et ouvrent sur le fleuve.
La seconde muraille, celle qui entoure la ville en dedans, n'est guère moins forte que la première, bien qu'elle soit plus étroite. Il y a une clôture au milieu de l'une des parties de la ville où est bâti le palais royal ; celui-ci est entouré d'une grande et forte muraille. Dans l'autre partie est le temple de Jupiter».
Ces superbes murailles concentriques ne durèrent pas longtemps après la conquête persane. Quoique les rois de la nouvelle dynastie prissent plaisir à habiter la fastueuse ville, ils avaient trop lieu de craindre l'insoumission de ses habitants pour lui laisser toute sa force. Entamé par Cyrus, dépouillé par Darius, à demi renversé par Xerxès, le mur extérieur n'existait plus vers le quatrième siècle avant notre ère. Jérémie dit, et la prédiction devait s'accomplir : «Les murs de la grande Babel seront rasés jusqu'aux fondements et ses hautes portes seront brûlées par le feu».
Le mur de l'intérieur dura plus longtemps, peut-être jusqu'à l'époque d'Alexandre ; mais les projets que le conquérant de l'Asie conçut au sujet du rétablissement de la ville dans son ancienne splendeur, ces projets moururent avec lui. Aujourd'hui une masse de briques entassées, des tumulus vagues et que leur direction suffit seule à caractériser en sont les traces uniques ; et c'est au milieu de ruines informes qu'il faut chercher les restes des constructions que les Nabuchodonosor élevaient pour l'éternité. «C'est la vengeance du Seigneur».
 |
Au milieu même de ces ruines, à une distance assez grande de la ville de Hillah, dans une situation qui correspond à peu près à l'un des angles du grand quadrilatère formé par la muraille, une masse énorme attire l'oeil vers le sud, comme une autre masse, Babil, attire d'autre part, vers le nord. Là encore le nom moderne éveille la curiosité : c'est le Birs-Nimroud (Tombeau de Nemrod). Cette curiosité se change en une attente anxieuse quand on sait que l'on a devant soi ce qui reste de la Tour de Babel.
«Pour aller au Birs-Nimroud, la route, dit M. Oppert, n'inspire pas un grand intérêt ; mais ce qui domine l'esprit du voyageur, c'est l'aspect de l'immense ruine que l'on aperçoit bien loin au delà de l'Euphrate à partir du Kasr-Ikenderich, à moitié chemin entre Bagdad et Babylone. Le Birs-Nimroud apparaît bientôt après la sortie de Hillah, comme une montagne que on croit pouvoir atteindre immédiatement et qui recule toujours. Mais l'effet est bien plus saisissant quand l'atmosphère - et c'est le cas, à la pointe du jour et vers le soir, - est obscurcie par le brouillard. Alors on ne voit rien pendant une heure et demie ; tout à coup, le brouillard semble se déchirer comme un rideau et fait entrevoir la masse colossale du Birs-Nimroud, d'autant plus intéressante que son aspect frappe de plus près et d'une manière complètement inattendue».
Combien l'intérêt s'accroît si l'on sait que cette ruine imposante n'est rien autre chose que la Tour de Babel elle-même !
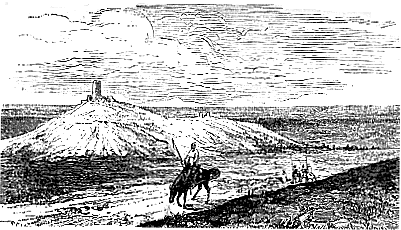 |
Le Birs a encore aujourd'hui 46 mètres de hauteur. Des pans de murs, des débris de briques cuites, des blocs vitrifiés ne cubant pas moins de cent mètres, des éboulements à demi calcinés attestent l'immensité du monument, et la grandeur de la chute dans laquelle il a péri.
Un pan de mur, le plus important de tous, a encore 11 mètres et demi de hauteur sur 8 mètres de largeur. On peut y reconnaître la nature des matériaux et le soin apporté dans la construction. Briques rouges, ciment blanc et roseaux interposés répondent bien aux descriptions laissées par les anciens. Tout autour de la masse générale, des éboulements partiels sèment la plaine et forment une montueuse surface de poussière rouge et de briques en fragments. Le pourtour de la ruine à la base est de 700 mètres.
Les recherches de M. Oppert complétées plus tard par le colonel Rawlinson, amenèrent les découvertes les plus curieuses. Elles établissaient d'une façon inéluctable que le Birs Nimroud n'était rien autre chose que le temple des sept lumières de la Terre, la Tour que Nabuchodonosor se vante d'avoir restaurée (après une première et ancienne destruction), la maison éternelle de Borsippa, le sanctuaire d'Apollon et d'Artémis, de Strabon et d'Arrien, la tour d'Hérodote qui était, à Borsippa, considérée encore comme faisant partie de Babylone, en un mot le monument élevé sur l'emplacement et peut-être sur les bases de la Babel biblique.
«Mais il n'y avait sur la terre qu'une seule langue que tous les hommes parlaient. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans 1e pays de Sennaar et ils y habitèrent. Et ils se disaient les uns aux autres : «Allons, faisons des briques et cuisons-les dans le feu». Ils eurent donc des briques au lieu de pierres et se servirent de bitume au lieu de ciment et ils disaient : «Allons, faisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre».
Et Yahveh descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme.
Et Yahveh dit : «Voici, ils sont un seul peuple, et une seule langue est pour tous, et ceci est le commencement de leurs oeuvres, et maintenant rien ne les empêcherait plus d'accomplir ce qu'ils auraient projeté.
Allons ! descendons et confondons leur langage, que l'un n'entende plus le langage de l'autre».
Et Yahveh les dispersa de là sur la surface de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville.
C'est pour cela qu'on l'appela du nom de Babel, parce que là Yahveh confondit le langage de toute la terre et de là Yahveh les dispersa sur toute la surface de la terre».
Hérodote à son tour avait donné de curieux détails sur le grand temple de Jupiter (Belus), l'honneur de Babylone. Il l'avait vu lui-même. C'était selon lui une série de tours superposées, en retrait les unes sur les autres. Au haut de l'édifice était construit un temple. Dans ce temple un lit en or et une table en or étaient toujours préparés, attendant la visite du dieu. En bas de l'édifice, il y avait un autre temple, où sur un autel se faisaient les sacrifices. Tout cela était couvert d'ornements et de lames en or que Xerxès enleva et fit fondre lors de la conquête.
Ce sanctuaire subsista longtemps encore. Il était situé dans une sorte de faubourg de Babylone qui s'appelait Borsippa (Borsif). La tradition du moyen-âge indiquait ce lieu comme celui où les langues s'étaient confondues, et les Talmudistes, qui perpétuèrent à Babylone le seul souvenir de la civilisation ancienne, rattachaient l'étymologie du nom de Borsippa à cette idée de la confusion des langues (Balal, sefah).
Le Borsippa de l'antiquité est certainement le Birs-Nimroud actuel. De plus la forme des ruines et jusqu'à certains détails des briques coloriées, rencontrées aux différents étages du massif répondent bien aux descriptions des anciens auteurs.
Tant de rapprochements curieux poussaient à reconnaître dans les ruines du Birs les restes mêmes du temple de Belus et l'emplacement de la tour de Babel. Les inscriptions trouvées dans les ruines ne firent que confirmer ces hypothèses.
M. Rawlinson trouva et M. Oppert publia le premier cette inscription désormais fameuse où Nabuchodonosor célèbre la fondation de l'édifice. Les passages les plus importants étaient traduits ainsi qu'il suit :
«Nabuchodonosor roi de Babylone, pasteur des peuples, etc... Nous disons, Mérodach, le grand seigneur, m'a lui-même engendré, il m'a enjoint de reconstruire ses sanctuaires... Le premier édifice qui est le temple des assises de la terre et auquel se rattache le plus ancien souvenir de Babylone, je l'ai refait et terminé en briques et en cuivre, j'en ai relevé le faîte.
Nous disons pour l'autre qui est cet édifice-ci, le temple des sept lumières de la terre (les sept planètes) et auquel remonte le plus ancien souvenir de Borsippa ; un roi antique le bâtit (on compte de là quarante-deux vies humaines). Mais il n'en éleva pas le faîte. Les hommes l'avaient abandonné depuis les jours du déluge, en désordre proférant leurs paroles. Le tremblement de terre et le tonnerre avaient ébranlé la brique crue, avaient fendu la brique cuite des revêtements ; la brique crue des massifs s'était éboulée en formant des collines. Le grand dieu Mérodach a engagé mon coeur à le rebâtir. Je n'en ai pas changé l'emplacement, je n'en ai pas altéré les fondations. Dans le mois du salut, au jour heureux, j'ai percé par des arcades la brique crue des massifs et la brique cuite des revêtements. J'ai ajusté les rampes circulaires ; j'ai inscrit la gloire de mon nom dans les frises des arcades.
J'ai mis la main à reconstruire la tour, et à en élever le faîte ; comme jadis elle dut être, ainsi je l'ai refondue et rebâtie : comme elle dût être dans les temps éloignés, ainsi j'en ai élevé le sommet».
On voit assez combien cette inscription, dans les termes de la traduction de M. Oppert, devait éveiller l'attention générale. Ne dût-on y reconnaître que la communauté d'origine des légendes juives et chaldéennes, que le résultat appliqué à un fait si précis et si grave eût été des plus importants. On le remarquera, ce n'était plus seulement la question de l'existence de la Tour de Babel qui était résolue par ce nouveau document ; c'était le fait même de la dispersion des peuples à la suite de la confusion des langues. Certes l'affirmation d'un fait si grave, émanant des deux sources si diverses, si anciennes et si respectables, ne pouvait manquer de tenir une grande place dans l'histoire des civilisations anciennes et dans la théorie des origines du langage.
Malheureusement la traduction proposée par M. Oppert était peut-être un peu prématurée, et le parti qu'on en tira aussitôt dans des livres de polémique l'était plus encore. Une traduction nouvelle fut bientôt proposée, elle rallia tous les suffrages, même celui de M. Oppert. Voici cette nouvelle traduction. Peut-être n'est-elle pas encore exempte de quelques défauts, mais les points principaux ont été livrés à une discussion assez étroite pour qu'on les considère désormais comme acquis à la science :
«Nabuchodonosor, etc. Je dis ceci : Le temple des sept lumières de la Terre, le Zigurrat de Barsippa, fut bâti par un roi ancien. Il couvrait 40 mesures de terre ; mais il n'en éleva pas le faîte. Les hommes l'avaient abandonné depuis le jour de l'inondation, dont ils n'avaient pas dirigé le cours. La pluie et les orages avaient dispersé les ouvrages d'argile, et les revêtements de ses murs. L'argile s'était effondrée avec la terre et formait un monceau de ruines. Le grand dieu Marduk a excité mon coeur à le rebâtir. Je n'ai pas changé l'emplacement. Je n'ai pas touché à son timin. J'ai mis la main à cette reconstruction ; j'ai élevé le faite (de l'édifice) ; je l'ai fondé. Je l'ai reconstruit, comme il était jadis, comme il était dans les temps anciens et j'en ai élevé le faîte».
On le voit, plus de traces, maintenant, de déluge ou de confusion des langues ; l'un est devenu l'inondation habituelle de l'Euphrate ; l'autre la négligence non moins habituelle des hommes. Les quarante-deux vies humaines sont devenues des mesures de longueur. Tout le reste du document, sans être absolument transformé, a pris ainsi, détails par détails, une signification tout autre, et d'ailleurs parfaitement raisonnable.
Peut-être devant cette explication, l'idée de la Tour de Babel rentre dans le domaine de la légende ; mais il reste toujours, et c'est assez pour l'histoire, le souvenir d'un des plus anciens monuments de la Chaldée et de la reconstruction entreprise par Nabuchodonosor.
En rapprochant les renseignements fournis par les inscriptions de l'état actuel de la ruine et des récits des anciens auteurs, M. Rawlinson a pu essayer une restauration du Temple des sept lumières, ou des sept planètes. C'était, comme nous l'apprend Nabuchodonosor lui-même, une Zigurrat.
On appelait ainsi un genre de monuments, spécial à la Chaldée, dont l'ensemble formait une pyramide à étages, composée d'une série de terrasses superposées, en retraite l'une sur l'autre, la dernière plate-forme portant le sanctuaire de la divinité. Un de ces édifices, représentés sur les bas-reliefs de Babylone, a permis de se faire une idée très exacte de leur forme habituelle. Chacun des étages - ici au nombre de sept, - était consacré à une divinité spéciale, - ici chacune des planètes. - Des couleurs diverses étaient consacrées à chacune d'entre elles et devaient être ici appliquées à chacun des étages successifs. C'était en partant de la base et en s'élevant progressivement : le noir pour Saturne, le blanc pour Vénus, l'orange pour Jupiter, le bleu pour Mercure, l'écarlate pour Mars, l'argent pour la Lune, et enfin l'or pour le Soleil. C'était à ce dernier dieu, le Bélus, le dieu suprême et comme la clef de voûte de l'Olympe babylonien que le temple, en somme, était dédié. C'était là que ses prêtres rendaient leurs oracles ; c'était là que s'accomplissaient les mystères trop souvent obscènes de la magie chaldéenne.
De tous les monuments babyloniens ce temple devait, si l'on en juge par la masse des ruines et par l'usage, être le plus important. Par suite de la légende qui s'y trouva quelque temps attachée ce fut, de tous, celui vers lequel l'attention de la science se porta principalement. De tous aussi c'était le seul qui pût montrer encore des ruines ayant quelque forme, et dont les descriptions anciennes eussent entre elles quelque concordance.
On le voit, cependant, que d'incertitudes encore sur le caractère et l'aspect général du monument ! combien peu nous suffisent ces seuls restes de tant de splendeurs qui sont parvenus jusquà nous. Est-ce là ce grand sanctuaire, sont-ce là ces monuments merveilleux, est-ce là cette Babylone, «l'ombilic du monde», celle dont le nom est encore le synonyme du luxe le plus effréné et de la civilisation la plus raffinée ?
Si le poète trouve dans ces débris une si vaine et si rare pâture à sa curiosité, l'archéologue n'y rencontrera-t-il point quelque satisfaction plus complète ? Une colonne, un torse, un bas-relief à demi rongé suffit pour révéler à son oeil attentif les principes d'un art ancien, et l'idéal que d'autres hommes ont essayé de réaliser. Mais à Babylone, pas même une colonne, pas un bas-relief, pas un fragment satisfaisant d'une oeuvre d'art importante.
C'est à peine, si de tant de recherches on a pu tirer cette unique conclusion certaine qui nous permet de nous représenter l'aspect des édifices de Babylone. Les édifices de cette capitale avaient une grande ressemblance avec ceux de Ninive ; ils ne devaient être que les produits d'une évolution dans un art dont les principes restaient au fond absolument identiques.
C'est donc à Ninive qu'il convient de retourner maintenant, et c'est dans les ruines de cette ville que nous chercherons les véritables modèles des anciennes constructions et la théorie complète de l'idéal rêvé par les artistes d'Assyrie et de Chaldée.
Notre intention n'est nullement, d'ailleurs, de donner ici un tableau exact et complet de l'ancienne ville. Nous ne le pourrions pas. Si heureux qu'aient été sur ce point les résultats des fouilles et des études qui les ont suivies, on ne peut dire absolument que Ninive soit sortie de ses cendres, et qu'on puisse se faire une idée exacte de son état ancien. On discute même encore sur la véritable étendue de la ville, qui, semble-t-il, devait contenir plusieurs villes séparées par des champs et par des plantations, mais entourées d'une seule et immense circonvallation.
Ce que nous voulons c'est essayer de présenter une idée des arts et des moeurs du second empire assyrien, dont les rois les plus glorieux vécurent quelque huit siècles avant notre ère, et furent les contemporains des premiers successeurs de Salomon.
Le tableau que nous allons faire, nous l'emprunterons surtout au livre de M. V. Place. M. V. Place, complétant les recherches de M. Botta, put retrouver dans son ensemble et dans ses détails les restes encore majestueux du palais du premier des Sargonides, Saryoukin ou Sargon, le père du Sennachérib de la Bible.
Ce sont les restes de ce palais qui font en ce moment la plus belle partie de la collection des antiquités assyriennes du Louvre ; collection bien incomplète, malheureusement, par suite du déplorable succès des envois de M. Place lui-même, mais suffisante encore pour donner une idée de l'idéal que concevaient les anciens artistes assyriens, et de la perfection relative qu'ils atteignaient dans l'exécution. Les remarques et les résultats de MM. Botta et Place se complètent par les travaux de M. Layard. C'est à ces différents livres que nous renverrons, pour autoriser l'exposé très incomplet que nous allons faire, et pour en combler toutes les lacunes.
Nous avons dit déjà qu'il y avait plusieurs causes à la disparition presque complète des anciens édifices de cette région. Celle de toutes qui leur fut la plus fatale, fut certainement la nature même de leurs constructions. A Babylone, dans un pays de plaines alluviales, l'absence absolue de carrières réduisit les habitants à ne faire usage dans leurs constructions que de la brique cuite au soleil. Cette habitude une fois prise, elle s'étendit à tous les peuples de ces contrées qui prenaient à tâche d'imiter les splendeurs de la grande ville chaldéenne.
A Ninive même, où la pierre se trouvait en assez grande abondance, on s'en servit peu. On la réserva pour les motifs d'ornementation et de sculpture, pour tracer des lignes architecturales, pour former les linteaux des rares fenêtres percées dans la masse.
L'ensemble des constructions, même des plus splendides, fut en briques. La nature particulière de cet élément, sa division, sa légèreté, et par contre son émiettement et sa destruction facile donnèrent à l'architecture assyrienne un caractère tout à fait particulier. L'ensemble est massif. Pas de ces lignes hardies et élancées, pas de ces colonnades à jour, pas de ces architraves à longues portées qui donnent à l'architecture égyptienne et surtout à l'architecture grecque tant de jour et tant de mouvement. Le support isolé n'existe pour ainsi dire pas. Le mur est tout ; et ce sera dans la construction et l'ornementation du mur, partie géneralement négligée et dédaignée, que brillera tout le savoir-faire et tout l'art des architectes assyriens.
Cette brique, cause d'infériorités manifestes, devient pour eux un sujet d'efforts nouveaux et le motif d'une ornementation peu durable peut-être, mais extrêmement éclatante. Ils deviennent excellents constructeurs, pas, la nécessité où ils sont de construire bien pour éviter une ruine rapide. Ils trouvent la voûte, que les Grecs n'ont pas connue, et qui ne reparaîtra que bien tard dans le progrès de l'architecture européenne. Ils trouvent même l'arc brisé ou ogive qui est de toutes les formes d'arcs le plus léger à la fois et le plus résistant.
Ces prodiges de construction sont revêtus de prodiges de décoration empruntés à tout ce que l'ornement polychrome peut fournir de plus éclatant et de plus splendide. On revient beaucoup de nos jours à l'emploi des terres cuites peintes et décorées. Or ce mode de décoration a été employé déjà avec tout l'art, avec tout le raffinement imaginable ; et ç'a été par ces anciens Chaldéens et Assyriens dont les constructions depuis plusieurs milliers d'années dormaient sous la poussière, cachant dans leurs ruines les exemples dont nous nous instruisons aujourd'hui.
Examinons un des monuments les plus importants conçus dans cet esprit. C'est le palais de Khorsabad bâti vers l'an 706 av. J.-C. par les prisonniers de guerre que le roi Sargon avait ramenés de ses conquêtes. M. Botta en a découvert le premier l'emplacement et les ruines en 1845, et l'expédition dirigée par M. V. Place à partir de 1850 a achevé l'oeuvre du premier explorateur. Les recherches de M. Place ont été conduites d'une manière si heureuse qu'elles lui ont permis de déterminer jusque dans les moindres détails la physionomie de l'édifice et de ses environs. On a pu même, à l'aide des bas-reliefs assyriens qui représentent fréquemment des palais et des citadelles, tenter une restauration complète de l'édifice, restauration qui laisse peu de place à l'arbitraire.
 |
Khorsabad était à la fois le château et la forteresse, l'arx d'une ville qui semble elle-même avoir été construite d'un seul jet. Nous l'avons déjà dit, et nous le répétons, Khorsabad, par sa construction, sa destination et le faste qui y régnait présente plus d'un trait de ressemblance avec Versailles. Le roi Sargon dans une inscription qui a été retrouvée parmi les ruines et déchiffrée, explique lui-même le but qu'il s'est proposé. «Au pied des monts Mousri, dit-il, pour remplacer Ninive, je fis d'après la volonté divine et le désir de mon coeur une ville que j'appelai Hisir-Sargon. Je l'ai construite pour qu'elle ressemble à Ninive, et les dieux qui règnent dans la Mésopotamie ont béni les murailles superbes et les rues splendides de cette ville. Pour y appeler les habitants pour en inaugurer le temple et le palais où trône sa majesté, j'ai choisi le nom ; j'ai tracé l'enceinte et l'ai tracée d'après mon propre nom.
Ainsi, on le voit, cette ville nouvelle était destinée à remplacer Ninive, elle-même déjà en décadence. Sur une énorme motte amassée de main d'homme, on construisit une immense enceinte de forme géométrique flanquée de cent soixante-sept tours qui, si nous en croyons les représentations des bas-reliefs anciens, étaient couronnées de créneaux dentelés, et percées d'archéres seulement à leur partie supérieure.
 |
L'importance de ces murailles elles-mêmes n'était en rien inférieure à l'idée que nous avaient donnée des fameuses murailles de Babylone, les récits des anciens que l'on aurait pu croire exagérés. Hautes de 25 mètres, larges de 24, elles formaient comme une immense route hérissée de créneaux tout autour de la place. Une armée entière pouvait s'y ranger en bataille et les chars y défiler par sept ou huit de front.
A une hauteur de plus de 40 mètres encore, s'élevait la citadelle ou le palais qui dominait toute l'enceinte. Avec ses proportions géométriques, il devait faire un effet plus singulier et plus étonnant encore. Il était à cheval sur la muraille d'enceinte et formait un rectangle dont une moitié mordait dans la ville et dont l'autre moitié s'étendait sur la campagne. Des fausses portes communiquaient même avec le dehors. On accédait à l'entrée principale par un chemin en pente douce tout entier bâti de main d'homme, et que l'on pouvait couper. Ainsi dans ce tas énorme de briques prenant peu de jour sur le dehors, monté sur un soubassement à pic, et dont l'épaisseur fatiguait le travail des machines de guerre les plus puissantes, au fond de en palais inaccessible, résidaient ces monarques assyriens qui étonnaient et terrifiaient l'Asie.
D'ailleurs dans l'enceinte même du palais, rien ne manquait aux besoins du roi, ni à ses plaisirs. Le palais était grand à la fois comme le Louvre et les Tuileries ; à l'intérieur, des cours étaient ménagées pour les exercices des troupes et le déploiement des pompes triomphales. Plus de deux cent salles étaient disposées dans le massif et prenaient jour sur les cours intérieures. M. Place a cru reconnaître que ce palais était divisé en cinq parties principales : le Sérail, où se tenait le roi au milieu de sa cour ; le Harem, où les femmes étaient enfermées sous la garde des eunuques, par un usage encore habituel en Orient : l'Observatoire, au haut duquel s'élevait le temple du plus grand dieu de l'Assyrie, Bal ou Bel. La description que nous avons donnée de la tour de Babel peut s'appliquer dans des proportions moindres à cet Observatoire.
L'Observatoire dominait la quatrième partie du palais assyrien, le Temple. La cinquième partie, très vaste, très importante formait les dépendances. C'est là que M. Place a pu reconnaître les magasins, les cuisines, les écuries, les salles de manège, les boulangeries, les pressoirs et tout ce qui servait à la vie du roi lui-même et de la nombreuse population de ce palais.
Nous n'avons rien dit jusqu'ici de l'ornementation de cet imposant édifice.
De ce que la brique à peu près seule fut employée dans la construction, il ne faut pas conclure que l'aspect général fût sombre. A l'extérieur comme à l'intérieur, le luxe le plus éclatant présidait à la décoration. Depuis le ras du sol jusqu'à une hauteur de trois mètres environ, régnait tout autour de l'édifice un superbe cordon de bas-reliefs où se déroulait la représentation des exploits du roi et de ses triomphes. Cette magnifique bande de sculptures aboutissait, à chaque entrée, à de colossales statues rangées deux par deux ou quatre par quatre, et qui représentaient ces taureaux à tête d'homme, à ailes d'aigle, dont on peut voir deux magnifiques spécimens dans les galeries du Musée du Louvre.
|
C'est dans la représentation de ces taureaux divins dont les visages étaient, comme on le sait, les visages des rois, que s'épuisait le dernier effort des sculpteurs assyriens. C'est devant eux que l'on ressent tout entière l'impression de force et de majesté sombre qui se dégage en dernière analyse de l'étude des débris de cette civilisation mystérieuse. Un habile critique d'art, M. Maurice Joly, dit en parlant de ces colosses : «C'est dans ces splendides monolithes que l'art assyrien semble avoir atteint ses dernières limites. Ce n'est certes ni la variété inépuisable, ni la forme si vivante et si naturelle de l'art grec. C'est un travail marqué d'un sceau à part et qui en fait le principal charme à nos veux ; c'est la force et l'effet obtenus par l'économie des moyens. On ne voit pas le moindre tâtonnement de ciseau dans le modelé de ces flancs gigantesques, dans ces vastes poitrails d'animaux humains ; le détail y est rendu par quelques traits d'une concision, d'une sûreté de main incomparables. On ne trouve pas dans l'exécution des taureaux ces lourdeurs de forme, ce manque de mouvement et ce faire de convention qui se remarquent dans les bas-reliefs. Là, tout est net, tout est puissant, tout ressort avec la plénitude d'un art qui ne connaît pas d'entrave». |
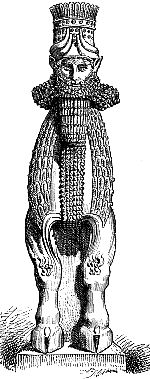 |
Les sculpteurs assyriens étaient surtout des animaliers. Leurs lions, leurs chevaux, leurs dromadaires, n'ont pas été dépassés. Ils réussissaient généralement moins bien dans les scènes où la représentation de l'homme joue le principal rôle. Dans leurs bas-reliefs l'absence absolue de perspective qui fait que les sujets grimpent pour ainsi dire et s'étagent les uns au-dessus des autres produit au premier abord un effet choquant. Mais il n'est pas moins vrai que quand on les regarde avec attention la réalité et le naturel des images, la finesse et l'élégance réelle de certains détails, et surtout la richesse et la majesté de l'ensemble produisent une grande impression.
Nous emprunterons à M. Place lui-même, la magnifique description qu'il a faite des bas-reliefs de Khorsabad. Personne n'est plus compétent et n'a pu s'exprimer plus heureusement que celui qui a assisté à la résurrection de ces antiques débris et qui les a vus sortir de terre tels qu'ils s'étaient enfouis, il y a plus de deux siècles et demi.
«En considérant l'ensemble des bas-reliefs d'un palais ninivite, on ne peut mieux le comparer qu'à un poème épique célébrant la gloire du fondateur. C'est lui le héros de ces longs récits ; et il est toujours en scène et tout s'y rapporte à sa personne. Comme dans les poèmes écrits, l'épopée débute par une sorte d'invocation aux esprits supérieurs représentés par les figures sacrées qui occupent les seuils. Après cette pensée donné aux génies protecteurs de l'Assyrie on passerait à la narration elle-même. Pendant de longues lie ures, l'intérêt se trouvait surexcité par une succession d'épisodes émouvants. Peuples de soldats, les Ninivites se complaisaient dans ces souvenirs qui flattaient l'amour-propre du prince et entretenaient l'esprit belliqueux de la nation.
Les façades les plus longues du palais, celles des cours et des grandes galeries qui s'offraient les premières sur l'itinéraire des visiteurs, sont vouées de préférence aux manifestations de la pompe souveraine. Ces cérémonies exécutées presque toujours dans des proportions colossales, montrent de longues files de prisonniers ou de tributaires se dirigeant vers le monarque. Celui-ci, reconnaissable à la place qu'il occupe, à son entourage, à ses insignes, à son attitude, reçoit ces hommages avec un calme, ou pour mieux dire, avec une placidité presque dédaigneuse. Il est tantôt debout, tantôt assis sur son trône, entouré de ses officiers et de ses serviteurs. Les personnages s'y suivent processionnellement sans confusion, sans précipitation et gardent quelque chose de cette froideur hautaine qui devait signaler les réceptions royales.
C'est plus loin, dans des salles plus petites et sur une plus petite échelle que le drame commence et que l'artiste manifeste plus d'entrain, de verve et d'invention. Marches, batailles, escalades de montagnes, constructions de digues, passages de rivières, se suivent nombreux et pressés, racontés en quelques traits expressifs. Ici, la mêlée est terrible et les guerriers luttent corps à corps ; là, couverts de boucliers, ils combattent à distance avec l'arc et la fronde, l'air est sillonné de flèches et de projectiles ; plus loin les blessés et les morts jonchent le sol ou sont précipités dans les flots, ou écrasés sous les roues des chars ; on voit même des vautours qui déchirent les entrailles des cadavres.
Le roi prend part au combat, quelquefois à pied ou à cheval, le plus souvent sur un char attelé de coursiers magnifiques. Parfois un dieu figuré dans un disque ailé, ou bien un aigle qui plane au-dessus de la tête du monarque, semble prendre parti pour les Assyriens. Ailleurs c'est une ville attaquée. L'assaut se prépare ; les machines de guerre battent la muraille ; les mineurs creusent la maçonnerie ; les assiégés se défendent encore avec des pierres, des liquides brûlants, des torches, des chaînes pour détourner les machines ; ou enfin, réduits à la dernière extrémité, les mains levées au ciel, ils implorent la clémence des vainqueurs ; mais ceux-ci sont impitoyables ; on les voit, chargés de butin, chasser devant eux des hordes de prisonniers, parmi lesquels se pressent, pêle-mêle, des hommes et des femmes, traînant leurs enfants par la main ou les portant sur leurs épaules, suivis de leurs troupeaux et prenant le chemin de l'exil pour aller travailler aux monuments que le vainqueur élèvera bientôt en souvenir de cette nouvelle conquête.
Voici, en effet, le roi lui-même qui préside à la construction du palais. Il commande, et ses soldats, le bâton levé, surveillent sur le chantier une multitude d'esclaves qui pétrissent l'argile, façonnent la brique et la transportent sur leurs épaules. Le monticule artificiel s'élève et déjà les monolithes gigantesques sont traînés péniblement par de longues files de travailleurs attelés ; puis ce sont de nouvelles guerres, de nouveaux triomphes : l'artiste ne se fatigue jamais de ces images et trouve toujours une manière nouvelle de les traiter. Et toujours quelle réalité saisissante !
Après le carnage de l'action, on assiste à des vengeances impitoyables. Ce sont des prisonniers écorchés vifs, sciés en deux, empalés, mis en croix, ou qui ont la tête tranchée en présence du monarque pendant qu'un scribe impassible inscrit froidement sur un papyrus le compte des têtes qui s'amoncèlent. Comme dernier trait, pour peindre ces conquérants barbares, le roi, de sa propre main, crève les yeux d'un captif qu'on lui amène un anneau passé dans les lèvres. Narrateur fidèle, le sculpteur ne cherche jamais à atténuer les horreurs qu'il présente et qui du reste étaient racontées tout au long dans les inscriptions. Il les exprime avec une brutalité naïve bien propre à nous faire comprendre la terreur qu'inspiraient les Assyriens, et dont les livres saints contiennent tant de témoignages.
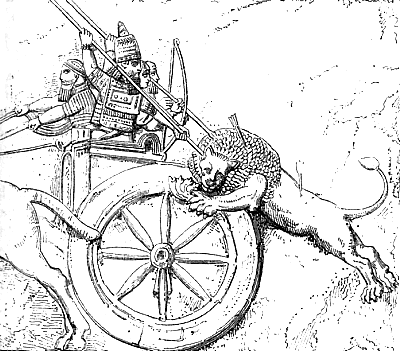 |
Après les tableaux héroïques les scènes de chasses occupent le premier rang. Les souverains assyriens, dignes enfants de Nemrod, ont manifesté une grande passion pour cet exercice violent, véritable diminutif de la guerre. On voit dans les bas-reliefs de Koyoundjik le roi chassant la gazelle, l'hémione, le cerf, et principalement le lion qui, à en juger par la multiplicité des tableaux, devait être le gibier qu'il préférait. En char, à cheval, à pied, il poursuit lui-même les animaux ; il manie la pique, le javelot, l'arc et la flèche avec assurance et c'est presque en se jouant que parfois, le poignard à la main, il semble vaincre ses redoutables adversaires.
A la fin, fatigué de carnage, il offre aux dieux les prémices de sa chasse, ou bien il se livre au repos. On le voit retiré au fond du harem, à demi couché sur un lit somptueux devant une table chargée de mets. La reine, assise en face de lui, prend part au festin. La fête est égayée par de jeunes esclaves accompagnant leurs voix des accords de la harpe, l'instrument préféré des poètes bibliques. Mais ce tableau, tiré de Koyoundjik, n'a pas été vu à Khorsabad où le terrible Sargon n'apparaît jamais que dans l'éclat de sa majesté royale.
D'autres bas-reliefs nous font assister au détail de la vie privée de ses sujets. Des intérieurs de villes ou de maisons mis à découvert en vertu d'une coupe géométrale très singulière nous montrent les Assyriens occupés des soins les plus vulgaires de leur ménage, dressant les lits, faisant rôtir les viandes, pansant les chevaux et se livrant à divers métiers ; ou bien ce sont encore des gens en marche avec leurs chariots remplis par des familles, chargés de grains, d'objets divers, et traînés par des boeufs où il nous semble reconnaître la race des boeufs à bosse de l'Inde ; ou bien encore, c'est une halte dans laquelle les animaux dételés se reposent et mangent pendant que les hommes portent la main à un plat ou boivent dans des outres.
Au-dessus de ces bandes de bas-reliefs dont l'effet d'ensemble vient d'être décrit régnait un autre ruban décoratif emprunté à un élément absolument original et spécial à l'art syrien. C'était une double rangée de briques émaillées à fond bleu sur lesquelles ressortaient des sujets représentant des ornements empruntés à la vie végétale ou animale.
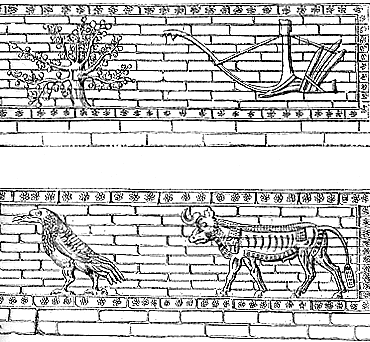 |
On y retrouve en particulier très fréquemment la mystérieuse pomme de pin que l'on voit à la main des colosses royaux ou divins. Cette partie de l'ornementation présente chez les Assyriens le plus grand intérêt et la plus grande originalité. Les animaux affrontés, les fleurs de convention alternés avec la plus remarquable variété d'effet et pureté de dessin méritent d'être signalés.
On a même cru reconnaitre dans la disposition de ces ornements l'origine de certains motifs chers à l'art grec et qu'il répéta souvent. M. Ferguson a pu écrire, non sans motif plausible : «Ce dont il est impossible de douter est que ce qu'il y a d'Ionique dans les arts de la Grèce a son origine dans les vallées du Tigre et de l'Euphrate».
Au-dessus de la bande de briques, enfin, le reste de l'édifice était revêtu d'un stucage blanc qui par endroits était couvert des plus riches peintures à fresque.
On comprend maintenant quel effet pouvait produire à l'extérieur la contemplation à la fois écrasante dans la masse, variée et amusante dans les détails, du palais d'un roi assyrien.
Ces bas-reliefs et ces peintures représentaient au peuple des faits tirés de sa propre histoire. S'il y voyait le roi toujours au premier rang dans les images, comme il avait été au premier rang dans les batailles, il y retrouvait aussi ses propres exploits glorifiés et le détail de sa vie journalière représentée avec la plus fidèle exactitude.
C'est là que nous avons pu recueillir à notre tour les renseignements les plus précis sur la vie habituelle et sur les moeurs de ces peuples étranges. Nous y avons retrouvé leur mythologie singulière qui tient d'ailleurs dans les décorations une place beaucoup moins grande que dans celle des Egvptiens. On pense cependant que la conception qu'ils ont eue de la divinité et les représentations diverses qu'ils en ont faites n'a pas été sans influence sur la religion et sur l'art des Hellènes. L'adoration des astres jouait un rôle important chez un peuple qui dès la plus haute antiquité avait constitué l'année lunaire et composé le zodiaque. L'idée d'un dieu unique et roi des autres dieux Bel ou Bal, Dieu saint et pur comme le feu, planait sur cette théologie bizarre, fruit des conceptions des prêtres et des mages assyriens et chaldéens.
Nous n'avons pas à revenir ici sur l'habitude de la guerre qui faisait comme le fond de la vie de ces peuples, la description même des bas-reliefs que nous avons empruntée à M. Place donne sur ce point les détails les plus complets et les plus curieux.
L'industrie, le commerce, l'agriculture s'étaient développés d'une façon remarquable sous la protection vigilante des grands conquérants. Le monde asiatique tout entier tournait pour ainsi dire autour de Babylone, c'était là qu'aboutissaient les longues files de caravanes qui apportaient à cette capitale les produits des terres étrangères. Tout le cours du Tigre et de l'Euphrate fut canalisé ; la vallée n'ayant pas d'inondation comme celle du Nil, l'eau fut répandue dans les campagnes à force de bras ou au moyen de machines hydrauliques.
La terre ainsi travaillée ne se montrait point ingrate. Hérodote qui avait visité le pays dit : «Les feuilles du froment et de l'orge ont bien quatre doigts de large. Quoique je n'ignore pas quelle hauteur y atteignent les tiges du millet et du sésame je préfère n'en rien dire : ceux qui n'ont pas été dans la Babylonie ne me croiraient pas. Par contre le pays n'a ni figuier, ni vigne, ni olivier ; il est couvert de palmiers et la plupart portent des fruits».
|
Une telle abondance de tous les produits de la terre, un commerce si étendu qui amenait dans les capitale des grands Empires les richesses des pays étrangers ; 1'activité industrieuse des sujets et des esclaves, une longue tradition d'art et de procédés conservée par les progrès faits dans toutes les sciences et notamment dans l'astronomie, l'agronomie, la médecine, etc. ; l'usage antique de l'écriture, l'habitude de conserver dans les palais et peut-être dans les maisons particulières des bibliothèques faites de briques de terre cuite sur lesquelles étaient gravés des caractères cunéiformes ; tant d'éléments, de progrès divers et combinés avaient poussé à un haut degré de splendeur les civilisations ninivite et babylonienne. Pour Ninive, ses restes mêmes, si abondants en monuments, en sculptures, en peintures, en objets de prix, en objets usuels, convainquent par la vue même des choses. Pour Babylone, la seule réputation qu'elle a laissée, si bien que son nom est encore le symbole d'un luxe effréné, confirme plus encore, s'il est possible, les renseignements un peu plus rares que les fouilles ont produits au grand jour. D'ailleurs les ruines des villes voisines Warka (Orchoé), Kutha, Niffer, abondantes en poteries, bijoux, pierres artistement travaillées, objets en verre et en bronze complètent l'idée que l'on peut se faire de la capitale. |
 |
Tandis que les troupeaux de l'Arabie apportaient leur laine et leurs toisons, que l'Arménie envoyait ses bois et ses vins, que les parfums de l'Inde et de l'Arabie venaient entre les mains des habiles ouvriers chaldéens se transformer en un baume dont la renommée s'étendait au loin, Babylone à son tour, exportait les tissus de laine, les manteaux de Babylone, les armes, les pierres taillées. Les Phéniciens étaient le plus souvent les intermédiaires de ce grand mouvement d'échange, et rien ne prouve mieux l'antiquité et l'étendue du commerce des Babyloniens que l'adoption de leurs poids et de leurs mesures par les Assyriens, par les Phéniciens, par les Juifs, par les Syriens, par les Lydiens et plus tard, indirectement, par les Grecs et par les Sabéens de l'Arabie méridionale.
|
Quelques traits empruntés aux écrivains antiques nous permettront de compléter l'image des moeurs babyloniennes. Tout dans leurs habitudes comme dans leur extérieur révélait un peuple antique riche et puissant. Leur habillement était élégant et commode. «Par-dessus une chemise de lin on mettait une longue robe de laine qui tombait sur la cheville et qu'une ceinture serrait à la taille ; on couvrait le tout d'un petit manteau blanc. Les cheveux étaient longs et retenus par une bandelette pendante. L'usage des baumes de myrrhe et de l'huile de sésame était général. Chacun portait un anneau qui lui servait de cachet et un bâton artistement travaillé, dont le haut était ordonné d'une pomme, d'une rose, d'un lis ou d'un aigle sculpté». (Ezéchiel, XXIII, 15 ; Hérodote, I, 195 ; Strabon, p.745-746) |
 |