
Les ruines du temple de Baal Hammon dans le chapitre consacré à Carthage
Pour se rendre à Tunis, des bords du Nil ou de l'Euphrate, il faut marcher pendant des jours et des jours du côté où se couche le soleil. Nous n'entrons cependant pas dans un monde absolument nouveau lorsque, pour étudier ce qui reste de Carthage, nous quittons Ninive, Babylone ou la ville d'Ammon, Thèbes aux cent portes. En dépit de sa situation, Carthage est une ville tout orientale. C'est que le berceau du peuple Carthaginois n'est pas cette terre d'Afrique qu'illustrèrent ses exploits et ses malheurs. Rameau de la grande famille sémitique, frères des Hébreux, les Phéniciens avaient habité pendant bien des siècles l'antique pays de Canaan, avant de couvrir de leurs colonies les côtes de la Méditerranée : les hommes que les tribus d'Israël durent combattre et vaincre pour prendre possession de la terre promise, c'étaient les ancêtres des Hannon et des Barca.
Les plus anciennes traditions des Sémites nous les montrent venus de l'Orient et déjà établis sur les confins de la Chaldée. C'est dans cet immense territoire compris entre la Méditerranée, la mer Noire, le Caucase, la mer Caspienne, l'Indus et les mers qui baignent les côtes méridionales de l'Asie que se formèrent peu à peu les nations qui devaient fonder plus tard tant et de si fameux empires. De là tous ces peuples emportèrent le fonds commun de religion que chacun, pendant le cours des siècles, modifia à sa guise au point de le rendre méconnaissable aux yeux du vulgaire, mais sans en effacer néanmoins ces analogies frappantes qui devaient plonger dans un si profond étonnement les premiers savants qui étudièrent ces questions. De là vient, la croyance à un dieu à la fois un et multiple, que nous retrouvons à Ninive comme à Tyr, à Jérusalem aussi bien qu'à Carthage.
Entre deux civilisations, produit du génie particulier de deux peuples dont l'origine est commune, il existe toujours des ressemblances, ressemblances souvent fort vagues, mais qu'il n'est cependant pas impossible de saisir. A cette première cause de similitude avec plusieurs des civilisations de l'Asie intérieure, les Phéniciens en joignaient une seconde peut-être plus importante encore. Peuple de marchands, ils portaient dans tous les pays les denrées les plus variées. Leurs flottes sillonnaient toutes les mers ; leurs caravanes allaient jusque dans l'extrême Orient, jusqu'au coeur du continent africain chercher l'or, l'ivoire, les parfums et tout ce qui pouvait satisfaire les besoins ou contribuer aux plaisirs. Ils étaient les grands pourvoyeurs du monde ancien.
Tandis que tous les peuples s'enfermaient chez eux n'ayant avec leurs voisins d'autres rapports que ceux du champ de bataille, et ceux qui s'établissaient ensuite entre le vainqueur et les vaincus réduits en esclavage ; tandis que tous vivaient isolés au milieu d'un monde qu'ils connaissaient à peine, les Phéniciens étaient partout. Ils frappaient à toutes les portes et n'étaient nulle part repoussés ; car, inspirés par ce génie du commerce, caractère distinctif de leur race, ils apportaient toujours ce qui cadrait le mieux avec les besoins du moment. La famine, chose fréquente au milieu des guerres continuelles, venait-elle à se faire sentir en quelque endroit ? Semblables à des points perdus sur l'immensité des flots, on voyait apparaître et grandir à l'horizon les vaisseaux de la flotte cananéenne. Bientôt on entendait le bruit cadencé des avirons, et les galères, lourdes de blé, entraient dans le port. La paix avait-elle ramené l'abondance ? On voyait revenir ces mêmes hommes, et c'étaient maintenant des parfums, des poteries, des armes étincelantes d'or et de pierreries, des joyaux aux formes bizarres et ces étoffes de pourpre dont la Phénicie avait le monopole.
Au cours de ces continuels voyages, les Phéniciens s'assimilaient les procédés industriels ou artistiques des nations qu'ils visitaient. Ainsi doit s'expliquer, plus encore que par une communauté lointaine d'origine, le caractère cosmopolite de la civilisation des Phéniciens.
Pénétrons dans une de leurs villes, à Tyr ou à Sidon. Nous pourrons douter par moment si nous sommes en Egypte ou dans une ville d'Assyrie. Ces édifices, dont les murs disparaissent sous des revêtements de bois et de métal, rappellent, par les peintures qui les ornent, les palais de Ninive. Les statues et les bas-reliefs sentent l'inspiration et la manière des artistes égyptiens. Mais ce qui donne à ces villes leur caractère propre, ce sont ces immenses faubourgs où pullule une population active d'ouvriers, de marins et de marchands. Dans nulle autre ville antique nous ne trouverions ces rues immenses bordées d'ateliers d'où s'échappe du matin jusqu'au soir un bruit assourdissant. Les marteaux frappent, les limes grincent, et, dominant ce tumulte, on entend le mugissement des forges et des hauts fourneaux. Plus loin ce sont les tisserands avec leurs métiers au bruit monotone. Plus loin encore ce sont les flaques sanglantes des teintureries où se prépare la pourpre phénicienne.
Ce spectacle animé et vif que devait présenter chacune des villes répandues sur la côte phénicienne, ne peut malheureusement emprunter ses couleurs qu'aux fantaisies de l'imagination. Peu de faits certains nous restent, peu de documents, peu de ruines. Nulle terre n'a été moins féconde en souvenirs de l'antiquité. Si bien conduites qu'aient été les recherches de M. Renan, il n'a rencontré que des débris, des objets minuscules, jamais de grandes ruines. Aussi peut-on dire que de la Phénicie il ne nous reste que le souvenir de la grande influence civilisatrice qu'elle a répandue sur le monde.
N'ayant laissé ni une littérature, ni un art, cette côte active n'a d'autre gloire durable que celle d'avoir colonisé les rivages de notre Méditerranée.
De toutes ces colonies la plus puissante et la plus célèbre fut Carthage.
L'origine et la construction de Carthage se perdent dans la légende que Virgile a racontée :
|
De la vaste cité qui frappe vos regards |
Telle est la légende. Voyons l'histoire.
A une époque reculée qu'on ne saurait préciser, des navigateurs sidoniens, venus de Sicile, abordèrent sur la côte septentrionale de l'Afrique et y fondèrent la ville de Iambê.
Combien de siècles s'écoulèrent ?
La splendeur de Kambê s'était éclipsée ; Tyr avait succédé à Sidon dans l'hégémonie des cités phéniciennes du pays de Canaan, lorsqu'une nouvelle colonie, chassée de la métropole par une révolution, vint débarquer dans la Zeugitane sur les ruines mêmes de l'antique cité. Le promontoire de forme rectangulaire couvert de sombres forêts s'élevait à peu de distance de la mer. Il devint le centre de la ville nouvelle. On y bâtit quelques maisons. Ou y éleva un temple à Esmum, et le tout fut entouré de murailles : Carthage était fondée. Depuis lors la «cité nouvelle» ne cessa de grandir, jusqu'au jour où, devenue la rivale de Rome, elle expia sous la pioche des démolisseurs la gloire d'avoir fait trembler la ville aux sept collines.
On avait eu grand' peur aux bords du Tibre. Aussi quelle joie après la victoire !
Avec quel luxe de détails les historiens romains nous racontent la destruction de la reine de l'Afrique ! Tout ce qui pouvait ajouter à la gloire de la cité victorieuse, à la honte de la cité vaincue, tout cela fut mentionné, exagéré.
Les premiers récits, eux-mêmes, firent boule de neige. Chacun y ajouta du sien et Paul Orose alla jusqu'à prétendre que Scipion avait employé ses soldats à réduire en poudre les pierres des remparts puniques. Après cela, comment espérer qu'il fût possible de retrouver la moindre trace de l'antique Kart-Hadshât ? L'inspection même des lieux n'était pas fait pour changer beaucoup cette opinion. Voici, en effet, dans quels termes M. de Sainte-Marie, un des derniers et des plus habiles archéologues qui aient exploré cette région, décrit l'aspect actuel du lieu où fut Carthage :
«Du haut de la colline de Saint-Louis on aperçoit au sud et au bout de la langue de terre qui sépare la mer du lac une petite ville que le touriste connaît déjà : la Goulette doit son origine à des fortifications élevées, en 1515, par les Espagnols, lors de l'expédition de Charles-Quint contre Barberousse. Les ouvrages avancés sont encore debout et ils servent au gouvernement tunisien qui y a placé plusieurs batteries de canons. Le palais où siègent les ministères en été et qui est situé au delà du canal est lui-même un fort espagnol de la même époque démantelé et approprié aux besoins du jour. La Goulette n'offre les débris d'aucun vestige punique ou romain : je citerai seulement dans l'arsenal une belle inscription romaine apportée de Khadès, il y a quelques années, ainsi que deux inscriptions néo-romaines scellées dans le mur du vice-consulat de France.
Toujours au sud et presque au pied de la colline on aperçoit Douar-Eschatt, composé de quelques maisons qu'un minaret domine. Entre Douar-Eschatt et la Goulette, je citerai le palais du général Khereddine, le Kram, le palais du bey, et au sud-est, est le palais de Mustapha-Ben-Ismaïl et d'Ahmed-Zarrouck. Au nord-est, sur une colline escarpée, on aperçoit Sidi-Bou-Saïd, dont les maisons blanches groupées l'une contre l'autre forment comme un essaim de colombes au repos. C'est une ville sainte où les musulmans prétendent que saint Louis, converti à l'islam, est enterré. Il y a tout autour de nombreuses ruines cachées sous terre. Après Sidi-Bou-Saïd et plus au nord, s'étendent les maisons de campagne de la Marsa : l'héritier présomptif y demeure et les consuls y viennent passer l'été. La Marsa est bornée au nord par la montagne de Gammart, dans les flancs de laquelle est la nécropole de Carthage. Après Gammart, on voit à l'horizon le lac de Soukra, les collines d'Utique, le village de l'Ariane et Tunis au fond du lac. Entre la Marsa et la colline de Saint-Louis, je citerai le village de la Malka dont j'ai déjà parlé, et celui de Sidi-Daoud, situé plus à l'ouest et que les débris de l'aqueduc côtoient un instant. Enfin, au bord du lac, et sur la route de Tunis on remarque El-Aouïna, naguère station des voitures et jadis témoin de la victoire de Xantippe sur Régulus».
 |
Pas une ruine antique apparente si on en excepte les débris de l'aqueduc bâti par l'empereur Hadrien ; pas un monument, à moins qu'on ne veuille considérer comme tels la chapelle de Saint-Louis bâtie en 1841, le palais de Mustapha ou celui du général Khereddine.
L'opinion courante, nous croyons avoir eu déjà occasion de le dire, était que de la ville punique il ne restait pas pierre sur pierre. Sans doute on n'ajoutait pas foi aux exagérations de Paul Orose. Dureau de la Malle avait même démontré que Scipion n'avait pas détruit la ville aussi complètement que la lecture des historiens anciens aurait porté à le croire. Mais sur les ruines de la colonie phénicienne s'était élevée une colonie romaine ; à la ville d'Hannibal avait succédé la ville de saint Augustin. Quand cette dernière avait laissé si peu de traces que pouvait-il rester de l'autre ? Pendant de longues années ses ruines avaient servi de carrière aux habitants des colonies voisines. Lorsque les architectes romains creusèrent les fondations de la nouvelle Carthage, ils avaient dû détruire jusqu'aux derniers vestiges des anciens édifices. Il fallait donc se résigner. La vengeance des Romains était complète. Leur rivale était retombée dans le néant. L'histoire ne connaîtrait d'elle que ce qu'ils avaient bien voulu lui en apprendre.
Cependant on devint peu à peu plus sceptique à l'égard de ces destructions absolues. Notre siècle a assisté à trop de résurrections pour croire beaucoup à ces effacements. Combien n'en avons-nous pas vu, de ces vieilles civilisations mortes, secouer leurs cendres, et, nouveaux Lazares, soulever tout à coup la pierre de leur tombeau ?
Par quelle transition M. Beulé, presque exclusivement occupé jusque-là des études grecques qui avaient illustré son nom, fut-il amené à s'occuper de la Carthage punique ? C'est ce qu'il a négligé de nous dire. Mais une fois décidé à entreprendre ces recherches, le point spécial sur lequel elles porteraient d'abord était fixé à l'avance. Byrsa, l'acropole de Carthage, devait exercer une attraction à peu près irrésistible sur l'homme qui avait retrouvé les portes de l'acropole d'Athènes.
En débarquant sur la terre d'Afrique M. Beulé eut d'abord à établir un premier point : quelle était la situation exacte de Byrsa ? Les auteurs qui, avant lui, s'étaient occupés de Carthage n'avaient guère fait qu'embrouiller la question.
En 1738, l'Anglais Shaw publia à Oxford ses Voyages ou Observations relatives à plusieurs parties de la Barbarie et du Levant. C'est le premier auteur qui ait decrit avec quelques détails les antiquités de l'Afrique septentrionale. Mais Shaw n'était pas exclusivement un archéologue. L'organisation intérieure des pays qu'il parcourait, la constitution de leur sol, l'intéressaient autant que les monuments anciens qu'il pouvait rencontrer. En visitant le golfe de Carthage il fut frappé par les déplacements du Bagrada et reconnut avec une grande sagacité que ce fleuve, ensablant la rive carthaginoise, s'était peu à peu rapproché d'Utique. Mais ici le géologue fit tort à l'antiquaire. Tout occupé de ses alluvions, il méconnut l'emplacement de Carthage et tourna vers l'ouest la ville qui, en réalité, regardait le levant.
L'erreur de Shaw fut acceptée par tous ses contemporains, notamment par d'Anville. En vain fut-elle rectifiée par le père Caroni et quelques autres. Chateaubriand seul accepta leurs idées, et presque jusqu'à nos jours l'opinion reproduite à l'envi par tous les savants qui s'occupèrent de Carthage, fut celle du dix-huitième siècle. On ne s'explique pas que l'emplacement exact d'une ville aussi fameuse ait été si longtemps méconnu, ni que tant d'hommes éminents aient pu émettre et répéter des idées que la seule inspection du terrain, aidée de la tradition, devait leur permettre de rectifier, «car, dit M. Beulé, les habitants de Tunis et des environs savent tous montrer du doigt les lieux où fut Carthage».
Citons encore pour mémoire le comte Camille Borgia dont les travaux n'ont pas été publiés, et le capitaine de vaisseau Falbe, consul général de Danemark, auteur d'un excellent plan de Carthage publié en 1855 et qui servit de base à tous les travaux ultérieurs.
M. Beulé reprit les opinions de ses devanciers et les soumit à une critique rigoureuse. Il compara attentivement les indications que lui fournissait le sol avec les passages des auteurs anciens et reconnut bientôt que la colline où s'élève la chapelle de Saint-Louis n'était autre que Byrsa. C'était l'opinion du père Caroni et de Chateaubriant. Il ne tarda pas à acquérir de plus la conviction que c'était «Byrsa entière».
Ce dernier point était capital. En effet, la seule manière de résoudre d'une façon définitive, irréfragable, une question si longtemps controversée était de retrouver à sa place quelque débris, ne fût-ce qu'une seule pierre, des célèbres murailles qui flanquaient la citadelle carthaginoise. Il fallait donc préciser, autant que faire se pouvait, le point sur lequel devaient porter les recherches.
L'attention de M. Beulé se tourna tout d'abord vers le côté ouest du plateau. Falbe signalait de ce côté des voûtes et des débris qui l'avaient fait songer è la triple enceinte de Byrsa, et où Dureau de la Malle avait vu tour à tour des prisons, et la caverne où Cesellius Bassus prétendait avoir retrouvé les trésors de Didon. Ce sont tout simplement des citernes d'époque romaine déblayées et appropriées à leurs besoins par quelques familles arabes qui y ont établi leur demeure. Les citernes abondent sur ce versant de la colline et les architectes romains avaient dû détruire en les creusant tout vestige de constructions plus anciennes. Des fouilles entreprises sur ce point offraient donc peu de chances de succès. D'ailleurs M. Beulé apprenait bientôt que les Arabes avaient depuis quelques années bouleversé toute cette pente pour vendre les matériaux qu'ils rencontraient.
Du côté nord les conditions n'étaient guère plus favorables. C'était là que les Vandales s'étaient bâti, à proximité du palais de leur roi Genséric de somptueuses habitations dont les ruines anciennes avaient fait tous les frais. Une tranchée ouverte non loin d'une tour byzantine dont il ne reste plus qu'un pan de mur au-dessus du sol, ne mit au jour que les restes d'un égout et d'une autre tour également d'époque byzantine ; au-dessous le rocher. Un boyau souterrain poussé sur une longueur de 11 mètres et en suivant le rocher ne traversa que des constructions grossières faites à l'aide de fragments d'architecture romaine, et des débris mêlés de fragments de poteries des bas temps, parmi lesquels se trouva une lampe avec le monogramme du Christ. De monuments puniques, pas l'ombre.
Des sondages pratiqués sur le versant occidental ne rencontrèrent que des débris d'époque romaine. Restait le versant méridional, le plus escarpé de tous. Le sol paraissait intact sauf sur un point d'où les Arabes avaient tiré de la pierre ; d'ailleurs la rapidité de la pente avait dû rebuter les constructeurs romains. Tout indiquait donc ce flanc de la colline comme offrant aux recherches le plus de chances de succès. M. Beulé résolut d'y concentrer ses efforts et d'arriver à tout prix à la couche des constructions puniques, dût-il pour cela pratiquer dans la montagne une ouverture de 50 ou 40 mètres de largeur.
Mais à quel niveau devaient être établis les travaux ? «Si la tranchée était entreprise trop haut, je pouvais passer par-dessus les ruines carthaginoises ; si elle était établie trop bas, je restais au-dessous, et perdais ma peine dans les deux cas».
Une série de sondages préliminaires prouva, chose d'ailleurs facile à prévoir, que le rocher se rencontrait à une profondeur de plus en plus grande au-dessous de la surface du sol, à mesure qu'on s'éloignait davantage du point culminant de Byrsa. A moins de supposer aux architectes carthaginois des habitudes contraires à celles de tous les constructeurs de l'antiquité, on devait admettre qu'ils avaient fondé les premières assises de leurs murailles sur le roc même. C'est donc au niveau de ce grès argileux, de couleur jaune pâle, dont est formé le noyau de Byrsa, qu'on avait le plus de chance de rencontrer quelque trace des fortifications puniques.
Les premiers sondages rencontrèrent le rocher à une profondeur variant de deux à cinq mètres environ, sans avoir amené d'autre découverte que celles de ruines byzantines et d'un cimetière arabe paraissant remonter au douzime siècle. Un nouveau sondage dut être poussé jusqu'à 19 mètres au-dessous de la superficie du sol. «Dès lors, les fouilles véritables pouvaient commencer et être conduites avec certitude».
Ce n'avait pas été chose facile de parvenir à une telle profondeur à travers un sol sans consistance, composé de débris de toute nature. Ouvrir une tranchée, c'était exposer les ouvriers à une mort presque certaine, chaque coup de pioche pouvant déterminer un éboulement. Percer des boyaux souterrains était également impraticable faute des charpentes nécessaires pour étayer les galeries. Il fallut se résigner, à mesure qu'on pénétrait plus profondément dans la terre, à élargir l'orifice de la fosse en forme d'entonnoir. Ce procédé était fort long et fort dispendieux puisque, pour découvrir une surface de 1 mètre carré, au niveau du rocher, il fallait enlever 200 ou 500 mètres cubes de terre.
Cette tâche gigantesque semblait devoir offrir plus d'une compensation à l'archéologue qui aurait le courage de l'entreprendre. En admettant même qu'on ne trouvât rien des murailles de Carthage, quelle abondante moisson de vases, de bas-reliefs, d'inscriptions, d'objets de toute nature intéressant l'histoire des moeurs ou des arts ne pouvait-on pas se promettre de recueillir en déplaçant une si énorme quantité de terre ! Cet espoir fut malheureusement déçu. Les couches supérieures n'offrirent naturellement que des débris d'époque byzantine, une lampe funéraire, des poteries brisées, des fragments informes de bas-reliefs et d'inscriptions.
Tout à coup les ouvriers furent arrêtés par d'énormes massifs de maçonnerie. C'étaient les murailles bâties sous Théodose, à l'approche des Vandales, et que les Arabes avaient renversées plus tard en les attaquant par l'intérieur et par le sommet du plateau. «Elles étaient à peu de profondeur, renversées par pans énormes, couchées en terre de toute leur longueur... Telle est l'excellence du mortier romain, que les petites pierres qui composaient ces vastes murailles n'ont été ni séparées ni ébranlées. Il s'est fait çà et là quelques fissures dans toute la hauteur comme si les machines eussent battu un massif homogène ou un rocher ; des blocs immenses ont été précipités sur la pente, s'y sont étendus, et ont été ensevelis sous la poussière et les décombres».
On dut avoir recours à la mine pour continuer les fouilles. Les ouvriers s'enfoncèrent alors à travers une effroyable masse de pierres renversées, brisées et noyées dans une poussière subtile de tuf broyé par le temps. Enfin ils rencontrèrent d'énormes pans de murs encore debout et formés de gigantesques blocs de pierre amoncelés les uns sur les autres ; c'était la partie inférieure des murailles puniques, tout semblait l'indiquer.
Les historiens anciens nous avaient appris que les murailles de Carthage renfermaient des écuries pour les chevaux et pour les éléphants, des arsenaux et des magasins de toute sorte. M. Beulé déblaya le pied des murailles. Le plan répondait parfaitement aux descriptions anciennes ; il n'y avait donc plus de doute possible, c'étaient bien les murs de Byrsa qu'on venait de retrouver. Protégées par les ruines des étages supérieurs écroulés sur elles, les premières assises avaient échappé à la fureur des Romains et bravé l'action du temps. Mais seules ces masses énormes avaient résisté. L'incendie avait eu raison de tout le reste. Noyés dans des monceaux de cendres, M. Beulé ne retrouva que des fragments informes. Les métaux étaient tordus et comme mâchés par les flammes. Quel avait été autrefois l'usage de ces masses rongées par la rouille ? Il était impossible de le deviner. Le verre se rencontra en grande abondance, mais réduit en miettes. Tout ce qu'on put reconnaître c'est qu'il était de deux sortes, uni ou strié, blanc, et surtout d'une extrême finesse. «Nos fabriques modernes n'obtiennent rien de plus mince ni de plus délicat dans ce genre que nous nous plaisons à comparer à une mousseline légère».
La terre cuite avait mieux résisté que le verre. Les fragments étaient trop menus pour qu'on pût reconstituer la forme des objets, mais le caractère de la fabrication et la provenance pouvaient encore être reconnus. Les débris de poteries étaient de trois sortes. D'abord des tessons d'une pâte jaunâtre présentant des traces de peinture brune et fort analogues aux vases archaïques que l'on retrouve à Corinthe, à Athènes, dans l'île de Théra, sur plusieurs autres points de la Grèce et en Etrurie.
On a souvent prétendu que la céramique grecque avait, à l'origine, subi l'influence orientale. La découverte que nous venons de rapporter est un argument de plus à l'appui de cette hypothèse.
D'autres tessons avaient appartenu à des vases grecs, sans doute importés de Sicile. Une troisième catégorie de débris n'offrait aucun point de rapprochement avec les poteries grecques ou romaines. C'était une terre d'un grain peu serré, facile à briser et d'une couleur orange tout à fait caractéristique. Fallait-il voir là des produits d'une fabrique indigène ? La preuve ne se fit pas attendre. Lorsque toutes les cendres eurent été enlevées et le sol déblayé, on remarqua que le grès avait une couleur orange exactement semblable à celle des tessons dont nous venons de parler. Entamait-on la surface ? Le grès reprenait la couleur jaune pâle qu'on lui avait reconnue sur tous les autres points. L'incendie en cuisant la terre sur une profondeur d'un centimètre environ, avait changé sa couleur. Les poteries orange étaient donc bien de fabrication carthaginoise. La preuve était faite. Pouvait-on la souhaiter à la fois plus singulière et plus concluante ? M. Beulé recueillit avec un soin pieux tous ces monuments d'une civilisation disparue. Il y joignit des échantillons des différentes sortes de mortier rencontrées au cours de ses travaux, et une grande quantité de balles de fronde, en terre cuite très dense, et d'une forme ovale légèrement aplatie. C'étaient les seuls objets qu'on eût retrouvés intacts.
Au printemps de l'année 1859, M. Beulé revint en France. Il avait définitivement résolu le problème de l'emplacement de Byrsa, sa tâche était accomplie. Est-ce à dire que la vieille citadelle punique nous ait livré son dernier mot ? Assurément non, et M. Beulé est le premier à appeler de ses voeux de nouvelles recherches sur ce point. Il est probable que les murailles se retrouveraient sur tout le versant méridional de la colline, et qu'en les dégageant sur toute leur longueur, on pourrait compléter sur plus d'un point la connaissance que nous en possédons. De plus, quelques produits de l'industrie ou de l'art puniques, protégés au milieu du désastre général par une circonstance fortuite, viendraient peut-être jeter un peu de lumière sur la question si obscure des moeurs carthaginoises et soulever un coin du voile qui dérobe à nos regards la vie intime plus encore que l'histoire de ce peuple fameux. Mais une semblable entreprise dépassait de beaucoup les ressources d'un simple particulier, et nous ne devons pas oublier que c'est à ses frais que M. Beulé entreprit et mena à bien des recherches dont le résultat, pour modeste qu'il soit, ne lui fait pas moins le plus grand honneur.
 |
Après avoir passé en France le temps des grandes chaleurs, M. Beulé retourna à Carthage, et l'automne le trouva occupé à explorer les ports, élément capital d'une ville maritime. L'emplacement des ports est on ne peut plus facile à reconnaître. Les recherches pouvaient donc être entreprises à coup sûr. En revanche, des difficultés de toute nature semblaient s'opposer à ce qu'elles fussent poussées plus loin qu'une simple inspection du terrain. Depuis longtemps comblés, les ports sont couverts de plantations. Le premier ministre du bey de Tunis, Sidi Mustapha, s'y est fait bâtir une maison de plaisance. Le général Khaïr-ed-din, ministre de la guerre, en possède une autre à quelque deux cent-pas de là. Il fallait tout d'abord obtenir de ces deux riches propriétaires l'autorisation de bouleverser leurs jardins. Le consul général et chargé d'affaires de France, M. Léon Roches, s'y employa. La permission fut accordée à la seule condition qu'avant son départ l'explorateur français remettrait toutes choses en l'état où il les aurait trouvées. Serait-on bien sûr de trouver auprès de nos amateurs de villégiature un aussi généreux concours ?
Restaient les difficultés inhérentes à la nature même du sol : les plus sérieuses de toutes. L'endroit où les fouilles devaient être entreprises n'était séparé de la Méditerranée que par une étroite langue de sable. L'eau ne pouvait manquer de venir gêner les ouvriers dès qu'ils auraient dépassé le niveau de la mer. «Cependant il fallait descendre plus bas pour trouver les restes des constructions puniques, car il était vraisemblable que les Romains avaient dû tout raser au niveau de l'eau. En effet, à peine mes ouvriers eurent-ils creusé jusqu'à deux ou trois mètres de profondeur que les infiltrations jaillirent de toutes parts. Entreprenaient-ils de les épuiser par de continuels efforts, ils n'en trouvaient pas moins sous leurs pieds une fange noire, fétide, compacte, mêlée de débris méconnaissables car les pierres de tuf étaient elles-mêmes comme pourries ; la pioche et la bêche restaient prises dans cet affreux mélange, les paniers de jonc, bientôt déformés et déchirés ne pouvaient plus servir au transport. A chaque coup l'eau et les taches volaient au visage de mes pauvres Arabes et sur leurs blancs burnous qu'ils n'osaient quitter de peur de la fièvre ; jamais pourtant leur patience et leur douceur ne se démentirent. Apres divers essais, voici le système que j'adoptai. Au lieu d'épuiser l'eau qui envahissait les tranchées, on laissait son niveau s'établir ; ce niveau était presque toujours celui des constructions carthaginoises quand elles avaient été seulement rasées et quand les colons romains ne les avaient pas, plus tard, détruites à plaisir. Quelquefois ces constructions étaient à trente ou quarante centimètres au-dessous de l'eau. Mes Arabes suivaient sous l'eau les murs, ils les tâtaient avec leurs pieds nus, s'y tenaient établis et retiraient la fange à droite et à gauche afin de les bien dégager. Quand une longueur suffisante était nettoyée, ils abandonnaient la tranchée et allaient en faire une autre à quelques pas plus loin.
Le lendemain, la vase s'était déposée, l'eau était redevenue limpide, les murs se voyaient clairement avec leur appareil, il était facile de les dessiner et de les mesurer avec précision. Dès que j'avais relevé un ensemble et raccordé mes dessins, on comblait les trous afin de ne point multiplier les foyers d'infection. La mort du comte Camille Borgia, qui avait respiré des miasmes mortels en étudiant les ports de Carthage, me servait d'avertissement».
C'est en procédant de la sorte que M. Beulé put relever avec exactitude le plan des ports. Arrêtant ses fouilles à une aussi petite profondeur, il est à peine besoin de dire que les ruines qu'il rencontrait étaient d'époque romaine. Les détails relevés appartenaient donc au port romain. Mais ce port romain ainsi restitué répondait si bien aux descriptions du port carthaginois laissées par les auteurs anciens, qu'il est évident que les vainqueurs s'étaient contentés de réparer ou de remplacer les anciens quais, mais sans rien changer à la forme primitive de l'eeuvre. Quelques traces de constructions puniques retrouvées çà et là ne firent que confirmer cette hypothèse.
Après avoir recueilli avec soin quelques rares débris de sculptures et de moulures trouvés au cours des fouilles et qu'il avait tout lieu de considérer comme remontant au temps de l'indépendance de Carthage, M. Beulé fit combler sa dernière tranchée. Il éprouvait bien quelque regret de ne pouvoir laisser au jour les ruines découvertes par lui. Mais il s'était engagé à remettre toutes choses en l'état où il les avait trouvées. D'ailleurs, laisser ces ruines apparentes, c'était les vouer à une destruction prompte et certaine. Il n'avait plus rien retrouvé, à son retour de France, des murailles puniques qu'il avait dégagées quelques mois auparavant. Malgré la défense du bey de Tunis, malgré la surveillance du gardien de Saint-Louis, les Arabes et les Maltais étaient venus et, sous forme de moellons ou de pierres de taille, les murailles avaient pris à leur tour le chemin suivi par toutes les ruines que la terre ne défend pas suffisamment contre l'avidité des traficants.
Tous ces travaux avaient coûté fort cher. Les résultats étaient remarquables. Cependant M. Beulé ne considéra pas sa tâche comme achevée. Les tombeaux sont d'ordinaire les oeuvres les plus durables des civilisations disparues. C'est dans la demeure des morts qu'on trouve souvent les plus vivantes traces des religions et des moeurs oubliées. C'est du fond des tombeaux que sont sortis la plupart des objets qui nous ont fait connaître d'une manière si précise l'Egypte et tant d'autres pays anciens.
M. Beulé ne voulut pas quitter Carthage sans avoir exploré sa nécropole. Elle se trouve près du village actuel de Qamart, sur le versant d'une colline. Les sépultures des anciens étaient bien plus exposées à être violées que ne le sont les nôtres, à cause de l'usage on on était d'ensevelir avec le cadavre divers objets précieux. Une forte muraille, coupant l'isthme qui rattache la presqu'île de Carthage à la terre ferme, mettait la nécropole punique à l'abri des profanations de l'ennemi.
L'attachement aux tombeaux des ancêtres est un trait commun à presque tous les peuples de l'antiquité. La Bible témoigne en maint endroit de la vivacité de ce sentiment chez les Hébreux. Lorsque le consul Censorius ordonne aux Carthaginois vaincus de raser leur ville et de la rebâtir à dix lieues dans l'intérieur des terres, un des députés, Bannon, surnommé Tigillas, lui répond qu'il est moins cruel d'exterminer un peuple que de lui faire abandonner ses temples et ses tombeaux (Appien, VIII, 84). Cependant nous ne trouvons pas ici entre les morts et les vivants ce commerce quotidien, cette familiarité respectueuse, caractéristique des civilisations égyptienne, grecque et romaine. Chez les Sémites, les tombeaux sont considérés comme quelque chose d'impur. La Mischna défend d'ensevelir un mort à moins de cinquante coudées d'une ville quelconque. Cette distance était portée à deux mille coudées pour les villes lévitiques.
Les Carthaginois partageaient-ils les préjugés des Hébreux à l'égard des morts ? Aucun texte ne nous permet de l'affirmer ; il est cependant permis de le croire. La nécropole punique se trouve à la pointe la plus reculée de la presqu'île, sur le versant extérieur du Djebel-Khawi, en sorte que les tombes ne pouvaient être aperçues d'aucun point de la ville. Peut-être trouvera-t-on cet indice bien faible ; mais en le rapprochant de la conformité presque parfaite qui existe entre les caveaux funéraires de Carthage et ceux qu'on a découverts en Judée, on pourra, croyons-nous, admettre au moins comme une hypothèse plausible, que les Phéniciens, sur ce point, pensaient comme les Hébreux. Le Carthaginois désirait ardemment reposer un jour dans le caveau de famille, à côté de ses ancêtres morts ; mais tant qu'il était vivant il ne tenait pas à les coudoyer de trop près.
Lorsqu'on a gravi la pente du Djebel-Khawi, on découvre, sur la gauche, Tunis avec ses maisons blanches son lac. En face, le lac de Soukra et le golfe d'Utique. A droite la mer. Aux pieds de la montagne et jusqu'au village de Qamart coquettement caché dans un bouquet de palmiers, s'étend la nécropole.
Aucun monument ne marque plus aujourd'hui l'emplacement des tombeaux.
M. Beulé en découvrit et en déblaya plusieurs et put se rendre un compte exact de l'état habituel des tombes carthaginoises. Elles étaient creusées dans un calcaire très vif. De même que le sol de certaines cryptes de Bordeaux ou de Palerme, cette pierre desséchait promptement les corps. Ces tombes étaient de véritables sarcophages, au sens étymologique du mot : elles dévoraient les cadavres.
Pour établir leurs sépultures, les Carthaginois aplanissaient d'abord la surface du rocher en ménageant une pente légère pour faciliter l'écoulement des eaux. Souvent ils enduisaient d'une couche de mortier bien battu l'espace ainsi nivelé. On perçait alors dans le roc une ouverture suffisante pour y établir un escalier. A une profondeur convenable, les ouvriers creusaient une salle rectangulaire soutenue, suivant sa grandeur, par une ou plusieurs arcades. Dans les parois de cette salle étaient pratiquées un certain nombre de niches, de fours à cercueil, pour employer l'expression pittoresque de M. de Saulcy, assez grandes pour recevoir le corps d'un homme. Une inscription funéraire, probablement en métal était scellée au-dessus de chaque niche. Le nombre de ces niches est variable, mais elles sont toujours disposées de la même manière autour de la salle principale. L'intérieur était revêtu de stuc blanc, sauf les fours à cercueil où le calcaire était laissé à nu. Un enduit eût neutralisé ses propriétés absorbantes. Une dalle énorme fermait la porte du caveau.
Toutes ces tombes ont été violées, probablement par les soldats romains ; et tous les objets qu'elles renfermaient ont disparu. A peine retrouve-t-on çà et là quelques poteries grossières et de rares ossements. Aujourd'hui la plupart des chambres funéraires communiquent entre elles : les dévastateurs ont trouvé plus commode d'enfoncer une mince cloison de pierre que de remonter à la surface pour chercher l'entrée du caveau voisin. Pendant tout le moyen âge ces dévastations ont continué et chaque jour voit encore disparaître quelqu'une de ces antiques sépultures. «Quelquefois, dit M. Beulé, je m'arrêtais devant un Arabe qui détruisait un tombeau pour faire de la chaux. Je lui disais que ceux dont il violait le dernier asile étaient de la même race que lui, peut-être ses ancêtres. Il s'arrêtait, me regardait indécis, réfléchissait, puis me demandait si ces pères de ses pères connaissaient Mahomet et le vrai Dieu. Quand j'avais reconnu qu'ils ne les connaissaient pas, il faisait entendre une exclamation gutturale, reprenait sa pioche et continuait, d'un coeur tranquille, son oeuvre de destruction».
Lorsque M. Beulé exécuta ses premières fouilles, un autre savant était déjà occupé à explorer pour le compte du gouvernement anglais les ruines de Carthage. Sa mission était terminée lorsque M. Beulé revint pour la seconde fois sur la côte d'Afrique. Malgré cela, c'est seulement en 1861 que le docteur Davis publia le résultat de ses travaux. Il semble qu'un volume de plus de 600 pages doive renfermer à peu près tout ce que l'on sait sur la vieille ville punique. On aurait tort de le croire. Le livre du docteur Davis est l'oeuvre d'un touriste autant que d'un archéologue.
Après un long chapitre dont le but est d'identifier Carthage avec la ville de Tarshish dont parlent les saintes Ecritures, vient un long récit de l'histoire et de chute de Carthage d'après Virgile et les autres auteurs de l'antiquité. Enfin nous arrivons aux fouilles. Mais le but de M. Davis n'est pas tant d'étudier les ruines, que de trouver des objets faciles à emporter et propres à enrichir les collections du British Museum. Aussi ne s'attache-t-il pas à décrire bien minutieusement les monuments qu'il rencontre.
En revanche, il nous raconte avec humour les péripéties de cette chasse aux inscriptions et aux mosaïques à laquelle il s'est livré pendant de longs mois. Ici c'est son entrevue avec le bey ; là le récit comique de ses efforts pour éviter le contact de certain marabout aux vêtements sordides qui s'était pris d'amitié pour l'étranger. Le docteur Davis change de place pour s'éloigner un peu de son hôte. Aussitôt le saint homme se lève et revient imperturbablement s'asseoir à ses côtés, en sorte qu'à chaque visite les deux interlocuteurs, l'un fuyant, l'autre le poursuivant, font de siège en siège deux ou trois fois le tour de la chambre.
Plus loin, le docteur nous fait part de l'accès de gaieté que lui causa un jour l'un de ses ouvriers en venant avec une gravité toute musulmane, lui demander s'il était vrai qu'il eût la faculté d'être en même temps dans plusieurs endroits différents, et de se promener à cheval dans l'atmosphère. Un vaisseau anglais vient-il à faire escale à Tunis pour emporter à Londres les antiquités découvertes ? M. Davis nous raconte la promenade à travers les fouilles faite avec les officiers du bord, sans oublier le succulent dîner qui les attendait au retour et qu'on avait fait dresser dans une salle antique récemment déblayée.
Il ne faudrait pas croire d'après ce qui précède, que le livre du savant anglais ne soit qu'un livre amusant. S'il est d'une lecture agréable, la science y a sa large part. Le docteur Davis n'a peut-être pas toujours apporté aux monuments qu'il découvrait toute l'attention désirable. Il n'en a pas moins consacré aux restes d'architecture antique de longues pages où il critique avec une grande vivacité les travaux et les opinions de ses devanciers. Pour lui les découvertes de M. Beulé ne sont rien moins que les fortifications de Byrsa ; l'aqueduc regardé jusque-là comme une construction romaine est l'oeuvre des Phéniciens et ainsi de suite. Il nous est impossible d'entrer ici dans la discussion des arguments sur lesquels se fonde une opinion si nouvelle. Nous ne pouvons que renvoyer au livre de M. Davis ceux de nos lecteurs qui seraient curieux d'approfondir ces questions. Dans ses dernières années un nouvel explorateur français, M. de Sainte-Marie, a étudié les ruines de Carthage. On peut voir à la Bibliothèque Nationale la belle collection d'inscriptions puniques découvertes par lui et qui, rapportée en France, par le Magenta, a si heureusement échappé au désastre de ce vaisseau.
Nous en avons fini avec les principaux travaux dont Carthage a été l'objet. Essayons maintenant, d'après les textes anciens et les études modernes, de nous faire une idée de ce qu'était au temps de sa splendeur et de son indépendance la grande cité phénicienne.
Conclure de l'identité du nom à l'identité de la chose signifiée est une erreur des plus communes et que n'a pas toujours su éviter plus d'un savant de profession.
Si nous nous figurions la capitale des Phéniciens d'Afrique comme quelque chose d'analogue à notre Paris moderne, nous nous tromperions lourdement. Des rues étroites et tortueuses aboutissant aux principaux édifices et aux portes de la ville ; d'innombrables impasses irrégulièrement disposées le long de ces grandes artères ; des maisons bâties un peu au hasard, telles étaient la plupart des villes de l'antiquité, telle était Carthage, telles sont encore aujourd'hui beaucoup de villes de l'Orient.
Les maisons carthaginoises étaient fort élevées, elles avaient jusqu'à six étages. De leur disposition intérieure nous ne savons rien, mais elles étaient terminées par des terrasses et du haut en bas badigeonnées avec du goudron. Que les murs aient été ensuite blanchis à la chaux, c'est ce qu'on peut affirmer sans crainte de se tromper. Le blanc réfracte la chaleur, le noir l'absorbe. Des maisons seulement goudronnées, sous le ciel brûlant de l'Afrique, auraient été parfaitement inhabitables. Nous avons d'ailleurs de l'usage de blanchir les maisons une preuve qui pour être indirecte n'en est pas moins concluante. Diodore de Sicile nous apprend que dans les grandes calamités publiques on tendait de noir non seulement les maisons, mais encore les remparts de la ville. Est-il probable qu'on eut pris cette peine si les murs avaient eu habituellement à peu près la couleur de la suie ?
Les rues étaient dallées et d'une largeur variable. Nul alignement n'étant imposé aux propriétaires, les deux rangs de maisons qui les bordaient s'écartaient et se rapprochaient tour à tour au point parfois de laisser à peine entre elles l'espace nécessaire au passage d'un chariot.
La topographie intérieure de Carthage nous est à peu près complètement inconnue. Des nombreux édifices qui embellissaient la ville, on connaît à peine le nom, les Romains n'ayant pas jugé à propos de laisser une description des monuments qu'ils détruisaient.
Le temple d'Esmum était situé précisément à l'endroit où s'élève aujourd'hui la chapelle de Saint-Louis ; au nord-est de Byrsa se voient encore les fondations supposées du palais de Didon ; entre Byrsa et la mer se trouvait le forum, grande place de forme rectangulaire, au dire de Diodore, et où se tenaient les assemblées. Le temple de Junon Céleste s'élevait sur une colline située en face de la colline de Saint-Louis.
Mais à quoi bon continuer cette énumération d'édifices sur lesquels manque toute donnée précise ? D'une manière générale, les plus anciennes constructions puniques étaient faites en blocage. Ce n'est que plus tard que l'usage de la pierre de taille devint fréquent dans les grands édifices. La prédilection pour les formes arrondies est un des caractères de l'architecture des Phéniciens. Les salles de leurs maisons ou de leurs palais sont généralement rondes ou ovales. Se trouve-t-il dans de très grands édifices une salle oblongue, les deux extrémités en sont arrondies. Les voûtes phéniciennes, bâties en blocage, sans claveaux, à la différence des voûtes romaines, sont ou des coupoles ou des voûtes en berceau ; mais dans ce cas, pour peu qu'elles soient de grande dimension, les angles en sont largement arrondis et le plus souvent elles se terminent en cul-de-four. Bref il semble qu'en toutes choses les architectes phéniciens aient eu horreur des angles et des lignes droites.
«J'ai pu remarquer aussi, dit M. Daux, dans les bâtisses quelconques les plus anciennes, que le nombre trois, prenant sans doute son origine dans une idée mystique, est observé en tout : trois salles, par exemple ; une salle longue divisée en trois demi-circonférences ; dans le décor trois moulures, ou mieux une moulure triple, trois boudins ; sur les stèles votives, trois doigts, trois unités jointes en bas, ou bien trois fois ces trois unités répétées ; les figures symboliques sont toujours disposées de façon à former trois saillies, trois extrémités».
L'extérieur des monuments est rarement orné de moulures ; dans les très grands édifices seulement, sur le parement en pierre de taille, on trouve parfois un boudin taillé grossièrement et au-dessus duquel le mur forme un retrait de sept à huit centimètres. A l'extérieur les murs étaient revêtus de plaques de marbre de diverses couleurs, sciées au moyen d'un fil métallique amorcé avec un mordant quelconque, puis dressées à la meule et polies. Il est très probable que les métaux étaient également employés à cet usage. Les lambris de bois, les tentures d'étoffes étaient encore plus communs. Le sol était couvert de mosaïques souvent d'une extrême finesse et d'une exquise beauté. L'intérieur des édifices religieux était enduit d'un stuc peint en ocre jaune, sur lequel se profilaient parfois des moulures d'un profil mou et indécis.
Ceci n'est vrai que des édifices les plus anciens et de ceux qui furent bâtis plus tard conformément aux usages phéniciens. Un grand nombre d'autres, bâtis par des architectes étrangers, surtout par des esclaves grecs de Sicile, présentent la plus grande analogie avec les monuments de l'art gréco-romain. On peut citer comme exemple la décoration ionique de l'un des ports de Carthage que nous allons étudier maintenant.
«Les ports de Carthage, dit Appien, étaient disposés de telle sorte, que les navires passaient de l'un dans l'autre ; du côté de la mer ils n'avaient qu'une seule entrée, large de soixante et dix pieds, qui se fermait avec des chaînes de fer.
Le premier port, destiné aux bâtiments marchands, était garni d'amarres nombreuses et variées. Au milieu du second était une île entourée de grands quais, de même que les bords opposés du bassin. Les quais présentaient une série de cales qui pouvaient contenir deux cent vingt vaisseaux. Au-dessus des cales, on avait construit des magasins pour les agrès. En avant de chaque cale s'élevaient deux colonnes d'ordre ionique qui donnaient à la circonférence du port et de l'île l'aspect d'un portique.
Dans l'île on a construit pour l'amiral un pavillon d'où partaient les signaux de la trompette, les ordres transmis par le héraut et d'où l'amiral exerçait sa surveillance. L'île était située vers le goulet et s'élevait sensiblement, afin que l'amiral vît tout ce qui se passait au large, sans que les navigateurs pussent distinguer ce qui se faisait dans l'intérieur du port. Les marchands mêmes qui trouvaient un abri dans le premier bassin, ne voyaient point les arsenaux du second : une double muraille les en séparait et une entrée particulière leur donnait accès dans la ville sans passer par le port militaire».
A ce passage d'Appien, se réduit à peu près tout ce que nous savons de certain sur les ports de Carthage, MM. Jal et Daux ayant démontré que la restauration proposée par M. Beulé à la suite de ses fouilles est inacceptable.
Mais toutes les villes phéniciennes du nord de l'Afrique avaient un port. Plusieurs de ces villes ont été étudiées, l'une surtout, toute voisine de Carthage et dont les monuments sont dans un état relativement bon de conservation, a été il y a quelques années de la part d'un savant français, l'objet de recherches approfondies. M. Daux a pu entre autres choses nous donner une restauration complète et certaine du port d'Utique. Or, comme le remarque fort bien cet auteur, les mêmes moeurs et les mêmes habitudes, sous un même climat, produisent, chez tous les peuples et dans tous les temps, une grande similitude dans la disposition des édifices. D'ailleurs, pour tous les ports puniques que M. Daux a pu étudier, il a constamment retrouvé, sauf des différences de détail, la même disposition. Est-il probable que seul le port de Carthage se soit écarté de cette forme traditionnelle ?
A défaut de renseignements directs, nous croyons donc qu'une description du port d'Utique pourra aider le lecteur à se faire une idée, au moins approximative, de ce qu'était le port de Carthage. Sans doute il n'y avait pas entre les deux identité parfaite, mais nous ne croyons pas que dans leurs lignes générales ils aient beaucoup différé l'un de l'autre, de même que tous les ports phéniciens étudiés jusqu'à ce jour.
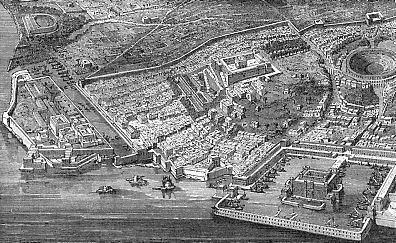 |
Le port d'Utique avait la forme d'un rectangle à angles largement arrondis. Au milieu, s'élevait le palais de l'amiral, relié à la terre ferme par une étroite langue de terre. «Des trois côtés de ce bassin, à gauche, à droite et au fond, s'élevaient, sur des quais à fleur d'eau, deux rangées ou, pour mieux dire, une double rangée de cales, ou magasins, superposées en retraite l'une sur l'autre ; le dessus des rangées inférieures, disposé eu terrasses plates et dallées, formait également un quai à peu près au niveau des bas quartiers de la ville. La hauteur était de 7m 20 pour la rangée ou étage inférieur ; l'étage supérieur pouvait avoir de 5m 50 à 6 mètres». Tout cela était bâti en blocage ; mais les murs de refend, c'est-à-dire les murs qui séparaient chaque cale de la cale voisine, étaient pourvus à leur partie antérieure d'un parement en pierre de taille, «formant une sorte de pilastre uni, sans saillie ni moulure. De sorte que, vu d'ensemble, l'aspect, dans le développement de la longueur en façade, devait présenter comme un seul mur en pierre de taille, uni et plat, évidé régulièrement par les ouvertures des voûtes et les baies des portes des cales».
En face de la langue de terre ou taenia conduisant au palais amiral et sur une largeur de 41 mètres, il n'y avait ni cales ni magasins, mais seulement un massif de maçonnerie, s'élevant jusqu'à la hauteur du quai supérieur et dans l'épaisseur duquel était pratiqué un large escalier donnant accès à la taenia.
Entre le quai supérieur et la grande muraille qui défendait le port se trouvaient, entre les doubles rangées de cales et derrière elles d'autres grandes salles et des logements. Aux angles est et sud-ouest se trouvaient deux édifices paraissant avoir été des temples, et dont l'un était orné de colonnes dont les débris gisent encore sur le sol. Au sud-ouest, derrière les magasins, étaient des chantiers et des ateliers bâtis sur des citernes. Des bassins, servant sans doute au radoub, se trouvaient aussi de ce côté. Une belle porte monumentale, décorée de colonnes, donnait issue de l'arsenal sur la campagne.
Les files de magasins qui s'étendaient à droite et à gauche du port s'appuyaient, du côté de la mer, sur un fort. L'un de ces forts richement orné de sculptures à l'intérieur, était en même temps un temple. Entre ce temple et deux autres forts reliés par une courtine qui s'élevaient sur un îlot à 25 mètres de là, se trouvait l'entrée du port. Un môle puissant, à angles courbes, achevait d'enclore le port du côté du nord-ouest.
Il nous reste à parler du palais de l'amiral. «Il se composait d'un corps de logis principal flanqué de six tours rondes et de quatre bastions ou forts latéraux.
Le corps principal, vaste parallélogramme irrégulier, portait une tour ronde à chaque angle extérieur. Le centre était une tour rectangulaire sur laquelle donnaient toutes les baies de portes et de fenêtres des différentes salles de l'édifice. Tout autour de l'intérieur de cette cour régnait une galerie à piliers supportant deux étages de voûtes.
Au nord du palais, une grande porte surmontée d'un large balcon, et protégée par deux tours engagées, pareilles à celles des angles extérieurs, s'ouvrait sur un bassin réservé à l'amiral ou au service maritime, enclavé dans le port, avec lequel il communiquait.
A l'opposé, au sud, une avant-cour précédée d'une haute porte fortifiée et appuyée sur deux tours rondes semblables aux autres, était protégée par des murs crénelés et engagés dans la façade du palais. De cette porte on débouchait sur un embarcadère large et aboutissant à un terre-plein, langue de terre, ou taenia, qui établissait une communication entre le palais, le fond du port et la ville.
A l'est et à l'ouest du palais, deux forts bastions aux angles arrondis extérieurement comme ceux du port étaient intérieurement, faisaient annexe à l'édifice. Ces deux bastions se composaient d'une large courtine à trois faces, portée en dedans sur voûte et piliers. Une cour faisait le centre. Sur la courtine ou plate-forme crénelée autour, étaient sans doute les machines de guerre.
Deux fortins carrés, têtes de môles, un peu moins élevés, précédaient les bastions du côté de la haute mer, et de leur face antérieure partait le petit môle qui isolait le bassin réservé de l'amiral.
Le pied des gros murs, tant de l'édifice principal que des dépendances, était séparé de l'Euripe par un quai continu, au sud-est et à l'ouest, recouvrant des séries de citernes parallèles».
Les salles qui se trouvaient dans les angles du palais étaient rondes et voûtées en coupole. Les autres salles étaient rectangulaires, arrondies aux angles et voûtées en berceau terminé par deux culs-de-four. Les salles étaient dallées. Des escaliers en spirale, pratiqués dans les tours ou dans l'épaisseur des murs donnaient accès aux étages supérieurs.
«L'aspect d'ensemble de ce monument, dit M. Baux, devait être très sévère. C'était en réalité une forteresse plutôt qu'un palais. On voit que la préoccupation dominante de ceux qui l'avaient édifié avait eu pour objet une solidité à toute épreuve alliée à tous les moyens de défense que le génie des fortifications des temps antiques avait pu suggérer. Les murs extérieurs, en effet, étaient d'une grande force de résistance, surtout dans le bas au-dessus des eaux, là où un bélier d'attaque, installé sur des navires ou radeaux ennemis joints ensemble, aurait pu les battre en brèche. Le vide des cages d'escaliers, si exigu déjà, est en vertu de ce principe et par surcroît de précaution, tout à fait nul en bas, car là ils prennent issue par la cour intérieure, traversant les massifs qui séparent les salles, et ne se rapprochant des murs extérieurs que vers le haut, hors de toute atteinte des béliers. La grande élévation des murailles en rendait l'escalade dangereuse et difficile : dangereuse parce que les assaillants se trouvaient de tous côtés exposés au tir des créneaux, qui les prenait dessus, devant et en face, et du saillant des tours, qui les découvrait de flanc ; difficile, par la raison que le pied des échelles ne pouvait être que sur des navires que la mobilité de l'eau rendait instables. De plus, ces murs extérieurs n'offraient pas de prise par les baies de fenêtres, les salles prenant leur jour par la cour intérieure.
Cette vaste construction, massive et sévère ; ce rare et presque sauvage décor architectural ; ces grandes dalles nues, à peine éclairées par un jour parcimonieux, à l'aspect sombre et imposant, sous les voûtes desquelles la voix devait être retentissante ; ce manque complet de tout marbre, de tout stucage, de toute répartition dont les détails facilitent la vie et adoucissent le travail quotidien ; tout cet ensemble fait évidemment remonter la fondation de ce monument à une haute antiquité, quelques siècles sans doute avant celui de Carthage, qui, lui-même, existait déjà, d'après des documents certains, il y a vingt-trois siècles.
Telles, ou à peu près, devaient être ces places fortes, ces châteaux, dont il est parlé dans la Bible, au temps où le peuple élu pénétrait en masse et le glaive en main sur la terre promise par le Seigneur, sous la conduite de son audacieux chef, Jésu ou Josué, quatorze siècles avant notre ère».
Nous ne quitterons pas Utique sans mentionner un petit édifice que M. Daux a retrouvé et qu'il suppose avoir peut-être servi autrefois aux «transmissions télégraphiques». Cette hypothèse n'est pas aussi extraordinaire qu'elle pourrait le paraître à quelques lecteurs. Si ces appareils qui, à l'aide de l'électricité, transmettent instantanément à d'énormes distances, non seulement de courtes indications, mais jusqu'aux discours politiques qui occupent plusieurs colonnes de nos journaux, sont d'invention toute récente ; en revanche, l'art de transmettre la pensée à distance au moyen de divers signaux remonte à une haute antiquité. Polybe décrit avec détail le système de transmission télégraphique le plus parfait à ses yeux, système inventé par Cléoxène et Démoclite, puis perfectionné par les Romains.
Les lettres de l'alphabet étaient réparties en cinq classes et inscrites sur autant de tablettes dont les quatre premières recevaient chacune cinq lettres, et la cinquième quatre seulement. Voulait-on correspondre ? au-dessus d'une palissade à hauteur d'homme, et jouant le rôle d'écran, on élevait deux fanaux. Le préposé à la station suivante en élevait deux de son côté, pour montrer qu'il était prêt à correspondre. On élevait alors au-dessus de la palissade de la station de départ et du côté gauche, un, deux ou cinq fanaux, suivant que la première lettre du premier mot qu'on voulait transmettre se trouvait sur la première, sur la seconde ou sur la cinquième tablette. Simultanément, on élevait du côté droit un nombre de fanaux indiquant le rang que cette lettre occupait sur la tablette. Chaque lettre ainsi transmise était au fur et à mesure inscrite sur une tablette, et pour peu que les hommes préposés à ce service fussent attentifs et exercés, on pouvait ainsi correspondre avec exactitude, et avec une rapidité relative. Les postes étaient naturellement placés sur des points élevés, et deux lunettes jumelles, au moyen desquelles on visait d'une station les fanaux de l'autre, permettaient de les placer à de grandes distances l'un de l'autre.
En ce qui regarde spécialement Carthage, nous avons un texte précis prouvant que ces signaux télégraphiques étaient connus et employés au quatrième siècle de notre ère.
«Pendant qu'ils faisaient la guerre en Sicile, dit Polybe (VI, 16), les Carthaginois s'avisèrent, pour avoir promptement toutes sortes de secours de la Libye, de fabriquer deux horloges d'eau de pareille structure. La hauteur de chacune était divisée en plusieurs cercles. Sur l'un ils avaient écrit : Il faut de l'or, des machines, des vivres, des bêtes de somme, de l'infanterie, de la cavalerie, etc.
De ces deux horloges d'eau ainsi marquées, ils en gardèrent une en Sicile et envoyèrent l'autre à Carthage, avec ordre, quand on verrait un feu allumé, de prendre bien garde au cercle où s'arrêterait l'eau quand on allumerait le second feu. Par ce moyen, on savait à Carthage, en un instant, ce qu'on demandait en Sicile, et ou l'envoyait sur-le-champ.
C'est ainsi que les Phéniciens vinrent à bout d'avoir très promptement tous les secours dont ils avaient besoin pour soutenir la guerre».
Mais revenons à la description de Carthage et occupons-nous de ses fortifications, qu'il nous reste maintenant à étudier.
Selon Appien, Carthage était défendue par trois murs identiques, placés à une certaine distance l'un de l'autre et mesurant 9 mètres d'épaisseur, sur près de 14 mètres de haut sous les créneaux : A l'intérieur de chacun des trois murs, qui étaient creux et à deux étages, on trouvait, selon notre auteur, le logement : 1° de 500 éléphants et, au-dessus d'eux, 2° de 4000 chevaux, 3° de 24000 hommes ; ce qui faisait en tout, à notre compte, pour les trois murs, 900 éléphants, 12 000 chevaux et 72 000 hommes.
En outre, on y avait ménagé de vastes magasins contenant une grande quantité de vivres pour ces nombreux éléphants, des fourrages et de l'orge pour toute cette cavalerie. Ces renseignements assez fantastiques ont été de nos jours révoqués en doute par des arguments qui semblent sans réplique :
«Je suppose, dit M. Graux, qu'Appien loge les éléphants au rez-de-chaussée. Quant aux chevaux, il n'y a pas à dire, et le texte est formel, il les fait monter, ainsi que les hommes, au premier étage. A raison de deux étages dans une hauteur de 14 mètres, le niveau du premier serait à 7 mètres d'élévation au-dessus du sol. Voilà des chevaux bien haut perchés ! Et comment expliquera-t-on, si la triple muraille règne sur plusieurs côtés de la ville, que trois enceintes concentriques successives fussent égales entre elles en longueur et, à épaisseur constante, égales en superficie ? Il faut être logique : si la plus intérieure est capable de contenir un nombre donné d'éléphants, de chevaux et dhommes, la seconde et surtout la plus extérieure des enceintes, à épaisseur et à hauteur égales, en contiendront davantage. Mais Appien n'a pas songé à tout cela».
Le système des trois murs identiques est inacceptable. Mais l'épithète de «triple» donnée par les auteurs aux fortifications de Carthage devait répondre quelque chose. Cherchons à nous en rendre compte. Et tout d'abord, quel était ce système adopté par les anciens pour la fortification de leur ville ? Un ingénieur grec, le seul dont les oeuvres soient venues jusqu'à nous, Philon de Byzance, va nous permettre de répondre à cette question.
A une assez grande distance du rempart principal, dans une zone large de plus de 160 mètres, on enfouissait des poteries vides, posées debout, et bouchées seulement avec des algues. Le terrain ainsi miné supportait aisément le poids des hommes, mais il s'effondrait sous celui des machines de guerre. L'ennemi se trouvait ainsi retenu à une grande distance, pendant un temps plus ou moins long.
Cette difficulté surmontée, il arrivait à un premier fossé derrière lequel s'élevait une levée de terre et une palissade. Cette première ligne prise d'assaut, le fossé comblé et le terrain nivelé pour que les machines de guerre pussent approcher, les assaillants se trouvaient en face d'une seconde ligne de fortifications exactement semblable ; et tout était à recommencer.
Ce n'était pas tout encore. Un nouveau fossé s'ouvrait à 40 coudées en arrière ; derrière ce fossé, une nouvelle levée de terre, mais revêtue cette fois de parements en maçonnerie, et constituant ce qu'en termes de fortification on nomme un avant-mur ; à un plèthre (30 mètres environ) en arrière et dominant le tout, s'élevait le rempart proprement dit.
Telles étaient dans leurs lignes générales les fortifications de Carthage ; la comparaison avec d'autres colonies phéniciennes où ces divers ouvrages sont encore visibles, et plusieurs autres arguments le prouvent assez. Nous ne pouvons les exposer ici. On les trouvera tout au long dans le savant et intéressant mémoire de M. Graux, auquel sont empruntés tous les détails qui précèdent et ceux qui vont suivre. Remarquons seulement que le rempart, l'avant-mur et les défenses extérieures constituent bien un triple rempart.
Arrivons au mur proprement dit. Nous n'avons que peu de choses à en dire. Ce mur, nous le savons déjà, était creux. Au rez-de-chaussée se trouvaient les écuries des éléphants et très probablement aussi, en dépit d'Appien, celles des chevaux. Les logements de la garnison et les magasins occupaient les deux étages supérieurs. Un parapet crénelé et un toit couronnaient l'édifice. Au-dessous on avait creusé des citernes. Ce sont ces citernes que M. Beulé déblaya et qu'il prit pour les chambres de la garnison.
 |
L'existence de ces citernes sous les fortifications de Carthage n'a rien qui doive surprendre ; on en a retrouvé de semblables sous les murs des autres villes phéniciennes de l'Afrique septentrionale. Tous les édifices puniques, monuments publics ou maisons particulières, étaient de même bâtis sur des citernes. Les rues de Carthage, nous l'avons déjà dit, étaient dallées. Ce nétait pas dans un but de propreté ou de luxe que les Phéniciens, si négligents en matière de voirie, avaient adopté pour leurs chaussées un revêtement aussi coûteux. Ces dalles empêchaient l'eau des pluies de se perdre dans le sol et la conduisaient par divers canaux dans d'immenses réservoirs publics creusés sur plusieurs points de la ville. Recueillir et conserver l'eau des pluies, était en effet pour les Carthaginois une question de vie ou de mort.
Jusqu'au jour où un aqueduc fut construit, l'eau des pluies, conservée dans des citernes dut suffire à leurs besoins, et ce n'est pas un de nos moindres étonnements de voir qu'une ville de cette importance se soit développée loin de tout cours d'eau.
Ce qui nous semblerait aujourd'hui un obstacle à peu près insurmontable ne paraît pas avoir jamais arrêté les Phéniciens lorsqu'ils choisissaient l'emplacement d'une de leurs colonies ; beaucoup de leurs villes se trouvaient dans la même situation que Carthage. «Les habitants, dit Strabon, en parlant de la ville d'Arad, boivent de l'eau de pluie conservée dans des citernes ou de l'eau qu'on fait venir de la côte opposée». Une source jaillissait à peu de distance au fond de la mer. En cas de besoin des plongeurs descendaient une cloche de plomb qu'ils appliquaient sur l'orifice de la source, et un tuyau de cuir amenait l'eau douce à la surface. Tyr n'avait même pas cette ressource. Que l'eau des citernes vint à s'épuiser, la partie insulaire de la ville n'avait qu'un moyen de se procurer l'eau : c'était de la faire apporter dans des barques qui l'allaient chercher au continent.
Toutes les citernes, puniques ou romaines, sont bâties d'après un même principe. Diviser la masse de l'eau de manière à pouvoir nettoyer les réservoirs sans interrompre le service, tel est le but que se proposaient les architectes qui les construisaient.
Les citernes puniques se composent invariablement de une et souvent de deux rangées de longs bassins parallèles, à parois très épaisses et voûtes en berceau plein cintre, le tout en blocage. Celles de Carthage, d'Utique, d'Hadrumète et de bien d'autres villes, forment un vaste parallélogramme. Des galeries couvertes, qui s'élevaient jadis au-dessus du sol, abritaient contre les ardeurs du soleil les habitants qui venaient journellement en ce lieu puiser l'eau nécessaire à leur consommation. Elles augmentaient aussi la fraîcheur des eaux sous les voûtes inférieures.
Les citernes de Carthage offraient ceci de particulier qu'aux quatre angles du parallélogramme, ainsi qu'au milieu, se trouvaient six filtres circulaires recouverts par autant de coupoles «dont l'effet gracieux rompait à l'oeil la monotone uniformité des extrados de voûtes en berceau». Du fond de ces filtres partaient des conduits en maçonnerie qui distribuaient l'eau sur des différents points de la ville. Des robinets en métal, ou, à une époque plus ancienne, en pierre de taille, permettaient d'interrompre et de rétablir à volonté le cours de l'eau.
Toutes les citernes n'étaient pas aussi vastes ni conçues sur un plan aussi compliqué. Celles notamment que les Carthaginois établissaient dans leurs propriétés rurales, avaient une forme beaucoup plus simple bien que tout aussi caractéristique. M. Daux a eu le bonheur de retrouver une de celles-ci à peu près intacte. Elle se composait de deux bassins ronds, creusés l'un à côté de l'autre au milieu d'une plaine. Nulle voûte ne les couvrait. Le plus grand de ces deux bassins avait une profondeur de 7 à 9 mètres ; le second était plus profond mais aussi plus étroit. Une fente verticale de 40 centimètres de largeur, et que l'on bouchait avec des planches ou autrement, mettait les deux bassins en communication l'un avec l'autre ; une margelle assez élevée entourait l'orifice de l'un et l'autre bassin. L'eau qui alimentait ce réservoir était celle que les orages versaient à torrent sur la plaine voisine ; elle pénétrait dans ce réservoir par des trous percés au niveau du sol, à travers la margelle. L'eau qui se précipitait ainsi dans le grand réservoir entraînait avec elle une grande quantité de sable, de feuilles et de détritus de toute nature. Toutes ces impuretés se déposaient peu à peu, et au bout de quelques jours l'eau était redevenue pure et limpide. On ouvrait alors avec précaution la communication entre les deux bassins et l'eau s'écoulait du grand bassin dans le petit, qui jouait ainsi le rôle de filtre. C'est dans ce petit bassin, qu'à l'aide de seaux en cuir, on puisait pour abreuver le bétail.
Du côté opposé au filtre se trouvait un grand bassin carré couvert d'une voûte formant plate-forme ; c'est un second filtre ajouté à l'époque romaine à la construction primitive ; la voûte gardait l'eau plus fraîche. La communication avec le réservoir était établie, non plus par une fente verticale, mais par une série de tuyaux en terre cuite traversant la paroi et disposés les uns au-dessus des autres de demi-mètre en demi-mètre. On les bouchait au moyen de tampons. On pouvait ainsi décanter l'eau d'un bassin dans l'autre sans agiter ln ruasse entière. Une cuvette à vase ménagée au fond de la construction romaine achevait d'établir la supériorité de ce filtre nouveau sur l'ancien bassin servant au même usage.
Les citernes de Byrsa jouissaient d'une réputation méritée. L'eau s'y conservait fraîche et pure mieux que partout ailleurs. Quelques-unes de celles que les Phéniciens y ont creusées servent encore, et, pendant les chaleurs de l'été, le bey de Tunis et les consuls étrangers y envoient puiser tous les jours.
Occupons-nous maintenant des produits des arts autres que l'architecture, trouvés à Carthage. Cette classe de monuments se réduit à bien peu de chose. Des monnaies et des stèles servant d'ex-voto, c'est à peu près tout.
|
Les monnaies ne nous apprennent pas grand' chose sur l'art punique, car l'exécution en était confiée à des esclaves grecs de Sicile. L'une de ces monnaies représente la tête de la nymphe Aréthuse. Au revers, Pégase. La légende BARAT signifie les puits. Peut-être lirait-ou plus exactement BI ABAT «à Arat», nom punique de Syracuse qui possédait la fontaine fameuse d'Aréthuse. C'est une grande pièce d'argent certainement frappée en Sicile, et probablement à Syracuse, dit M. de Saulcy, à qui nous empruntons ces détails de numismatique. Une seconde pièce, division de la précédente, porte également la tête d'Aréthuse. Au revers, un cheval libre adossé à un palmier, type essentiellement carthaginois. La légende a la même signification, ce qui assigne à cette pièce la même origine sicilienne. Sur une monnaie de Lybie, on voit la tête d'Hercule-Melkart coiffé d'une peau de lion ; au revers, un lion marchant ; au-dessous, le nom des Lybiens en caractères grecs ; en haut, la lettre punique correspondant à M, abréviation du mot MAKNAT, qui signifie camp. La pièce serait donc une moneta castrensis spéciale aux Lybiens. Outre les monnaies métalliques, les Carthaginois employaient encore dans leurs échanges des rondelles de cuir portant l'estampille de l'Etat, et qui jouaient à peu près le rôle de notre papier-monnaie. Inutile de dire qu'aucun spécimen de ces antiques billets de banque ne s'est conservé jusqu'à nous. |
 |
Si les monnaies puniques trouvées jusqu'à ce jour sont de style grec, en revanche les ex-voto sont des monuments purement carthaginois, partant plus intéressants pour le sujet qui nous occupe. «Les stèles votives carthaginoises, dit M. Berger, se ressemblent toutes».
 |
Ce sont des pierres de trente à cinquante centimètres, terminées en pointe. Souvent deux acrotères leur donnent à peu près la forme qu'affectent un grand nombre de nos tombeaux modernes. L'inscription votive occupe la partie inférieure de la stèle. Le haut est réservé à diverses représentations figurées qui constituent peut-être le principal intérêt de ces monuments.
|
Le symbole le plus fréquent est la main ouverte et levée vers le ciel. C'est la main du dieu qui bénit. Parfois cette main est accostée de deux oreilles. D'autres fois, le pouce de cette main offre un développement démesuré, pour signifier la puissance du dieu. Sur une des stèles rapportées par M. de Sainte-Marie, et qu'on peut voir à la Bibliothèque nationale, est représentée une bouche. Ces emblèmes rappellent tout naturellement la formule qui se lit sur un grand nombre d'ex-voto, et qui est toujours sous-entendue dans les inscriptions où elle ne se trouve pas : «Parce qu'il a entendu sa voix, qu'il le bénisse». |
 |
 |
Quel dieu représentent ces symboles ? Est-ce Tanit ? Est-ce Baal-Hammon? On ne pourrait répondre avec certitude à cette question. D'autres symboles également fréquents sur les monuments puniques peuvent heureusement être expliqués à coup sûr. C'est ainsi que le bélier représente Baal ; le disque de Vénus surmonté d'un croissant, Tanit. |
 |
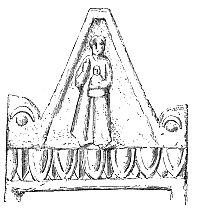 |
Une autre stèle publiée en 1872 par M. Euting dans les Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg, représente la déesse debout, vêtue d'une robe qui laisse voir les pieds, la main droite levée, la main gauche portant un enfant dans ses langes. A droite et à gauche, sur les acrotères, on voit le croissant surmontant le disque de Vénus. Cette composition présente cela de particulier qu'elle est en relief, au lieu d'être simplement gravée au trait, comme le sont généralement les monuments du même genre.
De tous les emblèmes de Tanit, le plus fréquent sans contredit est une sorte d'hiéroglyphe représentant la divinité, mais d'une façon si rudimentaire en général, qu'on a de la peine, dit M. Berger, même en le sachant, à y voir une forme humaine. On dirait une figure géométrique. Il n'en est rien pourtant ; c'est un personnage vêtu d'une robe et qui lève les mains vers le ciel.
Il y a dans la charpente de ce mannequin une préoccupation symbolique évidente. Les bras et les jambes ne sont que des appendices insignifiants. La tête même n'est le plus souvent qu'un simple disque. Toute l'importance de ce personnage réside dans la forme triangulaire de son corps ou de sa robe. L'explication nous en est donnée par Tacite, qui dit, en parlant de la Vénus de Paphos : «La déesse n'est point représentée sous la figure humaine ; c'est un bloc circulaire qui, s'élevant en cône, diminue graduellement de la base au sommet. La raison de cette forme est ignorée».
L'emblème punique ne jette-t-il pas à son tour quelque lumière sur cette question que Tacite ne pouvait résoudre ? N'est-ce pas dans quelque antique légende déjà oubliée au temps du grand historien romain, légende que nous ne connaissons pas, mais que nous connaîtrons peut-être un jour, qu'il faut chercher l'origine du cône de Paphos et du monogramme, qu'on nous passe l'expression, par lequel les Carthaginois représentaient Tanit ?
Dans les divers ex-voto que nous venons de passer en revue, nous n'avons observé que des représentations plus ou moins symboliques de la divinité. D'autres stèles se rapportent au culte rendu à ces divinités. On voit des animaux et des plantes : l'éléphant, la colombe, le cygne, oiseau consacré à Vénus et le grenadier du culte d'Adonis. Malheureusement, ces monuments sont en trop petit nombre et n'ont pas été jusqu'ici, faute d'éléments de critique, suffisamment étudiés pour qu'il soit possible de les expliquer avec quelque certitude.
Une dernière catégorie de stèles votives, celle qui offre le plus grand intérêt pour l'archéologie, nous fait pénétrer dans l'intimité de ces anciennes générations. On y voit un reflet du commerce et de l'industrie phéniciens. Ces stèles représentent soit l'offrande elle-même, soit un objet caractérisant la profession de celui qui faisait cette offrande. Les Carthaginois étaient un peuple de marins. Aussi trouvons-nous d'abord toute une série d'emblèmes maritimes qui font penser aux petits navires que nos marins suspendent dans les chapelles de la côte pour accomplir un voeu fait en un jour d'angoisse.
L'une de ces stèles, malheureusement en fort mauvais état, représente un navire entier. La poupe est arrondie et assez élevée, le mât ne porte pas de voiles ; sur le côté se voit un objet assez difficile â préciser et que M. Berger suppose être un gouvernail. L'avant est cassé. Ln autre monument nous montre seulement la proue d'un vaisseau. D'autres, en très grand nombre, portent des ancres, des gouvernails, etc. Les armes sont plus rares ; citons cependant un palmier entre deux piques que l'on peut voir sur une des pierres échappées au désastre du Magenta. Encore ces piques ne sont-elles pas des armes mais des enseignes analogues à celles des armées romaines, comme le montre le double renfleent qui se voit au-dessous du fer. Mentionnons encore une panoplie remarquable surtout en ceci : que la forme conique du casque qui la surmonte prouve que le casque célèbre trouvé sur le champ de bataille de Cannes et qui a cette forme appartenait bien à un des soldats d'Hannibal.
 |
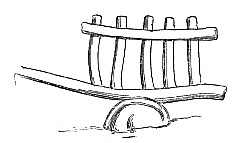 |
Des instruments de toute nature, marteaux, haches, burins, herminettes, etc., des vases sacrés, des candélabres, des charrues, un chariot à échelles, aux roues pleines et basses et à un seul timon, sont les objets qu'on remarque sur les autres stèles votives rapportées d'Afrique par M. de Sainte-Marie. «Que l'on compare, dit M. Duruy, ce qu'il est sorti de monuments précieux de la petite ville de Pompéi avec ce que nous livre le temple de Tanit, et, quelque grande que l'on fasse la part des profanations et du pillage, on n'échappera pas à la pensée que les Carthaginois, malgré le voisinage de la Sicile, n'ont eu qu'un art grossier».
Nous nous permettrons de n'être pas ici de l'avis de l'éminent historien. Ne se peut-il pas que ces images, qu'il ne nous viendra certes pas à l'esprit de comparer aux bas-reliefs de Pompéi et dont la naïveté, nous le reconnaissons volontiers, touche parfois au grotesque, soient des images traditionnelles et en quelque sorte hiératiques ? C'est un des caractères propres à toutes les religions, tant anciennes que modernes, de s'attacher invariablement aux formes qui étaient ou que l'on croit avoir été en usage à l'origine.
Ne voyons-nous pas le costume ecclésiastique demeurer à peu près invariable au milieu des transformations continuelles de la mode ?
La vieille écriture de la Daterie romaine n'est-elle pas restée la même pendant des siècles, bien qu'elle soit d'une lecture si difficile pour qui n'a pas fait de la paléographie une étude spéciale, que les pontifes ont été maintes fois obligés de joindre une copie en écriture ordinaire à l'original qu'ils envoyaient afin que le destinataire pût en prendre connaissance ?
Les bulles de plomb même aux époques de raffinement artistique, n'ont-elles pas reproduit presque constamment le type barbare de celles dont les papes du moyen âge scellaient leurs actes ?
Que conclure de tout cela ? Qu'il ne faut pas trop se hâter de porter un jugement sur l'état des arts dans les différentes colonies phéniciennes. Les rares monuments carthaginois retrouvés jusqu'à ce jour sont d'une grossièreté incontestable. Mais la prudence nous engage à ne pas affirmer que ce peuple n'en ait jamais produit que de semblables. Qui sait si demain une découverte nouvelle ne viendrait pas donner à notre assertion trop absolue un formel démenti ?
 |