
Le Jupiter d'Olympie (détail) - Lithographie de Ferdinand Knab publiée dans Munchener Bilderbogen, 1886
Le Jupiter d'Olympie
A travers le Péloponèse : Corinthe, Némée, Stymphale, Phonia, Olympie
Kalamaki fait pendant à Corinthe ; c'est un hameau qui
se trouve sur la côte orientale de l'isthme. Une route
carrossable, chose beaucoup plus rare en Grèce qu'un
temple antique, traverse l'isthme et relie Kalamaki à
la nouvelle Corinthe. Cette route cependant, nous la
dédaignons, et, en effet, ce n'est pas de ce
côté que nous avons marqué notre
première étape. Ce qui est nouveau en
Grèce ne vaut jamais ce qui est vieux, et la nouvelle
Corinthe ne l'ait pas exception à la règle.
Cette ville, éloignée de l'ancienne Corinthe de
cinq kilomètres environ, se déploie au fond du
golfe sur un sol plat ; elle compte à peine quelques
années d'existence, et les tremblements de terre l'ont
déjà ravagée plusieurs fois. Cette
année encore, les maisons, à peine
relevées, ont été jetées
bas.
A peine sortis de Kalamaki, nous laissons la route de
l'isthme sur la droite, pour suivre un sentier qui serpente
dans la direction du sud-ouest. On me signale bientôt,
sous un épais manteau de lentisques et de pins,
l'emplacement d'un petit théâtre, puis un stade
dont l'herbe envahit l'arène et les plans
inclinés où s'étageaient les gradins. Ce
stade a vu la pompe des jeux Isthmiques, les chars
furieusement emportés, les luttes
héroïques, les courses ardentes, le peuple
agité et roulant sous les portiques comme une mer
houleuse, et les vaincus sortant la tête basse, et les
vainqueurs proclamés au milieu des acclamations
retentissantes, et les poètes chantant leur triomphe,
et les pontifes chantant les hymnes des dieux ; il a vu la
Grèce de Thémislocle et de Léonidas, car
l'isthme était comme un trait d'union, une terre
sainte où Sparte se rencontrait avec Athènes,
Argos avec Mycènes, Corinthe avec Mégare. Ce
stade a vu encore, spectacleplus nouveau, un étranger,
un barbare, venu des bords du Tibre, présider les jeux
; c'était Flaminius qui proclama, au nom de Rome, la
liberté et l'indépendance de la Grèce.
Le vieux stade en faillit crouler, tant le peuple poussa de
cris de joie et fit tonner de frénétiques
applaudissements. Cela se passait en 196 ; cinquante ans plus
tard, un proconsul s'installait à Athènes, la
Grèce n'était plus qu'une province romaine.
Puis Néron vint à son tour, il descendit dans
l'arène, chanta ses vers et fut plus applaudi que
Pindare ; il daigna vaincre, et les couronnes d'or lui furent
décernées. Les Grecs flattaient mieux encore
que les Romains, et l'empereur en fut ravi. Ce fut alors
qu'il conçut le projet de couper l'isthme de Corinthe
; on commença les travaux, mais pour les interrompre
bientôt après. Il est aujourd'hui vaguement
question de les reprendre.
Nous nous élevons lentement à travers une
campagne aride. On reconnaît des carrières
abandonnées et quelques tronçons d'une
chaussée antique. L'Acro-Corinthe, montagne grandiose,
apparaît ; elle semble défendre la porte du
Péloponèse. Les fortifications que
l'antiquité, le moyen âge
élevèrent pour fermer l'isthme, ont
laissé des pans de murs rougeâtres ; catapultes
et canons, confondant leurs ravages à travers les
âges, en ont fait des ruines informes.
Nous atteignons un plateau que les orges recouvrent, et les
épis verts, que la brise balance, ondulent, se
plissent, chatoient, car la lumière varie
subitementses jeux sur cette petite plaine mouvante.
Près de là une sorte de cuve ovale est
creusée dans le tuf ; quelques archéologues y
veulent connaître l'arène d'un
amphithéâtre. Ce serait alors le seul monument
de ce genre que renferme la Grèce. Stades,
théâtres abondent ; l'amphithéâtre
est presque inconnu, et rien ne fait plus l'éloge des
Grecs et de la délicatesse aimable, humaine de leur
goût. Les luttes loyales, héroïques des
boxeurs, des coureurs pouvaient les passionner, le corps y
révélait sa vigueur, son agilité en
même temps que sa beauté ; mais le massacre
organisé comme une fête, les fauves rugissants,
les hommes jetés en pâture à leur
appétit féroce, c'étaient là
choses grossières, stupides autant qu'odieuses, et les
hommes qui s'empressaient aux comédies de
Ménandre, aux drames d'Euripide, ne pouvaient les
accepter. Les Grecs applaudirent dans Néron un
méchant histrion, mais ils s'obstinèrent
toujours à siffler les gladiateurs.
Mon guide m'apprend bientôt que je suis à
Corinthe, et certes l'avis n'est pas inutile.
«L'opulente Corinthe, chante Pindare, vestibule de
Neptune Isthmique, mère des jeunes
héros». Corinthe qui était une des plus
grandes et des plus riches cités de la Grèce,
Corinthe, la ville de Laïs et des belles courtisanes,
Corinthe, la ville des faciles amours où les riches
patriciens, la jeunesse folle, les traitants, les corsaires
pillards, les négociants enrichis allaient prodiguer
à Vénus les trésors qu'ils devaient
à Mercure, Corinthe où
Démostliène lui-même un jour égara
sa sagesse, l'antique et voluptueuse Corinthe n'est plus
qu'un pauvre hameau poudreux, sale, lézardé,
croulant. Je trouve un petit café, un érable
centenaire y prête son ombre à la table que je
fais dresser ; mais plus de Laïs qui égayé
le repas de quelque chanson d'Anacréon. Je n'ai pour
compagnie que des chiens hargneux et des poules
affamées. Mummius a passé là, et
Mummius, comme on sait, s'entendait à
déménager une ville ; lui-même, dans une
inscription que l'on conserve au Vatican, se vante d'avoir
détruit Corinthe. Corinthe toutefois s'était
peu à peu relevée de ses ruines ; Pausanias qui
vint là, au second siècle de l'ère
chrétienne, parle de tombeaux fastueux, d'autels, de
temples et de statues de bronze.
Corinthe ne garde aujourd'hui que les restes d'un temple,
fort ancien, antérieur au Parthénon, et, comme
quelques temples de Sélinonte en Sicile, remontant
probablement au sixième siècle. Sept colonnes
sont debout ; cinq conservent leurs chapiteaux et les
architraves qui les réunissent ; elles accusent l'un
des angles du monument. La sixième a perdu son
chapiteau, la septième coiffe encore le sien, mais un
peu de travers ; les tremblements de terre ont compromis son
aplomb. Les fûts monolithes se renflent lourdement,
rétrécissant vers le sommet leurs larges
cannelures. Les colonnes ne mesurent pas sept mètres
de hauteur totale, tandis qu'elles ont plus d'un mètre
et demi de diamètre à leur base. Les chapiteaux
projettent un tailloir d'une saillie énorme. Aussi
toute cette bâtisse est robuste, trapue, mais non sans
majesté ; il semble qu'on ait taillé ces blocs
à grands coups de hache, et non pas qu'on les ait
appareillés par le travail patient du ciseau. Cette
ébauche brutale a quelque chose de grandiose et
d'héroïque. Ce furent des hommes rudes encore qui
élevèrent ce temple. Bien
vénérables sont ces colonnes : elles ont vu
Corinthe aux premiers jours de ses grandeurs. La
tempête que Rome déchaînait a passé
sur elles sans les détruire ; elles ne gardent plus un
équilibre parfait, et l'on dirait qu'elles
s'étayent l'une l'autre pour ne pas tomber. Les
éperviers tourbillonnent tout à l'entour,
gardiens des ruines, et leurs cris protestent contre notre
profane curiosité.
L'Acro-Corinthe portait l'acropole de Corinthe ; mais aucune
acropole ne prit jamais piédestal plus
élevé, car la montagne dresse sa cime à
près de six cents mètres au-dessus du golfe.
Celait là une formidable citadelle ; depuis les
Pélages jusqu'aux Turcs, tous les peuples, tous les
conquérants s'empressèrent à s'y
retrancher.
L'Acro-Corinthe ceint encore des murailles
crénelées qui montent, descendent, remontent,
obéissant à toutes les sinuosités du
rocher ; chaque siècle, chaque invasion victorieuse
est venue y apporter sa pierre. On reconnaît, aux
premières assises, quelques blocs cyclopéens,
puis des blocs plus petits, moins anciens et d'un appareil
plus régulier ; les Grecs et les Romains ont dû
les porter là. Le moyen âge, à son tour,
a exhaussé les murailles et les a flanquées de
tours d'une maçonnerie grossière. On voit les
trous bouchés, les brèches fermées
à la hâte, et peut-être entre deux
assauts, car ces remparts racontent eux-mêmes leur
histoire et chaque pierre dit son passé.
Les portes sont d'apparence toute féodale ; leurs
battants vermoulus sortent à demi des gonds. Plusieurs
enceintes s'échelonnent, toutes désertes,
toutes abandonnées. Les campanules suspendent aux
créneaux leurs bouquets bleus, les fougères
s'échappent des meurtrières, curieuses,
dirait-on, de voir le jour, et les chardons géants,
réunis en phalange, tout hérissés
d'épines, escaladent les décombres. Maisons,
palais, tombeaux, sanctuaires païens, églises
chétiennes, mosquées musulmanes mêlent
leurs ruines, et toutes ces grandeurs tour à tour
déchues, tous ces vainqueurs tour à tour
vaincus, toutes ces gloires tour à tour abolies
semblent se réconcilier dans une commune
dévastation.
Ici traîne un canon rouillé, là
jaillissent quelques fûts de marbre, plus loin de noirs
soupiraux révèlent des citernes souterraines.
Les koubas turques croulent et leurs petites coupoles sont
percées de trous comme un ballon qui crève. Les
murailles grimpent sur les murailles, les ruines
ensevelissent les ruines, l'herbe ronge les pierres, parfois
quelque serpent s'enfuit, agitant les euphorbes ou les
asphodèles roses, et le vent, que rien n'arrête,
jette à cette solitude désolée de longs
gémissements.
L'Acro-Corinthe a deux cimes d'inégale hauteur ;
j'entreprends de me hisser jusqu'à la plus
élevée. De là les yeux embrassent de
toutes parts un horizon immense. D'un côté,
c'est l'isthme, pont gigantesque qui réunit le
Péloponèse à l'Attique ; à
l'orient, à l'occident, la mer le presse et l'enserre.
A nos pieds, auprès des ruines de son dernier temple,
la vieille Corinthe agonise. La nouvelle Corinthe est un peu
plus loin ; elle aligne des rues symétriques, mais les
maisons qui les bordent sont déjà croulantes.
Cependant quelques petites voiles blanches s'avancent vers le
port. Le golfe s'allonge, protégé contre les
vents du nord par un rempart de montagnes ; c'est là
que don Juan d'Autriche coula la flotte turque. Vers le nord
apparaît la baie d'Eleusis, et Salamine y
découpe ses côtes capricieuses.
Près de là sont l'Hymette et le
Pentélique qui ont porté les temples
d'Athènes dans leurs flancs. Egine occupe les limites
extrêmes de l'horizon. Au sud se trouve un vallon
verdoyant où sommeille Cléones ; puis
d'énormes montagnes, aux flancs sombres, aux cimes
rayonnantes, limitent la terre du
Péloponèse.
Laissant derrière nous l'Acro-Corinthe, nous prenons
la direction de Cléones. Le sentier caillouteux que
nous suivons, a longtemps été redouté
des voyageurs. C'est ici que Sinis dévalisait et
martyrisait, avec une atroce cruauté, les malheureux
capturés par lui. Il les attachait, nous dit-on,
à des pins que ployaient ses mains puissantes, puis
les pins, brusquement abandonnés à
eux-mêmes, se redressaient, et les membres
déchirés, mis en lambeaux, allaient se balancer
à leurs branches.
Thésée, le grand redresseur de torts de la
Grèce légendaire, triompha de Sinis et lui fit
subir le supplice qu'il avait inventé. Sinis toutefois
eut une longue postérité ; naguère
encore le brigandage hantait ces parages. Mon guide me fait
remarquer de petits tas de pierres élevés de
loin en loin ; ce sont des signes de convention, une sorte de
langage mystérieux qui permettait aux brigands de
connaître quelque cachette, de transmettre quelques
mots d'ordre, de préciser le lieu de quelque
rendez-vous ; le petit Poucet agissait ainsi pour être
bien sûr de retrouver son chemin. Mais, le dernier
brigand a disparu. Il est encore des pins qui se cramponnent
aux pentes arides, il n'est plus de Sinis qui menace de nous
y accrocher. Le gendarme grec, comme son aïeul,
l'héroïque Thésée, fait maintenant
bonne garde.
Nous cheminons pendant plusieurs heures dans un pays
montueux. Enfin nous atteignons Cléones, site presque
désert qui garde encore quelques blocs de ses murs
cyclopéens. Une pauvre masure s'adosse au tronc d'un
vieux saule ; on m'y accueille sans peine, et l'on m'adjuge
la plus belle chambre: c'est un grenier poudreux, sombre ; la
lumière n'y pénètre que par les
brèches de la toiture. La nuit vient. Je dîne au
pied d'un saule pleureur, rêvant de tant de ruines
saluées, de tant de souvenirs évoqués
entre l'aurore et le crépuscule du même
jour.
Nous repartons dès l'aube. Nous voici chevauchant
gaiement entre une double haie d'amandiers sauvages ; un
petit ruisseau nous accompagne et, gazouillant dans les
herbes, semble nous souhaiter bon voyage.
Mais bientôt nous sortons du vallon de Cléones,
une pénible escalade commence. Le roc apparaît,
presque toujours nu ou seulement moucheté
d'arbrisseaux épineux. Quelques entailles assez
régulières, quelques blocs abandonnés
marquent l'emplacement d'anciennes carrières ; c'est
de là sans doute que sortirent les monuments de
Némée. Nous atteignons une crête
dévastée, aride et de là, changeant de
versant, nous découvrons Némée et son
vallon. La descente est plus rapide que la
montée.
Nous passons devant la fontaine Adrastée que Pausanias
mentionne ; puis une dépression du sol
allongée, régulière, donne vaguement
l'idée d'un stade. Près de là un antre
est creusé dans le rocher : l'antiquité voulait
y reconnaître le repaire du lion dont Hercule triompha.
Enfin le temple trône au centre du vallon, et les
montagnes énormes se groupent tout alentour.
Tout à coup une meute de chiens furieux nous assaille
: ce sont de véritable bêtes fauves, et leurs
maîtres, les bergers du pays, ne s'empressent jamais de
les calmer ; je suis chassé à courre comme un
cerf.
Mon pauvre cheval, épouvanté, étourdi
des aboiements, prend le galop, peut-être pour la
première fois de sa vie. Cette terrible
chevauchée me conduit bientôt jusqu'aux ruines ;
là, les pierres ne manquent pas, munitions
précieuses, et nos ennemis, devinant sans doute mon
intention de les lapider, précipitent aussitôt
leur retraite.
Au second siècle de notre ère, le temple de
Némée était déjà
abandonné. Pausanias nous dit en effet : «On
trouve un temple de Jupiter Néméen qui
mérite d'être vu bien qu'il n'ait plus de toit
et qu'il n'y reste aucune statue». Depuis Pausanias
l'oeuvre de destruction ne s'est pas arrêtée. Le
temple toutefois ne semble pas avoir subi la lente injure des
siècles, et l'on dirait qu'il a été
jeté à terre tout d'un coup. Les colonnes ont
été renversées avec une sorte de
symétrie : leurs tambours s'alignent dans l'herbe,
inclinés les uns sur les autres sans désordre
et le chapiteau les termine. Il semble qu'on ait là
les pions d'un jeu de dames qu'un géant,
mécontent d'une défaite, aurait
bousculés d'un revers de main.
Pas un bloc ne s'est brisé. Les donjons
féodaux, s'émiettent en s'écroulant ; le
temple grec se divise, se démonte, il ne fait ni
décombres, ni poussière. Une main patiente
pourrait le relever, et sans grande difficulté ; il
suffirait de recueillir une à une les pierres. Chaque
bloc suppose le bloc suivant, et l'unité parfaite du
corps se révèle en ses membres
épars.
Trois colonnes seulement sont restées debout. Deux
appartenaient au pronaos ; la troisième, de
proportions un peu plus fortes, haute de plus de dix
mètres, se dressait à l'extérieur ; son
chapiteau est ébréché. On peut suivre
sans trop de peine le périmètre de la
cella ; quelques blocs en indiquent l'enceinte et le
sol garde quelques-unes des dalles qui le recouvraient.
Le temple était d'ordre dorique, assez vaste, sans
être immense. Les fûts s'allongent à peu
près dans les mêmes proportions qu'au temple de
Sunium ; les tailloirs des chapiteaux n'accusent qu'une
faible saillie ; enfin une certaine grâce
tempère la majesté un peu sévère
des lignes. Aussi les archéologues assignent-ils au
temple de Némée une date postérieure
à celle du Parthénon. Il aurait
été construit dans les dernières
années du quatrième siècle avant
l'ère vulgaire.
Tout est de pierre ; on rencontre rarement des monuments
grecs en marbre, en dehors d'Athènes et de ses
environs immédiats. Il était
réservé aux Romains, grands constructeurs de
voies, de mettre à contribution toutes les
carrières du monde soumis par eux, et de promener de
l'Afrique à la Gaule, de l'Asie à l'Espagne,
les marbres, les granits, les porphyres les plus
précieux. Les Grecs étaient plus
empressés à construire des temples qu'à
percer des routes, aussi est-on sûr, et cela se
vérifie en Grèce comme en Sicile, de trouver
à peu de distance des cités, les
carrières qui en ont fourni les
matériaux.
Du vallon de Némée nous nous élevons sur
une pente rapide, chevauchant à la recherche de Hagios
Georgios.
Hagios Georgios est un village de quelque importance ; il
succède à la ville de Phliunte et fut sans
doute construit de ses ruines. C'est au village moderne que
nous passerons la nuit ; mais respectueux des gloires
séculaires, nous faisons avant tout visite à
l'antique cité. Les restes, à peine
reconnaissables, sont presque partout rasés au niveau
du sol. L'acropole renfermait, nous dit-on, un temple de
Junon et un temple de sa fille Hébé, leurs
colonnades blanches s'encadraient aux colonnades noires des
cyprès, mais cyprès et colonnes ont disparu
sans laisser de traces. Au sud de Phliunte coule un petit
ruisseau qui va rejoindre l'Anopus. Nous sommes peu
éloignés de l'Omphalus, point que les anciens
considéraient comme le centre exact du
Péloponèse, et en pleine Arcadie, la terre
classique des bergers. Et in Arcadia ego.
Les bergers n'ont pas déserté ; nous en voyons
quelques-uns de noble et élégante tournure ;
ils se tiennent debout, au faite des rochers comme des
héros de marbre au front d'un temple.
Leur fustanelle qui fut blanche, se balance autour des reins
à chaque mouvement ; les jambes sont serrées
dans une sorte de maillot qui dessine leurs maigreurs
vigoureuses et fines ; les pieds chaussent des souliers qui
se relèvent vers l'extrétrémité
et sont ornés d'une houpette. La taille est mince, et
bien des femmes en envieraient la grâce svelte et la
souplesse exquise. La ceinture faite de cuir, est
disposée pour recevoir yatacans et poignards, sabres
et pistolets, tout ce bagage menaçant dont les hommes
de l'Orient se plaisent à s'embarrasser. La
Grèce, à l'exemple des grandes nations
européennes, proscrit les armes apparentes. La mise en
scène y perd de son originalité pittoresque si
la sécurité publique y gagne : telle querelle
qui aurait fini dans le sang, se dénoue par quelques
coups de poing.
Le torse revêt une petite veste aux manches pendantes ;
enfin une calotte décolorée complète le
costume. Les traits sont fortement accentués, et les
moustaches, que seules le rasoir épargne,
prêtent à la physionomie quelque chose de
martial et d'un peu rude.
Les rois qu'a chantés Homère, devaient
ressembler fort à ces bergers et comme eux sans doute
ils allaient, sur la montagne, faire pâturer leurs
troupeaux. Le premier sceptre fut une houlette.
Mon guide est pris du caprice de boire du lait, il interpelle
un berger. Le berger nous entend ; il descend, majestueux et
calme, son bâton posé sur la nuque et ses mains
brunes encadrant son visage. Il vient à nous. Il a du
lait, nous dit-il et ne refuse pas de nous en céder,
mais ce lait ce sont les chèvres qui le portent, et il
n'a pas de vase pour les traire ; qu'à cela ne tienne
! mon guide ne s'embarrasse pas pour si peu. Une
chèvre est saisie, en dépit de ses vaines
protestations, on la maîtrise, le buveur s'étend
sur le dos, saisit les mamelles comme ferait un chevreau.
L'homme et la bête sont bizarrement entrelacés.
Quel groupe ! parodie grotesque de la légende
païenne qui nous dit la chèvre Amalthée
allaitant le jeune Jupiter ; si j'avais des cymbales, je
m'improviserais corybante. La pauvre bête regarde de
côté à la dérobée son
formidable nourisson, elle a des airs de stupéfaction
et d'épouvante. Aussi, à peine
délivrée, quelle fuite ! quelle course folle et
qui ne cesse qu'à la crête des rochers les plus
abrupts !
En face de Hagios Georgios, le mont Polyphengos porte
quelques restes antiques. Vers le nord-ouest, plus
élevé, plus majestueux, le mont Courias se
déploie, il distille de ses flancs les sources qui
forment l'Asopus.
Le lendemain matin, en moins de deux heures, de Hagios
Georgios, nous gagnons Stymphale que les flèches
d'Hercule délivrèrent de ses oiseaux
redoutés. Il y avait là une ville ruinée
dès le temps de Pausanias et qui marque vaguement son
enceinte par quelques vestiges de fortifications ; il y avait
aussi un lac plus fameux et qui croupit encore, au milieu
d'une plaine aride. C'est une sorte de marais que les pluies
de l'hiver remplissent, que dessèchent presque
complètement les chaleurs de l'été ; il
va se déverser dans un kalavothron, gouffre
où les eaux bouillonnantes se précipitent avec
fracas. La terre les engloutit, comme si elle voulait en
grossir, au fond des Enfers, le Styx et
l'Achéron.
Nous passons au-dessus de ce katavothron, et bientôt
nous traversons un petit ruisseau que l'on appelle
pompeusement la rivière de Lafra. Puis nous nous
engageons sur les pentes de Gérantion ; une vue
magnifique nous attend à son sommet. De là on
découvre les villages de Masa, de Mesano, et Phonia
avec son lac bleu enchâssé dans la
verdure.
La journée a été fatigante, aussi je ne
tarde pas à me retirer dans la chambre que
l'hospitalité obligeante d'un habitant de Phonia a
mise à ma disposition.
Mais Phonia n'a rien qui puisse retenir quiconque est avant
tout curieux de vieilles pierres et de vieux souvenirs ; le
lendemain, dès l'aurore, nous chevauchons dans la
direction de Clitor. Il nous faudra plus de six heures de
marche avant d'y atteindre.
Nous longeons quelque temps le lac de Phonia. Un pic jaillit
bientôt sur la droite, tout hérissé de
pins. Le sol garde quelques vestiges mal effacés de
constructions antiques. Un mur paraît avoir autrefois
intercepté le passage entre le lac et les montagnes
qui l'encadrent à l'occident ; sans doute les
habitants de Phonia craignaient les visites
intéressées de quelques turbulents
voisins.
Les eaux du lac de Phonia, comme celles du petit lac de
Stymphale, se perdent dans un de ces gouffres que les Grecs
appellent Katavothron ; puis elles cheminent souterrainement
et vont reparaître beaucoup plus loin au village de
Lycomia, de là enfin elles descendent au Ladon.
Le lac disparaît. Nous nous hissons péniblement
dans un sentier que les chèvres semblent avoir
tracé pour leur usage exclusif. Le col que nous
traversons incline au nord vers Kalavrita ; mais nous suivons
la direction du sud. Le Ladon prend ici sa source, le Ladon
est un affluent de l'Alphée, l'Alphée traverse
Olympie, cette eau que nous voyons sourdre dans les rochers
va où nous allons nous-mêmes.
La vallée de l'Arvanius apparaît souriante ;
quelques moulins y caquettent, faisant barbotter dans l'eau
leurs roues ruisselantes. Nous sommes sur le chemin de
quelque cité antique, car une voie marque vaguement
son tracé. Elle gagnait Clitor, et si la
légende ne ment pas, cette voie serait la
première où les roues d'un char auraient
creusé leurs ornières, car les chars furent,
dit-on, inventés à Clitor. Le site de Clitor
est désert ; ses temples n'ont laissé que
quelques tambours ombragés d'un chêne
centenaire, ses remparts que des blocs dispersés, des
assises incomplètes et le cercle indécis de
quelques tours.
Nous allons coucher à Kalyvia de Mazi.
Le nom d'Erymanthe s'applique tout à la fois à
un groupe de montagnes et à une petite rivière
affluent de l'Alphée ; montagnes et rivière
sont peu éloignées. Nous sommes aux lieux
où Hercule accomplit l'un de ses douze travaux, et
c'est le troisième champ de victoire illustré
par lui que nous rencontrons ; nous suivons une à une
les étapes de sa gloire. A Némée il tua
un lion, à Stymphale il extermina des oiseaux
monstrueux, aux campagnes de l'Erymanthe, il étouffa
un sanglier qui saccageait toute la contrée. Que de
grands souvenirs en ce beau pays de Grèce ! Les
héros et les dieux y font partout cortège au
voyageur.
C'est aussi sur cette terre que nous foulons,
qu'Alcméon se retira, fuyant les Furies
acharnées à sa poursuite. Il avait tué
sa mère Eryphile et voulait expier son forfait par
d'austères pénitences. L'eau de l'Erymanthe ne
put suffire à purifier ses mains, et certes s'il
existe un fleuve qui puisse laver la souillure sanglante d'un
parricide, ce n'est assurément pas en Grèce.
Ici fleuves et ruisseaux coulent le plus souvent à
sec, et c'est merveille quand on se mouille un pied pour les
traverser.
Aux rives de l'Erymanthe, ainsi qu'aux rives des autres
rivières du Péloponèse, les roseaux se
pressent, dérobant aux yeux des profanes la honte des
Naïades et de leurs urnes taries. Parfois aussi les
lauriers-roses s'entrelacent aux roseaux, frémissant
comme si les baisers d'Apollon y cherchaient encore
Daphné disparue.
Tripotamo où l'Erymanthe reçoit le maigre
tribut de deux petits torrents ombragés de platanes,
possède un khan et quelques maisons ; c'est une
dépendance du village moderne de Mostivitza.
Près de là s'élevait Psophis, place
forte qui défendait le passage entre l'Arcadie et
l'Elide. Elle prend pour base un roc avancé qui domine
l'Erymanthe et TArvanius. Il était une double enceinte
qui a laissé des restes reconnaissables. Fiers de la
force de leur ville, et se croyant sans doute invincibles
dans ce nid de pierre, les habitants osèrent s'allier
aux Etoliens, aux Eléens et défier Philippe de
Macédoine. Mais Philippe était coutumier de
vaincre, et le premier assaut lui livra la place. Polybe nous
dit, du reste, qu'il usa avec modération des droits de
la victoire.
Psophis conserve encore quelques gradins d'un petit
théâtre et, sur la rive droite de l'Erymanthe,
les fondements d'un grand édifice. Les chênes,
au feuillage sombre, recouvrent les montagnes
environnantes.
De Psophis à Olympie nous ne cessons de descendre. Ce
sont d'abord des bois où les chênes
cèdent bientôt la place aux pins, puis le sol
s'abaissant, quelques oliviers apparaissent, puis quelques
champs de maïs. On traverse le petit village de Lala, le
dernier centre habité que l'on rencontre avant de
gagner Olympie.
 |
Olympie
Olympie était moins une ville qu'un lieu sanctifié par les traditions légendaires et le culte des dieux. Tout y était prodige, la nature elle-même avait, en toutes choses, de mystérieuses origines. Jupiter, disait-on, avait combattu là contre un certain Cronus qui lui disputait l'empire du monde, et c'était en commémoration de cette victoire de son père qu'Hercule avait institué des jeux solennels. Plus tard, Jupiter lui-même confirma la consécration de cette terre et frappant. le sol de la foudre, il y fit brèche. Parfois de cet antre béant, s'échappait une voix qui chantait des oracles redoutés.
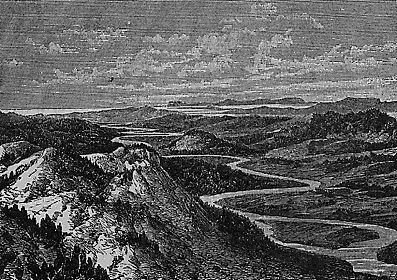 |
Vallée de l'Alphée
L'Alphée, qui traverse la plaine
d'Olympie, avait été primitivement,
prétendait-on, un hardi chasseur. Epris follement de
la nymphe Aréthuse, il l'avait poursuivie de campagne
en campagne ; mais celle-ci, toujours rebelle, toujours
fuyant, avait traversé la mer et abordé aux
rivages de Sicile. Là une divinité protectrice
l'avait transformée en fontaine. L'îlot
d'Ortygie, qui porte un des quartiers de Syracuse, montre
encore cette eau pure et douce qui naît à
quelques pas de la mer. Alors Alphée, lui aussi,
sollicita sa métamorphose ; devenu fleuve, il
n'abdiqua pas son amour. Toujours à la recherche de
l'ingrate, il entra à son tour dans la mer, puis, par
une voie mystérieuse, il gagna la Sicile, et
Aréthuse, enfin touchée, consentit à
mêler ses ondes aux ondes de celui qui l'avait tant
aimée.
Historiquement, les jeux Olympiques furent établis, ou
du moins rétablis, en 884 par Iphitus, roi d'Elide,
sur les conseils de Lycurgue. On les célébrait
tous les quatre ans, à la pleine lune du solstice
d'été. Ils duraient cinq jours et chaque jour
était réservé à un exercice
spécial : le saut, la lutte, la course à pied
et en char, le jet du disque, le jet du javelot donnaient
tour à tour aux jouteurs l'occasion de déployer
leur habileté et leur vaillance.
 |
Génies des jeux d'athlètes
On organisa aussi, un peu plus tard, des jeux en l'honneur de Junon, soeur et femme de Jupiter. Seules les jeunes filles y prenaient part. Elles descendaient dans l'arène et couraient sommairement vêtues, des voiles trop lourds auraient gêné la légèreté de ces nouvelles Atalantes ; galant spectacle et qui devait agréablement reposer les yeux fatigués des athlètes, des boxeurs, des assommeurs et de leurs bousculades héroïques.
 | Le vainqueur recevait une
couronne d'olivier sauvage ; on dressait une statue en son
honneur. Si le même homme avait triomphé trois
jours de suite, c'est-à-dire dans trois exercices
différents, on avait soin que cette statue fût
parfaitement ressemblante et pût fidèlement
transmettre à la postérité les traits du
héros. |
Le fameux Milon de Crotone tour à tour renversa,
dépassa, assomma tous ses rivaux ; puis pour mettre le
comble à sa gloire, il chargea lui-même sur son
épaule sa statue faite d'airain et seul la porta
jusqu'au piédestal.
Ces statues étaient souvent l'oeuvre des sculpteurs
les plus illustres. Lysippe avait fait celle d'un certain
Polydamas de Scolusse, l'homme le plus grand et le plus fort
de son temps. On racontait de lui des exploits qui semblent
fabuleux. Il avait étouffé un lion dans ses
bras.
Un taureau furieux mettant tout un troupeau en émoi,
Polydamas l'avait saisi par une patte, arrêté
tout net, et la bête n'avait réussi à se
dégager qu'en laissant son sabot dans la main de son
terrible dompteur.
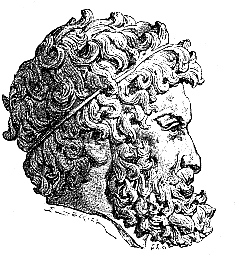 |
Etre beau,
être fort, être grand, cela suffisait aux Grecs
pour que l'on fut digne de l'immortalité.
Les jeux Olympiques restèrent en honneur tant qu'il
fut un Olympe et des dieux ; on les célébrait
encore au troisième siècle de notre
ère.
C'est au milieu de cette solennité toute païenne
que le philosophe Lucien vit, aux dernières
années du second siècle,
Pérégrinus se brûler vif dans un
bûcher que lui-même avait fait élever. Ce
Pérégrinus, dit aussi Protée,
chrétien peut-être, du moins initié
quelque temps aux idées chrétiennes, dans tous
les cas fou d'orgueil, avait pompeusement annoncé
qu'il donnerait par son supplice volontaire un
témoignage du mépris que mérite la
mort.
«Dès que la lune est levée, dit Lucien,
car il fallait bien qu'elle fût aussi témoin de
ce bel exploit, Protée s'avance dans son costume
ordinaire, entouré des sommités de la secte
cynique, notamment l'illustre citoyen de Patras, qui marche,
un flambeau à la main, et remplit à merveille
le second rôle de la pièce. Protée aussi
portait un flambeau. Arrivés au bûcher, chacun y
met le feu de son côté, et il
s'élève aussitôt une grande flamme,
produite par les torches et le bois sec. Ici, mon cher, fais
bien attention. Protée dépose sa besace, met
bas sa massue d'Hercule, se dépouille de son manteau,
et paraît avec une chemise horriblement sale. Il
demande de l'encens pour le jeter dans le feu : on lui en
donne, il le jette et dit, en se tournant vers le midi, car
le midi joue aussi un rôle dans cette tragédie :
«Mânes de ma mère et de mon père,
recevez-moi avec bonté !» Après quoi, il
s'élance dans le brasier et disparaît
enveloppé par une grande flamme qui
s'élève...» Voilà certes un
spectacle qui fut nouveau pour Olympie.
Les jeux Olympiques imposaient à tout le monde Grec
une trêve sacrée. Nulle scène de discorde
et de haine ne devait profaner ces grandes solennités
nationales. Il y avait donc, dans cette institution, une
pensée haute et noblement humaine. Ce n'était
pas seulement le triomphe des corps jeunes, souples,
vigoureux, puissants ; c'était encore, au moins pour
quelques jours, la paix des esprits et comme le saint
apprentissage de la fraternité. L'ennemi que l'on
combattait la veille, furieusement, follement, il fallait le
voir, l'entendre, le connaître, il fallait
peut-être applaudir à la victoire de quelqu'un
de ses enfants, car l'impartialité la plus
austère inspirait les jugements rendus, et l'injustice
était impossible en face de la Grèce
entière. Les juges ne faisaient le plus souvent que
formuler un arrêt que la foule avait
prononcé.
L'homme mis en face de l'homme dans un duel loyal, oblige de
se respecter lui-même dans son rival ! Quelle heureuse
leçon ! mais peu féconde par malheur. La
Grèce en avait pu concevoir la pensée, mais
elle ne devait pas en tirer grand profit ; en même
temps que les jouteurs reprenaient leurs vêtements, les
peuples reprenaient leurs passions égoïstes et
leurs haines insensées.
Quel spectacle devait présenter Olympie aux jours de
ces belles fêtes ! La Grèce tout entière
était là, et le spirituel Athénien, et
le rude Spartiate, et le lourd Béotien et le
Crétois subtil, et ceux de Messène, et ceux de
Delphes, et ceux de Thèbes, et ceux d'Epidaure, et
ceux qui venaient des îles, et les colons qui se
souvenaient en Asie, en Gaule, en Sicile, que leurs
ancêtres étaient nés sur cette terre de
l'Hellade si fertile en fils glorieux. C'était une
réunion de famille ; le passé, vivant encore
dans le bronze des statues, dans le marbre des frontons, y
souhaitait au présent la bienvenue.
Alors Olympie regorgeait d'une foule immense. En tout autre
temps, on aurait aisément dénombré les
habitants. Quelques prêtres, quelques gardiens des
temples composaient la population, et l'on trouvait beaucoup
plus de monuments que de maisons. Les dieux et les
héros étaient là chez eux, les hommes ne
faisaient que passer comme des hôtes d'un jour.
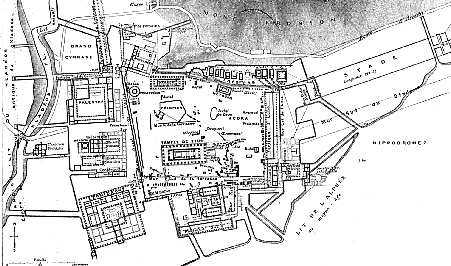 |
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Les principaux édifices sacrés
d'Olympie se groupaient dans un bois dit Altis qu'une
enceinte entourait. On comptait quatre portes ; la
première était réservée au
passage des cortèges pompeux, la seconde conduisait
à l'hippodrome, la troisième faisait face au
gymnase, la quatrième regardait le stade. Une
cinquième porte, beaucoup plus petite, servait
seulement aux prêtres et aux hommes de leur
suite.
On trouvait dans l'Altis un temple de Junon, l'édifice
le plus ancien d'Olympie. Il conservait une colonne faite de
bois de chêne. C'est là que l'on gardait
précieusement le coffre où la boiteuse Labda
cacha son fils Cypsélus pour le soustraire aux
assassins ; ce coffre était orné de bas-reliefs
en ivoire dont Pausanias nous fait une interminable
description.
Puis venait le Metroum, grand temple dorique,
élevé à la mère des dieux. Les
empereurs Romains y trônaient en compagnie des
immortels, Trajan avec Mars, Hadrien avec Mercure. Les
Césars s'égalaient aux dieux, mais le jour
était proche où Césars et dieux allaient
disparaître dans une commune ruine. Philippe de
Macédoine avait élevé près de
là, en commémoration de la bataille de
Chéronée, un monument circulaire
surmonté d'un dôme, entouré de colonnes.
Trois statues d'or et d'ivoire s'y dressaient, reproduisant
les traits du roi et de deux princes de sa famille.
On voyait encore les statues d'Antigone, de Séleucus,
d'Alexandre, de Ptolémée fils de Lagus. Roi ou
général heureux, conquérant ou simple
athlète, quiconque avait mérité la
gloire de quelque triomphe, quiconque portait un
diadème d'or ou d'olivier revivait à Olympie ;
les dieux s'y composaient une cour de toutes les grandeurs de
la terre.
Un autel, consacré à Jupiter, s'élevait
à vingt-cinq pieds au-dessus du sol et
présentait cent vingt-cinq pieds de
circonférence. On trouvait un sanctuaire de Jupiter
Aponius (qui chasse les mouches). Voilà une
divinité dont la protection serait encore fort
désirable aux pays d'Orient. Pourquoi avoir
déserté son culte ?
Un autel, quelle heureuse tolérance ! était
réservé aux dieux inconnus, et le dévot
pouvait y invoquer telle puissance surhumaine qu'il
préférait. On conservait l'atelier de Phidias,
et nul sanctuaire sans doute n'était plus
vénérable.
Une colonne de bois se dressait, religieusement
protégée, sous un toit que soutenaient quatre
colonnes, c'était, disait-on, la dernière
relique de la maison d'Onomaüs. Ainsi, au milieu de
toutes ces magnificences, on signalait à la
vénération du pèlerin deux pauvres
colonnes de bois. Aux âges héroïques, les
demeures des hommes, celles mêmes des dieux
étaient ainsi construites. Le premier temple fut une
grande cabane, les temples élevés par la suite
indiquent encore les dispositions essentielles de ce
modèle primitif, et les colonnes de marbre
elles-mêmes rappellent, par leurs cannelures, les
entailles que la hache laissait aux poteaux de bois.
Une curiosité d'un autre ordre, mais qui sans doute
amusait fort les touristes, était un écho qui
répétait, sous un portique, sept fois les sons,
de là son nom heptaphonon, sept voix.
Enfin apparaissait le temple de Jupiter qu'avait
élevé Libon. Il était de proportions
énormes : soixante-dix-huit pieds de haut,
quatre-vingt-quinze pieds de large, deux cent trente de long
; les colonnes mesuraient plus de deux mètres de
diamètre.
Ce temple avait reçu de chaque âge, de chaque
peuple quelques trésors nouveaux ; toute victoire y
laissait un trophée et les ennemis semblaient
s'associer pour le faire splendide entre tous. Sur la cime,
une Victoire ailée portait un bouclier d'or ; les
Lacédémoniens, vainqueurs des Athéniens
et des Argiens à Tanagre, l'avaient faite de la
dîme du butin. Vingt-et-un boucliers dorés
étaient des présents de Mummius. Ce Mummius qui
pilla Corinthe avait, s'il en faut croire Pline, une
rapacité désintéressée ; il
mourut pauvre et sans laisser de dot à sa fille. Les
généraux Romains ne devaient pas tarder
à perfectionner le système, et les Sylla, les
Pompée, les César ne pillaient pas qu'au profit
de la seule République.
Alcamènes d'Athènes avait sculpté le
fronton Ouest ; les Centaures y combattaient les Lapithes aux
noces sanglantes de Pirithoüs. Poeonios de Mendé
en Thrace avait sculpté le fronton Est ; on y voyait
le roi Oenomaos vaincu à la course en char et mourant
dans la carrière, tandis que triomphe son heureux
vainqueur Pélops, qui mérite ainsi la gloire de
gouverner le pays et de lui donner son nom. Poeonios avait
aussi modelé la gigantesque victoire de bronze qui
planait au faîte de son fronton.

Jupiter d'Olympie par Quatremère de Quincy (1814) |
Enfin la merveille de toutes ces merveilles
trônaient dans le temple ; Phidias avait dressé
là le colosse de Jupiter, et son génie
s'était surpassé lui-même en cette
création sublime.
Les Athéniens, fort renommés pour leur esprit,
ce qui ne les empêchait pas de commettre souvent de
grosses sottises, avaient intenté contre Phidias,
déjà âgé, une accusation de vol et
de sacrilège ! Le grand artiste avait
été contraint de quitter cette Athènes
tant embellie par lui et si follement ingrate. Il se retira
en Elide. Les Eléens l'accueillirent avec empressement
et n'eurent garde de laisser inactif un ciseau qui donnait la
vie. Or et ivoire furent prodigués au banni. Phidias,
reconnaissant, entreprit de faire un Jupiter plus admirable
encore que les Pallas par lui dressées à
l'acropole d'Athènes. Il représenta le dieu
assis sur un trône. Le torse était nu, fait
d'ivoire. Les anciens excellaient à travailler cette
matière ; ils savaient l'assouplir, la tailler, la
plier, la modeler, la souder de façon à
dissimuler les joints aux yeux les plus attentifs. Une
couronne d'olivier ceignait le front. Les jambes
étaient enveloppées dans des draperies d'or que
des fleurs émaillées constellaient. La main
gauche, majestueusement relevée, soutenait un sceptre
dont un aigle occupait la cime. La main droite
abaissée portait une Victoire ailée. Nul
accessoire qui ne fût animé de figurines, de
ciselures. La hampe du sceptre rayonnait de l'éclat
des pierres précieuses. Au sommet des montants du
trône, les Heures, les Grâces rythmaient leurs
rondes harmonieuses ; sur les traverses, Hercule combattait
les Amazones, Apollon et Diane perçaient de leurs
flèches les enfants de Niobé ; aux bras, des
sphinx emportaient de jeunes Thébains.
Le tabouret où s'appuyaient les pieds du dieu montrait
des lions accroupis. Sur le socle, Neptune et Amphitrite
promenaient leur cortège de nymphes et de triions,
tandis que Phoebé s'élançait dans
l'espace. Et toutes ces fables aimables, toutes ces
légendes païennes, cet Olympe en miniature,
semblait anéanti dans la gloire du dieu suprême
; il les écrasait de sa masse formidable et son front
calme planait sur toutes ces chétives
immortalités.
Lorsque Phidias eût terminé sa tâche, il
regarda en face le dieu fait par lui, et certes son
génie avait droit à cette audace, puis il dit :
«Jupiter, es-tu content ?» La foudre
éclata aussitôt et, tombant au pied du colosse,
fendit le marbre du sol. Jupiter avait répondu.
Quelques années plus tard, Antiochus fit
présent d'un rideau de laine enrichi de broderies ; on
le disposa de manière à former
encadrement.
Les anciens qui n'avaient pas toujours l'amour de la
précision, varient dans les mesures qu'ils donnent du
Jupiter Olympien. Les uns veulent qu'il ait eu trente-six
coudées, les autres soixante pieds. Strabon nous dit
que s'il s'était dressé debout, il aurait
enfoncé de la tête le plafond de son
temple.
Cléopâtre avait offert aux Eléens une
somme énorme de leur Jupiter, mais vainement ;
Caligula prétendit se l'approprier sans autre droit
que son caprice. Il méditait de le faire placer au
Palatin, de le décapiter et de lui faire l'honneur de
substituer à la tête qu'avait modelée
Phidias, sa propre tête impériale.
Déjà les pillards officiels avaient
abordé aux côtes d'Elide, on disposait tout pour
conduire au maître de Rome le maître de l'Olympe
; mais tout à coup le tonnerre gronda et le vaisseau
de César fut mis en pièces par la foudre.
Libanius affirme qu'au temps de l'empereur Julien, le Jupiter
était encore assis dans son temple. Il y resta plus de
six siècles. Enfin Théodose le fit enlever et
transporter à Constantinople. Alors le christianisme
triomphait de toutes parts ; il n'était plus de
Jupiter pour défendre son image. Ce dieu de Phidias
qu'on avait adoré si longtemps ne devait pas survivre
beaucoup à la honte de son exil, il périt dans
un incendie et avec lui le palais impérial qu'il
devait décorer.
De tant de monuments entassés, Olympie ne garde plus
rien qui soit reconnaissable. Quelques pans de murs de
briques, des poteries brisées, des fragments informes,
et c'est tout. L'Alphée parfois s'encaisse entre des
rochers bizarrement découpés. Il est
d'inextricables fouillis où les pins se mêlent
aux oliviers sauvages, ceux-là même
peut-être qui donnaient les couronnes qu'attendaient
les vainqueurs. Le petit ruisseau de Cladaos rejoint
l'Alphée ; quelques platanes le bordent.
Il y a près d'un demi-siècle, une
expédition scientifique Française venait
à Olympie ; elle put reconnaître l'emplacement
du temple et recueillir, dans les fouilles, quelques
débris de sculpture aujourd'hui déposés
au Louvre.
Deux métopes de marbre représentent deux
épisodes des travaux d'Hercule. Dans l'une, la nymphe
protectrice du dieu, est assise sur un rocher : sa main
droite levée a dû tenir un rameau gage de
victoire ; Hercule (on n'a trouvé de cette figure que
des restes affreusement morcelés) lui
présentait, suppose-t-on, les oiseaux de
Stymphale.
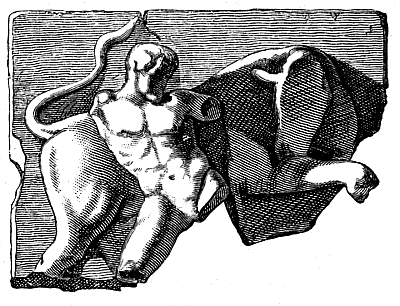 |
Hercule et le taureau, métope du temple de Jupiter à Olympie
La seconde
métope montre Hercule assommant un taureau. Il y a
encore un torse incliné dans un mouvement hardi et
sillonné de muscles puissants ; un ciseau fier et
vigoureux a modelé ce marbre.
Depuis plus de deux ans, une expédition allemande a
repris méthodiquement et avec l'appui de subsides
considérables, les travaux rapides et un peu sommaires
de l'expédition française. MM. Curtius,
Hirschfeld, Botticher et en dernier lieu le docteur Georges
Treu se sont succédés dans la direction des
fouilles. On se propose en effet l'entreprise immense
d'étudier, dans toute son étendue, le site
illustre d'Olympie, et les recherches sont laborieuses,
malaisées, l'Alphée, par ses
débordements fréquents et les alluvions
déposées, ayant bouleversé, et, sur
quelques points, beaucoup exhaussé le sol
primitif.
Déjà cependant sont dégagés
presque complètement les restes du temple ; puis dans
toutes les directions on a poussé au delà, et
c'est encore le temple qu'on s'efforçait de retrouver.
Sa destruction première paraît avoir
été en effet, comme celle de tant d'autres
monuments de la Grèce, l'oeuvre d'un tremblement de
terre, et les blocs, surtout ceux qui composaient les parties
supérieures du temple, ont été
projetés au loin. C'est ainsi qu'ont été
découvertes, à une assez grande distance en
avant des ruines, les figures des frontons.
Le fronton Est, le premier dont les débris aient
reparu, oeuvre, avons-nous dit, de Poeonios de Mendé,
représentait les apprêts de la lutte entre
Pélops et le roi Oenomaos. Celui-ci, selon la
légende que la sculpture traduisait, avait appris
d'Apollon qu'il mourrait le jour même du mariage de sa
fille. Aussi l'avait-il condamnée au célibat.
Un prétendant se présentait-il, Oenomaos le
défiait à la course des chars ; on partait de
l'autel de Jupiter et l'autel de Neptune, à Corinthe
était le but proposé. Et toujours, dans cette
longue carrière, le roi atteignait et perçait
de sa lance le malheureux qui n'avait pas craint de briguer
le dangereux honneur d'être son gendre. Pélops
cependant, après tant d'autres accepta la lutte : mais
il s'était assuré la complicité de
Myrtilas cocher d'Oenomaos, et celui-ci fut enfin vaincu. Il
se tua de désespoir, disent les uns ; selon d'autres,
le traître Myrtilas avait remplacé la cheville
de bronze qui fixait les roues du char de son maître
par une cheville de bois et le bois se brisant bientôt,
Oenomaos fut précipité à terre et mis en
pièces.
Des treize figures qui décoraient le fronton, les
fragments de sept ont été retrouvés.
Deux figures de fleuve terminaient à droite comme
à gauche la vaste composition sculpturale de Poeonios.
On les possède maintenant, mutilées mais
cependant reconnaissables. Celle qui personnifie
l'Alphée repose nonchalamment étendue,
l'attitude est calme, molle, les jambes s'allongent immobiles
; et les muscles du torse que nul mouvement ne met en jeu, ne
s'accusent qu'en saillies légères et
gracieusement adoucies. Tout autre est la figure du
Cladéos. En représentant l'Alphée, le
sculpteur semble avoir eu la pensée de nous montrer
une rivière tranquille, lente, aux ondes paresseuses
et caressantes ; il veut au contraire que dans le
Cladéos nous devinions un torrent impétueux et
fier. Celui-ci en effet, couché sur le
côté droit, se soulève et brusquement se
retourne ; les muscles sont en action, accentuant leurs
mobiles saillies, la charpente osseuse elle-même
s'accuse et l'on voit les sillons des côtes, le creux
des clavicules.
On veut reconnaître, non sans quelque vraisemblance,
dans un jeune homme accroupi, l'un des serviteurs de
Pélops. La jambe droite est repliée sous lui,
la jambe gauche se dresse courbée et le genou en avant
; le poids du corps porte en grande partie sur le bras droit,
et la main droite pose fortement contre le sol. L'autre main
cherche, aux environs du pied gauche, une sandale maintenant
disparue et qui peut-être fut de bronze, détail
familier, vulgaire dirait quiconque ne connaît pas les
libertés et les audaces qu'acceptait le génie
Grec. Un homme qui se déchausse ou se rechausse
placé au fronton d'un temple, c'est là ce qu'on
n'oserait plus ; et cet homme cependant est admirable de
noblesse, d'aisance héroïque et naïve en
même temps que de vérité.
Une quatrième figure a pu être le cocher de
Pélops. Il a un genou en terre, l'autre relevé.
Il est nu jusqu'à la ceinture. Les draperies qui vont
reposer sur l'épaule droite, sont traitées
sommairement, mais largement. Au reste, dans cette grande
page, les draperies sont rares et destinées seulement,
semble-t-il, à combler certains vides, à
équilibrer certaines lignes.
Un torse jeune très mâle, très fier a
peut-être appartenu à Pélops
lui-même. Dans un autre torse plus robuste, plus
âgé, on hésite s'il faut
reconnaître le corps du roi Oenomaos ou celui de
Jupiter qui présidait, comme on sait, à la
lutte des deux rivaux.
La dernière figure est celle d'un vieillard assis ;
jambes et cuisses sont affreusement mutilées, mais la
tête est intacte et très remarquable. Le haut du
crâne est chauve ; la nuque et les oreilles
disparaissent cependant couvertes de cheveux abondants. Une
ride profonde comme une balafre que l'âge aurait faite,
traverse le front ; l'oeil s'enfonce au creux de l'orbite,
les joues semblent un peu molles, alourdies ainsi qu'il
convient aux joues d'un vieillard ; le nez est droit et fort,
la bouche s'entrouve pour parler. Ce n'est pas là une
tête toute de convention, mais une tête
personnelle, vibrante et qu'une vie intense
éclaire.
Le fronton de l'Ouest qu'avait sculpté
Alcamènes d'Athènes, représentait le
combat des Centaures et des Lapithes aux noces de
Pirithoüs. Des fragments plus considérables
encore ont été découverts : onze
têtes, vingt-neuf grands fragments, et l'on a pu
reconstituer, au moins, en partie, dix-sept figures. Apollon,
bien que Pausanias l'oublie dans sa description, paraît
avoir occupé le centre du fronton et
présidé à l'héroïque
mêlée. On a retrouvé le torse et la
tête. Les cheveux, partagés en boucles
symétriques, portent la trace d'un diadème,
qui, sans doute fut de bronze ; la colère anime le
visage. La chlamyde se replie sur l'épaule gauche ; le
corps est jeune, svelte en même temps que fort. Sur le
dos on remarque des traces de scellement, et il en est ainsi
dans plusieurs autres statues ; on aurait craint de laisser
tous ces grands marbres peser de tout leur poids sur la seule
corniche du fronton.
En un groupe magnifique, un centaure, le visage
enflammé d'ivresse et de lubricité, saisit une
femme Lapithe. Il l'étreint, ses jambes de cheval
l'enserrent ; elle se défend cependant, elle a pris le
monstre par la barbe, elle tire furieuse et s'efforce
d'écarter loin d'elle cette bouche avide de
baisers.
Il faut citer encore deux mains unies, la poitrine d'un
Lapithe avec la partie supérieure de son épaule
gauche.
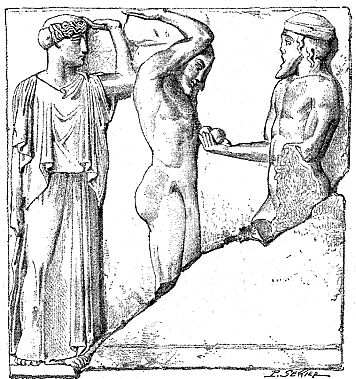 |
Hercule et Atlas, métope du Louvre
Puis nous signalerons une fort belle
métope, digne pendant de celles dont notre Louvre
garde les fragments. Elle faisait partie de la même
série et raconte elle aussi l'un des travaux
d'Hercule. Le dieu est debout, vu de profil, sur un coussin
que ses bras soutiennent, il porte le monde ; et d'une main
qui gracieusement se lève, une Atlandide l'aide en ce
rude labeur.
Cette figure, noble et grave, s'enveloppe de draperies
austères, symétriques et qui rappellent un peu,
mais avec plus d'élégance, celles des danseuses
de bronze qui menaient leur ronde solennelle au
théâtre d'Herculanum. Atlas enfin est debout
devant le dieu et lui présente les pommes promises
à sa valeur.
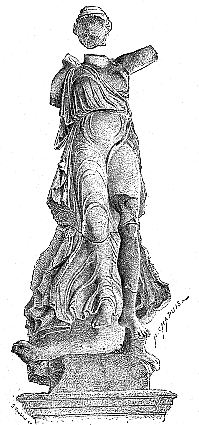 |
La Victoire de Paeonios
Nous savons
que les monuments votifs étaient très nombreux
à Olympie ; quelques-uns, en débris
reconnaissables, nous sont maintenant rendus. Au faîte
du fronton Est planait une victoire qu'avaient
consacrée les Messéniens vainqueurs dans
l'île de Sphactérie des troupes
Athéniennes ; Poeonios l'avait sculptée. Elle
reposait sur une base triangulaire. La victoire est sortie de
terre, et la base qui la portait, et l'inscription qui
immortalise le nom du maître. La déesse
s'envole, il n'est que son pied droit qui touche encore le
tronc d'un arbre et s'y appuie comme pour précipiter
un élan plus hardi. Les draperies flottent,
légères, harmonieuses et trahissent librement
les contours du jeune corps qu'elles recouvrent. Les seins
sont hauts et fermes, le ventre est un peu fort et c'est une
héroïque ardeur qui agite la vierge prête
à dévorer l'espace.
Ici encore, comme dans tous les marbres que nous livrent les
fouilles, le ciseau révèle des audaces qui ne
reculent devant aucune réalité, même un
peu vulgaire, pour accentuer plus fortement l'expression de
la vie. Quel art puissant et sûr de lui-même
s'affirme là ! Car il n'y a que les forts et les
grands qui savent, sans trahir le vrai, l'emporter comme en
une sublime apothéose et faire entrevoir, à
travers l'homme, la gloire d'un héros et le
rayonnement d'un dieu.
Ainsi qu'il élait aisé de le prévoir, la
pioche a ramené au jour beaucoup plus de marbres que
de bronzes. Le marbre est une pauvre proie pour les barbares
pillards, ils ne peuvent que le briser : les métaux au
contraire, le bronze même, aisément utilisables
pour les besoins les plus vulgaires, tentent toujours la
cupidité. Ainsi ont disparu ces statues de vainqueurs
que Pausanias porte au nombre de trois mille, ainsi ont
été partout enlevés les petits
détails de bronze, diadèmes, bandeaux,
sandales, sceptres que portaient souvent les figures de
marbre.
On possède cependant une tête d'homme en bronze,
avec une barbe courte mais épaisse et des cheveux aux
longues boucles.
Enfin on annonce la découverte du monument votif que
Philippe de Macédoine éleva en
commémoration de sa victoire de Chéronée
et des restes d'aqueduc avec des conduites semi-circulaires
en pierre de Porus. D'après la convention intervenue
entre le gouvernement grec et le gouvernement allemand, les
objets exhumés dans les fouilles d'Olympie restent la
propriété de la Grèce, mais l'Allemagne,
à qui seule incombent tous les frais, se
réserve le droit exlusif de les reproduire et de les
mouler durant quelques années.
Et pour compléter cette visite, vous pouvez voir sur la toile
- Une page de Wikipedia.
- Et surtout l'excellent dossier de Musagora