
Le ramassage des olives - Mosaïque romaine du IIe s. apr.JC - Musée national du Bardo, Tunis
(Elaia, elaion) - La plante que les Grecs appelaient elaia (attique, elaa) et les Romains olea est l'olivier cultivé (olea europaea de Linné) ; les anciens utilisaient son huile (elaion, oleum) pour les soins corporels, l'alimentation et l'éclairage.
Origine et expansion de l'olivier
L'olivier cultivé dérive de l'olivier sauvage ou stérile, dont les fruits, de très petite taille, donnent une huile amère et de peu d'usage. Les Grecs connaissaient diverses sortes d'oliviers stériles, agrielaia, kotinos, phulia ; les Romains les réunissaient toutes sous le nom général d'oleaster, qui a passé dans le vocabulaire botanique des modernes. Il n'est pas probable que l'olivier soit réellement indigène et spontané dans tous les pays de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique du Nord où il existe à l'état sauvage, ni même qu'il se rencontrait en chacun d'eux dès une haute antiquité ; les oiseaux, qui emportent au loin ses fruits, comme ceux de la vigne, ont dû contribuer à le propager ; d'autre part, l'olivier cultivé, abandonné à lui-même et privé de soins, redevient très vite sauvage. On doit noter cependant que des feuilles d'olivier ont été trouvées dans les gisements pliocènes de Mongardino, à 18 kilomètres de Bologne, et des noyaux d'olive dans les stations néolithiques d'El Garcel en Espagne.
Sur tout le pourtour de la Méditerranée l'olea europaea rencontre des conditions favorables et réussit à merveille. D'après Théophraste, l'olivier cultivé ne s'éloignerait jamais à plus de 300 stades des côtes ; en réalité, le voisinage des lacs, comme ceux de Garde et de Lugano, lui est aussi propice que la proximité même de la mer. Il faut chercher en Orient sa patrie d'origine. La plupart des botanistes croient qu'il provient, comme le figuier, du sud de l'Asie antérieure. Il n'a pas de nom en sanscrit. Les peuples de la Babylonie et de l'Assyrie, qui l'ignoraient, se servaient uniquement d'huile de sésame. En revanche, il était connu des peuples sémitiques, des Arméniens, des Egyptiens. Dans les livres de l'Ancien Testament l'olivier et l'huile d'olive sont très souvent mentionnés. La transformation de 1'oleaster par la culture parait être l'oeuvre des populations de la Syrie. L'olea europaea a pris naissance, très probablement, dans l'angle sud-est de la Méditerranée. Strabon signale d'importantes plantations d'oliviers dans le Pont, l'Arménie, la Mélitène, aux environs de Sinope, près de Phanaroéa ; dans le récit biblique du Déluge, la colombe de l'arche rapporte à Noé un rameau d'olivier cueilli sur le mont Ararat, montagne du pays des Alarodioi en Arménie. L'olivier aurait été importé de Syrie en Egypte, d'après G. Schweinfurth, sous la XIXe dynastie. Il est déjà représenté sur les monuments de la XVIIIe qui célèbrent les victoires des Pharaons. Hehn suppose à tort qu'il ne réussissait pas dans la vallée du Ni1. Des couronnes d'oliviers accompagnaient des momies du temps de la XXIIe à la XXVe dynastie. Si les Egyptiens employaient comme onguent et dans les lampes l'huile du ricin (sillikuprion) ou kiki, ils utilsaient aussi l'huile d'olive pour se parfumer, dans les sacrifices et comme aliment.
De très bonne heure l'olivier a passé d'Asie Mineure dans les îles de l'Archipel et jusqu'en Grèce. Parmi les monuments préhistoriques ou protohistoriques ramenés à la lumière par Fouqué à Santorin, on a reconnu les vestiges d'un pressoir à huile en pierre de lave. Schliemann et Tsountas ont recueilli des noyaux d'olive dans les ruines du palais de Tyrinthe, dans des maisons et des tombes de Mycènes. Sur les scènes qui décorent les gobelets d'or de Vafio et un fragment de vase d'argent découvert à Mycènes figurent des oliviers. Ces rencontres attestent que longtemps avant l'époque où furent rédigées l'Iliade et l'Odyssée les peuples de la mer Egée savaient cultiver l'olivier et fabriquer l'huile. De l'examen même des poèmes homériques Hehn avait cru pouvoir tirer une conclusion toute contraire. Il est souvent question dans Homère de l'olivier verdoyant (têlethoôn), aux feuilles allongées (tanuphullos), bienfaisant et sacré (ieros), dont le bois dur sert à faire des manches de haches et de massues, et de l'huile odorante et liquide (euôdês, ugros, par opposition à l'épaisse graisse animale, aleiphar), avec laquelle les dieux et les héros se frottent le corps pour l'assouplir et le parfumer. Hehn estime qu'au temps du poète la culture de l'olivier commençait à peine dans le monde hellénique ; c'est l'olivier sauvage qu'Homère aurait en vue presque partout ; l'huile apparaîtrait dans ses oeuvres comme un produit rare et coûteux, réservé aux riches, qui la faisaient venir d'Orient. En réalité, dans 1'Iliade comme dans l'Odyssée il est question très nettement de l'olivier cultivé, et si les peuples orientaux exportaient chez les Grecs d'Asie ou d'Europe les huiles parfumées dont ils avaient le secret, ceux-ci ne pouvaient manquer cependant d'être initiés, comme les premiers habitants de Santorin, à l'art de presser les olives.
Aux époques suivantes l'olivier existe partout en Ionie et dans les îles ; les vieilles traditions poétiques et religieuses qui le mentionnent prouvent qu'il avait été introduit très anciennement en ces régions. Une année, disait-on, Thalès, averti par ses observations astronomiques que la récolte d'olives allait être très abondante, afferma à l'avance tous les pressoirs de Milet et de Chios et réalisa d'importants bénéfices. Près d'Ephèse était une source vénérée, nommée Upelaios ; on montrait dans cette ville l'olivier sacré à côté duquel Léto avait mis au monde Apollon et Artémis ; la même légende reparaissait à Délos, qui possédait, elle aussi, un olivier sacré. Eschyle donne à Samos l'épithète d'elaiophuios. Il y avait à Lindos, dans l'île de Rhodes, auprès du temple d'Athéna, un antique et célèbre bois d'oliviers. Au temps de Strabon Chypre produisait encore une huile renommée. Dans la Grèce continentale l'olivier n'a pénétré qu'assez tard. Il n'est nulle part cité par Hésiode. D'après une légende que rapporte Hérodote, il n'aurait existé d'abord, et pendant longtemps, qu'en Attique ; le sol de cette contrée lui était plus favorable que celui de l'Asie et du Péloponnèse. Dion Chrysostome attribue à tort son importation à Pisistrate ; déjà Solon avait pris des mesures pour favoriser sa culture : il défendait aux propriétaires, sous peine d'amende, d'arracher plus de deux oliviers par an. L'olivier était particulièrement consacré à Athéna ; on conservait précieusement sur l'Acropole l'arbre que la déesse avait fait surgir de terre lors de sa dispute avec Poseidon ; des douze rejetons plantés dans les jardins de l'Académie provenaient les moriai ou oliviers sacrés, propriété d'Athéna, répandus par toute l'Attique. Les Athéniens regardaient l'olivier comme un arbre national ; ils réclamaient la possession de tous les pays qui le produisaient. Dans le Péloponnèse on vantait les olives de Sicyone et au pied du Parnasse celles de Tithoréa. On voyait, à Olympie un olivier sauvage qu'Héraklès avait rapporté du pays des Hyperboréens ; c'est avec ses rameaux qu'étaient faites les couronnes décernées aux jeux Olympiques.
La culture de l'olivier a été portée dans le bassin occidental de la Méditerranée par les colons grecs ou peut-être même, avant eux, par les navigateurs phéniciens. La légende attribuait sa lointaine propagation au héros Aristée, fils d'Apollon et de la nymphe Cyrène, né à l'endroit où s'éleva plus tard la ville de Cyrène. On rencontre ce demi-dieu pasteur et voyageur en Thessalie, en Béotie, en Arcadie, à Céos, en Sardaigne, en Sicile ; partout où il passe il enseigne aux hommes l'agriculture et les civilise. Les anciens voyaient en lui l'inventeur de l'huile et des pressoirs ; il était honoré tout particulièrement en Sicile, nous dit Diodore, par ceux qui récoltent les olives. A toutes les époques de l'antiquité l'olivier était compté parmi les plus importantes productions de la Pentapole cyrénaïque. C'est de là, très probablement, qu'il aura gagné la Sardaigne, la Sicile et le sud de l'Italie. Le brillant essor des colonies grecques n'a pu que servir ensuite et hâter son expansion. Fenestella, cité par Pline, rapporte qu'avant l'époque de Tarquin l'Ancien (58O av. J.-C.) ni l'Italie (c'est-à-dire, à proprement parler, le Latium), ni l'Espagne, ni l'Afrique (c'est-à-dire la Tunisie actuelle) ne le connaissaient encore. Il fut introduit à Rome, selon toute apparence, par les Grecs de Campanie ; les mots latins olea, oleum, et la plupart des termes techniques relatifs aux diverses sortes d'olives et aux procédés de fabrication de l'huile dérivent directement du grec. Les principaux centres de culture de l'olivier étaient, dans la Grande-Grèce, la région de Thurii et de Tarente ; dans l'Italie centrale, en première ligne le territoire de Vénafre, ensuite Casinum, la Sabine et le Picenum ; dans l'Italie du nord la côte de Ligurie. Sur la rive orientale de l'Adriatique, en Istrie, on récoltait des olives très estimées. En Gaule, les Phocéens avaient planté des oliviers aux environs de Marseille ; plus au nord l'olivier disparaissait. En Espagne, on le trouvait dans toute la région méditerranéenne, notamment en Turdétanie, en Bétique, auprès de Corduba ; sur les plateaux de l'intérieur et sur la côte océanique il n'avait pu s'acclimater. Pline déclare en propres termes que la nature a refusé à l'Afrique la vigne et l'olivier. Cependant César exigeait déjà des villes ou des provinces africaines une contribution de guerre sous forme de livres d'huile. L'olivier a dû être apporté sur le littoral par les Phéniciens. A partir du IIe siècle de l'Empire il s'est répandu dans l'intérieur ; les Romains, qui avaient besoin d'huile pour les distributions gratuites de la capitale, ont favorisé ses progrès et développé sa culture ; les inscriptions d'Henchir Mettich et d'Ain Ouassel nous apprennent que les colons des grands domaines gardaient intégralement pour eux pendant les premières années la récolte des olivettes nouvelles et des oliviers sauvages greffés par leurs soins. On rencontre fréquemment en Algérie et en Tunisie des traces de plantations antiques et des ruines de pressoirs. Les écrivains arabes racontent qu'au temps de la conquête musulmane une forêt d'oliviers s'étendait sans interruption de Tripoli à Tanger. Les régions où l'olivier prospérait le mieux étaient, en Tunisie, la vallée de la Medjerda et le quadrilatère compris entre Sousse, Tébessa, Maharès et Gafsa ; en Algérie, les plaines au nord de l'Aurès, le Hodna, les vallées de l'oued Sahel, de l'oued Sehaou et du Chélif ; dans les pays montagneux on le cultivait en terrasses. Ainsi, sous l'Empire romain, l'olea europaea avait achevé de faire le tour de la Méditerranée et gagné l'un après l'autre tous les pays susceptibles de l'adopter.
Culture de l'olivier
Dans sa classification des terres cultivées par ordre de préférence, Caton mettait les olivettes au quatrième rang, après les vignes, les jardins potagers, les oseraies. D'après Columelle, l'olivier est le premier de tous les arbres et le plus avantageux ; s'il n'a de fruits qu'une année sur deux, il exige peu de soins et produit, lorsqu'il rapporte, une récolte abondante et rémunératrice ; on a certainement avantage à transformer en olivettes les terres à blé, comme le font les Italiens sous l'Empire. Les agronomes grecs et latins nous donnent de longs détails sur les procédés auxquels on avait recours de leur temps pour planter et entretenir les oliviers. Toutes les terres ni toutes les expositions ne sont pas également bonnes ; il faut éviter les sols humides ou trop légers ; rien ne vaut l'argile ou un mélange d'argile et de sable avec un sous-sol caillouteux qui absorbe l'eau ; il faut éviter aussi les lieux qui peuvent avoir à souffrir des gelées de l'hiver ou des fortes chaleurs de l'été ; des collines ondulées sont préférables aux plaines ; dans les régions chaudes l'olivier tapissera le versant qui regarde le nord, dans les régions plus froides celui qui regarde le midi. On distingue plusieurs variétés d'arbres, qui n'ont pas tous les mêmes qualités ; les plus estimées sont la pausia, dont les fruits ont une odeur forte, la regia, qui donne une huile très fine, la liciniana, surtout fréquente aux environs de Vénafre, la sergia en Sabine, l'orchis, le radius, etc. Une plantation d'oliviers s'appelle oletum ou olivetum ; elle doit avoir, selon Caton, deux cent quarante jugera et alimenter deux ou trois pressoirs. Il faut de longues années avant qu'elle entre en plein rapport. Voici comment l'on s'y prend le plus souvent pour la créer. On choisit dans une plantation ancienne de jeunes branches vigoureuses, que l'on coupe en tronçons d'un pied et demi de longueur (taleae, clavolae, trunci), taillés en pointe aux extrémités. On enterre ces rejetons, après les avoir enduits de fumier et de cendre, dans un terrain spécialement destiné à servir de seminarium ; le sol est remué et sarclé avec soin aux alentours. La troisième année on élague toutes les branches des jeunes pousses, sauf deux ; la quatrième année on coupe la plus faible des deux branches subsistantes, et la cinquième l'arbre nouveau est prêt à être transplanté. Dans l'olivetum sont creusées des fosses (scrobes) de quatre pieds, garnies au fond de gravier ; quand les oliviers y ont été placés, on les remplit de terre végétale et d'engrais. Les arbres sont disposés par lignes régulières ; quand le sol est riche en blé, on laisse soixante pieds entre les rangées et quarante d'un arbre à l'autre de la même rangée ; dans les sols pauvres, vingt-cinq pieds en chaque sens suffisent ; l'espace intermédiaire est cultivé. Chaque année on déchausse les racines des oliviers, et on enlève la mousse de l'écorce ; tous les quatre ans on met de l'engrais au pied des arbres et tous les huit ans on les élague ; la greffe permet de fertiliser ceux qui sont stériles et d'améliorer les espèces. La cueillette des olives (oleitas, olivitas) se fait en hiver ; les ouvriers agricoles qu'on y emploie s'appellent operarii ou leguli ; Caton engage le propriétaire à traiter à forfait avec un entrepreneur ou redemptor qui se charge du travail. Il ne faut jamais attendre que les olives tombent d'elles-mêmes : elles sont alors trop avancées et ne peuvent donner que de mauvaise huile ; selon les espèces et l'usage qu'on en veut faire, on les cueille tantôt vertes et avant la maturité (olivae albae ou acerbae), tantôt à demi mûres (olivae variae ou fuscae), tantôt tout à fait mûres (olivae nigrae) ; il est recommandé de les prendre, autant que possible, à la main une à une ; celles qu'on ne peut atteindre en montant dans les arbres sont détachées à l'aide de longs roseaux souples, et non de bâtons qui abimeraient l'écorce. Des peintures de vases grecs représentent des hommes armés de bâtons qui font tomber les olives de l'arbre ; si l'on voulait obtenir de belles récoltes et ménager les plantations, il fallait se conformer plus strictement aux préceptes des agronomes.
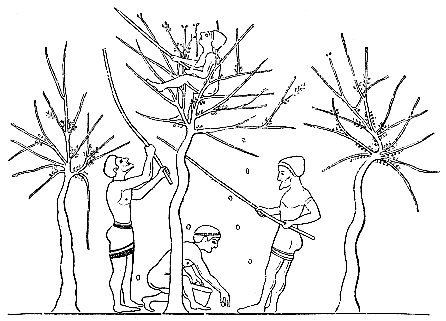 |
Usages de l'olivier et des olives
L'olivier dans l'antiquité servait à maints usages. Son bois est très dur et l'on peut facilement le polir ; on en fabriquait des manches de haches et de massues, ainsi que l'attestent Homère pour la hache de Pisandre et la massue de Polyphème, et Théocrite pour la massue d'Hérakles. Ulysse avait taillé son lit nuptial dans la souche résistante d'une elaiê. Comme les Epidauriens se plaignaient à l'oracle delphique de l'infertilité de leurs terres, la Pythie leur ordonna d'élever à Damia et à Auxésia des statues en bois d'olivier : cet arbre passail donc, aux yeux des Grecs, pour un emblème de fécondité. Il était aussi un emblème de purification ; on enveloppait quelquefois les cadavres avec ses feuilles ; dans l'Enéide, lors des funérailles de Misène, c'est avec un rameau d'olivier que les Troyens arrosent les assistants d'eau lustrale. Thésée, au moment de s'embarquer pour la Crète, avait offert en supplication à Apollon une branche de l'astê elaia de l'Acropole, attachée avec des brins de laine blanche ; on appelait cette offrande l'Eirésioné. A l'imitation du héros, les suppliants, en Grèce et en Italie, se présentaient devant les temples avec des rameaux d'olivier entourés de bandelettes de laine. L'apex de la coiffure que portait à Rome le flamen Dialis était formé pareillement de laine et d'olivier ; peut-être faut-il voir dans ce détail un souvenir de l'eirésioné.
L'olivier était surtout un symbole de paix et de victoire. Les vainqueurs des Panathénées et des jeux Olympiques recevaient en récompense des couronnes tressées avec le feuillage de l'arbre sacré de l'Acropole et de celui qu'Héraklès avait rapporté des pays hyperboréens. Après Salamine, Sparte décerna à Thémistocle une couronne d'olivier. A Rome les triomphateurs étaient couronnés de laurier, mais les ministri triumphantium qui les accompagnaient portaient des rameaux d'olivier : dans l'ovatio l'olivier remplaçait le laurier. Chaque année aux ides de juillet, lors de la transvectio equitum instituée en l'honneur de Castor et Pollux, les chevaliers se présentaient à cheval, le front ceint d'une couronne d'oliviers. Le culte des Dioscures avait été emprunté par Rome à la Grande-Grèce ; c'est aux Grecs que les Romains devaient, avec l'elaias, les idées symboliques qui s'y rattachaient.
Les anciens mangeaient les olives fraîches et surtout confites cibaria ; à Rome, elles faisaient partie de la gustatio, le premier des trois services du dîner ; déjà dans 1'Odyssée l'olivier est cité parmi les arbres dont la vue excite la convoitise de Tantale. La préparation des olives confites (olivarum conditura) demandait beaucoup d'attention : les olivae acerbae étaient pilées en masse et mises dans de la saumure (muria), du vin cuit, du vinaigre ou du miel, les olivae variae cueillies avec leurs tiges et gardées dans de l'huile (olivae colymbades), les olivae nigrae arrosées de sel et séchées au soleil ; on appelait epityrum une sorte de confiture faite avec des olives dont on ôtait les noyaux et hachait la pulpe, qui marinait ensuite dans l'huile avec des herbes odoriférantes.
Fabrication de l'huile
C'est principalement en vue de la fabrication de l'huile (oleum conficere) que l'on cultive l'olivier. Il faut presser les olives pour détacher le noyau de la pulpe et faire sortir de celle-ci d'abord un liquide amer, amorgê, ou amurca, utilisé comme engrais et pour dessécher le bois ou les cuirs, ensuite le suc gras de l'oleum. Ces opérations doivent se faire aussi tôt que possible après la cueillette. Les auteurs anciens décrivent minutieusement les machines qu'employaient les Grecs et les Romains ; les découvertes archéologiques ont permis de contrôler et de compléter leurs témoignages ; on a retrouvé en plusieurs endroits des moulins à huile et des pressoirs, parfois fort bien conservés, ou des monuments figurés qui les représentent.
Un premier appareil servait à écraser les fruits (thlan, alein, frangere, molere). Il est probable qu'à l'origine on les foulait aux pieds : sous les coups des sabots de bois (soleae) l'amurca s'écoulait ; un conduit (canalisl la recueillait. On imagina ensuite divers instruments. La tudicula rappelait la tribula ou herse ; c'était une sorte de battoir, d'un maniement délicat et facile à déranger.
La mola olearia ressemblait au moulin à blé et comprenait comme lui deux pierres s'emboîtant, l'une fixe, l'autre mobile. Elle est représentée en bas-relief sur un sarcophage d'Arles.
Au contraire de ce qui avait lieu dans le moulin à blé, c'est la pierre inférieure qui était creuse ; elle avait la forme d'une cuve, dans laquelle se mouvait un disque de pierre qu'on manoeuvrait à l'aide d'un long manche transversal et qu'une poutre perpendiculaire passant par son centre permettait de hausser plus ou moins selon la quantité d'olives à broyer ; on évitait ainsi de briser les noyaux, qui auraient donné mauvais goût à l'huile. Le trapetum était une sorte particulière de moulin ; il avait été inventé, d'après la légende, par Aristée ; Caton nous a transmis les noms techniques de toutes ses parties ; on les retrouve sur les trapeta qu'ont ramenés à la lumière les fouilles de Stabies, de Pompéi, de la villa de Boscoreale et de l'Afrique romaine. | 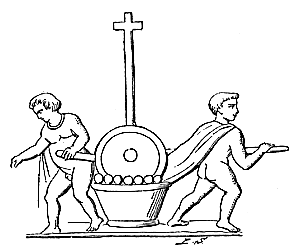 |
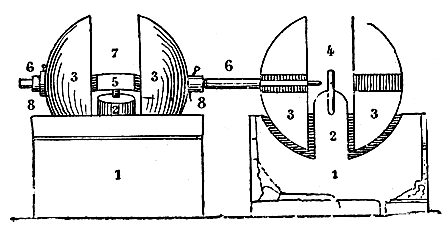 |
Au milieu d'une cuve ronde (1, mortarium) s'élève une courte colonne de pierre (2, milliarium) qui supporte une pièce rectangulaire en bois de hêtre ou d'orme (5, cupa), recouverte de lamelles de métal et tournant sur un pivot de fer (4, columella) auquel un boulon (7, fistula ferrea) la fixe à sa partie supérieure. Aux extrémités de cette pièce viennent s'insérer deux manches de bois (6, modioli), qui traversent de part en part deux demi-sphères de pierre (3, orbes), plates du côté de l'intérieur, convexes du côté des bords (labra) de la cuve ; les orbes peuvent se déplacer circulairement dans le mortarium ; ils sont maintenus à distance des parois par des anneaux (8, armillae), qui enserrent les modioli à leur sortie des demi-sphères de pierre et règlent les déplacements horizontaux de ces dernières ; des coins de bois (orbiculi) qu'on introduit entre le milliarium et la columella permettent de régler l'élévation des orbes au-dessus du fond de la cuve. Quand le mortarium est rempli d'olives, deux hommes font tourner les orbes à l'aide des modioli, autour de la columella comme pivot ; la résistance qu'offrent les fruits oblige les demi-sphères de pierre à tourner légèrement sur leur axe ; les deux mouvements se combinent et la pression ne s'exerce que modérément, sans briser les noyaux.
Lorsque le moulin avait fait son office, la pulpe écrasée et d'où l'amurca s'était écoulée (sampsa) devait être soumise à l'action d'un second appareil chargé d'en exprimer l'huile (ekpiezein, premere, exprimere). Primitivement on foulait la sampsa dans une corbeille à l'aide d'une lourde pierre. Plus tard on inventa des pressoirs (piestêr, piestêrion, lênos, torcular, torculum), tout à fait analogues à ceux qui servaient pour la fabrication du vin ; nous les connaissons, comme les moulins, par les auteurs et par les découvertes qui ont été faites pendant les deux derniers siècles en Italie et en Afrique ; dans l'ancienne Byzacène les ruines de pressoirs à olives sont très nombreuses et ont souvent des proportions considérables. Le plus ancien document figuré qui mette sous nos yeux un pressoir est un vase grec du VIe siècle, à figures noires :
 |
on voit sur la droite une masse carrée divisée en compartiments par des lignes parallèles : ce sont les enveloppes plates superposées qui renferment les fruits ; au-dessous, un tuyau conduit l'huile dans un vase placé sur le sol ; au-dessus s'appuie l'extrémité d'une longue poutre à laquelle, sur la gauche, un jeune homme nu attache avec des cordes deux énormes poids, tandis qu'au milieu un homme barbu s'y suspend pour augmenter encore la pression. A Praesos, en Crète, on a retrouvé dans une maison hellénistique du IIe siècle av. J.-C. l'emplacement et quelques vestiges d'un pressoir qui parait avoir exactement correspondu à celui que reproduit ce vase ; l'antique procédé de fabrication aurait donc longtemps subsisté. Le torcular de l'époque classique est fort simple.
 |
Deux piliers de bois (aa, arbores), enfoncés dans le sol, encadrent l'extrémité (b, ligula) d'une grosse poutre (c, prelum) ; quelquefois, comme à Stabies, il n'y a qu'un seul pilier, percé d'une ouverture circulaire par où passe la ligula ; à l'autre bout du prelum est un cabestan (ee, succula), maintenu par deux montants (dd, stipites) et manoeuvré par des leviers (vectes) ; il permet d'élever et d'abaisser le prelum, par l'intermédiaire d'une poulie (trochlea), au-dessus d'un plateau rond (f, arca), sur lequel on dispose les olives enfermées dans une corbeille (fiscina) maintenues par des lattes (regulae) et recouvertes d'une planche circulaire (orbis olearius) ; la pression se fait sentir partout également et peut être très forte. Cent ans avant Pline, on substitua au cabestan une vis (cochlea), d'invention hellénique. Vers le milieu du premier siècle de l'ère chrétienne un nouveau progrès fut réalisé : la vis, au lieu d'être fixée à l'une des extrémités du prelum, est mise au milieu de l'appareil ; un montant vertical (malus) la supporte ; elle exerce directement la pression au moyen de madriers horizontaux (tympana) qui appuient sur la sampsa ; le prelum et ses accessoires encombrants sont supprimés. Le pressoir à vis [pressorium] présentait le même aspect que la machine avec laquelle les foulons pressaient leurs étoffes ; il occupait beaucoup moins de place que l'ancien torcular ; celui-ci resta cependant en usage.
 |
Un autre genre de pressoir est figuré sur une peinture d'Herculanum et sur une peinture de la maison des Vettii à Pompéi : deux montants de bois verticaux sont reliés en haut et en bas par des poutres transversales ; plusieurs rangées de madriers séparés par des planches horizontales pèsent sur une corbeille d'où s'échappe le jus des fruits, qu'un conduit en métal amène dans une cuve ; des coins de bois enfoncés entre les madriers augmentent la pression.
 |
Les sculptures d'un sarcophage de basse époque nous résument toute l'histoire de la fabrication de l'huile. Au centre un génie ailé ramasse dans une corbeille les olives, tombées de l'arbre ; à droite un autre génie tourne le moulin : à gauche apparaît le pressoir : les olives, déjà broyées par le trapetum, remplissent un coffre ; un petit génie les foule aux pieds pour mieux les tasser ; on voit derrière lui le prelum qui va les écraser ; quatre vases enfoncés en terre au premier plan sont destinés à recevoir l'huile quand elle sort du pressoir.
Dans un domaine rural le local où l'on fabriquait l'huile s'appelait lêneôn ou torcularium. Celui qu'on a déblayé à Stabies en 1779 répondait assez exactement aux descriptions des écrivains anciens.
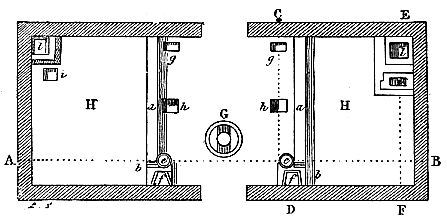 |
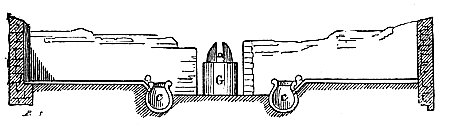 |
Il avait la forme d'un rectangle long ; un couloir central (forum) y donnait accès ; c'est là que se trouvait le moulin (G, trapetum) ; à droite et à gauche, deux pièces (H, H, lacus) renfermaient chacune un pressoir (torcular) ; les stipites (g, h) et l'arbor (i) de l'un et l'autre torcular descendaient assez profondément dans le sol, où les fixaient des poutres transversales (pedicini), qu'abritait une petite chambre souterraine ; un escalier (l) conduisait à cette pièce. Le sol des lacus s'inclinait en pente douce : des vases ronds en terre cuite (cc, labra) recueillaient l'huile ; en face de ces labra étaient des piédestaux surélevés (ff) ; on y plaçait sans doute les récipients plus petits dans lesquels on versait l'huile afin de l'emporter dans les caves. Le torcularium de la villa de Boscoreale se composait des mêmes éléments que celui de Stabies, mais il ne renfermait qu'un seul torcular.
A Bir Sgaoun en Algérie, au sud de Tébessa, une grande tuilerie monumentale, maintenant en ruines, contenait six pressoirs ; des débris de constructions analogues, quoique moins vastes, ont été signalés dans toute la région de Tébessa et de Khrenchela. En général, comme le moulin travaillait plus vite que le pressoir, un trapetum suffisait à approvisionner deux torcularia. Quelquefois les olives n'étaient pas portées directement du trapetum au torcular. On les déposait alors dans une pièce spéciale que les auteurs nous font connaître, le tabulatum : la sampsa était étendue sur une claie que supportaient de petits piliers ; l'amurca qu'elle pouvait contenir encore tombait goutte à goutte dans des cavités (lacusculi) disposées en pente et aboutissant à une cuve.
On nommait factus ou factum la quantité d'olives que l'on soumettait à la fois au pressoir ; le factus se composait de cent à cent soixante modii. Caton appelle le pressoir lui-même factor et les ouvriers qui le manoeuvrent factores ; comme ceux qui font la cueillette, ils sont étrangers au domaine et fournis à forfait par un entrepreneur, ils sont dits par Columelle torcularii. Les capulatores ou transvaseurs puisent l'huile dans les labra du torcularium à l'aide d'une sorte de cuiller ou capula ; un certain nombre d'inscriptions d'Italie nous les montrent organisés en collèges. L'huile retirée des labra était mise successivement dans plusieurs vases ; on la laissait séjourner quelque temps en chacun d'eux pour qu'elle se débarrassât de l'amurca et des autres impuretés (fraces, faeces) qu'elle tenait en suspension ; finalement on l'enfermait dans de grandes jarres, dolia olearia, dont les rangs bien alignés garnissaient les caves et magasins de réserve (cellae oleariae).
La qualité de l'huile ne dépendait pas seulement de l'espèce des olives qu'on employait, mais aussi de leur degré de maturité. L'huile des olives encore vertes (oleum acerbum ou aestivum) était bonne et peu abondante ; on appréciait surtout l'elaion omphakinon, oleum viride, qu'on tirait des olives à moitié mûres (olivae variae) ; l'oleum maturum provenait des fruits mûrs et l'elaion koinon, oleum cibarium ou ordinarium, de fruits avancés ou tombés ; l'un et l'autre n'avaient qu'une médiocre valeur. D'autre part les anciens faisaient presser à plusieurs reprises, jusqu'à trois fois, la même masse de sampsa ; bien entendu, l'huile qu'on obtenait était de moins en moins bonne ; il fallait prendre soin de ne pas confondre dans les caves les jarres qui contenaient le produit des différentes pressurae ; la première pressura des olivae variae donnait la meilleure huile.
Usages de l'huile
L'usage de l'huile d'olive s'est peu à peu répandu dans tout le bassin de la Méditerranée, à mesure que se propageait la culture même de l'arbre qui la fournit. Elle se substituait à la graisse animale et au beurre, comme le vin à la bière ; les denrées que les hommes primitifs du midi aussi bien que du nord avaient seules connues restèrent finalement l'apanage exclusif des pays septentrionaux, dont le climat est contraire à l'olivier et à la vigne.
Les Grecs et les Romains faisaient une grande consommation d'huile. Ils s'en servaient surtout en frictions pour les soins du corps. C'est sous cette forme qu'ils commencèrent à l'utiliser, suivant en cela l'exemple des peuples orientaux. Les héros d'Homère, après s'être baignés ou lavés, se frottent d'huile ; ils font subir aux cadavres des onctions qui les purifient ; les épithètes phaeinos et liparos caractérisent sans doute l'aspect que donnait à la chevelure l'huile brillante et grasse ; Patrocle humecte même avec elle la crinière des chevaux d'Achille. La coutume de se frictionner ainsi persista pendant toute l'antiquité ; le liquide était contenu dans de petites fioles à col étroit que les Grecs appelaient lêkuthoi [Lecythus] et les Romains ampullae oleariae ; on les emportait avec soi dans les palestres et les thermes. L'huile jouait nécessairement un grand rôle dans la préparation aux concours gymniques : aussi les Athéniens donnaient-ils en prix aux vainqueurs des Panathénées toute celle que l'on récoltait des moriai [Certamina]. Sous l'Empire romain les repas que prenaient en commun les membres des collèges étaient précédés de bains dans les établissements publics ; les citoyens qui faisaient par testament des libéralités aux collèges pour fonder de pareils banquets ajoutaient souvent à leur donation une somme supplémentaire qui permettait de distribuer gratuitement aux baigneurs l'huile dont ils devaient être munis [Gymnasium]. Les empereurs à Rome, les municipalités dans les provinces, faisaient très fréquemment des distributions d'huile, publiques et gratuites. Les frictions répétées exerçaient la plus favorable influence sur la santé. Démocrite d'Abdère, plus que centenaire, déclarait que pour bien se porter et atteindre son âge il fallait se nourrir de miel et s'oindre d'huile ; Pollio Romilius fit à Auguste, qui l'interrogeait sur les moyens de vivre vieux, une réponse analogue : intus mulso (on entendait par mulsum du vin mêlé de miel), foris oleo. D'après Pline, la vigne et l'olivier donnent aux hommes les deux liqueurs les plus agréables, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur ; et l'huile est plus utile encore que le vin : on ne saurait s'en passer.
Elle avait sa place aussi parmi les aliments. Elle figure avec le vinaigre, le sel et le poivre, au nombre des condiments les plus usités [Condimenta]. A l'époque classique, on assaisonne avec elle le froment, le millet, le poisson, la viande, les légumes. Les contemporains d'Homère connaissent parfaitement l'elaion, mais ils ne le mangent pas encore. Plus tard Posidonius constate que les Gaulois, faute d'occasion et d'habitude, ne consomment pas d'huile.
Les personnages que mettent en scène l'Iliade et l'Odyssée ne s'éclairent qu'à la lueur du feu de bois ou à l'aide de torches résineuses. Les lampes à huile auraient été inventées, selon saint Clément d'Alexandrie, par les Egyptiens ; ceux-ci, nous dit Hérodote, mettaient du sel et de l'huile dans des écuelles et les faisaient briller. Ce sont les Phéniciens sans doute qui ont fait connaître aux Grecs la lampe d'argile ou de bronze, et les colons grecs de l'Italie méridionale en amont ensuite révélé l'usage aux Romains [Lucerna].
L'huile enfin était employée dans la fabrication de certains tissus de lin pour les rendre plus souples et assurer leur conservation. Deux passages d'Homère, dont le sens avait longtemps paru obscur et donné matière à de longues discussions, font allusion à cette coutume. On sait d'autre part que les foulons grecs rafraîchissaient avec de l'huile les vêlements fripés et fanés. Des étoffes de pourpre qu'Alexandre trouva à Suse en 331 avaient cent quatre-vingt-dix ans d'âge et semblaient cependant toutes neuves, parce qu'on les avait plongées jadis dans une mixture de miel et d'huile.
Commerce de l'huile
En raison même des services multiples qu'elle rendait, l'huile d'olive dans l'antiquité donnait matière à de nombreuses transactions et faisait l'objet d'un commerce très actif. Non seulement en chacune des contrées riveraines de la mer Intérieure des négociants l'achetaient aux propriétaires ruraux pour la revendre au détail, mais encore il s'établissait entre les diverses régions des courants d'échange. Si tous les pays méditerranéens possédaient des oliviers, les circonstances locales favorisaient plus ou moins la culture et l'on n'apportait pas partout un soin égal à préparer l'huile. De là des différences appréciables dans la quantité et la qualité des produits obtenus. Certains pays n'avaient pas assez d'huile pour suffire à leurs besoins ; d'autres en fabriquaient plus qu'ils n'en consommaient. Celle d'Attique ou d'Italie était réputée pour sa finesse et sa limpidité ; celle d'Afrique passait pour grossière et propre seulement aux usages communs. L'exportation et l'importation étaient une nécessité ; elles corrigeaient ces inégalités de fait et devenaient la source de gros bénéfices.
Les peuples d'Orient avaient pour spécialité la fabrication et la vente des huiles aromatisées et des parfums [Unguentum]. Les vases, les boîtes et les flacons d'albâtre où l'on enfermait ces précieuses denrées, appelées souvent à voyager longtemps et loin, sortaient des ateliers phéniciens. Le commerce de la parfumerie était déjà très développé dans le bassin oriental de la Méditerranée au temps d'Homère. Il se perpétua jusque sous l'Empire romain.
Chez les Grecs, les marchands qui faisaient le trafic de l'huile s'appelaient elaiopôlai, elaiokapêloi. Ils transportaient leur marchandise, du lieu d'origine aux comptoirs de vente, dans de grandes amphores estampillées que décoraient souvent, des sujets peints. Les vases grecs, même ornés, ont un caractère essentiellement pratique ; on ne les exportait jamais à vide ; ils renfermaient dans leurs flancs des denrées utiles, vin ou huile. La diffusion lointaine des vases grecs nous est donc un témoin irréfutable de l'extension du commerce hellénique. Les marques de fabrique qu'ils parlent nous renseignent d'autre part sur la provenance exacte de leur contenu. Tandis que les Corinthiens exportaient surtout des petits vases à parfums, les Chalcidiens et les Athéniens envoyaient outre-mer des amphores : l'huile et le vin n'étaient-elles pas les principales richesses naturelles de l'Eubée et de l'Attique ? Sur des anses d'amphores on lit aussi les noms de Rhodes, de Cnide, de Thasos ; on peut tirer de ces documents une conclusion analogue. Il faut ajouter que les sujets représentés sur les vases ne sont pas sans rapport avec leur destination.
 |
Une amphore du Musée du Vatican, trouvée à Caeré en Etrurie, met sous nos yeux, en deux tableaux, une scène amusante qui se passe entre un marchand d'huile et un acheteur ; des inscriptions tracées auprès des personnages nous communiquent leurs réflexions. D'un côté deux hommes sont assis, à droite et à gauche d'un olivier ; devant chacun d'eux une amphore est posée à terre ; l'un verse de l'huile dans un lécythe, l'autre tient un bâton dans la main droite et tend la gauche vers un chien placé en face de lui et qui le regarde ; on lit ces mots : ô Zeu pater, aithe plousios gen(oiman), «ô Zeus, puissé-je m'enrichir !».
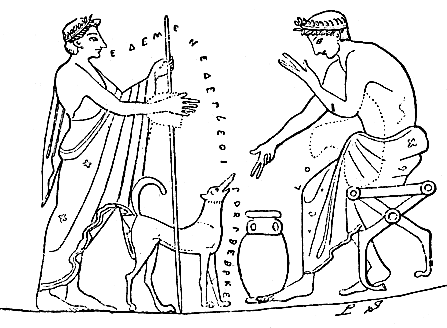 |
Sur l'autre côté, un homme assis montre de la main droite une amphore et approche de son visage les doigts de la plain gauche comme pour compter ; en face de lui un autre homme debout, appuyé sur un bâton, tend la main ; un chien les sépare ; on lit : êdê men êdê pleon (a)p'ara bebaken, «le vase est plein, il déborde».
L'huile la plus estimée était celle de l'Attique. On a constaté qu'à partir du VIe siècle av.J.-C. les ateliers attiques, dans le mobilier funéraire de la Sicile et de l'Italie, éliminent toutes les autres fabriques. La vogue de la céramique athénienne à cette époque tient à l'essor que prenaient alors, sous l'impulsion de Solon et de Pisistrate, la culture de l'olivier et la fabrication de l'huile. Solon interdit toute exportation, sauf celle de l'huile : cette denrée était assez abondante déjà pour qu'on pût la laisser sortir du pays sans inconvénient ; il en resterait toujours assez pour les besoins des habitants. Les Athéniens se trouvèrent tout naturellement amenés à faire le commerce de l'huile : ils portèrent l'excès de leur production chez les peuples moins bien pourvus. Les vainqueurs des grandes Panathénées recevaient, en même temps que des couronnes faites avec le feuillage de l'olivier sacré de l'Acropole, des amphores contenant l'huile que fournissaient les moriai ; ils avaient le privilège exclusif de l'exporter. En dehors de l'Attique, les meilleures huiles du monde hellénique étaient celles de Sicyone dans le Péloponnèse, de Tithoréa en Phocide, d'Eubée, de Chypre, de Cyrène. Un passage de l'Economique d'Aristote nous donne une indication sur les prix de vente : à Lampsaque un chous (3 litres 237) valait trois drachmes (2 fr 79) ; en outre l'Etat prélevait sur les transactions un droit égal à la moitié du prix, ce qui mettait le métrète (39 litres environ) à 36 drachmes. D'après le tarif des sacrifices pour la centième Olympiade trois cotyles valaient à Athènes une obole et demie, ce qui mettait le métrète à douze drachmes. D'après une inscription de Délos, le métrète au début du IIe siècle contait de quinze à dix-sept drachmes. Un papyrus de l'année 130 av.J-C. fixe le prix du métrète d'elaion xenikon à dix drachmes.
En Occident aucune huile ne valait celle de l'Italie, et dans la péninsule même on accordait sans conteste la préférence à l'oleum Licinianum du territoire de Vénafre. Au second rang venaient l'huile d'Istrie et celle de Bétique ; Martial, par patriotisme, exagère la valeur de cette dernière. Celle d'Afrique en revanche avait mauvaise réputation ; peut-être était-elle fabriquée plus négligemment. A la fin de la République et au début de l'Empire, à la suite de transformations économiques et sociales qui réagissaient sur l'agriculture, les olivettes se multiplièrent en Italie tandis que disparaissaient les terres à blé. L'huile italienne était alors extrêmement abondante et à bas prix ; Pline nous cite quelques chiffres caractéristiques : en 5O5 de Rome, 249 av. J-C., on avait douze livres pour un as ; en 680-71, pendant une année entière, dix livres pour un as ; aussi l'exportait-on en masse : l'Italie la fournissait aux provinces. Les Romains prenaient d'ailleurs des mesures pour empêcher toute concurrence. Cicéron nous dit, dans son De Republica, qu'ils avaient défendu aux peuples transalpins de planter des oliviers et des vignes ; le dialogue que Cicéron est censé rapporter aurait eu lieu, d'après lui, en 129 avant l'ère chrétienne ; les peuples transalpins dont il s'agit en ce texte ne peuvent être ni les gens de Marseille, alliés de Rome, ni les Salluviens, Voconces et Arvernes, avec lesquels l'Etat romain n'entra en conflit qu'en 125 ; ce sont les Oxybes et les Déciales, Ligures de l'est du Var, vaincus en 154. Il est très probable que cet exemple a dû être suivi plus tard et que jusqu'à la comquête de César une loi défendait expressément en Gaule la plantation d'oliviers et de vignes. On sait que vers l'an 92 ap.J.-C. Domitien devait renouveler cette interdiction pour tout l'Empire, du moins en ce qui concerne les vignes ; les documents conservés ne disent rien des oliviers, et pourtant l'Apocalypse signale à cette époque, à côté du renchérissement de l'orge et du blé, une surabondance désastreuse d'huile en même temps que du vin. Deux villes du nord de l'Italie sont citées par Strabon comme des centres importants du commerce de l'huile et du vin aux premiers temps de l'époque impériale : Gènes, où les Ligures de l'intérieur apportaient en échange du bois, des bestiaux, des peaux et du miel ; Aquilée, où s'approvisionnaient les Illyriens de l'Ister, qui donnaient en retour des bestiaux, des cuirs et des esclaves ; l'huile qu'on vendait au marché d'Aquilée ne venait pas d'Italie, la vallée de Pô ne produisait pas d'oliviers, mais de l'Istrie et de la Liburnie ; l'oleum liburnicum était assez réputé : il avait une saveur particulière et les agronomes donnent des recettes pour le fabriquer artificiellement à l'aide de certains condiments. En ce qui concerne le commerce de détail, il faut rappeler qu'on a découvert à Pompéi, dans la strada Stabiana, la boutique d'un marchand d'huile : dans le comptoir d'argile, en façade sur la rue et recouvert d'une plaque de cipollin, sont enfoncés huit vases de terre qui contenaient encore, au moment des fouilles, quelques résidus d'huile et d'olives. Une taberna analogue est représentée sur un bas-relief du Musée du Vatican. La peinture murale de la maison des Vettii où l'on voit un pressoir manoeuvré par des Amours nous montre d'autre part les mêmes petits personnages occupés à peser et à vendre de l'huile.
A partir du IIe siècle de l'Empire l'Italie n'exporte pas d'huile d'olive, elle en importe. Le travail de la terre était de plus en plus négligé par toute la péninsule. Spartien raconte, dans sa Vie de Septime-Sévère, que la culture de l'olivier avait été abandonnée comme celle des céréales. Or à cette époque précisément Rome avait besoin de plus d'huile que jamais pour suffire aux distributions gratuites que multipliaient les empereurs. Il était nécessaire de faire appel aux provinces. C'est à l'Afrique et à l'Espagne que l'on s'adressa, comme en témoignent les estampilles des fragments d'amphore recueillis à Rome au mont Testaccio ; ces marques de fabrique mentionnent les unes Leptis en Tripolitaine et Tupusuctu en Maurétanie Césarienne, les autres Italica, Saguntum, Astigi, Corduba, Saxum ferreum (bourgade du conventus cordubensis), ou plus généralement la province de Bétique ; en outre, beaucoup d'amphores qui ne portent pas de marque espagnole sont aussi, à en juger par leur technique, d'origine ibérique ; toutes les estampilles qu'on peut dater nous reportent à la seconde moitié du IIe siècle. Les empereurs avaient pris des mesures pour encourager le commerce privé de l'huile ; ceux qui s'y adonnaient, se nommaient olearii ou encore olearii negotiatores, mercatores, diffusores ; après cinq ans de profession, s'ils consacraient aux affaires une grande partie de leur patrimoine, ils étaient exemptés, comme les navicularii, de toute charge publique. Dès le IIe siècle, les olearii forment à Rome et à Ostie des collèges influents. Ils trafiquaient avec l'Afrique et la Bétique. Ils avaient souvent pour patrons des préfets de l'annone : leurs collèges entretenaient donc des rapports avec le service des approvisionnements [Annona]. Quant à l'huile dont on avait besoin pour les distributions gratuites, elle était fournie, sous forme d'impôt, par les régions mêmes où négociaient les olearii, Afrique et Bétique ; la contribution que livraient aussi Nicée et, depuis Septime-Sévère, Tripoli fut supprimée par Constantin. La levée se faisait par les soins d'adjoints (adjutores) au préfet de l'annone ou de procurateurs sous ses ordres ; on en chargea plus tard les gouverneurs de province. Le transport était confié aux naviculaires [Navicularii] ; ils amenaient les convois à Ostie, où les bateliers du Tibre les prenaient sur leurs embarcations pour les conduire jusqu'à Rome ; sur une fresque des catacombes est figuré un bateau à voiles garni de rameurs et chargé d'amphores. Dans la capitale, des portefaix organisés en collège, frugis oleique bajuli, portaient l'huile des quais de débarquement aux magasins de l'annone et aux lieux de distribution. Une caisse spéciale, Arca olearia, centralisait toute la comptabilité. Une loi du Code Théodosien traite de mensis oleariis ; le Curiosum et la Notitia Urbis Romae nous apprennent que ces mensae étaient au nombre de 2 300 dans la ville de Rome ; c'étaient sans doute les comptoirs où l'on distribuait gratuitement l'huile aux habitants. Sous l'Empire la valeur marchande de l'huile avait augmenté ; l'édit de Dioclétien fixe le prix maximum auquel on peut la vendre ; ce prix varie selon la qualité : un sextarius (0 litre 54) d'elaion omphakinon est évalué à quarante deniers (le denier représente 2 centimes un quart) ; les qualités inférieures sont cotées vingt-quatre et douze deniers, l'huile apprêtée au raifort huit deniers seulement ; en somme, le litre valait de 37 centimes à 1 fr. 85. Une loi de Valentinien, Théodose et Arcadius, en 389, estime qu'un solidus (15 fr. 20) équivaut à quatre-vingts livres d'huile, soit 19 centimes la livre. Pour empêcher que l'huile ne manque ou ne devînt trop rare et trop chère, on avait fini par en défendre l'exportation hors des frontières de l'Empire.
Article de M. Besnier