PERPIGNAN : DES AMIS
UNE OEUVRE A MATURITE, LE DERNIER HAVRE DE RAOUL DUFY
(Le Havre, 1877- Forcalquier, 1953)
Conférence donnée par Marie-Claude Valaison pour les Journées du Patrimoine, en septembre 2002.
Cette conférence reprend les recherches que j'avais faites pour l'exposition Dufy et le Midi, au Palais des Rois de Majorque en 1990. A l'occasion de cette exposition, j'avais été conduite à préciser les titres de dessins de Dufy, et à les situer géographiquement dans le département, et ce, bien avant l'exposition de Céret qui a repris ces identifications. Cette exposition mettait pour la première fois en évidence l'importance, dans son oeuvre, des dix années que Dufy a passées à Perpignan. Les dix dernières années de sa vie... Ce texte est un modeste hommage à ceux qui furent les amis fidèles de Dufy à Perpignan : la famille du docteur Pierre Nicolau, sa femme, Yvonne, ses enfants, la famille du docteur René Puig, sa femme et leurs enfants ; Pau Casals et Ludovic Massé.
Chassé par l'occupation allemande, Dufy quitte l'Orne au
début de 1940 pour se réfugier en zone libre.
Après un court séjour à Nice où il
retrouve sa femme, il va à Céret dont on lui a
vanté le climat, favorable, lui a-t-on dit aux crises de
rhumatismes qui le harcèlent. Il y fait la connaissance
du peintre Pierre Brune qui avertit son ami le Docteur Pierre
Nicolau de Perpignan de la détresse morale, physique et
matérielle dans laquelle se trouvait «le
maître Raoul Dufy».
Le docteur Bernard Nicolau, fils du précédent,
raconte comment son père est allé chercher Dufy
à Céret, et a trouvé un grabataire
quasiment paralysé par une crise de rhumatismes
déformants. Il ramène Dufy à Perpignan, et
l'hospitalise dans sa clinique des Platanes. Il y trouve les
soins appropriés à son état, un meilleur
confort, et l'amitié que la famille Nicolau ne cessera de
lui prodiguer (Pierre Nicolau connaissait Dufy de
réputation, était un admirateur de son travail,
mais n'avait encore jamais eu l'occasion de l'approcher). Ces
rhumatismes se soignaient alors aux sels d'or : un mieux ne
tarda pas à se faire sentir, et Dufy put se mouvoir.
Bernard Nicolau poursuit que, les difficultés de logement
étant grandes à Perpignan à cette
époque, Raoul Dufy fut logé dans la maison
familiale, rue de la Poste (actuellement rue Jeanne d'Arc). Il y
resta plus de six mois. Le salon fut aménagé pour
qu'il puisse y installer son atelier. Jusqu'à la mort de
Dufy, les liens d'amitié, d'affection, resteront
très profonds entre le peintre et les Nicolau.
Plus tard, et toujours grâce aux Nicolau, Dufy trouva un
petit studio, dans la même rue, en face du Centro
Espanol, que tous les Perpignanais connaissent bien ! Ce
studio lui était loué par la famille Sauvy,
propriétaire du beau domaine de l'Esparrou à
Canet-Plage, où Dufy était souvent invité.
Ce studio était un peu sombre. Joseph Sauvy lui loue
alors un appartement laissé libre par le
décès de sa mère, rue de l'Ange. Les
fenêtres de cet appartement donnent sur la Place Arago,
l'une des plus animées de Perpignan. De sa fenêtre,
Dufy pouvait voir les fêtes et l'animation de la Place
Arago (sardanes et carnavals) mais aussi les fenêtres de
l'appartement de son ami l'écrivain roussillonnais
Ludovic Massé, qui habitait rue Vauban, de l'autre
côté de la place !
Grâce aux Nicolau et sans doute à la Clinique des
Platanes, Dufy qui était un grand amateur de musique,
rencontra le Docteur René Puig, sa femme, violoncelliste
à ses heures, mais aussi Pau Casals, il y retrouve son
amie la pianiste Yvonne Lefébure, et le violoncelliste
Nicolas Karjinsky venu poser dans l'atelier de Dufy, rue Jeanne
d'Arc.
C'est donc peu de dire que les années passées par
Dufy à Perpignan ont été riches en
amitié, fructueuses en travail. Il reprend les
séries sur lesquelles il avait commencé à
travailler (les Arlequins, les instruments de musique et les
orchestres, le Dimanche ou Kiosque à Musique, le
thème de l'atelier, la série du Cargo Noir).
Grâce à Lurçat et Firmin Bauby, à
Sant Vicens, il réalise des tapisseries. Il fait la
connaissance du peintre et céramiste Jean-Jacques
Prolongeau qui met à sa disposition son atelier et son
four. Il peint aussi la vie de Perpignan (sardanes et
coblas, carnavals) et les paysages de ce département.
Son collaborateur André Robert le suit à Perpignan
et l'aide dans la préparation des toiles, des aquarelles.
Et puis à ses côtés, la toute
dévouée Berthe Reysz est venue aussi, pour lui
prodiguer les soins qui lui sont nécessaires.
Ce seront les dix dernières années de sa vie. Il
ne quitte guère Perpignan que pour de courts
séjours à Paris, aux Etats-Unis où il est
soigné à la cortisone, dans l'Ariège ou la
Haute Garonne chez ses amis Dorgelès, chez Simone Laval
fille de Pierre Nicolau, à Caldas de Montbuy (Catalogne),
où il suit des cures thermales. Son installation
définitive à Forcalquier date de septembre 1952.
Dans sa dernière lettre à Ludovic Massé
datée du 24 février 1953, Dufy écrit :
«Je me débats avec mon foie, mon intestin et mon
estomac ravagés par l'auréomycine et la
pénicilline qui m'ont délivré d'une
congestion pulmonaire. Je suis encore très faible et au
repos complet».
Ludovic ne recevra plus de lettre de son ami : Dufy meurt
à Forcalquier le 25 mars 1953. Il est enterré au
cimetière de Cimiez, près de son
épouse.
Les différents historiens d'art qui ont travaillé
sur l'oeuvre de Dufy ont assez peu parlé de ce
séjour perpignanais, bien qu'il ait correspondu à
la maturité de l'oeuvre, et que Dufy lui-même en
ait dit la grande importance. Seule Dora Pérez-Tibi, dans
un ouvrage extrêmement complet sur Dufy, a fait une place
de choix à ce séjour, en donnant une chronologie
précise. Il est vrai qu'elle n'a pas hésité
à venir et revenir à Perpignan, à
rencontrer tous ceux qui avaient connu Dufy, à venir
consulter les archives et toute la documentation du musée
Rigaud sur ce sujet. Dora poursuit son travail sur le peintre
avec passion et compétence. Ses efforts ont
été reconnus, puisque son livre a reçu le
prestigieux prix Elie Faure, destiné à
récompenser une recherche novatrice en Histoire de l'Art.
C'est donc un homme malade qui arrive à Céret en
ce début de 1940. Il trouvera à la clinique des
Platanes les soins nécessaires, mais il va surtout
trouver une ambiance stimulante pour lui. Les Nicolau ont
évidemment bien facilité son adaptation
perpignanaise en le faisant profiter de leurs relations
amicales. Dufy jamais ne se plaint des souffrances qu'il endure
; il conserve une joie de vivre, un optimiste que sa peinture
traduit sans relâche.
Cette joie de vivre est éclatante dans la série
des Arlequins, série reprise à Perpignan. Un
Arlequin les bras croisés sur fond champêtre
est un souvenir de Montsaunès : un autre dit Arlequin
à St Georges de Venise, resté à
Perpignan, est à rapprocher du célèbre
Arlequin à la manière vénitienne. Dufy
considérait que l'Arlequin à St Georges
n'était pas terminé, et se proposait toujours de
le terminer...
En 1945/46, Dufy fait une cure dans la station thermale
catalane de Caldas de Montbuy, où était
installé le sculpteur Manolo Hugué. Se sont-ils
rencontrés là-bas ? Nous n'en savons rien, et cela
a pu être difficile puisque Manolo est mort en 1945. Par
contre, ils ont très bien pu se rencontrer à
Perpignan chez les Puig, chez qui Manolo se rendait souvent, ou
chez M. et Mme de Lazerme qui recevaient de très nombreux
artistes, dont Dufy. Il semble d'ailleurs que ce soit le docteur
René Puig qui l'ait incité à faire cette
cure thermale. Il rapporte de Caldas de Montbuy des Arlequins
au violon, à demi allongés sur une terrasse,
sous des ombrages. Le violon occupe le centre de ces petits
tableaux. Il va même jusqu'à costumer Berthe Reysz
en Arlequin ! Il n'est cependant pas certain que cet Arlequin
ait bien été peint à Perpignan.
Issu d'une famille de musiciens, musicien lui-même, Dufy
garde toute sa vie un grand amour pour la musique. On sait qu'il
a tenté de représenter les différents
timbres des instruments, le rythme musical, par des formes ou
des couleurs, et par le mouvement donné à la
couleur. On prête d'ailleurs à Pau Casals cette
réflexion : «Je ne peux pas dire le morceau que
joue votre orchestre, mais je sais dans quelle clé il est
écrit». A Perpignan, entre 1946 et 1948, il
accompagne les Nicolau au théâtre municipal,
où il peut écouter des orchestres et poursuivre
son travail sur ce thème : il est sans doute permis de
voir la salle du théâtre de Perpignan dans la
série des Quintette. Orchestres symphoniques ou de
chambre, dans un théâtre, mais aussi, et c'est plus
nouveau, musiciens en plein air : c'est la série des
musiciens à la campagne.

Musiciens à la campagne, huile sur
contreplaqué, circa 1942
|
Sur un des tableaux du musée Rigaud, des personnages se
reposent, assis de part et d'autre d'une table ; un homme joue
de la trompette, un autre du bandonéon, tandis que le
dépiquage se poursuit à l'arrière plan. Ces
scènes de dépiquage se retrouvent dans les
tableaux faits à l'occasion des séjours de Dufy
dans la Haute-Garonne, à Montsaunès chez les
Dorgelès en 1942 et 1943. Le musée Rigaud conserve
aussi des dessins sur ce thème. Dora Pérez-Tibi a
bien montré comment les tableaux à thème
rustique sont nés dès 1924, mais les
séjours chez Roland et Hania Dorgelès renouvellent
le thème : ils lui offrent l'occasion de peindre sur le
motif de nouveaux sites, et de nouvelles activités des
paysans, qu'il découvre en parcourant la région en
carriole. Il continue à traiter ce thème à
l'occasion de ses séjours en 1948, dans le domaine de
Rozès (près de St Lizier, dans l'Ariège)
où il est accueilli par la comtesse de Tessac à
qui Ludovic Massé l'a recommandé. Il reprend ce
thème lorsque le Dr Roudinesco lui demande d'illustrer
les Bucoliques de Virgile, traduites par Valéry.
Dufy, ce chantre de la couleur, veut faire des illustrations en
noir et blanc, ce que refusent ses commanditaires. Dufy tient
bon. Il écrit le 27 octobre 1947 à Ludovic
Massé, depuis le domaine de Rozès : «Je
fignole et bichonne mon Virgile, mais je suis toujours dans les
mêmes difficultés avec les couleurs et Mme Paul
Valéry et Roudinesco. Mais ma décision est
inébranlable ; les dessins sans couleurs et si on ne veut
pas m'écouter je me servirai de ces dessins pour les
Bucoliques à moi, avec tout bêtement une
traduction élastique (sic), celle de Delille par
exemple». (Cette lettre est de la main de Berthe Reysz
à qui Dufy l'a dictée).
D'autres orchestres vont fasciner Dufy : ce sont les
coblas, orchestres qui accompagnent les sardanes. De son
atelier donnant sur la Place Arago, Dufy voit toute l'animation
de la place, et il en fait des séries de dessins,
d'aquarelles éblouissants. Le touche alerte, vive,
allusive, sait rendre les rondes concentriques de sardanes, les
mouvements caractéristiques des bras et des mains des
danseurs. Les coblas sont décrites avec un soin
tout particulier, et Dufy prend même la peine de noter le
nom catalan des instruments : fiscorn, tenora,
prima.
Il est très émouvant de penser que ce peintre,
immobilisé dans son atelier par sa maladie, ce peintre
qui ne pouvait marcher sans cannes et sans aide, qui ne pouvait
monter les escaliers, et qu'on était obligé de
pousser sur son fauteuil roulant, ce peintre qui ne pouvant
tenir ses pinceaux avait appris à peindre de la main
gauche et se faisait aider par André Robert, ce peintre
reste le peintre de la couleur, le peintre de la joie de vivre,
et jamais ne se plaint...

Portrait du Dr René Puig - Ed. de la Monnaie de
Paris
|
Peut-on imaginer la difficulté qui était la sienne
lorsqu'il se rendait chez le Docteur René Puig,
mélomane, ami de Pau Casals, qu'il recevait chez lui, rue
Fontfroide ? Dufy devait d'abord descendre de son premier
étage rue de l'Ange, se faire accompagner chez ses
hôtes, et monter à nouveau jusqu'au premier
étage... et refaire cet effort en sens inverse quelques
heures plus tard. Le Docteur René Puig explique comment
on faisait : «Je suis allé le chercher dans son
appartement. Je le descendais sur une chaise avec son valet de
chambre, et nous le posions dans la voiture. On le remontait
part le même moyen dans le salon de musique». La
fille de Monsieur et Madame Puig se souvient de cet homme aux
cheveux blancs qu'on hissait (le mot n'est pas trop fort) dans
les escaliers, et qui ne se départissait jamais de sa
courtoisie et de sa bonne humeur. Une fois dans le salon, Dufy
rencontrait Pau Casals, mais retrouvait aussi sa chère
amie la pianiste Yvonne Lefébure, et le violoniste
catalan Lluis Pixot, ami très proche de Dali. Et autour
du piano à queue des Puig, on jouait de la musique, Mme
Carcassonne, l'épouse de Pixot, tournait les pages pour
Yvonne Lefébure, et Dufy dessinait ; pendant les pauses,
on refaisait le monde de la musique, on imaginait un festival de
musique à Prades... Le célèbre festival de
musique de Prades, le célèbre festival Pau Casals,
devenu le «souvenir de Pau Casals», est né
dans ce salon au cours de discussions en ces années 1949
et 1950. Dufy, c'est promis, dessinera la couverture du premier
programme. Mais, en 1950, Dufy est à Boston pour se faire
soigner. Il ne peut donc réaliser cette illustration.
Cependant, il autorise la reproduction de son oeuvre Hommage
à Mozart en frontispice : le programme est
illustré par le catalan Louis Jou avec des textes de
Marcel Durliat et de René Puig, pour présenter les
sites et monuments des Pyrénées-Orientales.
C'est chez les Puig encore qu'il rencontre le violoncelliste
Nicolas Karjinsky dont il fait le portrait dans l'atelier de la
rue Jeanne d'Arc, en 1942. Est-ce le violoncelle de Casals ou
celui de Karjinsky dont Dufy a laissé des études
au crayon et à l'encre ? Nous l'ignorons, comme nous
ignorons aussi l'identité du violoniste qui a posé
pour un autre dessin, non daté. Il ne peut s'agir de
Pixot, qui avait une grande barbe ! Est-ce Alexandre Schneider
venu aussi chez les Puig, mais un peu plus tard, vers 1949
?
On connaît bien la série des Hommages,
à Bach, à Mozart, à Debussy, de 1945
à 1952. Sait-on qu'elle a été faite dans
l'atelier de Perpignan, par un homme rongé par la douleur
? Quant aux déclinaisons du Violon Rouge, elles
sont nées aussi à Perpignan. Laissons Bernard
Nicolau raconter dans quelles circonstances : «Je prenais
des leçons avec le violoniste Pixot que Dufy a bien
connu. Un jour, j'ai laissé traîner mon violon
d'études sur un linge posé sur une table. Dufy en
fait le fameux violon rouge, thème de plusieurs de ses
toiles».
Un kiosque à musique se trouve dans la grande promenade
dite des Platanes à Perpignan. On y donnait encore
quelques concerts. Ce thème du Kiosque à musique,
Dufy l'affectionnait et il l'a repris à Perpignan,
où il conduit ce thème à son aboutissement.
Cela donnera le célèbre tableau Le Dimanche
de 1943, recomposition de plusieurs éléments des
paysages qui ont marqué Dufy : le kiosque à
musique (est-ce celui d'Hyères, ou celui de Perpignan, ou
un mélange des deux ?), est transporté sur des
champs du plateau de Langres sous un ciel de Normandie. Le
musée Hyacinthe Rigaud en possède une étude
à l'huile, et un dessin préparatoire.
Tous ces thèmes, Dufy les traite dans son atelier. Il se
contente de prendre quelques croquis sur le vif, quand son
état physique le lui permet ; il rajoute ensuite des
détails au tableau qui l'attend sur son chevalet. Le
mouvement d'un personnage, la couleur d'une robe, la silhouette
d'un musicien, la ligne d'un instrument. L'atelier est toujours,
pour un peintre, le lieu de l'alchimie secrète, où
se font et se défont, dans la solitude et les angoisses
bien souvent, leurs oeuvres. Pour Dufy particulièrement,
l'atelier est ce lieu. Et ce lieu intime, il le
représente, il nous le donne à voir, il nous y
accueille. Sur ses pas, nous découvrons ses
différents ateliers à Perpignan. Par
discrétion pour ses hôtes, il n'a pas
représenté le salon des Nicolau transformé
en atelier, mais l'atelier dit «Atelier Rue Jeanne
d'Arc», chez les Sauvy, avec ses grands carreaux, sa table
de style catalan, la vue sur le Centro Espanol, et la
copie en plâtre de la Frileuse de Houdon. Ce
plâtre restait un peu mystérieux pour Dora
Pérez-Tibi lorsqu'elle préparait son livre sur
Dufy. Et puis, un jour, elle rencontre Bernard Nicolau et les
siens : Dora garde le souvenir ému de l'accueil
reçu chez eux, et de sa joie, lorsque Bernard Nicolau la
conduit dans son petit coin de bricolage, (un chirurgien, cela a
des doigts habiles et minutieux !) pour lui faire voir un objet
à quoi il tient, et qu'il est en train de restaurer.
Dora, médusée, se trouve face... à la copie
de la Frileuse qu'elle tenait pour disparue ! Nous
n'avons pas pu savoir ce qu'est devenu le torse à
l'antique qui est sur l'Atelier dit au Torse de 1946,
conservé au Musée d'Art Moderne de la Ville de
Paris, et qui est un don de Berthe Reysz. Toujours est-il que la
table sur lequel il est posé est bien de style catalan
!
Installé au numéro 2 de la rue de l'Ange, Dufy
trouve un atelier spacieux dont les fenêtres donnent sur
la Place Arago. Entre les deux fenêtres, une console de
style Louis XV, surmontée d'une glace. Par les
fenêtres, on voit les maisons et les arbres de la place.
Le sol est carrelé de tomettes rouges. Une
méridienne est là. Dans l'Atelier
conservé au musée du Havre, un modèle pose
sur cette méridienne. Sur le chevalet, la toile à
laquelle travaille Dufy est une des études du Cargo
Noir : elle est entourée des dessins
préparatoires.
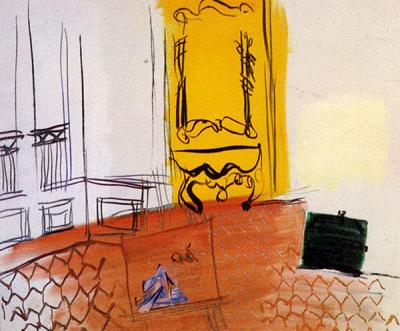
L'atelier place Arago, huile sur toile, circa
1942
|
L'atelier à Perpignan, conservé au
musée Rigaud, met l'accent sur les instruments du
métier de peintre : carton à dessins, Vie
Silencieuse oubliée sur une table, et
l'omniprésence de la console jaune, qui illumine l'espace
de l'atelier.
Dès 1946, le thème du Cargo Noir,
déjà abordé en 1925, revient dans les
tableaux de Dufy. Il le situe dans la baie de Sainte Adresse,
encore encombrée par les blocs de béton qu'on y
avait mis pendant la guerre. Il est soit cerné de blanc,
soit cerné de vert, soit noir comme dans celui de
Perpignan, soit sur un fond plus clair, soit encore, comme dans
celui du musée de Sète, blanc (c'est le fond de la
toile qui est laissé vierge) comme s'avançant sous
un violent projecteur qui laisserait dans l'ombre (bleu et vert
foncés) les quais du port. Le noir de ce cargo est pour
Dufy la couleur qui symbolise le mieux l'éblouissement du
soleil au zénith. Est-ce aussi l'éblouissement du
soleil catalan ? Celui du soleil sur cette place Arago où
les palmiers et les magnolias récemment plantés,
en 1946, ne font pas la belle ombre que nous connaissons ?
Il était à Perpignan un lieu magique,
animé par une sorte de génie bienfaisant : c'est
le Mas de Sant Vicens, au temps où Firmin Bauby en
était l'âme. Firmin Bauby avait restauré
cette propriété de sa famille, en avait fait un
lieu enchanteur où le maître de maison ne quittait
son four de céramiste que pour recevoir ses hôtes
avec une courtoisie, un raffinement que nous ne pouvons oublier.
Céramiste, nous l'avons dit : il mettait son four, ses
ateliers à la disposition des artistes. Sant Vicens,
grâce à Firmin Bauby, dès les années
40 était synonyme de talent. Lurçat, Picart
Ledoux, Perrot y ont rénové l'art de la
tapisserie. Dès 1941, Dufy, sur les conseils de
Lurçat, rencontré chez Pierre Nicolau, fait des
cartons de tapisserie. Il réalisera Le Bel
Eté et Collioure. Ces tapisseries ont
été tissées dans les ateliers Tabard,
à Aubusson. Plus tard, en 1948, il fera des cartons de
tapisserie pour la galerie Louis Carré. Bernard Nicolau
était très fier d'avoir pu «aider»
Dufy lorsqu'il faisait les cartons de ces tapisseries :
«Je me souviens d'avoir aidé Dufy dans la
préparation d'un carton de tapisserie. C'était
à Vernet-les-Bains et Dufy inscrivait le numéro de
référence des couleurs sur le grand papier kraft
où il avait dessiné son projet. Je lui faisais
passer les échantillons de laine, et il en notait la
référence». Bernard Nicolau se souvient
d'une lettre où Dufy dit son plaisir d'avoir
retrouvé, mieux qu'il ne pensait, une tapisserie
conçue à Perpignan.
Quand Dufy a recommencé à faire des
céramiques, c'est bien à Perpignan, mais non avec
Firmin Bauby. C'est Jean-Jacques Prolongeau qui lui prête
son four. Ils font ensemble, en particulier, une très
belle série de carreaux, décorés de
baigneuses. Jean-Jacques Prolongeau est à ce
moment-là professeur à l'école des
Beaux-Arts de Perpignan, il en deviendra le Directeur, avant
d'aller diriger l'école des Beaux-Arts de Limoges,
où il pourra mieux mettre en valeur son talent de
céramiste.
Dora Pérez-Tibi fait bien remarquer que Dufy, tout au
long de sa carrière, n'a pas fait de différence
avec la peinture et les arts décoratifs, pratiquant l'une
et les autres sans qu'il y ait pour lui une activité
mineure. Avec la complicité du céramiste catalan
Llorens Artigas, avec qui il travaille depuis les années
20, il a grandement contribué à rénover
l'art de la céramique, comme le fera Picasso plus tard
à Vallauris. Il a réalisé en particulier de
merveilleux jardins japonais, mais aussi de grands vases
somptueusement décorés de coquillages ou de motifs
végétaux. Il n'a pas dédaigné de
faire des cartons pour des décors de tissus, et sa
collaboration avec les couturiers Paul Poiré et
Bianchini-Férier a toujours été fructueuse.
Dans ses années perpignanaises, c'est cependant avec le
seul Jean-Jacques Prolongeau qu'il a travaillé la
céramique : sans doute par commodité et
amitié pour un artiste installé à
Perpignan.
On peut aussi se demander quelles ont été ses
relations réelles avec les Perpignanais en
général, et les artistes catalans en particulier,
et si Perpignan et sa région ont été des
sujets à part entière dans ses peintures et ses
dessins.
Naturellement, le docteur Pierre Nicolau, sa femme Yvonne,
leurs enfants, Jacques, Simone, Colette et Bernard ont introduit
Dufy dans leur cercle familial, amical, médical, puis
dans celui des grands bourgeois et des personnes qui, à
cette époque là, manifestaient un grand
intérêt pour les «choses de
l'art».
Bernard Nicolau se plaisait à rappeler combien Dufy
«faisait partie de la famille», et combien il
partageait la vie de ses hôtes. Pierre Nicolau mettait
à la disposition de Dufy sa demeure de Vernet-les-Bains,
pour qu'il puisse profiter des soins thermaux. Située en
Conflent, au pied du Canigou, (tout près de la
propriété occupée au début du
siècle par George-Daniel de Monfreid), la ville de Vernet
jouit d'un climat vivifiant surtout appréciable
l'été, lorsque la touffeur de Perpignan est
oppressante. Dufy s'y réfugie donc avec ses amis : nous
retrouvons Vernet dans de nombreuses aquarelles ou dessins,
conservés au musée d'Art Moderne de la Ville de
Paris, donnés par Berthe Reysz : le château, le
jardin d'hiver des Nicolau au beau salon en rotin, une vue de la
ville haute datée par Dufy de 1941, et
dédicacée à Yvonne Nicolau.
Collioure donne son nom à une tapisserie : il ne s'agit
pas d'une représentation de Collioure, nulle part on n'y
peut trouver un quelconque élément qui rappelle le
petit port. Seule la blondeur de la lumière... Quelques
aquarelles représentant Collioure sont aussi connues,
dont une (dans une collection privée), porte un joli
texte de Dufy : «Collioure sans barques est un ciel sans
étoiles». Le musée Rigaud possède
aussi une belle aquarelle représentant Collioure. Il
s'agit d'une dédicace au peintre Willy Mucha, à
qui Dufy avait offert le livre que le critique d'art Pierre
Courthion venait de lui consacrer.
Le musée d'art moderne de la Ville de Paris
possède deux dessins dont nous avons pu identifier le
sujet avec précision : il s'agit pour l'un, d'un paysage
des Pyrénées-Orientales, peint
précisément depuis la propriété que
les Sauvy avaient au Boulou. De la même façon, le
dessin nommé La grille du jardin du musée
d'art moderne de la Ville de Paris, est en fait la porte
d'entrée du domaine de l'Esparrou, à Canet Plage,
construit au début du siècle par l'architecte
danois Petersen, pour la famille Sauvy qui l'occupe toujours, et
où Dufy était reçu
régulièrement... Le «jardin»
était un parc de plusieurs hectares ! L'alignement des
ceps de vignes qui se déroulent sur tout le paysage va
être aussi le sujet de nombreux croquis, avec, en marge,
le dessin d'une ou deux feuilles de vigne, ainsi que des plates
bandes et des platanes du parc que les Perpignanais appellent
modestement «le square».
Les relations avec les Sauvy ont toujours été
cordiales et amicales. Joseph Sauvy, après avoir
accueilli Dufy dans un studio rue Jeanne d'Arc (anciennement rue
de la Poste), lui a loué le bel appartement qu'il
occupait rue de l'Ange, et dont les fenêtres donnaient sur
la Place Arago.
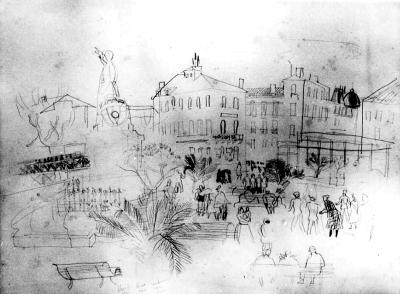
Place Arago, dessin, circa 1942
|
Cette place Arago, pleine de vie, de mouvements, occupée en son centre par un café, le Palmarium, point de rassemblement festif de tous les Perpignanais, est le sujet de très nombreux dessins faits par Dufy depuis ses fenêtres. La place elle-même, avec la statue de bronze d'Arago au centre, les maisons qui la bordent et, au fond celle où habite Ludovic Massé dont Dufy dessine la rangée de fenêtres ; mais aussi palmiers et magnolias, de toute petite taille, qui ne cachent en rien tout ce qui se passe sur la place. La sardane et son orchestre, la cobla, ont fasciné Dufy. Il en a laissé des croquis alertes, vifs, des aquarelles légères, où une simple petite touche colorée suffit à indiquer un personnage, les masques du carnaval. Ces dessins sont cependant de la plus grande précision en ce qui concerne les instruments de musique : il note, nous l'avons vu, le nom des instruments en catalan.

Sardane place Arago, dessin, circa 1942
|
Lorsque les personnages de carnaval sont traités à
la seule mine de plomb, il prend la peine de noter la couleur
des vêtements pour pouvoir ensuite en faire des aquarelles
ou des gouaches : violet, rouge, jaune...
C'est tout un peuple en liesse qui se retrouve sous les
fenêtre d'un peintre qui, tout au long de sa vie,
même immobilisé par les douleurs, chante la joie de
vivre. Nous sommes alors bien loin des rendez-vous mondains des
régates ou des courses à Dauville que Dufy a
célébrés dans ce qui semble avoir
été une autre vie.
Il avait profité de ces séjours à Caldas
de Montbuy, pour aller à Tolède et assister
à une corrida, dont il ramène des peintures. Il
jure bien qu'il ne pourra plus voir de corridas à
Céret ou à Collioure après celle-là
! Ce qui ne l'empêche pas d'y retourner, et d'en parler
à Ludovic Massé le 28 août 1946. A
Collioure, il va naturellement chez René et Pauline Pous,
à l'Auberge des Templiers, chez ce couple qui a toujours
aimé les artistes, les accueillis et aidés avec
chaleur et amitié. Il y rencontre le peintre Willy
Mucha.
La maladie de Dufy a été suivie avec la plus
grande attention par ses amis médecins : Pierre Nicolau
et René Puig. Tous deux ont tenté sur lui un
traitement aux sel d'or, traitement novateur qui l'a
soulagé, mais qui n'était pas admis par la
communauté médicale internationale (Il faut
attendre 1973 pour que les Américains reconnaissent son
efficacité et sa relative inocuité !) Bernard
Nicolau remarque : «Après des soins aux sels d'or
(remède alors utilisé pour ce type de rhumatisme)
Dufy, en quelques semaines, put mieux se mouvoir».
Sur les conseils de ces deux amis, il va faire des cures
à à Caldas de Montbuy, à
Thuès-les-Bains (Conflent). «Je vais partir samedi
à Thuès-les-Bains : j'espère que je vais
m'améliorer à l'aide de ces célèbres
eaux sulfureuses, et que je pourrai, en revenant, arpenter les
rue de Perpignan la canne à la main (allusion au fauteuil
roulant grâce auquel il se déplaçait) : pour
danser la sardane, je crois que ce sera plus long !»
(Lettre à Ludovic Massé du 28 août 1946). Il
fait des séjours à Font Romeu où il
rencontre un ostéopathe qui lui fait grand bien : il
l'écrit à Ludovic Massé, le 4 août
1947. Il fait une autre cure à Amélie-les-Bains
(Vallespir), et dans une lettre non datée, sans doute de
mai 1948, Dufy parle à Ludovic Massé de la
beauté du pays et de l'agrément que lui donne la
compagnie des Courthion. En effet, Pierre Courthion et sa femme
sont venus rendre visite à Dufy à Amélie,
ils ont séjourné à l'hôtel Pujades.
Berthe Reysz avait tout organisé. Courthion garde un
souvenir attendri de cette visite, et rend un hommage
sincère à Berthe Reysze : «Berthe Reysz
était ... entièrement dévouée au
peintre dont elle tenait le ménage lorsque, seul, il dut
affronter une maladie redoutable.... C'est elle qui, en plus des
soins corporels dont il avait besoin, dosait et lui faisait
prendre les médicaments prescrits, elle qui, du matin au
soir, le servait avec abnégation....Je la revis à
Perpignan, en mai 1948, quand elle était avec Dufy dans
l'appartement au sol carrelé de rouge qu'il a peint
souvent et qui donnait sur la place Arago. Dufy peignait alors
la série du Violon Rouge et de son Cargo
Noir... (Il) nous fit découvrir les sardanes que l'on
dansait au son aigu de la ténora devant le
Café de France (place de la Loge) : vous verrez, nous
avait-il dit, c'est presque aussi, beau que Bach !... Nous
partons, nous dit Berthe Reysz un matin. Nous allons tous
à Amélie-les-Bains, dans la vallée du Tech,
où Dufy fera sa cure. Elle avait tout
préparé. L'hôtel des Thermes Pujades
était là-bas, une sorte de palace à
galeries et dépendances 1900, avec de grands halls
vitrés, de vastes chambres, plusieurs salons, nous
mettions une demie heure pour aller de nos chambres à la
salle à manger. Je revois Dufy marcher devant nous sur
ses béquilles...»
Ses amis catalans ont tous suivi avec angoisse les
progrès de la maladie de Dufy, surtout, naturellement,
les docteurs Nicolau et Puig. Ils ont tous deux très vite
diagnostiqué une polyarthrite, et l'ont soigné aux
sels d'or, comme nous l'avons dit, ce qui avait
amélioré son état, au point que Dufy avait
pu faire l'ascension du Canigou, en 1942 avec les Nicolau.
Cependant, Dufy souffre de nombreuses rechutes en 1941 et 1942,
malgré une hospitalisation à Montpellier, à
la Clinique des Violettes, où exerçait le
père du Dr Viard, pour qui Dufy avait travaillé,
à Paris, à la réalisation d'un grande
fresque murale pour sa salle à manger. Marie Viard, sa
fille, se souvient que le Dr Viard de Montpellier avait
autorisé Dufy à faire des croquis de salles
d'opération ou d'interventions chirurgicales dans cette
même clinique. Elle rappelle la gentillesse de Dufy qui
lui prodiguait des conseils pour qu'elle se perfectionne en
peinture. Dufy qui ne se plaint jamais, avait appris à
peindre des deux mains : lorsque la douleur devenait trop forte
à la main droite, il peignait de la main gauche ; dans
son atelier, comme le dit joliment le Dr Puig «le tube
d'aspirine voisinait avec la palette, les crayons et les
pinceaux».
Lors de la préparation du premier festival P. Casals de
Prades, dans les salons du Dr Puig, un photographe
américain de la revue Life vint rencontrer le
violoncelliste. Il demanda aussi à voir Dufy, alors
à Caldas de Montbuy, et publia une photo où on le
voit dessiner de la main gauche. Cette photo est tombée
sous les yeux d'un médecin américain, le
professeur Homburger, qui écrit à Dufy pour lui
proposer un nouveau traitement, encore expérimental dont
on venait de découvrir les effets miraculeux. Dufy
accepte, et part pour Boston au Jewish Memorial Hospital,
où il est admis, dans un état grabataire, le 25
avril 1950. Il y reste jusqu'au 22 juillet. Il partit ensuite en
Arizona se reposer. Ce traitement lui causa un réel
mieux, mais il faut aussi la cause de très nombreuses
complications, bien décrites par le Dr Lamboley. Le 16
juin 1950, Dufy écrit à Ludovic Massé :
«Le traitement de cortisone de l'ACTH est terriblement
fatigant pour moi... Je peux marcher 10 minutes sans cannes ni
béquilles, les articulations sont bien
dégagées mais l'atrophie musculaire est
extrêmement dure à récupérer. Mes
articulations sont plus libres, mais sans muscles pour les tenir
me font comme un pantin désarticulé». Au
printemps 1951, il écrit au Dr Puig : «Ma
santé est assez bonne. J'ai bien
récupéré 90% de mon état
général, et de 60 à 70% de mon état
rhumatismal après tous les incidents et accidents du
traitement cortisone qui est très dur. Je vous promets
que je me souviendrai des trois mois au Jewish Hospital... Avec
un peu d'aspirine et des béquilles je travaille assez
bien».
Lorsqu'il rentre en France, Bernard Nicolau se souvient
«qu'il était bouffi et violacé, et dans un
état de faible résistance». A ce
moment-là il songe à s'installer
définitivement à Perpignan, auprès de tous
ses amis. Mais la marinade qui souffle souvent et
l'humidité dont elle est porteuse, était
très défavorable à sa santé.
Après s'être renseigné auprès du
service de la météorologie nationale pour
connaître l'endroit le plus sec de France, il choisit
Forcalquier, proche de Nice où habite sa femme, et
où il achète un mas qu'il fait restaurer. Il s'y
installe alors que la maison n'est pas encore terminée,
et écrit à ses amis combien ils lui
manquent...
Si l'on en croit Jean-Jacques Prolongeau, les relations de Dufy
avec les peintres du Roussillon ont été à
peu près inexistantes. Le musée des Beaux-Arts de
la ville, qui ne porte pas encore le nom de musée
Hyacinthe Rigaud, n'a acheté aucune oeuvre de Dufy, ni
organisé d'exposition de lui. Il est vrai que la
période de guerre n'est pas très favorable
à ces manifestations, mais on peut noter que de
nombreuses peintures d'artistes roussillonnais ont
été achetées à cette époque.
Que s'est-il donc passé ? Le prix des oeuvres de Dufy
était certainement plus élevé que celui des
oeuvres des peintres locaux. Nous ne pensons pas que ce soit une
raison suffisante. Lorsque Picasso a séjourné
à Perpignan de 1954 à 1956, les temps
étaient plus favorables puisque le musée
était refait entièrement. La ville n'a cependant
acheté (ou tenté d'acheter !) aucune oeuvre de
Picasso ! En ce qui concerne Dufy comme en ce qui concerne
Picasso, il n'y a même pas eu la moindre réception
officielle à l'Hôtel de Ville. Pas le moindre geste
pour reconnaître son talent et l'honneur qu'il faisait
à Perpignan en s'y installant. L'USAP, l'équipe de
rugby locale a été plus honorée par la
ville ! Prolongeau pensait à une sorte de jalousie de la
part des artistes locaux, et racontait une anecdote à ce
sujet : les artistes locaux se réunissaient
régulièrement à l'occasion de repas, mais
n'ont jamais invité Dufy à se joindre à
eux. Une année cependant, Dufy a manifesté le
désir de se joindre à eux à l'occasion d'un
repas, et on a accédé à son désir.
Le jour venu, Dufy n'est pas venu au repas, mais l'a offert
à tous ceux qui étaient là...
Que faut-il réellement penser de la façon dont
Dufy a été accueilli par ces artistes ? Au
même moment, en effet, le peintre Martin Vivès, qui
n'est pas encore le conservateur du musée, note dans un
de ses carnets, qu'il a porté des pommes de terre
à Dufy...
Dufy a-t-il rencontré Jean Cocteau, Jean Marais et
Charles Trenet chez les Nicolau ? C'est probable, même
s'il n'en parle pas. En effet pendant les dernières
années de la guerre, Cocteau, rejoint par Jean Marais
dès sa démobilisation, était
hébergé chez le Dr Pierre Nicolau, et Charles
Trenet venait leur rendre visite. Il a dû continuer
à voir le peintre Pierre Brune, soit chez les Nicolau
dont il était un familier, soir chez M. et Mme de Lazerme
qui recevaient aussi Cocteau, et des critiques d'art ou
galeristes, comme les Leiris.
Dufy a beaucoup vu Maillol, puisque ce dernier était un
grand ami des Nicolau. Bernard nous disait un jour que Maillol
avec ses yeux bleus et sa grande barbe était comme le
Père Noël pour les enfants Nicolau. On sait que le
Dr Pierre Nicolau conduisait souvent Dufy à Banyuls voir
Maillol, ou Maillol à Vernet ou Perpignan pour voir Dufy.
Le 15 septembre 1944, le Dr Pierre Nicolau rencontre Maillol en
ville, triste et désemparé : son fils a
été arrêté par les Allemands et
emprisonné à la Citadelle de Perpignan (le Palais
des Rois de Majorque). Pour le distraire, le Dr Nicolau lui
propose de l'emmener à Vernet-les-Bains où se
trouve Dufy. On sait la suite : le pneu qui éclate, la
voiture qui fait une embardée ; Maillol souffrant d'une
fracture de la mâchoire, est hospitalisé à
la Clinique des Platanes, où il est bien soigné et
se rétablit. Il est ramené chez lui, et il meurt
à Banyuls le 27 septembre 1944 à cause de
complications médicales. (Entre temps, son fils avait
été libéré).
Les relations de Dufy avec l'écrivain Ludovic
Massé sont bien connues à travers la
correspondance qu'ils n'ont jamais cessé
d'échanger, du 13 août 1946 au 24 février
1953. Ils se sont écrit en amis attentionnés,
partageant leurs joies et leurs peines familiales, leurs joies
et leurs doutes en tant que créateurs, parlent des
personnes qu'ils ont vues (les Dorgelès, F. Bauby, le
peintre de Collioure Willy Mucha ..), donnent librement leurs
sentiments sur le travail artistique des uns et des autres. On y
sent toujours pour Dufy un profond attachement pour le
Roussillon et ses habitants.
C'est d'ailleurs dans l'une des lettres de Dufy à
Ludovic Massé, datée du 11 décembre 1952,
postée de Forcalquier, que le peintre explique ce qu'il
doit à ce pays :
«J'ai pris une exacte connaissance de moi-même, je
suis plus tranquille... Je continue à développer
... tout ce qui découle du violon rouge et du cargo noir,
les orchestres sont plus sonores, plus grandioses... J'ai repris
aquarelles et petites peintures de l'atelier de Perpignan, avec
la console jaune et les mallons (sic) rouges, et je suis
arrivé à une synthèse très exacte
avec ces sujets du caractère de la lumière de
Perpignan. De sorte que cet intérieur que vous avez connu
de la Place Arago contient pour moi tout le Roussillon, avec ses
montagnes, ses vignobles et ses rochers et j'ai, avec tous ces
travaux faits à Perpignan, la même
révélation que Matisse à
Collioure...»
Dufy est malade, cette lettre est dictée, elle est
dactylographiée...
Dufy meurt à Forcalquier le 23 mars 1953.
© Marie-Claude Valaison, Conservateur en Chef du
Patrimoine, Musée des Beaux-Arts Hyacinthe Rigaud, et
Musée des Monnaies et Médailles J. Puig
Perpignan, novembre 2002
Mise en ligne sur Méditerranées le 16/03/2007