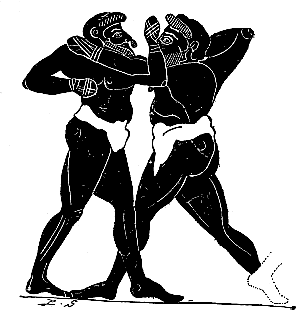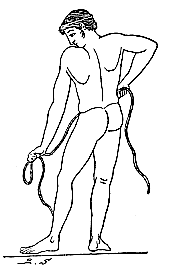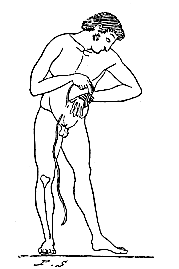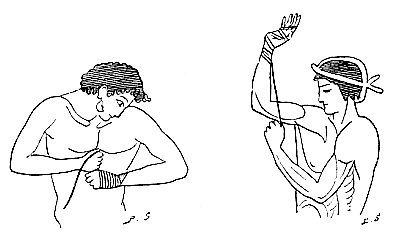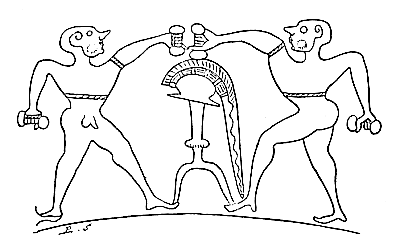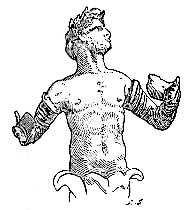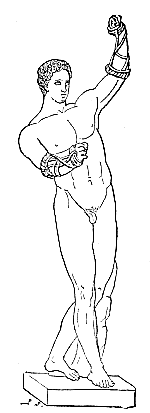(Pugmê, pugmachiê, puktosunê)
Lutte à coups de poing (de pugmê, poing, comme pugilatus vient de pugnus), pux paiein, lutter à coups de poing, pugmachos, puktês, pugiliste. - La boxe, - car la pugmê n'est, au fond, pas autre chose, - faisait, chez les Grecs, partie de tous les concours athlétiques et les origines légendaires n'en étaient pas moins illustres que celles des autres jeux. Thésée passait pour l'avoir inventée et Héraclès pour l'avoir apprise d'Harpalycos, le fils d'Hermès. La lutte du Dioscure Pollux contre Amycos, roi des Bébryces, est l'un des épisodes connus de la fable des Argonautes, et Virgile a pu s'en souvenir lorsqu'il a mis aux prises Dares et Entellus, l'élève d'Eryx. Tydée, Epeios, Alkidamas étaient d'autres pugilistes célèbres et Apollon lui-même avait lutté à Olympie contre Arès : on le connaissait comme pugmaios et il recevait à Delphes des sacrifices en qualité de dieu boxeur, puktês.
- Les pugilistes combattaient nus, mais il n'en avait pas toujours été ainsi et les anciens gardaient le souvenir des luttes légendaires où les agonistes se ceignaient pour boxer.Au Ve siècle les Ioniens en agissaient encore ainsi, et il ne manque pas de représentations de pugilistes, sur lesquelles on distingue nettement une sorte de caleçon ou de pagne (perizôma), mais le fait est toujours resté, en Grèce, à l'état d'exception. De même, il semble logique que les premiers concurrents aient combattu avec les poings nus et les peintures de vases d'ancien style nous en offrent de nombreux exemples, mais qui ne sont pas tous également probants, car les silhouettes des poteries à figures noires sont souvent trop rapidement tracées pour laisser distinguer ce point de détail et, même lorsque la représentation est certaine, on peut se demander si ce sont bien des boxeurs qu'elle met en scène, car, comme nous le verrons tout à l'heure, le pancrace, qui tient à la fois de la lutte et du pugilat, ne diffère de ce dernier que par l'usage exclusif des poings nus. De fait, Amycos passait pour avoir inventé le ceste et, dès les temps légendaires, les Grecs avaient imaginé d'entourer de courroies ou d'un gantelet de forme spéciale les poings des pugilistes. Ils y gagnaient soit d'adoucir le coup, soit de lui prêter, au contraire, une force plus redoutable.
| Dans sa forme la plus ancienne le ceste consistait simplement en lanières enlacées et enroulées autour de la main et de l'avant-bras, imantes, meilichai, speirai. C'était ce que l'on appelait le ceste doux, malakôteros. La courroie était faite de cuir de boeuf, plus ou moins tanné et sa longueur était considérable. Jüthner l'évalue à 1 m. 50 environ, mais, si l'on en juge par comparaison avec la taille des personnages qui la tiennent en main, il n'est pas impossible qu'elle ait parfois dépassé ce chiffre. Les éphèbes, dans les représentations agonistiques, portent souvent soit, d'une main, soit des deux mains, des sortes de filets : il faut y voir des cestes encore enroulés et noués à leur extrémité. L'agoniste, qui est sur le point d'armer ses bras, tient des deux mains les deux bouts d'une même corde et semble la mesurer ; il en cherche simplement le milieu, qu'il était nécessaire de trouver pour bien ajuster le ceste. Pour y réussir, aucune aide étrangère n'était nécessaire et l'athlète procédait seul. Philostrate nous enseigne que les quatre doigts étaient serrés par les lanières qui les maintenaient, tout en permettant au poing de se fermer ; le pouce était quelquefois pris dans l'entrelacs, mais toujours indépendamment des autres doigts et les courroies, qui pouvaient être doubles ou triples, se croisaient en haut du bras pour ne s'arrêter quelquefois qu'au-dessus du coude. | 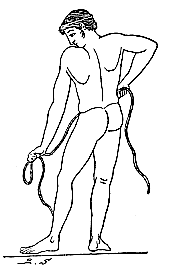 |
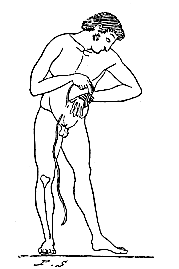 |
Les différentes phases de l'opération sont représentées sur les vases ; on y voit avec quel soin le pugiliste resserrait les imantes et s'assurait de leur ajustement ; une peinture nous le montre même tirant une dernière fois les lanières avant de mettre au ceste le noeud final.Ainsi armé, l'agoniste pouvait, à volonté, étendre les mains ou fermer les poings pour frapper. L'agencement était ingénieux et n'avait d'autre tort que de protéger la défense plutôt que d'aider à l'attaque. Il semble que la mode n'en ait pas survécu au Ve siècle, mais Jüthner remarque avec raison qu'on continua de l'employer dans les palestres. Il fallait pour les concours publics d'autres armes et qui fussent plus meurtrières.
Une amphore panathénaïque du British Museum, datée de l'archonte Pythodelos (336 av. JC.), montre qu'à ce moment du IVe siècle, et sans doute dès avant cette date, un autre ceste commentait d'être en usage. Celui-ci est singulièrement plus terrible. Hülsen et Jüthner en ont tour à tour étudié l'agencement, qui nous est, rendu plus clair par un certain nombre de représentations bien conservées. Les monuments les plus intéressants à cet égard sont la statue de pugiliste du Musée des Thermes, celle qui a été trouvée à Sorrente, une autre, imparfaitement conservée, découverte à Herculanum, enfin un bras recueilli à Vérone, dans l'amphithéâtre. D'après leur témoignage, cette variété de ceste se composait de deux pièces, un gantelet et un large anneau de cuir.Le gant était très long et allait depuis l'avant-bras jusqu'aux doigts qui n'étaient jamais couverts jusqu'au bout, l'extrémite en restant toujours libre ; il devait être épais et s'ouvrait sur la paume où la piqûre du cuir sur les bords est parfois très visible ; un fourreau de laine frisée pouvait en assurer l'adhérence et en doubler en même temps l'épaisseur et il va sans dire que des courroies serrées très fortement le fixaient au poignet et à l'avant-bras. Le second élément consistait en un large anneau cylindrique (strophion), haut de deux doigts environ et qui était formé de deux à cinq épaisseurs de cuir, dont les tranches étaient solidement reliées par des lanières transversales. Cet anneau venait coiffer les quatre doigts à leur naissance, de telle manière qu'ils pussent se fermer par-dessus le gantelet et que le pouce restât toujours libre, un système compliqué de liens assurant l'adhérence des deux pièces entre elles et la bonne mise en place du ceste. Celui-ci était une arme terrible et on s'explique, à en étudier le mécanisme, que Damoxenos ait pu arracher de ses doigts les entrailles de son adversaire et le tuer d'un seul coup. Le ceste qui est figuré sur l'amphore panathénaïque de Pythodelos paraît moins compliqué et les effets en étaient sans doute moins redoutables. Il semble se composer simplement de lanières et d'un gant de peau, sans l'adjonction d'un anneau distinct, ou strophion que remplace ici le redoublement des courroies autour des premières phalanges. Le type parait plus primitif, mais Jüthner remarque avec raison que le pugiliste de Sorrente est du IVe siècle : il semble donc qu'on ait employé concurremment l'une et l'autre forme, car les exemples du ceste panathénaïque ne sont pas rares à cette époque. Une question plus difficile est de savoir le nom qu'il faut donner à ces variétés. Les auteurs parlent de l'imas oxus comme spécialement redoutable et, d'autre part, Platon employant le terme de sphairai pour désigner un ceste différent des imantes et quelque peu moins dangereux, Jüthner suppose que l'imas oxus est l'arme portée par le pugiliste des Thermes et que les sphairai sont représentées au contraire sur les amphores panathénaïques. Il est possible, mais le mot de boule (sphaira) s'applique assez mal à la seconde espèce. Je l'entends plutôt de ces gantelets rembourrés, pareils à nos gants d'escrime, que tiennent souvent les figurines en terre cuite.
Il y avait d'autres cestes encore. Sur la situle de Watsch, les pugilistes sont armés de courts bâtons transversaux, sorte d'haltères qui devaient être fixées par des courroies.
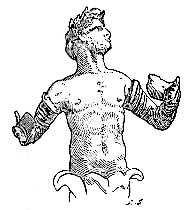
| Ailleurs, surtout en Italie, une masse ou des clous de plomb renforçaient le gant de boxe. Un quadruple anneau de bronze, orné de pointes redoutables, pouvait de même serrer les doigts. Enfin Jüthner a cru reconnaître sur un certain nombre de monuments un ceste métallique, dont l'agencement est peu clair. Il semble se composer d'un cylindre creux qui serait tenu par une poignée et qui protégerait à la fois les doigts et le dos de la main ; les doigts pouvaient revenir par-dessus le bord, et les coups assénés à l'aide de cette masse métallique devaient être redoutables. C'est pour les parer que les athlètes faisaient parfois usage de couvre-oreilles, amphôtides : il va sans dire que ce préservatif ne pouvait servir dans les jeux publics et n'était réservé qu'aux gymnases et aux palestres. Quant au cirrus, toupet de cheveux qui se dressait sur le crâne en partie rasé, il n'était pas spécial aux pugilistes et seuls les pancratiastes pouvaient trouver quelque avantage à cette coiffure ; la mode paraît d'ailleurs d'époque romaine.
|
- Les qualités requises du pugiliste étaient multiples. L'endurance ne lui était pas moins nécessaire pour supporter la chaleur que pour soutenir la force des coups, car les concours publics avaient lieu le plus souvent, comme à Olympie, dans le fort de l'été et le pugilat prenait place l'après-midi pendant les heures les plus chaudes et se prolongeait parfois jusqu'à la nuit, alors que l'ardeur de la canicule incommodait jusqu'aux simples spectateurs ; elle passait pour avoir hâté la fin de Thalès de Milet. Quant aux blessures causées par les cestes, on s'imagine sans peine combien elles étaient redoutables et nous verrons qu'elles pouvaient donner la mort. Pour attaquer, le pugiliste devait avoir un bras vigoureux, capable de renverser d'un seul coup l'adversaire et qui frappait comme un marteau : la détente soudaine des muscles était accompagnée d'une sorte d'ahan et elle pouvait être si violente que, si l'adversaire échappait par un bond de côté, l'athlète était renversé par son propre élan. L'adresse n'était pas, en effet, moins nécessaire que la force. En rentrant la tête et en se servant à propos du bras libre pour parer, on pouvait éviter les coups ou, du moins, n'exposer que les parties les moins vulnérables. Certains réussissaient, en opposant à toutes les attaques leurs bras tendus en avant, à lasser leur adversaire ; ils remportaient ainsi la victoire sans avoir reçu de blessure grave et ils s'en faisaient gloire à juste titre. D'autres ménageaient leurs forces et ne répondaient pas aux premiers assauts, laissant l'antagoniste s'épuiser en vains efforts. Mais le dernier mot restait, le plus souvent à la vigueur physique, car, lorsque les coups se succédaient sans relâche et frappaient l'air comme des rames battant l'eau, la présence d'esprit abandonnait les plus résolus et le vainqueur était celui dont le corps était le plus robuste et le plus endurci.
- Dans ces concours publics une loi réglait les conditions de la lutte. Qu'elle fût dictée par le désir de rendre plus humain ce combat que les anciens eux-mêmes qualifiaient de terrible, ou qu'elle fût inspirée par la simple nécessité d'éviter les contestations, toujours est-il qu'elle intervint assez tôt dans les grands jeux. Onomastos de Smyrne, vainqueur à la 23e Olympiade, passait pour avoir codifié les conditions du combat et Pythagoras de Samos, victorieux dans la 48e Olympiade, aurait, le premier, lutté selon les règles. Il va sans dire que nous connaissons assez mal ces ordonnances primitives, dont la teneur a dû varier dans le détail. Du moins en savons-nous quelques points essentiels. La première règle, celle qui constituait l'essence même du pugilat, portait que les corps à corps étaient interdits ; l'emploi simultané de la lutte et des cestes n'a jamais été admis par les Grecs et les lutteurs du pancrace qui, comme nous le verrons, pouvaient se prendre à bras le corps, ne se frappaient que des poings nus. Une seconde disposition, dont l'application devait être plus délicate, réglait que les agonistes ne pouvaient, intentionnellement du moins, se donner la mort. Lorsque la fraude était manifeste, les agonothètes condamnaient les délinquants et les chassaient hors du stade, en leur refusant la victoire qu'ils accordaient à leurs victimes. La peine est toute morale et nous semble légère ; elle suffisait cependant, car, s'il faut en croire un singulier récit de Pausanias, l'un des coupables, Kléomédès d'Astypalée, perdit la raison à la suite d'un pareil traitement. Nous ignorons malheureusement la manière dont était réglé le détail de chaque combat, mais il devait y avoir, dans certains cas, des pauses auxquelles succédaient des reprises de la lutte et il n'est pas impossible que le pugiliste assis du Musée des Thermes se repose après une première passe. Peut-être le son des flûtes réglait-t-il les différentes phases du concours. En tout cas, nous savons que, lorsque l'engagement se prolongeait trop longtemps, on employait, pour décider de la victoire, un moyen radical : chacun des pugilistes devait s'exposer tour à tour aux coups sans les rendre et en les parant seulement avec ses bras étendus. C'est, semble-t-il, ce que l'on appelait le klimax, auquel il est probable qu'on n'avait pas souvent recours.
- Les représentations figurées permettent de reconstituer certaines des phases de la lutte.
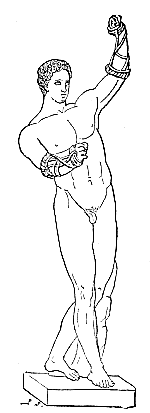
| L'un des motifs les plus fréquents est antérieur au combat. C'est celui de l'athlète s'entraînant et frappant de ses poings soit le vide, soit un ballon ou une outre gonflée. La ciste Ficoroni, une peinture de vase à figures rouges, une sardoine de Berlin, et un torse du même Musée donnent des exemples de skiomachia. L'akrocheirismos, où les agonistes ne se servaient que du bout des doigts, était de même une sorte de préparation à la lutte. Pour les concours, le premier point était de s'assurer une bonne mise en garde, mais il ne semble pas qu'il y eût des règles sur ce point, et chacun des agonistes devait avoir une tactique qui lui était propre. Un petit bronze polyclétéen, trouvé sur l'Acropole, montre un boxeur debout sur la jambe droite, l'avant-bras droit ramené devant le corps et le poing gauche levé. Le poing droit est à demi brandi et la position semble meilleure dans une statue de Cassel dont nous connaissons au moins une réplique. Les gestes sont inversés dans un marbre aujourd'hui perdu et que nous ne connaissons que par les moulages. L'on peut citer encore une statue du Louvre, où les gestes sont tout autrement vifs et rapides et que l'on attribue, sans raisons bien précises, à Pythagoras de Rhegium. |
Une fois aux prises, les pugilistes ont d'ordinaire le bras gauche allongé pour parer et le poing droit ramené en arrière pour frapper avec plus de force. Souvent un trépied sépare les deux combattants et indique le prix du combat, mais les silhouettes des agonistes diffèrent peu entre elles ; seuls les avant-bras sont plus ou moins levés et parfois se croisent à demi. Ils s'entrelacent tout à fait sur un stamnos à figures noires du Cabinet des Médailles, où l'engagement est devenu plus vif. D'autres fois le bras droit est tendu en avant pour frapper, et c'était sans doute pour le faire de plus loin et avec plus de force que certains pugilistes se tenaient sur la pointe des pieds. Les monuments sont, sur ce point, tout à fait d'accord avec les textes, mais il va sans dire que la pratique n'était pas générale et que beaucoup préféraient avoir les pieds bien d'aplomb et les jambes écartées. Les mouvements des deux bras étaient souvent parallèles, soit qu'ils fussent également levés ou tendus de même en avant. Il est souvent difficile, en pareil cas, de savoir si l'athlète se défend ou, au contraire, s'il attaque de ses deux poings. Pourtant l'alternative n'est pas douteuse sur certains monuments et un boxeur dessiné par Clarac est certainement dans le second cas, tandis que l'agoniste de Chiusi reste évidemment sur la défensive. Il est souvent malaisé de déterminer les cas où l'un des boxeurs faiblit et commence d'être vaincu, mais le cas est clair sur une petite coupe inédite du Musée du Louvre où l'on voit en figures noires du VIe siècle deux pugilistes dont l'un, dans l'attitude de la boxe, porte auprès de lui l'inscription pukta (pour pukteuei, il boxe), tandis que l'autre, saignant du nez abondamment, prend la fuite, comme l'indique aussi l'inscription pheuga (pour pheugei, il fuit). Je citerai encore, comme pouvant être interprété ainsi, un fragment de coupe à figures rouges où M. Hartwig reconnaît le style de Douris : un des combattants, saignant du nez, la joue meurtrie, baisse la tête et paraît prêt à abandonner la lutte, tandis que le premier pugiliste s'élance plein d'ardeur. Le doute n'est plus possible, quand l'un des lutteurs tombe en arrière. Sur le revers d'une amphore panathénaïque de Saint-Pétersbourg, le mouvement est à peine commencé. Mais sur un vase semblable au Musée du Louvre, le corps du vaincu s'affaisse et paraît presque horizontal. Ailleurs il a un genou en terre ou est renversé entièrement sur le dos. La défaite n'est pas moins certaine, quand le pugiliste ramène le bras devant la tête et ne songe plus qu'à parer les coups qui pleuvent sur lui. Il paraît bien qu'un pas de plus était nécessaire et qu'il fallait renoncer publiquement à la lutte, apagoreuein. Pour le faire, ou bien on levait simplement l'un des bras ou bien on levait un doigt de la main, de préférence, semble-t-il, l'index.
- Le pancrace, pankration, tenait à, la fois de la pugmê, et de la palê ; il se rapprochait du pugilat par l'emploi des poings fermés, il en différait par l'absence du ceste et par les prises de corps qui, non seulement étaient autorisées, mais sans lesquelles on ne concevait pas cet exercice. D'autre part, les pancratiastes pratiquaient tous les genres de lutte, même la lutte à terre (kulisis, alindêsis), qui n'était pas permise dans la palê, proprement dite. C'est dire que le combat était des plus variés (pammachos agôn) et que l'agoniste devait faire appel à toutes les ressources de son art. La force corporelle n'était guère moins nécessaire qu'au pugiliste, mais la souplesse, l'agilité, la ruse même devaient s'allier à la vigueur physique. Les évolutions du bon agoniste étaient si rapides qu'elles le faisaient ressembler à un homme ivre et la victoire était souvent, non au plus robuste, mais à-celui qui savait le mieux déconcerter l'adversaire. Les effets de la lutte, quoique encore redoutables, étaient moins terribles que dans le pugilat et nous voyons un athlète, avant à subir successivement les deux épreuves, demander à commencer exceptionnellement par le pancrace, afin d'être sûr de se trouver ensuite en état de boxer. Pourtant on pouvait, comme nous le verrons, y tordre les membres, y donner de terribles coups de poings, voire y mordre furieusement l'adversaire. L'épreuve avait lieu ordinairement tard et ne semble pas avoir comporté de conditions spéciales. Les athlètes y étaient frottés d'huile comme pour la lutte et ils devaient avoir la tête rasée ou les cheveux coupés courts, sans qu'ils fussent nécessairement relevés en toupet, comme le cirrus romain. Le pancrace paraît à Olympie dès la 33e Olympiade, mais les enfants n'y auraient, semble-t-il, concouru qu'assez tard (145e Ol.)
- Le pancrace tenant du pugilat et de la lutte, beaucoup des passes qui y étaient employées ont déjà été étudiées, soit à l'article Lucta, soit dans la page qui précède. Quelques représentations méritent cependant d'être relevées et quelques motifs d'être étudiés de plus près. Sur une amphore panathénaïque de Vienne, l'un des agonistes saisit de sa main gauche la jambe levée de son adversaire et s'efforce de le faire tomber, pendant que ce dernier essaie de se dégager par un violent coup de poing. Ailleurs, sur un fragment portant le nom de Léagros, c'est le bras du second boxeur que le protagoniste saisit et paralyse, tandis que, de l'autre main fermée, il va frapper son concurrent désarmé. Un autre athlète, non content d'avoir renversé son rival, l'étouffe d'une main et l'achève de son poing fermé, tandis qu'ailleurs, les corps s'enlacent de telle sorte que l'issue de la lutte semble incertaine : l'un des agonistes a bien renversé l'autre d'un croc en jambe et s'efforce de l'étouffer d'un bras, mais l'adversaire résiste et s'efforce de crever l'oeil droit du vainqueur dont la face se contracte de douleur et qui va lâcher prise.Je me borne à signaler d'autres représentations, dont l'une figure peut-être le début de la lutte, dont d'autres en reproduisent les phases diverses. Un curieux bronze syrien, trouvé à Balanée et conservé dans la collection de Clercq, est un bel exemple de kulisis.
- Le pancrace, comme le pugilat, quoiqu'un peu moins que lui peut-être, exposait les agonistes à des blessures terribles et qu'il nous faut maintenant étudier. Il arrivait dans le concours, nous l'avons vu plus haut, que les boxeurs mouraient sur place. Les pancratiastes n'étaient guère moins redoutables et nous n'essaierons pas de distinguer entre les deux sortes d'agonistes. Lorsque le vaincu se retirait en bon ordre, il avait chance encore de périr tôt après, car il pouvait avoir revu de ces blessures secrètes qui ne pardonnent pas. Après quatre heures de pugilat, le corps devenait une masse informe que les chiens seuls savaient reconnaître et une épigramme de l'Anthologie parle avec quelque exagération d'un mine dont les morceaux s'étaient perdus peu à peu en diverses rencontres et qu'il fallut reconstituer pour l'offrir en présent aux dieux. En effet il n'était pas de partie du corps qui fût à l'abri des dommages et qui restât longtemps saine chez le pugiliste et le pancratiaste. Les oreilles étaient particulièrement exposées : brisées chez le boxeur, aplaties et déformées chez le lutteur, elles sont dans mainte statue d'athlète un signe caractéristique de sa profession. Le front, les joues, les yeux, le nez recevaient des coups qui les figuraient ou les mutilaient : les monuments, surtout les vases peints, donnent sur ce point un témoignage formel et qui permet de contrôler les textes. La mâchoire, de même, était souvent brisée et le vainqueur était heureux s'il ne perdait qu'une ou plusieurs dents à la suite des coups reçus. La chronique des grands jeux parlait avec admiration d'un certain Eurydamas de Cyrène qui aurait su ravaler si à propos ses dents déchaussées qu'il aurait forcé son adversaire à se reconnaître vaincu. Aucune partie du corps n'était à l'abri. Les blessures sur la nuque, sur les bras, sur la poitrine, sur le côté, sur le dos, sur les cuisses, étaient aussi fréquentes que sur la tête et il était rare que le sang de l'un des adversaires, sinon de tous les deux, ne coulât pas dans l'arène. Il ne faut pas perdre de vue le caractère brutal et presque sauvage de la boxe antique, si l'on veut se faire une idée précise des Grands Jeux. Krause fait ressortir avec raison que le pugilat n'était pas tenu en moindre estime que les autres concours dont c'était le plus difficile, chalepôtaton ; le spectacle de la douleur physique n'avait donc rien qui répugnât à la très grande majorité des Grecs et ce serait se faire une idée très fausse des anciens que de leur prêter les délicatesses d'une âme sensible et moderne.
- Dans les concours, le pugilat précédait toujours le pancrace. On ne signale qu'une exception et elle est faite à la demande spéciale d'un athlète. La lutte était antérieure au pugilat, et le pentathle à la lutte, mais on sait que tous les jeux n'admettaient pas le pentathle [Quinquertium]. Le pancrace et le pugilat comptaient tous deux parmi les exercices lourds, c'est-à-dire ceux pour lesquels la force était surtout nécessaire ; aussi les athlètes qui s'y préparaient étaient-ils d'ordinaire mal habiles dans les agones divers dont se composait le pentathle. La souplesse et surtout l'agilité leur faisant défaut, ils ne se risquaient pas à y concourir et l'on ne cite qu'un concurrent qui ait triomphé à la fois à la course et au pancrace. La lutte était l'un des éléments dont se composait le pancrace ; elle était donc plus familière aux pammachoi ; pourtant l'on comptait ceux de ces derniers qui y avaient remporté la victoire. Quant aux athlètes, qui étaient à la fois bons boxeurs et possédaient l'art plus complexe du pancratiaste, ils étaient nécessairement plus nombreux, les deux exercices se ressemblant sous maint rapport, mais il n'était pas fréquent qu'ils eussent été couronnés dans les deux concours et il était infiniment rare que le fait eût lieu le même jour et dans les mêmes jeux. Héraklès avait, dit-on, accompli jadis cet exploit à Olympie. Depuis lui, une dizaine d'athlètes célèbres étaient appelés, pour la même prouesse, les descendants ou les rivaux d'Héraklès. Je ne citerai pas ici tous les pugilistes et tous les pancratiastes dont parlent les auteurs, leur histoire ayant perdu pour nous tout l'intérêt qu'elle avait pour les anciens. Les plus fameux étaient le Rhodien Diagoras, dont l'épinikion était gravé en lettres d'or dans le temple d'Athéna Lindia, l'Eginète Praxidamas, l'Eubéen Glaukos de Karystos, le Thasien Théagène, le Thessalien Agias, le Thébain Klitomachos, l'Athénien Callias, Aristion d'Epidaure, Euthymos de Locres, Tisandros de Naxos en Sicile. Les statuaires les plus célèbres avaient représenté les vainqueurs, soit de leur vivant soit après leur mort. Pythagoras de Rhegium en 472, Myron et Polyclète en 452, Lysippe peut-être ont modelé des statues de pugilistes ; Micon en 472 et Myron en 455, des statues de pancratiastes. On peut être tenté de chercher dans la masse des marbres antiques, parvenus jusqu'à nous, les répliques de ces bronzes fameux dont le souvenir s'était conservé dans les annales des Grands Jeux. Pythagoras de Rhegium, selon les uns, un élève de Critios, selon les autres, serait l'auteur de l'Harmodios des jardins Boboli, où il faut reconnaître un pugiliste. Au même Pythagoras et à Polyclète seraient dues d'autres statues d'athlètes dont de mauvaises copies nous permettent d'admirer encore le mouvement et le rythme. Il y en avait bien d'autres, comme les boxeurs les bras baissés ou les deux mains en garde, dont les coroplastes eux-mêmes ont reproduit l'attitude. D'autres agonistes se reposent assis ou accroupis. Un grand nombre enfin sont représentés couronnés et vainqueurs.
- En dehors des jeux publics, le pugilat était exercé dans les gymnases et dans les palestres. Il avait le défaut de développer outre mesure les épaules et les bras, mais il raffermissait la poitrine et fortifiait les muscles. Le fond de la guerre n'étant que de frapper et d'éviter les coups, les anciens estimaient que l'art de la boxe n'était pas une mauvaise préparation aux combats. D'autres en appréciaient la valeur éducatrice, car on gagnait à la pratiquer l'endurance physique, et l'on apprenait la ruse et la rapidité de décision. Enfin les médecins, s'ils en blâmaient les excès, la recommandaient dans certains cas contre les vertiges et les maux de tête. Les Etrusques connaissaient la boxe comme les Grecs et l'apprirent sans doute aux Romains. La tradition voulait qu'aux ludi célébrés par Tarquin l'Ancien des pugilistes eussent été appelés d'Etrurie et il n'est pas de fête romaine ou de triomphe sans combat de boxeurs. On sait que Caton instruisit lui-même son fils dans cet art et Auguste, comme Caligula, prenait plaisir aux assauts publics. Enfin Suétone nous parle des ludi caestici qui étaient célébrés à Padoue et dont la fondation remontait, disait-on, à Anténor.
Article d'A. de Ridder