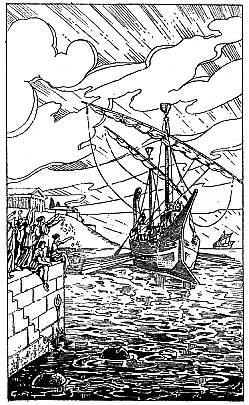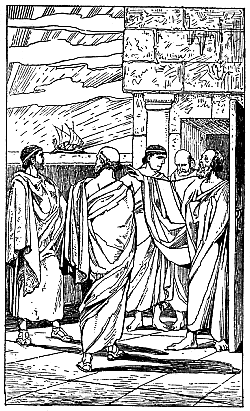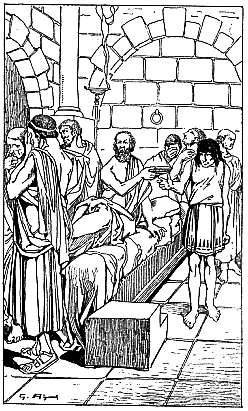Vous
le savez, amis ; souvent, dès ma jeunesse,
Un génie inconnu m'inspira la sagesse,
Et du monde futur me découvrit les lois.
Etait-ce quelque Dieu caché dans une voix
?
Une ombre m'embrassant d'une amitié
secrète ?
L'écho de l'avenir ? la muse du poète
?
Je ne sais ; mais l'esprit qui me parlait tout
bas,
Depuis que de ma fin je m'approche à grands
pas,
En sons plus élevés me parle, me
console.
Je reconnais plus tôt sa divine parole,
Soit qu'un coeur affranchi du tumulte des sens
Avec plus de silence écoute ses accents ;
Soit que, comme l'oiseau, l'invisible
génie
Redouble vers le soir sa touchante harmonie ;
Soit plutôt qu'oubliant le jour qui va
finir,
Mon âme, suspendue aux bords de l'avenir,
Distingue mieux le son qui part d'un autre monde,
Comme le nautonier, le soir, errant sur l'onde,
A mesure qu'il vogue et s'approche du bord,
Distingue mieux la voix qui s'élève du
port.
Cet invisible ami jamais ne m'abandonne,
Toujours de son accent mon oreille
résonne,
Et sa voix dans ma voix parle seule aujourd'hui ;
Amis, écoutez donc ! ce n'est plus moi, c'est
lui !»
Le front calme et serein, l'oeil rayonnant
d'espoir,
Socrate à ses amis fit signe de s'asseoir
;
A ce signe muet soudain ils obéirent,
Et sur les bords du lit en silence ils s'assirent
:
Symmias abaissait son manteau sur ses yeux ;
Criton d'un oeil pensif interrogeait les cieux ;
Cébès penchait à terre un front
mélancolique ;
Anaxagore, armé d'un rire sardonique,
Semblait, du philosophe enviant l'heureux sort,
Rire de la fortune et défier la mort !
Et le dos appuyé sur la porte de bronze,
Les bras entrelacés, le serviteur des
Onze,
De doute et de pitié tour à tour
combattu,
Murmurait sourdement : «Que lui sert sa vertu
?»
Mais Phédon, regrettant l'ami plus que le
sage,
Sous ses cheveux épars voilant son beau
visage,
Plus près du lit funèbre, aux pieds du
maître assis,
Sur ses genoux pliés se penchait comme un
fils,
Levait ses yeux voilés sur l'ami qu'il
adore,
Rougissait de pleurer, et le pleurait encore !
Du sage cependant la terrestre douleur
N'osait point altérer les traits ni la couleur
;
Son regard élevé loin de nous semblait
lire ;
Sa bouche, où reposait son gracieux
sourire,
Toute prête à parler, s'entr'ouvrait
à demi ;
Son oreille écoutait son invisible ami ;
Ses cheveux, effleurés du souffle de
l'automne,
Dessinaient sur sa tête une pâle
couronne,
Et, de l'air matinal par moments agités,
Répandaient sur son front des reflets
argentés ;
Mais, à travers ce front où son
âme est tracée,
On voyait rayonner sa sublime pensée,
Comme, à travers l'albâtre ou l'airain
transparents,
La lampe, sur l'autel jetant ses feux mourants,
Par son éclat voilé se trahissant
encore,
D'un reflet lumineux les frappe et les colore.
Comme l'oeil sur les mers suit la voile qui part,
Sur ce front solennel attachant leur regard,
A ses yeux suspendus, ne respirant qu'à
peine,
Ses amis attentifs retenaient leur haleine ;
Leurs yeux le contemplaient pour la dernière
fois ;
Ils allaient pour jamais emporter cette voix !
Comme la vague s'ouvre au souffle errant d'Eole,
Leur âme impatiente attendait sa parole.
Enfin du ciel sur eux son regard s'abaissa,
Et lui, comme autrefois, sourit, et commença
:
«Quoi ! vous pleurez, amis ! vous pleurez quand
mon âme,
Semblable au pur encens que la prêtresse
enflamme,
Affranchie à jamais du vil poids de son
corps,
Va s'envoler aux dieux, et, dans de saints
transports,
Saluant ce jour pur, qu'elle entrevit
peut-être,
Chercher la vérité, la voir et la
connaître !
Pourquoi donc vivons-nous, si ce n'est pour mourir
?
Pourquoi pour la justice ai-je aimé de
souffrir ?
Pourquoi dans cette mort qu'on appelle la vie,
Contre ces vils penchants luttant, quoique
asservie,
Mon âme avec mes sens a-t-elle combattu !
Sans la mort, mes amis, que serait la vertu ?...
C'est le prix du combat, la céleste
couronne
Qu'aux bornes de la course un saint juge nous donne
;
La voix de Jupiter qui nous rappelle à lui
!
Amis, bénissons-la ! Je l'entends
aujourd'hui.
Je pouvais, de mes jours disputant quelque reste,
Me faire répéter deux fois l'ordre
céleste :
Me préservent les dieux d'en prolonger le
cours !
En esclave attentif, ils m'appellent, j'y cours.
Et vous, si vous m'aimez, comme aux plus belles
fêtes,
Amis, faites couler des parfums sur vos têtes
!
Suspendez une offrande aux murs de la prison !
Et, le front couronné d'un verdoyant
feston,
Ainsi qu'un jeune époux qu'une foule
empressée,
Semant de chastes fleurs le seuil du
gynécée,
Vers le lit nuptial conduit après le bain,
Dans les bras de la mort menez-moi par la main
!...
Qu'est-ce donc que mourir ? Briser ce noeud
infâme,
Cet adultère hymen de la terre avec
l'âme ;
D'un vil poids, à la tombe, enfin se
décharger !
Mourir n'est pas mourir, mes amis, c'est changer
!
Tant qu'il vit, accablé sous le corps qu'il
enchaîne,
L'homme vers le vrai bien languissamment se
traîne,
Et, par ses vils besoins dans sa course
arrêté,
Suit d'un pas chancelant ou perd la
vérité.
Mais celui qui, touchant au terme qu'il implore,
Voit du jour éternel étinceler
l'aurore,
Comme un rayon du soir remontant dans les deux,
Exilé de leur sein, remonte au sein des dieux
;
Et, buvant à longs traits le nectar qui
l'enivre,
Du jour de son trépas il commence de vivre
!
- Mais mourir, c'est souffrir ; et souffrir est un
mal.
- Amis, qu'en savons-nous ? Et quand l'instant
fatal,
Consacré par le sang comme un grand
sacrifice,
Pour ce corps immolé serait un court
supplice,
N'est-ce pas par un mal que tout bien est produit
?
L'été sort de l'hiver, le jour sort de
la nuit ;
Dieu lui-même a noué cette
éternelle chaîne.
Nous fûmes à la vie enfantés avec
peine,
Et cet heureux trépas, des faibles
redouté,
N'est qu'un enfantement à l'immortalité
!
Cependant de la mort qui peut sonder l'abîme
?
Les dieux ont mis leur doigt sur sa lèvre
sublime :
Qui sait si dans ses mains, prêtes à la
saisir,
L'âme incertaine tombe avec peine ou plaisir
?
Pour moi, qui vis encor, je ne sais, mais je
pense
Qu'il est quelque mystère au fond de ce
silence ;
Que des dieux indulgents la sévère
bonté
A jusque dans la mort caché la
volupté,
Comme, en blessant nos coeurs de ses divines
armes,
L'amour cache souvent un plaisir sous des larmes
!»
L'incrédule Cébès à ce
discours sourit.
«Je le saurai bientôt», dit
Socrate. Il reprit :
«Oui : le premier salut de l'homme à la
lumière,
Quand le rayon doré vient baiser sa
paupière,
L'accent de ce qu'on aime à la lyre
mêlé,
Le parfum fugitif de la coupe exhalé,
La saveur du baiser, quand de sa lèvre
errante
L'amant cherche, la nuit, les lèvres de
l'amante,
Sont moins doux à nos sens que le premier
transport
De l'homme vertueux affranchi par la mort !
Et pendant qu'ici-bas sa cendre est recueillie,
Emporté par sa course, en fuyant il oublie
De dire même au monde un éternel
adieu.
Ce monde évanoui disparaît devant Dieu
!
- Mais quoi ! suffit-il donc de mourir pour revivre
?
- Non ; il faut que des sens notre âme se
délivre,
De ses penchants mortels triomphe avec effort ;
Que notre vie enfin soit une longue mort !
La vie est le combat, la mort est la victoire,
Et la terre est pour nous l'autel expiatoire
Où l'homme, de ses sens sur le seuil
dépouillé,
Doit jeter dans les feux son vêtement
souillé,
Avant d'aller offrir, sur un autel propice,
De sa vie, au Dieu pur, l'aussi pur sacrifice !
Ils iront, d'un seul trait, du tombeau dans les
cieux,
Joindre, où la mort n'est plus, les
héros et les dieux,
Ceux qui, vainqueurs des sens pendant leur courte
vie,
Ont soumis à l'esprit la matière
asservie,
Ont marché sous le joug des rites et des
lois,
Du juge intérieur interrogé la
voix,
Suivi les droits sentiers écartés de la
foule,
Prié, servi les dieux, d'où la vertu
découle,
Souffert pour la justice, aimé la
vérité,
Et des enfants du ciel conquis la liberté
!
Mais ceux qui, chérissant la chair autant que
l'âme,
De l'esprit et des sens ont resserré la
trame
Et prostitué l'âme aux vils baisers du
corps,
Comme Léda livrée à de honteux
transports,
Ceux-là, si toutefois un dieu ne les
délivre,
Même après leur trépas ne cessent
pas de vivre,
Et des coupables noeuds qu'eux-même ils ont
serrés
Ces mânes imparfaits ne sont pas
délivrés.
Comme à ses fils impurs Arachné
suspendue,
Leur âme, avec leur corps mêlée et
confondue,
Cherche enfin à briser ses liens
flétrissants ;
L'amour qu'elle eut pour eux vit encor dans ses sens
;
De leurs bras décharnés ils la pressent
encore,
Lui rappellent cent fois cet hymen qu'elle
abhorre,
Et, comme un air pesant qui dort sur les marais,
Leur vil poids, loin des dieux, la retient à
jamais !
Ces mânes gémissants, errant dans les
ténèbres,
Avec l'oiseau de nuit jettent des cris
funèbres ;
Autour des monuments, des urnes, des tombeaux,
De leur corps importun traînant d'affreux
lambeaux,
Honteux de vivre encore, et fuyant la
lumière,
A l'heure où l'innocence a fermé sa
paupière,
De leurs antres obscurs ils s'échappent sans
bruit,
Comme des criminels s'emparent de la nuit,
Imitent sur les flots le réveil de
l'aurore,
Font courir sur les monts le pâle
météore,
De songes effrayants assiégeant nos
esprits,
Au fond des bois sacrés poussent d'horribles
cris ;
Ou, tristement assis sur le bord d'une tombe,
Et dans leurs doigts sanglants cachant leur front qui
tombe,
Jaloux de leur victime, ils pleurent leurs forfaits
:
Mais les âmes des bons ne reviennent jamais
!»
Il se tut, et Cébès rompit seul ce
silence :
«Me préservent les dieux d'offenser
l'Espérance,
Cette divinité qui, semblable à
l'Amour,
Un bandeau sur les yeux, nous conduit au vrai jour
!
Mais puisque de ces bords comme elle tu
t'envoles,
Hélas ! et que voilà tes suprêmes
paroles,
Pour m'instruire, ô mon maître, et non
pour t'affiiger,
Permets-moi de répondre et de
t'interroger».
Socrate, avec douceur, inclina son visage,
Et Cébès en ces mots interrogea le sage
:
«L'âme, dis-tu, doit vivre au delà
du tombeau ;
Mais si l'âme est pour nous la lueur d'un
flambeau,
Quand la flamme a des sens consumé la
matière,
Quand le flambeau s'éteint, que devient la
lumière ?
La clarté, le flambeau, tout ensemble est
détruit,
Et tout rentre à la fois dans une même
nuit !
Ou si l'âme est aux sens ce qu'est à
cette lyre
L'harmonieux accord que notre main en tire,
Quand le temps ou les vers en ont usé le
bois,
Quand la corde rompue a crié sous nos
doigts,
Et que les nerfs brisés de la lyre
expirante
Sont foulés-sous les pieds de la jeune
bacchante,
Qu'est devenu le bruit de ces divins accords ?
Meurt-il avec la lyre ? et l'âme avec le corps
?...»
Les sages, à ces mots, pour sonder ce
mystère,
Baissant leurs fronts pensifs et regardant la
terre,
Cherchaient une réponse et ne la trouvaient
pas.
Se parlant l'un à l'autre, ils murmuraient
tout bas :
«Quand la lyre n'est plus, où donc est
l'harmonie ?»
Et Socrate semblait attendre son génie.
Sur l'une de ses mains appuyant son menton,
L'autre se promenait sur le front de
Phédon,
Et, sur son cou d'ivoire errant à
l'aventure,
Caressait, en passant, sa blonde chevelure ;
Puis, détachant du doigt un de ses longs
rameaux
Qui pendaient jusqu'à terre en flexibles
anneaux,
Faisait sur ses genoux flotter leurs molles
ondes,
Ou dans ses doigts distraits roulait leurs tresses
blondes,
Et parlait en jouant, comme un vieillard divin
Qui mêle la sagesse aux coupes d'un festin.
«Amis, l'âme n'est pas l'incertaine
lumière
Dont le flambeau des sens ici-bas nous éclaire
:
Elle est l'oeil immortel qui voit ce faible jour
Naître, grandir, baisser, renaître tour
à tour,
Et qui sent hors de soi, sans en être
affaiblie,
Pâlir et s'éclipser ce flambeau de la
vie,
Pareille à l'oeil mortel qui dans
l'obscurité
Conserve le regard en perdant la clarté !
L'âme n'est pas aux sens ce qu'est à
cette lyre
L'harmonieux accord que notre main en tire ;
Elle est le doigt divin qui seul la fait
frémir,
L'oreille qui l'entend ou chanter ou
gémir,
L'auditeur attentif, l'invisible génie
Qui juge, enchaîne, ordonne et règle
l'harmonie,
Et qui des sons discords que rendent chaque sens
Forme au plaisir des dieux des concerts
ravissants.
En vain la lyre meurt et le son s'évapore
:
Sur ces débris muets l'oreille écoute
encore...
Es-tu content, Cébès ! - Oui, j'en
crois tes adieux,
Socrate est immortel ! - Eh bien ! parlons des dieux
!»
Et déjà le soleil était sur les
montagnes,
Et, rasant d'un rayon les flots et les campagnes,
Semblait, faisant au monde un magnifique adieu,
Aller se rajeunir au sein brillant de Dieu.
Les troupeaux descendaient des sommets du
Taygète ;
L'ombre dormait déjà sur les flancs de
l'Hymette ;
Le Cithéron nageait dans un océan d'or
;
Le pêcheur matinal, sur l'onde errant
encor,
Modérant près du bord sa course
suspendue,
Repliait, en chantant, sa voile détendue ;
La flûte dans les bois, et ces chants sur les
mers.
Arrivaient jusqu'à nous sur les soupirs des
airs,
Et venaient se mêler à nos sanglots
funèbres,
Comme un rayon du soir se fond dans les
ténèbres. |