XXXVIII - Les Gracques |
IV - CAIUS GRACCHUS
Caïus avait vingt et un ans à la mort de son
frère. Plus impétueux, plus éloquent,
d'une ambition peut-être moins pure, il donna à
la lutte commencée par Tiberius des proportions plus
grandes. Celui-ci n'avait voulu que soulager la misère
des pauvres : Caïus prétendit changer toute la
constitution. D'abord il avait paru répudier le
sanglant héritage de son frère ; mais une nuit,
dit Cicéron, il crut entendre sa voix :
« Caïus, pourquoi différer ? ta
destinée sera la mienne : combattre et mourir pour le
peuple ». Cependant il voyait le nombre de ses
partisans croître avec celui des assignations de terres
: entre les années 131 et 125, le cens s'augmenta de
soixante-seize mille citoyens, qui devaient leur aisance
à la loi Sempronia. Aussi la première
fois qu'il parla en public, de vifs applaudissements
l'accueillirent et ranimèrent sa confiance ; il
soutint les lois de Carbon, et, en 127, il brigua la
questure. Le sort le désigna pour accompagner en
Sardaigne le consul Oreste. Tel était l'ascendant de
son nom sur les alliés, que la province ayant, dans
une saison mauvaise, refusé au consul, avec
l'autorisation du sénat, des vêtements pour ses
légionnaires, le questeur alla de ville en ville et
obtint d'elles plus qu'il ne leur avait été
demandé. A sa considération, le roi de Numidie,
Micipsa, envoya dans l'île un grand convoi de
blé. Déjà le sénat s'alarmait de
ce crédit d'un jeune homme qui seul habillait et
nourrissait une armée. Pour empêcher le retour
de Caïus, il ordonna au consul de rester dans sa
province, même après le licenciement des troupes
qu'on fit remplacer par de nouvelles levées. Mais
Caïus n'accepta pas cet exil : il courut à Rome,
et, quand on l'accusa devant les censeurs d'avoir
violé la loi qui retenait le questeur auprès de
son général, il se défendit en jetant de
la tribune, comme il le disait lui-même, des
épées et des poignards : « J'ai fait
douze campagnes, et la loi n'en exige que dix ; je suis
resté trois ans questeur, et au bout d'une
année je pouvais sortir de charge. Dans la province,
ce n'est pas mon ambition, mais l'intérêt public
qui a réglé ma conduite. Chez moi, il n'y eut
jamais ni festins ni jeunes esclaves à belle figure,
et à ma table la modestie de vos enfants fut plus
respectée que devant les tentes de vos chefs. Personne
ne peut dire qu'il m'a donné un as en présent
ni rien dépensé pour moi. Aussi les ceintures
que j'avais emportées de Rome pleines d'argent, je les
rapporte vides. D'autres ont rapporté pleines d'or les
amphores qu'ils avaient emportées pleines de
vin ». On lui suscita encore d'autres chicanes :
on l'accusa d'avoir trempé dans la révolte des
Frégellans. C'était le désigner à
la faveur des Italiens.
Cependant Cornélie, si forte, sentit, dit-on, son
courage faiblir elle s'effraya de le voir entrer dans la voie
de son frère, et tenta de l'arrêter.
« Quand donc notre famille cessera-t-elle de
délirer ? Quand donc aurons-nous honte de troubler la
république ? Mais, s'il faut absolument qu'il en
advienne ainsi, dès que je serai morte, demande le
tribunat, fais ce que tu voudras, alors je n'en sentirai
rien. Tu m'offriras le culte des aïeux, et tu invoqueras
la divinité de ta mère ; mais ne rougiras-tu
pas d'implorer par des prières ces divinités
que, vivantes et présentes, tu auras
délaissées ? Veuille Jupiter ne pas permettre
que tu persévères davantage ni qu'il te vienne
dans l'esprit une si grande démence ; car je crains
que tu ne recueilles de ta faute une telle douleur, qu'en
aucun temps tu ne puisses être en paix avec
toi-même ». Remarquez ces paroles
très romaines et conformes aux croyances de ce peuple
sur les mânes et les génies, qui avaient conduit
les Grecs à l'apothéose des héros, puis
des rois, et qui conduira les Romains à celle des
empereurs.
Caïus ne pouvait reculer. Le jour de l'élection
des tribuns, tous les clients des nobles, tous les citoyens
épars dans l'Italie accoururent. La lutte fut
très vive ; les grands ne parvinrent pas à
empêcher son élection, mais il n'arriva que le
quatrième.
Il voulut inaugurer son tribunat en offrant à l'ombre
de son frère un sacrifice expiatoire où les
ennemis et les meurtriers de Tiberius seraient les victimes.
« Où irai-je ? s'écriait-il d'une
voix puissante qui allait remuer les coeurs jusqu'aux
derniers rangs de la foule ; où trouverai-je un asile
? Au Capitole ? Mais le temple saint est inondé du
sang de mon frère. Dans la maison de mon père ?
Mais j'y trouverai une mère inconsolable. Romains, vos
pères ont déclaré la guerre aux
Falisques parce qu'ils avaient insulté le tribun
Genucius. Ils condamnèrent à mort C. Veturius
pour ne s'être pas rangé devant un tribun qui
traversait le Forum. C'est un usage de nos pères que,
quand un citoyen accusé d'un crime capital ne
comparait pas, le héraut aille dès le matin
à sa porte, sonne de la trompette et l'appelle par son
nom ; après cela seulement, les juges peuvent porter
la sentence, et, sous vos yeux, ces hommes ont tué
Tiberius, ils ont ignominieusement traîné son
cadavre par les rues de la ville !... »
Quand il vit le peuple soulevé par ces paroles, il
proposa deux lois : la première, dirigée contre
Octavius, portait qu'un citoyen frappé par le peuple
de destitution ne pourrait être élevé
à aucune charge ; la seconde, qu'un magistrat, qui
aurait mis à mort ou banni sans jugement un citoyen,
serait traduit par-devant le peuple. A la prière de
Cornélie, il retira la première ; mais l'ancien
consul Popillius Laenas, le persécuteur des amis de
son frère, s'exila dès que la seconde eut
été votée. Tiberius avait donné
le fatal exemple d'attenter à l'inviolabilité
tribunitienne ; Caïus, en imprimant à ses deux
plébiscites un effet rétroactif, donna celui de
faire servir la loi à des vengeances privées.
Un jour Clodius s'en souviendra.
Cette satisfaction accordée aux mânes de son
frère, Caïus reprit ses projets en les
développant :
- Nouvelle confirmation de la loi agraire.
- Distributions régulières de blé à moitié prix (6 as 1/3 le boisseau).
- Fourniture gratuite, aux soldats sous les drapeaux, des vêtements militaires, et défense d'enrôler des jeunes gens avant leur dix-septième année révolue.
- Etablissement de nouveaux impôts à l'entrée des marchandises tirées, pour les besoins des riches, des contrées étrangères.
- Puis des colonies pour les citoyens pauvres.
- Pour ceux qui voulaient du travail, en attendant que la loi agraire leur donnât des terres, construction de greniers publics, de ponts et de grands chemins, qu'il traça lui-même à travers l'Italie et qui augmentèrent la valeur des propriétés en donnant plus de facilité pour leur exploitation. Il y plaçait des bornes milliaires qui indiquaient les distances et des montoirs pour que les cavaliers pussent se mettre aisément en selle. En même temps il flattait l'orgueil de la multitude : les rostres étaient placés devant le Comitium, sous l'oeil vigilant du sénat, et l'on dit que jusqu'alors les orateurs qui parlaient du haut de la tribune s'étaient tournés de ce côté, afin de bien montrer que c'était au peuple que passait la puissance. Caïus ne s'adressa jamais qu'à la foule, comme au souverain véritable.
Toutes ces lois étaient excellentes ; l'une d'elles
cependant a donné lieu à beaucoup de
déclamations : le blé vendu au peuple à
bas prix. Mais nous aurions bien mal exposé
jusqu'à présent l'histoire de Rome si nous
n'avions pas fait comprendre que cette mesure, à
laquelle le sénat avait eu recours très
souvent, était une conséquence de l'idée
même que les Romains se faisaient, et avec eux toute
l'antiquité, des droits de la victoire. D'après
ces idées, le vaincu devait, pour le rachat de sa vie,
une portion de son revenu, qu'il donnait par l'impôt,
et une portion de ses terres, qu'il abandonnait au domaine
public du vainqueur. De ces terres et de cet argent, celui-ci
faisait deux parts. l'une réservée pour les
besoins de l'Etat ; l'autre réclamée, au nom de
ceux qui, étant, malgré leur dénuement,
le peuple souverain, avaient le droit d'appliquer par un
vote, au soulagement de leur misère, ces biens acquis
en commun sur les champs de bataille, et dont les riches
prétendaient avoir seuls la jouissance. Or l'ager
publicus était maintenant assez étendu, les
revenus tirés des provinces assez abondants pour que
l'Etat pût distribuer aux citoyens soit de la terre,
soit du blé. A ceux qui consentaient à partir
pour une colonie lointaine, Caïus donnait de la terre ;
à ceux qui préféraient rester à
Rome, il donnait du blé. Sa loi n'était donc
qu'une forme particulière de ces lois agraires qu'il
faut considérer comme aussi légitimes alors,
qu'elles seraient iniques aujourd'hui. Si elle n'avait pas
été portée plus tôt, c'est qu'on
n'en avait pas eu besoin, tant que la classe des petits
propriétaires avait préservé Rome du
paupérisme. Mais les institutions changent avec les
moeurs : par la formation d'un peuple famélique,
l'assistance de l'Etat devint une nécessité
sociale que le second Caton, un des chefs de I'aristocratie,
reconnut lui-même lorsqu'il reprit la loi de Caïus
pour la rendre plus libérale. Cette assistance que
nous donnons à nos pauvres par esprit de
charité, la société romaine l'accordait
aux siens par esprit de justice, d'une justice telle, du
moins, qu'on la concevait en ce temps-là.
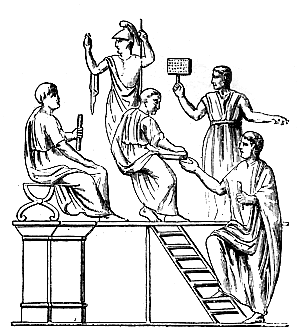
Distribution gratuite au peuple |
Après avoir gagné par ces innovations
populaires l'armée, les tribus rustiques et le petit
peuple de Rome, Caïus commença la lutte politique
contre les privilégiés. Depuis l'année
179, les nobles et les riches avaient ressaisi la
prépondérance dans l'assemblée
centuriate ; pour la leur arracher, sans bouleverser encore
une fois cette institution, le tribun fit
décréter qu'à l'avenir le sort
désignerait l'ordre dans lequel les centuries
voteraient. Les dernières pouvaient être ainsi
appelées les premières, et la majorité
ne dépendait plus du vote des riches. Le vote de la
centurie qui allait la première au suffrage,
centuria praerogativa, avait aux yeux des Romains une
importance particulière, parce qu'il semblait
résulter d'une sorte d'inspiration divine ; et le
sort, qui dispensait maintenant cet avantage, est de sa
nature très démocratique. De nouveaux articles
ajoutés à la loi Porcia
défendirent à tout magistrat de jamais rien
entreprendre contre un citoyen sans l'ordre du peuple.
C'était enlever au sénat la faculté de
recourir à la dictature ou à ces commissions
extraordinaires, comme celle qui avait été si
dure pour les partisans de Tiberius.
Un changement bien autrement grave fut celui qui donna aux
chevaliers toutes les places de juges, dans les causes
criminelles portées devant les quaestiones
perpetuae.
Dans une république, le pouvoir judiciaire est
peut-être le plus important. S'il tombe aux mains d'un
parti, il devient un instrument de persécution et
d'injustice. Aussi, dans les cités italiennes du moyen
âge, le podestat n'était-il jamais un citoyen,
mais un étranger. A Rome, quand le sénat avait
les jugements, judicia publica, c'est-à-dire
quand il réunissait les deux pouvoirs,
l'exécutif et le judiciaire, avec une part
considérable de l'autorité législative,
les gouverneurs étaient à peu près
assurés de l'impunité. En ce moment même,
les envoyés de plusieurs provinces demandaient
vainement justice d'Aurelius Cotta, de Salinator et de Manius
Aquillius. Et puis ces juges sénatoriaux
n'étaient pas tous de très graves personnages.
Un orateur les montre allant à leur fonction
après de joyeux festins avec des courtisanes.
« Quand la dixième heure approche, ils
envoient un esclave au Forum pour savoir ce qu'on a fait, qui
a parlé pour, qui a parlé contre et comment les
tribus ont voté. Le moment venu, ils se rendent au
Comitium, afin de n'avoir pas à payer l'amende, et en
route il n'est point d'amphore au coin des ruelles qu'ils ne
remplissent. Ils arrivent au tribunal de fort mauvaise
humeur. « Allons, disent-ils, qu'on
plaide ». Ils font appeler les témoins, et
en attendant retournent aux amphores ; puis, demandent les
pièces du procès, et, appesantis par le vin,
peuvent à peine lever la paupière. Enfin ils
votent en s'écriant : « Qu'avons-nous
à faire de toutes ces sottises ? Allons boire un bon
vin de Grèce miellé et manger une grive grasse,
avec un loup de mer pris entre les deux
ponts ».
Caïus profita de tous ces scandales pour proposer sa
loi, qui allait séparer du sénat une partie des
riches et mettre les gouverneurs de province à la
merci des banquiers, argentarii. Si les chevaliers, en
effet, remplissaient seuls les tribunaux, les publicains
n'avaient pas à craindre qu'on se risquât
à appeler de leurs exactions, et les gouverneurs
intègres étaient placés, comme le sera
le vertueux Rupilius, sous le coup d'une sentence
capitale.
En provoquant cette révolution judiciaire, Caïus
porta une rude atteinte à la moralité publique.
Si les sénateurs ne rendaient pas bonne justice, les
hommes d'argent la vendirent, et les nobles descendaient
rarement à ces honteux marchés. Sans doute il
avait prévu ce danger et les reproches des vieux
Romains, qui lui criaient : « La république
a maintenant deux têtes, la guerre civile sera donc
éternelle ? » Mais, son frère ayant
échoué en cherchant à tirer du peuple,
par la reconstitution de la petite propriété,
une classe moyenne qui tînt la balance égale
entre le sénat et la foule, Caïus se
résigna à former cet ordre intermédiaire
d'hommes qui tenaient au peuple par leur origine, aux nobles
par leurs richesses. Malheureusement ce n'était pas
créer une classe nouvelle, mais un parti nouveau. Les
gens de finance, chevaliers et publicains (ces deux mots sont
maintenant à peu près synonymes) formaient
déjà une corporation puissante à
laquelle il eût fallu donner tout autre chose que les
jugements, pour laisser la justice en dehors des querelles de
partis. Mais Caïus ne pouvait faire descendre plus bas
des fonctions jusqu'alors réservées aux
premiers de l'Etat. Dans un demi-siècle seulement l'on
comprendra que, pour être impartiale, la justice doit
être confiée non à une classe de
citoyens, mais aux plus intègres citoyens de toutes
les classes. Et puis, pour Caïus, dans cette
réforme, la question politique voilait la question
d'équité ; toute arme lui était bonne
contre les grands. Il pensait que ce qu'il ôtait au
sénat profiterait au peuple et à la
liberté, et que les chevaliers, reconnaissants,
l'aideraient dans ses autres desseins. « D'un
coup, disait-il, j'ai brisé l'orgueil et la puissance
des nobles ». Ceux-ci le savaient et le
menaçaient de leur vengeance. « Mais,
répondait-il, quand vous me tueriez, arracheriez-vous
de vos flancs le glaive que j'y ai enfoncé
? » Et, malgré le jugement
sévère de Montesquieu, qui écrivait dans
cet esprit parlementaire si hostile aux traitants,
malgré les faits trop avérés de
sentences iniques rendues par les nouveaux juges, on peut
applaudir à cette tentative de Caïus pour
créer ce que Napoléon appelait, un grand corps
intermédiaire. Sans elle peut-être la
république fût tombée plus vite, car ce
fut avec l'ordre équestre que Cicéron combattit
Catilina. Il est vrai qu'il eût mieux valu pour le
monde que cette agonie de la liberté eût
duré moins longtemps.
Caïus croyait avoir raffermi la constitution ; pour
assurer l'empire en intéressant à sa cause un
peuple nombreux, il proposa de donner aux alliés
latins le droit d'aspirer aux magistratures romaines, jus
honorum, et aux Italiens celui de suffrage. Les forces du
parti démocratique allaient être, par cette
mesure, singulièrement accrues mais
l'élément aristocratique devait se fortifier
aussi de tous les nobles alliés, que leur fortune
classerait dans l'ordre équestre ; et le sénat
avec sa noblesse, les chevaliers avec leur pouvoir
judiciaire, seraient assez forts pour contenir la foule et
conserver l'équilibre.
Ainsi, aux soldats des vêtements gratuits, aux pauvres
des tribus urbaines du blé, à ceux des tribus
rustiques des terres, aux Latins l'entrée des charges
publiques, aux Italiens l'espérance du droit de
cité, aux chevaliers les jugements,
c'est-à-dire les pauvres soulagés, les
opprimés défendus et une tentative pour
établir l'équilibre dans l'Etat : tels sont les
actes de ce tribunat mémorable. Caïus avait donc
réalisé ce qu'avaient voulu son frère et
son beau-frère, Tiberius et Scipion Emilien. Il
semblait plus grand qu'eux, et, à le voir
entouré sans cesse de magistrats, de soldats, de gens
de lettres, d'artistes, d'ambassadeurs, on eût dit un
roi dans Rome. Il l'était en effet par la faveur du
peuple, par la terreur des nobles, par la reconnaissance des
chevaliers et des Italiens ; il voulut l'être aussi par
l'amour des provinciaux. Le propréteur avait
envoyé d'Espagne des blés extorqués aux
habitants : Caïus leur en fit rendre le prix. Les
consuls se faisaient assigner par le sénat, pour y
être envoyés gouverneurs, une province à
leur convenance, celle qui prêtait le plus au pillage
ou à l'ambition militaire : il fit
décréter que les provinces seraient
désignées avant l'élection des consuls,
pour que l'intérêt seul de l'Etat, non celui des
élus, fût désormais consulté. Il
voulait aussi relever Capoue, Tarente, et, malgré les
imprécations prononcées contre ceux qui
rebâtiraient Carthage, envoyer une colonie sur ses
ruines, afin de bien montrer au monde l'esprit nouveau de
libéralité et de grandeur qui allait
régner dans les conseils de Rome.
Tiberius avait prétendu régler l'organisation
financière de l'Asie pergaméenne, tout
récemment acquise, et n'en avait pas eu le temps.
Caïus reprit son dessein et fit décider par un
plébiscite que les limes de l'Asie seraient
affermées à Rome par les censeurs,
règlement où l'on n'a voulu voir qu'une faveur
aux publicains, mais qui, à en juger d'après
l'esprit général des réformes du tribun,
doit avoir été, au moins à l'origine,
une bonne mesure pour la nouvelle province.
Pour consolider son pouvoir et son ouvrage, Caïus
demanda au peuple de nommer consul son ami Fannius Strabon.
Quant à lui, il n'eut pas même besoin de
solliciter sa réélection au tribunat ; le
peuple l'y porta par d'unanimes suffrages. Les nobles
étaient atterrés ; mais, connaissant la
mobilité et l'égoïsme de la foule, ils
dressèrent contre Caïus un plan de campagne qui
eut bientôt ruiné sa popularité : ce fut
de se montrer plus populaires que lui-même. Ils
subornèrent un des nouveaux tribuns, Livius Drusus,
qui, à chaque proposition de son collègue, en
fit une, au nom du sénat, plus libérale.
Caïus avait demandé l'établissement de
deux colonies : Livius proposa d'en fonder douze de trois
mille citoyens chacune. Il avait assujetti à une rente
annuelle pour le trésor les terres distribuées
aux pauvres : Livius la supprima. Il voulait donner le droit
complet de cité aux Latins : Livius opposa son veto,
mais demanda et obtint que désormais aucun soldat
latin ne pourrait être battu de verges. Dans son
activité, Caïus se mettait de toutes les
commissions, puisait dans le trésor pour les travaux
qu'il avait fait voter et les dirigeait lui-même, se
montrant partout, se mêlant à tout. Drusus, au
contraire, affectait de se tenir aux stricts devoirs de sa
charge ; et cette réserve, cette probité qui ne
voulait pas donner prise même au plus léger
soupçon d'ambition ou d'avidité, charmaient la
foule, qui se plaît aux contrastes et court à
tout spectacle nouveau.
Fannius aussi était passé aux grands et
combattait celui qui lui avait valu le consulat. Contre la
proposition d'accorder la pleine franchise aux Latins, il
prononça un discours fort admiré encore du
temps de Cicéron, mais dont un fragment qui nous reste
montre qu'il suffisait d'exciter les appétits de la
tourbe du Forum pour empêcher un acte conforme à
la politique traditionnelle de Rome : l'élargissement
progressif de la cité. « Ah ! vous croyez
qu'après que vous aurez donné la cité
aux Latins, vous resterez ce que vous êtes aujourd'hui,
que vous aurez la même place dans les comices, dans les
jeux, dans les amusements publics (et il ajoutait sans doute
: dans les distributions) ? Ne voyez-vous pas que ces hommes
rempliront tout et prendront tout ? » Il ne
fallait pas de plus nobles paroles avec des gens qui ayant,
comme leur disait Caton, plus de ventre que d'oreille, se
vendaient au plus offrant.

Denier d'Opimius |
Fatigué de cette lutte étrange où tous les coups portaient sur lui, Caïus partit pour conduire six mille colons romains à Carthage, qu'il appela Junonia, la ville de Junon. Cette absence, imprudemment prolongée durant trois mois, laissait le champ libre à Drusus. Il sut montrer aux chevaliers qu'ils n'avaient plus qu'à perdre dans l'alliance de ce tribun, exécuteur de la loi agraire ; et au peuple, que le sénat, plus libéral que Caïus, ne le dégradait pas en lui associant les Italiens. Lorsque Caïus reparut, sa popularité était ruinée, ses amis menacés, les chevaliers détachés de lui, et l'un de ses plus violents ennemis, le destructeur de Frégelles, Opimius, proposé pour le consulat. Dès lors il fut aisé de prévoir que la tragédie où Tiberius avait péri allait recommencer. Caïus quitta sa maison du Palatin pour se loger au milieu du peuple, près du Forum, et appela autour de lui les Latins. Mais un édit des consuls chassa de Rome tous les Italiens. Le tribun protesta contre ce décret, sans oser toutefois en arrêter l'exécution. Sous ses yeux, un de ses amis, un de ses hôtes, fut traîné en prison, et il ne l'empêcha point. Sa confiance diminuait, bientôt son pouvoir lui échappa ; il ne put obtenir sa réélection à un troisième tribunat. |
Le nouveau consul, pour l'irriter et le pousser à quelque acte qui légitimât la violence, parla tout haut de casser ses lois, et ordonna une enquête sur la colonie de Junonia. Aussitôt on raconta tous les présages funestes dont le sénat avait besoin : une enseigne arrachée par le vent des mains qui la tenaient et brisée ; les entrailles de la victime enlevées de l'autel par une trombe furieuse et jetées hors de l'enceinte tracée ; les bornes mêmes de la cité déterrées par les hyènes et emportées au loin. Les dieux ne voulaient évidemment pas que la ville maudite se relevât, et celui qui avait proposé de la reconstruire était un sacrilège envers les immortels et envers Rome. Il fallait se défendre ou s'attendre à périr. Le premier sang fut versé par les partisans de la réforme. Ils tuèrent un certain Antyllius, qui, selon les uns, avait pris les mains de Caïus et le suppliait d'épargner sa patrie, mais qui, selon d'autres, licteur du consul, avait insulté l'ancien tribun et ses amis, en leur criant : « Mauvais citoyens, faites place aux honnêtes gens ».

Cadavre sur un chariot
|
Une pluie violente qui survint sépara les deux
partis ; le lendemain, au point du jour, Opimius convoqua le
sénat. Pendant qu'il se rassemble, des gens
apostés par le consul mettent sur un lit le corps nu
d'Antyllius, le promènent par la ville avec pleurs et
lamentations et le déposent aux portes de la curie.
Les sénateurs quittent la séance pour
contempler ce cadavre qui leur est si utile et l'entourent en
gémissant, honorant d'une fausse douleur la mort d'un
mercenaire, eux qui naguère faisaient traîner
par les rues et jeter au Tibre le petit-fils du vainqueur de
Zama. Rentrés en séance, ils investirent
Opimius de la puissance dictatoriale par la formule Caveat
consul, et lui ordonnèrent d'abattre les
tyrans.
Il y avait eu mort d'homme : il fallait donc un jugement, et
les accusés paraissant vouloir s'y soustraire par la
force, le sénat avait pour lui les apparences de la
légalité. Par la promenade du cadavre, il avait
ému une partie du populaire ; par une promesse
d'amnistie pour ceux qui déserteraient avant le
combat, il en détacha une autre ; le décret
contre les tyrans acheva d'isoler les
démocrates, en servant de prétexte à
toutes les lâchetés, surtout à celles des
riches, des publicains, qui devaient tant à Gracchus
et qui ne firent rien pour lui.

Le mont Aventin |
Durant la nuit, Opimius avait fait occuper par des
archers crétois le Capitole et le temple des
Dioscures, d'où il commandait tout le Forum. Il
enjoignit aux sénateurs et aux chevaliers de leur
parti d'aller chercher des armes, d'en donner à leurs
esclaves et d'amener les plus vigoureux. Ils
s'empressèrent d'obéir, même le vieux
Metellus, le vainqueur de la Macédoine et de la
Grèce, qui revint portant l'épée et le
bouclier. De l'autre côté aussi, on se
prépara au combat, mais au milieu des cris, sans ordre
ni résolution. Le consulaire Fulvius, un des triumvirs
pour l'exécution de la loi agraire, avait armé
ses gens des dépouilles gauloises suspendues dans sa
maison, et s'était établi sur l'Aventin,
l'antique citadelle des plébéiens ; il y fut
rejoint par une troupe d'affranchis et de paysans que
Cornélie envoyait à son fils
déguisés en moissonneurs. Sur sa route Fulvius
avait appelé les esclaves à la liberté.
Au temps de leur puissance, ces réformateurs n'avaient
rien vu au delà des misères du peuple ;
opprimés à leur tour, ils se souvenaient, au
dernier moment, d'hommes plus malheureux encore, et ils
ajoutaient un nouveau grief à tous ceux qui
inspiraient aux grands une haine si furieuse.
Caïus répugnait à une lutte violente ; il
voyait bien que l'heure suprême était
arrivée, et son sacrifice était fait : ces
Romains savaient mourir. Mais, avec lui, ses grands projets
allaient aussi tomber. Avoir eu l'ambition et le pouvoir de
régénérer sa patrie et sentir que
bientôt il ne resterait rien de si
généreux efforts, c'était la douleur
profonde qui déchirait son âme. La veille, en
revenant du Forum, il s'était arrêté
devant la statue de son père, l'avait
contemplée longtemps, et on avait vu des larmes couler
silencieuses sur son visage. Au matin, il sortit de sa
maison, en toge et n'ayant qu'un petit poignard à la
ceinture, non pour combattre, mais pour rester maître
de sa vie, ou plutôt de sa mort. Sa femme Licinia
voulut l'arrêter sur le seuil, il se dégagea
doucement de ses étreintes. Lorsqu'il
s'éloigna, elle tomba sans mouvement, et ses esclaves
la portèrent évanouie chez son frère
Crassus.
Sur le conseil de Caïus, Fulvius envoya aux
sénateurs le plus jeune de ses fils, un caducée
à la main : c'était un bel enfant, et
quelques-uns se laissaient toucher aux propositions
d'accommodement qu'il redisait au milieu de ses larmes.
Opimius répondit durement que des coupables ne
parlementaient pas, mais venaient se livrer, seul moyen
d'adoucir une juste colère. Caïus voulait se
rendre au sénat, demander des juges, plaider encore
une fois, avec sa cause, celle du peuple ; ses amis l'en
empêchèrent, et Fulvius renvoya son fils pour
obtenir au moins quelques garanties. Le consul, impatient
d'en finir, retint l'enfant et marcha sur l'Aventin avec une
infanterie nombreuse et ses Crétois, dont les
flèches eurent bientôt mis en fuite ces bandes
sans courage qu'une promesse d'amnistie avait réduites
de moitié. Fulvius et l'aîné de ses fils,
réfugiés dans un bain abandonné, y
furent découverts et massacrés.
Caïus n'avait peint pris part au combat. Retiré
dans le temple de Diane, il se serait donné la mort si
deux de ses amis, Pomponius et Licinius, ne lui avaient
arraché le poignard. A l'approche de l'ennemi, ils
l'entraînèrent vers le pont Sublicius et lui
firent prendre les devants, tandis qu'eux-mêmes
s'arrêtaient à l'entrée de
l'étroit passage et s'y faisaient tuer pour retarder
la poursuite. Caïus fuyait avec un seul esclave,
Philocratès, et, dans ce peuple
hébété, pas un bras ne se levait pour le
défendre ; s'il avait trouvé un cheval, il
eût échappé ; il en demandait un avec
instance, mais on se contentait de l'encourager dans sa fuite
du geste et de la voix, comme s'il se fût agi de gagner
aux jeux le prix de la course. Il se jeta dans le bois des
Furies et se fit tuer par son esclave, qui se poignarda sur
le corps de son maître. Opimius avait promis de payer
la tête de l'ancien tribun son pesant d'or. Un ami du
consul, Septimuleius, en fit sortir la cervelle, coula du
plomb à la place, et reçut les 17 livres 8
onces d'or qu'elle pesait. Même promesse avait
été faite pour celle de Fulvius. Mais ce furent
de petites gens qui apportèrent, on ne leur donna
rien. Ce jour-là, trois mille hommes périrent :
ceux qu'on ne tua pas dans l'action furent
étranglés en prison. Le jeune Fulvius,
arrêté avant le combat, fut égorgé
de sang-froid. On rasa leurs maisons ; on confisqua leurs
biens ; on défendit aux veuves de porter le deuil ; on
prit même sa dot à la femme de Caïus.
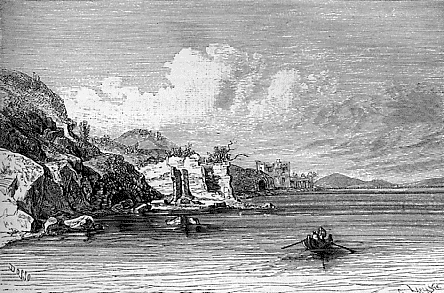
Ruines à Misène |
Plus tard, le peuple dressa aux Gracques des statues,
et éleva des autels dans les lieux où ils
avaient péri. Longtemps on y fit des sacrifices et des
offrandes. Cette tardive reconnaissance consola
Cornélie, trop fidèle peut-être à
son grand caractère. Retirée dans sa maison du
cap Misène, au milieu des envoyés des rois et
des lettrés de la Grèce, elle se plaisait
à raconter à ses hôtes surpris la vie et
la mort de ses deux fils, sans verser une larme et comme si
elle eût parlé de quelques héros des
anciens temps. Seulement on l'entendait quelquefois ajouter
au récit des exploits de son père l'Africain :
« Et les petits-fils de ce grand homme
étaient mes enfants. Ils sont tombés dans les
temples et les bois sacrés des dieux. Ils ont les
tombeaux que leurs vertus méritent, car ils ont
sacrifié leur vie au plus noble but, au bonheur du
peuple ».
L'histoire doit-elle parler comme Cornélie ? Oui,
puisque Rome, devenue un monde, ne pouvait conserver la
constitution qui avait servi à l'humble cité
des Sept Collines. Les Gracques tentèrent
d'opérer cette révolution par les voies
légales : ils n'y réussirent pas ; d'autres
l'essayeront par les armes. Caïus est le
précurseur des Césars par sa lutte contre
l'aristocratie et par la nature de son pouvoir : car la plus
importante des prérogatives impériales sera la
puissance tribunitienne, celle même dont Caïus
était revêtu, et que de nos jours les
Napoléons ont reprise par les plébiscites. Ses
deux tribunats furent une royauté véritable,
mais sans l'élément militaire que les empereurs
y mêleront et qui perdra l'empire. Il avait
constitué une tyrannie populaire dans le sens grec du
mot, et s'il avait réussi, on aurait vu un pouvoir
civil s'élever, dans l'intérêt de tous,
citoyens, alliés et provinciaux, au-dessus de la
faction des grands.
Rome va se débattre un siècle entier au milieu
des égorgements, des proscriptions et des ruines
contre cette inévitable solution du problème de
ses destinées, que la guerre civile fit sanglantes et
que Caïus aurait pu faire pacifiques. Mais qui jeta Rome
dans cette voie douloureuse ? Ceux qui ouvrirent l'ère
des révolutions, en assassinant les tribuns dont les
lois auraient assuré aux Romains, pour plusieurs
générations, le repos et la liberté. Les
violences exercées contre les Gracques et leurs amis
en susciteront d'autres, et, comme la justice était du
côté des premières victimes, ce seront
les fils des meurtriers qui subiront l'expiation
dernière. La logique de l'histoire veut que toute
grande faute, politique ou sociale, soit punie.