 | C'était dans la dernière année du règne d'Hérode le Grand, prince de Jérusalem, qui gouvernait les Juifs au nom de César Auguste, empereur des Romains. |
 |
Un soir d'hiver, le long du rivage occidental de la mer Morte, deux cortèges étranges allaient lentement l'un vers l'autre, à la lueur d'une multitude de torches.
En tête de celui qui venait du Nord, jouait une musique barbare, fifres stridents et tambourins de cuivre. Entouré de guerriers à la face plate et féroce, couleur de safran, à la barbe noire comme le jais, à la chevelure tordue en longues tresses, s'avançait, monté sur un cheval cuirassé de lames d'acier, une sorte de géant, plus jaune de figure et de mine plus inquiétante que le reste de sa bande ; ses yeux noirs et durs exprimaient l'insolence de la domination ; une énorme moustache noire retombait jusqu'à sa poitrine : coiffé d'acier, dans sa cotte de mailles d'acier, il étincelait d'une façon sinistre, tel qu'un dieu exterminateur, au-dessus d'une forêt de piques, de haches, de massues et de larges sabres recourbés, qui luisaient au feu rouge des torches, comme inondés d'une rosée sanglante. Plus loin, à l'arrière-garde, une file de mules chargées de tapis et de tentes cheminaient pesamment, encouragées par le cri rauque d'esclaves à demi nus ; éclairées par le flamboiement du cortège royal, elles traînaient sur les grèves et les eaux noires du lac maudit une vision d'ombres monstrueuses. Mais le roi formidable ne voyait autour de lui ni les gardes qui veillaient sur sa chevauchée mystérieuse, ni la mer impure, unie comme le marbre d'une tombe, ni la lande violette où rampaient des vapeurs livides, ni les montagnes ténébreuses dressées dans les profondeurs du désert ; la tête tournée vers sa droite, il regardait d'un oeil fixe, tout enfiévré de terreur religieuse, une grande étoile d'or qui penchait sur le couchant et glissait, solitaire, dans les replis de l'azur. |  |
 |
 | L'autre cortège, qui suivait la rive méridionale et sortait des steppes horribles de l'Arabie, était plus extraordinaire encore. La lumière vacillante des torches élevées par des esclaves au teint de bronze, revêtus de tuniques blanches, la tête couverte de voiles blancs, montrait une procession d'éléphants noirs drapés de pourpre, sur le dos desquels se pressait une foule d'hommes au visage pâle, aux yeux très doux, dont les robes de soie vermeille ruisselaient de pierreries ; des vieillards, le front ceint de bandelettes de laine blanche, dont la barbe vendait jusqu'à la ceinture, portaient des camails d'hermine où tremblaient des étincelles de diamants ; des pages charmants tiraient de légères cithares aux cordes d'or des mélodies lentes, douloureuses, d'une suavité troublante ; des ascètes, au corps décharné, au visage aride, aux yeux morts, psalmodiaient sourdement, sans s'arrêter jamais, des oraisons mélancoliques. Tout au milieu du cortège, là où la musique pleurait en accords plus tristes, où la prière était plus lugubre, marchait un éléphant colossal, tout blanc, harnaché d'une tour d'ivoire, sur la plate-forme de laquelle se tenait à demi couché, à demi noyé dans la neige des fourrures précieuses, un jeune homme d'une beauté merveilleuse, enveloppé d'hermine, couronné de rubis, et qui semblait languir de lassitude mortelle. Et tous ils allaient, bercés par les murmures sacrés, avec une pose et un geste hiératiques, pareils à des idoles perdues dans le crépuscule effrayant d'un temple ; attentifs à leur seul rêve, ils ne voyaient ni la montagne, ni la mer, ni la lande désolée, ni la nuit scintillante. Seul, le jeune roi suivait du regard, avec une tendresse infinie, la course de l'étoile d'or, de l'étoile solitaire qui lui souriait du fond du ciel. |
 |
Les deux cortèges fantastiques n'étaient plus maintenant qu'à une faible distance l'un de l'autre. Tout à coup la carapace massive des éléphants fut secouée d'un frisson ; ils agitèrent leurs trompes et lancèrent un barrit furieux ; les fifres et les tambourins leur irritaient les oreilles ; les faces jaunes et les corps vêtus d'acier, dans la fumée rouge, les épouvantaient. Le jeune roi, du haut de son trône, ordonna que l'on fît halte ; le roi guerrier, d'un terrible coup de tam-tam, arrêta sa troupe ; des deux côtés, on s'observa longuement, en un silence plein de menaces.
 |
Les rois échangèrent des ambassades. Chacun d'eux parut fort surpris par le récit que lui rapporta son propre légat. Une heure plus tard, à l'abri d'une tente de pourpre, accoudés à des coussins, près d'un brasero où les esclaves brûlaient les parfums les plus exquis de l'Asie, les deux voyageurs se contaient comment ils se trouvaient cette nuit-là sur les bords lamentables de la mer Morte.
 | «Je suis le plus malheureux des princes, dit le roi venu du Nord. Mon empire est si vaste que je n'en connais point les bornes vers la région où le soleil se couche. Partout ailleurs, ma puissance ne cesse qu'à la mer ou à des montagnes si prodigieuses que le pied de l'homme ne peut les franchir. Tous les peuples jaunes tremblent sous ma main. Je possède des provinces où les fleurs sont toujours épanouies, les fruits toujours dorés, et des déserts dont le souvenir seul fait frémir ; jamais la glace n'y fond, jamais la tempête ne s'y calme et pas une bête vivante ne s'y rencontre. Au cœur de mon royaume s'étend un vaste pays magique où pèse un brouillard éternel, où courent des fantômes et des démons dont la voix, plus plaisante à ouïr que le chant des jeunes filles, attire les hommes à des gouffres sans fond. |
 |
J'ai aussi de beaux et larges fleuves, très commodes pour le transport des denrées, mais qui nourrissent des caïmans en trop grande abondance. Toutes ces misères, qui ne font pâtir que mes sujets, ne m'empêcheraient point, à la vérité, de vivre parfaitement joyeux. On m'appelle le Fils du Ciel, mes ancêtres étaient tous Fils du Ciel ; mais, dans l'intimité, pour mes douze cents femmes et mes enfants, mon nom est Gaspard. Malheureusement, le Fils du Ciel ne connaît point son Père Céleste.
 |
Je suis le Pontife unique d'un dieu incertain, sorti du cerveau d'un grand philosophe, mort il y a plusieurs centaines d'années. Mes temples, dépourvus de prêtres et d'adorateurs, sont toujours vides. Mes peuples se contentent sottement de divinités aussi hideuses que ridicules, en présence desquelles je suis forcé, par bonne politique, de faire la révérence. Figurez-vous, auguste frère, des scorpions gros comme des bœufs, des chevaux à tête de serpent, des dragons hérissés de plumes, des crapauds dont la gueule engloutirait sans peine le plus lourd de vos éléphants ! Un grand dieu chimérique et une foule de monstres en plâtre et en toiles peintes ne sont point les ressorts d'une sérieuse police. A la rigueur, avec mon armée, mes espions et mes bourreaux, je m'assurerais de la paix publique. |  |
 | Si une province se révolte ou refuse l'impôt, je déchaîne sur elle cent mille soldats affamés des biens d'ici-bas. J'ai des supplices fort élégants et raisonnablement atroces. Le grand garçon que j'ai placé tout à l'heure à l'entrée de notre tente est le ministre de ma justice : d'un coup de rasoir, il fait voler à vingt pas la tête d'un homme qui marche. |
Mais la fortune méchante me cause parfois de trop cruels embarras. De temps en temps, des armées de sauvages, venus je ne sais d'où, peut-être tombés de la lune, se jettent sur mes plus riches domaines et pillent et massacrent tout. Quand mes généraux paraissent, ils ne trouvent plus personne, ou s'ils atteignent l'ennemi, ils sont régulièrement battus d'une façon honteuse. Alors le peuple, dont l'esprit est naturellement faux, s'en prend à mon dieu et le charge de toutes ses souffrances, et, comme ce dieu n'appartient qu'à moi seul, c'est à moi seul qu'il demande compte du sang versé, des villes et des moissons brûlées, des enfants outragés. Chaque nuit, le cauchemar d'une révolution visite ma couche. Je rêve que ma tête sacrée et mes membres inviolables sont promenés en petits morceaux dans les cités les plus lointaines du royaume.
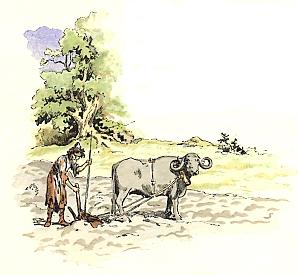 |
Simple laboureur avec une charrue de bois, humble marinier avec une vieille barque, je serais plus heureux. J'ai consulté mes astrologues et mes magiciens ; longtemps leurs réponses m'ont déplu et plusieurs, pour cela, furent étranglés. L'un d'eux, un devin, aveugle et centenaire, me dit enfin :
«Roi Gaspard, Empereur du monde, monte sur ton cheval de guerre et dirige-toi à la fois vers le midi et le couchant : une étoile inconnue jusqu'à présent y paraîtra bientôt : oriente-toi sur l'étoile, sans jamais te décourager ; une nuit, elle demeurera immobile, et d'un triple rayon elle éclairera le berceau d'un dieu. Si ce dieu accepte ta foi, tu seras sauvé et bien heureux ! »
 |
J'ai franchi l'Asie, l'oeil fixé chaque nuit sur l'étoile. Elle m'a guidé à travers le brouillard et les tempêtes de neige. Mais je chevauche depuis près de deux années sur le même air de musique ; je me sens bien fatigué et je voudrais demain découvrir le dieu ! »
Ce conte d'Emile Gebhart a été publié pour la première fois dans Au son des cloches (1898).
L'édition présente est celle de Ferroud (1919) et les illustrations sont de Serge de Solomko.