Pompéi et Herculanum
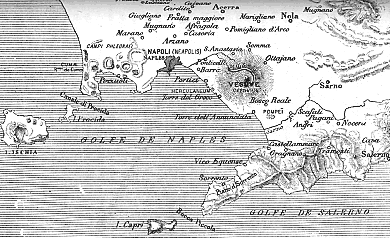 |
Quittons maintenant l'Orient, où nous sommes restés jusqu'alors, et que notre Odyssée, comme celle d'Ulysse, se poursuive jusqu'en Occident et aux rives fortunées de l'Italie. Ici ce ne sont plus des civilisations antiques, douteuses en quelque sorte, et plus imposantes par leur masse qu'intéressantes par leurs détails, que nous allons rencontrer. Ce sont nos soeurs aînées, la Grèce et Rome, qui, dans les champs où nous abordons, ont vécu ensemble et se sont données la main.
Cette heureuse terre, Campania felix, eut cette destinée de servir de trait d'union aux peuples de l'Orient et de l'Occident. Grecs, Africains et Italiens unirent là et confondirent leurs aspirations et leurs goûts. Le pays de Naples, «ce doux coin du ciel tombé sur la terre», fut toujours adoré par ses habitants, envié ou regretté de ceux qui l'avaient vu une fois seulement. Encore aujourd'hui, c'est un proverbe italien : «Voir Naples et mourir».
Tout y était fait pour la vie molle, insoucieuse, épicurienne. Là une civilisation à son enfance devait mettre son Eden : cétait là, d'après Homère, que les fleuves de lait coulaient dans les prairies. Là surtout une civilisation à son déclin devait porter tout l'effort de son luxe, se bercer mollement au doux balancement des vagues du beau golfe et s'endormir dans une longue et charmeuse rêverie, loin de la préoccupation des misères humaines et de la crainte des dieux.
C'est l'impression mystérieusement douce qui se dégage de cette côte et qu'exprime l'harmonieux vers du poète :
Sorrente m'a rendu mon doux rêve infini.
Cependant, la félicité de cette terre où les villages, les bourgs et les villes se pressaient l'un contre l'autre, où les amateurs et les lettrés de la capitale venaient se reposer de leurs fatigues, et quelquefois attendre la mort dans le calme et le repos de la nature, cette félicité, dis-je, n'était peut-être qu'apparente. Il y avait deux ennemis cachés qui guettaient cette riche proie, et ce coin de paradis n'était pas loin d'une des bouches de l'enfer.
Il y avait là, disons-nous, deux périls graves : on pouvait craindre l'eau et on pouvait craindre le feu. Ce sont là les deux ennemis que l'Italie redoute ; l'eau qui envahit et transforme en marais puants les riches plaines couvertes de moissons ; le feu qui mine, éclate, brûle, étouffe.
L'envahissement de l'eau était peu à craindre au moment où Romains et Grecs mêlés habitaient cette côte. Nous savons qu'elle avait été colonisée par les Etrusques ; habiles à dessécher et à cultiver, ils avaient par des travaux séculaires établi la sécurité de la plaine. Il n'a pas fallu moins que des milliers de siècles d'abandon pour que le travail ancien fût perdu, et pour que nos yeux aient le triste spectacle qui frappe maintenant dans ces plaines :
«Aujourd'hui, Baia, le délicieux séjour des nobles romains ; Paestum, avec ses champs de roses, tant aimés d'Ovide, tepidi rosaria Paesti ; la riche Capoue, et Cumes, qui fut un temps la plus puissante cité de l'Italie, et Sybaris, qui en était la plus voluptueuse, sont au milieu d'eaux stagnantes et fétides, dans la plaine fiévreuse, febbrosa, «où la terre pourrie mange plus d'hommes qu'elle ne peut en nourrir». Les miasmes pestilentiels, la solitude et le silence ont aussi reconquis les bords du golfe de Tarente, 190 kilomètres de côtes ; dans le Latium, 150 kilomètres carrés de pays furent abandonnés aux influences délétères» (Duruy).
Mais, nous l'avons dit, ce danger qui nous apparaît maintenant dans une si triste réalité était conjuré, aux temps anciens, rien que par le soin avec lequel étaient entretenus les premiers travaux d'assèchement.
L'autre péril que nous avons signalé, le feu, était totalement oublié. A cet égard, on vivait dans une sécurité parfaite ; les villes, les villages, les riches maisons de campagne s'entassaient, se pressaient sur les bords de la mer, au pied de la montagne. Des populations actives, industrieuses s'agitaient comme les abeilles auprès des ruches et tiraient parti de la situation exceptionnelle de la contrée ; plus de 40 000 âmes à Pompéi ; partout, à Herculanum, à Stabies, à Stola, à Veseris, à Sorrente, sans parler de Naples, une population dense, de commerçants, de marins, et de villégiateurs qui vivaient sans autre souci que ceux de la vie présente et sans songer au terrible réveil qui les menaçait.
Strabon, géographe observateur, qui visita cette région quelque temps avant la catastrophe, s'écrie : «C'est le plus heureux pays que l'on connaisse !» et il ajoute avec insouciance en parlant du volcan éteint : «Au-dessus de ces lieux est situé le mont Vésuve, entouré de toutes parts de campagnes fertiles, mais dont le sommet presque plat est entièrement stérile. Son sol, à la surface, a l'apparence de la cendre, et on y retrouve l'entrée de cavernes profondes qui s'ouvrent dans tous les sens ; les pierres paraissent, à leur couleur noire, avoir été brûlées par le feu, tellement qu'il y a lieu de conjecturer que, dans l'antiquité, cette montagne fut un volcan qui s'est éteint faute d'aliments».
Strabon ne se doutait guère, et les habitants du pays pensaient moins encore que ce volcan se rallumerait un jour et que ces laves refroidies auxquelles ils attribuaient la fertilité de leurs champs, n'étaient que les précurseurs de celles qui devaient les ensevelir bientôt sous leur épouvantable déluge.
Bien des symptômes menaçants eussent dû cependant tenir leurs esprits dans une anxieuse et perpétuelle attente. A lui seul, l'ancien nom du pays eût suffi. En effet, si la province entière s'appelait l'heureuse Campanie, la partie qui avoisinait les bords de la mer avait été autrefois désignée sous le nom de champs de flamme : campi phlaegraei, et Diodore de Sicile nous apprend que ce nom avait été donné en souvenir des feux que le Vésuve lançait autrefois comme l'Etna et dont les traces subsistaient dans tout le voisinage.
C'était là encore que la légende plaçait le lieu de la lutte des Titans contre les dieux ; ils avaient voulu, disait-on, escalader l'Olympe, et l'Etna lui-même n'était rien autre que le tombeau sous lequel l'un d'entre eux vomissait sa rage et son haleine enflammée contre le ciel ; quelle autre allégorie que celle des volcans en éruption se cachait sous cette ancienne légende ?
C'était là encore que vivait autrefois ce monstrueux Cacus dont la massue d'Hercule avait pu seule débarrasser la contrée. La longue troupe de boeufs emmenée par le héros hors de la caverne du monstre, qu'était-ce autre chose que la fertilité et les gras pâturages rendus à la région, après le desséchement de quelque horrible maremme ?
Non loin de là on rencontrait le cap Misène, que la mort de Palinure avait rendu célèbre ; et en face Caprée, où le sombre tyran Tibère avait cherché la solitude ; Puteoli, au nom sinistre ; Baia, réputée par ses eaux thermales «également propres, dit Strabon, au pur délassement de ceux qui s'y baignent et à la guérison des malades», mais, à coup sûr, indices significatifs de la nature volcanique du terrain ; plus haut enfin, nous l'avons dit déjà, s'ouvrait horriblement une des bouches de l'enfer : c'était le lac Averne, au-dessus duquel les oiseaux ne volaient pas impunément «quem non impune volantes»... Sur ses bords, d'après la tradition, avait eu lieu l'évocation des mânes par Ulysse, et là avait parlé l'oracle des morts : «Aujourd'hui, ajoute encore Strabon, que la forêt qui obombrait les contours du lac Aornus a été abattue par les ordres de Marcus Agrippa, que les arbres ont été remplacés par un grand nombre d'édifices et que l'on a vu percer la route souterraine qui conduit de l'Aornus à Cyme, le mythe est dévoilé».
Certes, le scepticisme de siècles plus avancés pouvait se railler élégamment des anciennes légendes ; mais l'attention des hommes ne devait pas se détourner de l'observation des phénomènes dangereux que le mythe - dévoilé maintenant - avait signalés autrefois.
Ce n'était pas assez des anciens récits et des vieux noms, traces confuses de souvenirs à peu près effacés ; la terre elle-même, dans les derniers temps, plusieurs fois avait parlé. Des secousses plus ou moins violentes avaient remué le sol de la Campanie. On commençait même à s'y habituer, et Pline le Jeune l'observe.
Le 5 février de l'an 63, un avertissement plus terrible encore avait été donné. Sénèque dit : «Pompéi, ville considérable de la Campanie, qu'avoisinent d'un côté le cap de Sorrente et Stabies et, de l'autre, le rivage d'Herculanum, entre lesquels la mer s'est creusé un rivage riant, fut abîmée par un tremblement de terre dont souffrirent tous les alentours, et cela en hiver, saison privilégiée contre ces sortes de périls, au dire habituel de nos pères. Cette catastrophe eut lieu le jour des nones de février, sous le consulat de Régulus et de Virginius. La Campanie qui n'avait jamais été sans alarme, bien qu'elle fût restée sans atteinte et n'eût payé au fléau d'autre tribut que la peur, se vit cette fois cruellement dévastée. Outre Pompéi, Herculanum fut en partie détruite, et ce qui en reste n'est pas bien assuré. La colonie de Nuceria, plus respectée, n'est pas sans avoir à se plaindre. A Naples, beaucoup de maisons particulières ont péri ; mais les édifices publics ont résisté : l'épouvantable désastre n'a fait que l'effleurer. Des villas furent ébranlées sans éprouver d'autres dommages. On ajoute qu'un troupeau de six cents moutons perdit la vie, que des statues se fendirent et qu'on vit errer dans la campagne des malheureux auxquels la frayeur avait fait perdre la raison».
Cette fois, le drame était bien réellement ouvert. Sans que le volcan eût encore rendu béante aucune de ses bouches redoutables, du moins on devait sentir que quelque chose de sombre et de terrible se préparait dans ses flancs. Une fausse sécurité n'en régna pas moins bientôt dans tout le voisinage. Les maisons ruinées se relevèrent rapidement ; les statues des dieux abattues reprirent leur place et rendirent, s'il en fut besoin, de nouveaux oracles ; les temples avaient été démolis ; on se mit à les relever sur de nouveaux plans et avec un luxe plus grand encore ; le forum de Pompéi, qui avait si gravement souffert, fut repris et reconstruit sur de nouvelles bases. Les édiles soigneux profitèrent du désastre pour inaugurer un alignement plus régulier ; on se mit à l'ouvrage avec ardeur, et bientôt presque il n'y parut plus.
Dix-sept ans n'étaient pas écoulés, et le souvenir de ce grand malheur n'existait plus guère que dans la mémoire de quelques vieillards, porteurs de mauvais présages, quand tout à coup, sur la fin du mois d'août alors qu'une chaleur torride accablait hommes et animaux ; au milieu d'une de ces journées brûlantes, africaines, qui à cette époque de l'année ne sont pas rares dans le sud de l'Italie, tout à coup un hideux nuage rougeâtre s'éleva sur l'horizon, et comme un immense pin, arbre de mort, couvrit les campagnes et les villes de son ombre. Les feux souterrains avaient enfin fait voler en éclat le couvercle qui les cachait depuis tant de siècles. Le volcan était rallumé pour ne plus s'éteindre.
Laissons maintenant parler un témoin oculaire de la catastrophe ; c'est Pline le Jeune : «Vous me priez, écrit-il à Tacite, de vous apprendre au vrai comment mon oncle est mort, afin que vous puissiez en instruire la postérité. Je vous en remercie, car je conçois que sa mort sera suivie d'une gloire immortelle si vous lui donnez place dans vos écrits. Quoiqu'il ait péri par une fatalité qui a désolé de très beaux pays, et que sa perte, causée par un accident mémorable et qui lui a été commun avec des villes et des peuples entiers, doive éterniser sa mémoire ; quoiqu'il ait fait bien des ouvrages qui dureront toujours, je compte pourtant que l'immortalité des vôtres contribuera beaucoup à celle qu'il doit attendre. Pour moi, j'estime heureux ceux à qui les dieux ont accordé le don ou de faire des choses dignes d'être écrites, ou d'en écrire de dignes d'être lues, et plus heureux encore, ceux qu'ils ont favorisés de ce double avantage. Mon oncle tiendra son rang entre ces derniers et par vos écrits et par les siens, et c'est ce qui m'engage à exécuter plus volontiers des ordres que je vous aurais demandés.
Il était à Misène, où il commandait la flotte. Le 25e d'août, environ une heure après midi, ma mère l'avertit qu'il paraissait un nuage d'une grandeur et d'une figure extraordinaires. Après avoir été quelque temps couché au soleil, selon sa coutume, et avoir pris un bain d'eau froide, il s'était jeté sur un lit où il étudiait. Il se lève et monte en un lieu d'où il pouvait aisément observer ce prodige. Il était difficile d'observer de loin de quelle montagne sortait ce nuage ; l'événement a découvert, depuis, que c'était du mont Vésuve ; sa forme approchait d'un arbre et de celle d'un pin plus que de tout autre ; car, après s'être élevé fort haut en forme de tronc, il étendait une espèce de feuillage. Je m'imagine qu'un vent souterrain violent le poussait d'abord avec impétuosité et le soutenait ; mais, soit que l'impulsion diminuât peu à peu, soit que ce nuage fût affaissé par son propre poids, on le voyait s'élargir et se répandre ; il paraissait tantôt blanc, tantôt noirâtre et tantôt de diverses couleurs, selon qu'il était plus chargé ou de cendre ou de terre. Ce prodige surprit mon oncle, qui était très savant, et il le crut digne d'être examiné de plus près. Il commande que l'on apprête sa frégate légère et me laisse la liberté de le suivre. Je lui répondis que j'aimais mieux étudier, et, par hasard, il m'avait donné lui-même quelque chose à écrire.
Il sortait de chez lui, ses tablettes à la main, lorsque les troupes de la flotte qui étaient à Rétina, effrayées par la grandeur du danger (car ce bourg est précisément en face de Misène et on ne s'en pouvait sauver que par la mer), vinrent le conjurer de vouloir bien les garantir d'un si affreux péril. Il ne changea pas de dessein et poursuivit avec un courage héroïque ce qu'il n'avait entrepris d'abord que par simple curiosité. Il fait venir des galères, monte lui-même dessus, et part dans le dessein de voir quels secours on pouvait donner non seulement à Rétina, mais à tous les autres bourgs de cette côte, qui sont en grand nombre à cause de sa beauté. Il se presse d'arriver au lieu d'où tout le monde fuit et où le péril paraissait plus grand, mais avec une telle liberté d'esprit qu'à mesure qu'il apercevait quelque mouvement ou quelque figure extraordinaire dans ce prodige, il faisait ses observations et les dictait.
Déjà sur ses vaisseaux volait la cendre, plus épaisse et plus chaude à mesure qu'ils approchaient ; déjà tombaient autour d'eux des pierres calcinées et des cailloux tout noirs, tout brûlés, tout pulvérisés par la violence du feu ; déjà la mer semblait refluer et le village devenir inaccesible par des morceaux entiers de montagne dont il était couvert, lorsque, après s'être arrêté quelques moments, incertain s'il retournerait, il dit à son pilote, qui lui conseillait de gagner la pleine mer : La fortune favorise le courage. Tournez du côté de Pomponianus. Pomponianus était à Stabie, en un endroit séparé par un petit golfe que forme insensiblement la mer sur ces rivages qui se courbent. Là, à la vue du péril, qui était encore éloigné, mais qui semblait s'approcher toujours, il avait retiré tous ses meubles dans ses vaisseaux, et n'attendait pour s'éloigner qu'un vent moins contraire.
Mon oncle, à qui ce vent avait été très favorable, l'aborde, le trouve tout tremblant, l'embrasse, le rassure, l'encourage, et, pour dissiper par sa sécurité la crainte de son ami, se fait porter au bain. Après s'être baigné, il se met à table et soupe avec toute sa gaieté ou (ce qui n'est pas moins grand) avec toutes les apparences de sa gaieté ordinaire.
Cependant on voyait luire, de plusieurs endroits du mont Vésuve, de grandes flammes et des embrasements dont les ténèbres augmentaient l'éclat. Mon oncle, pour rassurer ceux qui l'accompagnaient, leur dit que ce qu'ils voyaient brûler c'étaient des villages que les paysans alarmés avaient abandonnés et qui étaient restés sans secours. Ensuite, il se coucha et dormit d'un profond sommeil ; car, comme il était puissant, on l'entendait ronfler de l'antichambre. Mais enfin la cour par où on entrait dans son appartement commençait à se remplir si fort de cendres que, pour peu qu'il fût resté plus longtemps, il ne lui aurait plus été libre de sortir. On l'éveille ; il sort et va rejoindre Pomponianus et les autres, qui avaient veillé.
Ils tiennent conseil et délibèrent s'ils se renfermeront dans la maison ou tiendront la campagne ; car les maisons étaient tellement ébranlées par les fréquents tremblements de terre, que l'on aurait dit qu'elles étaient successivement arrachées de leurs fondements et remises à leur place. Hors de la ville, la chute des pierres, quoique légères et desséchées par le feu, était à craindre. Entre ces périls, on choisit la rase campagne. Chez ceux de sa suite, une crainte surmonta l'autre ; chez lui la raison la plus forte l'emporta sur la plus faible. Ils sortent donc et se couvrent la tête d'oreillers attachés avec des mouchoirs, ce fut toute la précaution qu'ils prirent contre ce qui tombait d'en haut. Le jour recommençait ailleurs ; mais dans le lieu où ils étaient, continuait la nuit, la plus sombre et la plus affreuse de toutes les nuits, et qui n'était un peu dissipée que par la lueur d'un grand nombre de flambeaux et d'autres lumières.
On trouva bon de s'approcher du rivage et d'examiner de près ce que la mer permettait de tenter ; mais on la trouva encore fort grosse et fort agitée d'un vent contraire. Là, mon oncle, ayant demandé de l'eau et bu deux fois, se coucha sur un drap qu'il fit étendre. Ensuite des flammes qui parurent plus grandes et une odeur de soufre qui annonçait leur approche mit tout le monde en fuite. Il se lève, appuyé sur deux valets, et dans le moment tombe mort. Je m'imagine qu'une fumée trop épaisse le suffoqua, d'autant plus aisément qu'il avait la poitrine faible et souvent la respiration embarrassée.
Lorsque l'on commença à revoir la lumière (ce qui n'arriva que trois jours après), on retrouva au même endroit son corps entier couvert de la même robe qu'il avait quand il mourut, et dans la posture plutôt d'un homme qui repose que d'un homme qui est mort. Pendant ce temps, ma mère et moi nous étions à Misène. Mais cela ne regarde plus votre histoire ; vous ne voulez être informé que de la mort de mon oncle. Je finis donc, et je n'ajoute qu'un mot : c'est que je ne vous ai rien dit que je n'aie ou vu ou appris dans ces moments où la vérité de l'action qui vient de se passer n'a pu être altérée. C'est à vous de choisir ce qui vous paraîtra plus important. Il y a bien de la différence entre écrire une lettre ou une histoire, écrire pour un ami ou pour la postérité. Adieu».
Pour compléter ces détails sur l'étendue et la nature du désastre, il nous suffira d'ajouter ici quelques-unes des observations que la science moderne a faites sur les plus modernes éruptions du Vésuve. Michelet les a résumées dans les premières pages de son Histoire romaine : «Herculanum, dit-il, est ensevelie sous une masse épaisse de quatre-vingt-douze pieds. Il fallut presque, pour produire un pareil entassement, que le Vésuve se lançât lui-même dans les airs.
Nous avons des détails précis sur plusieurs éruptions, entre autres sur celle de 1794. Le 12 juin, de dix heures du soir à quatre heures du matin, la lave descendit à la mer sur une longueur de 12 000 pieds et une largeur de 1500 ; elle y poussa jusqu'à la distance de 60 toises.
Le volcan vomit des matières équivalant à un cube de 2 804 400 toises. La ville de Torre del Greco, habitée de 15 000 personnes, fut renversée. A dix ou douze milles du Vésuve, on ne marchait, à midi, qu'à la lueur des flambeaux. La cendre tomba à la hauteur de quatorze pouces et demi, à trois milles autour de la montagne. La flamme et la fumée montaient trois fois plus haut que le volcan. Puis vinrent quinze jours de pluies impétueuses, qui emportaient tout, maisons, arbres, ponts, chemins. Des moffettes tuaient les hommes, les animaux, les plantes jusqu'à leurs racines, excepté les poiriers et oliviers, qui restèrent verts et vigoureux.
Ces désastres ne sont rien encore en comparaison de l'épouvantable tremblement de terre de 1783, dans lequel la Calabre crut être abîmée. Les villes et les villages s'écroulaient ; des montagnes se renversaient sur les plaines. Des populations, fuyant les hauteurs, s'étaient réfugiées sur le rivage : la mer sortit de son lit et les engloutit. On évalue à 40 000 le nombre des morts».
On peut, à ces traits à la fois historiques et scientifiques, se faire une idée de l'étendue du premier désastre et de la terreur qui dut frapper soudainement les habitants de ces fertiles rivages. L'Italie entière ressentit la terrible secousse ; à Rome, le soleil se cacha, comme au jour de la mort de César.
Cum caput obscura nitidum ferrugine texit
Impiaque aeternam timuerunt saecula noctem.
Des tourbillons de cendre furent emportés, dit-on, jusqu'en Egypte, jusqu'en Asie.
Le monde entier prit sa part du deuil immense qui frappait la Campanie.
Ici, cinq villes, sans compter les bourgs, les villages et les maisons de plaisance, cinq villes disparurent complètement ; Herculanum, Retina et Oplonte, enfouies sous une couche durcie de laves ; Pompéi et Stabie, recouvertes seulement d'un linceul de cendres légères et de ces petites pierres nommées en Italie lapilli.
On a beaucoup répété, - et un roman célébre a rendu populaire cette affirmation, - que le désastre avait été tellement subit que les habitants des villes voisines n'avaient pu échapper ; on ajoutait que la catastrophe avait surpris les Pompéiens dans un jour de fête, la foule étant assemblée au théâtre, et que la plus grande partie des spectateurs avait été ensevelie. Le récit de Dion, sur lequel est appuyé cette tradition, est absolument erroné. L'on ne peut croire, d'après ce que dit Pline et d'après les études faites sur les éruptions postérieures du Vésuve, que celle dans laquelle périt Pompéi ait pu avoir un caractère aussi brusque ; d'ailleurs, le petit nombre de morts trouvés dans les fouilles, et surtout l'absence complète de cadavres dans l'amphithéâtre, mis absolument à jour, suffit pour infirmer le récit de l'historien grec.
Il n'en est pas moins vrai que tous les habitants de la contrée furent saisis au milieu de leurs occupations habituelles et journalières ; que, s'ils eurent le temps de se sauver, - au moins en partie, - ils durent laisser dans leurs demeures ce qu'ils avaient de plus précieux : argent, bijoux, statues des dieux, meubles de luxe, tout ce qu'on emporte dans les catastrophes de ce genre. On a remarqué seulement que, plus tard, des fouilles furent pratiquées pour rechercher quelques-uns des objets les plus précieux. Probablement, plusieurs des malheureux fugitifs revinrent là creuser quelque trou et percer quelques murailles, espérant rencontrer des débris de leur ancienne fortune ; mais ces recherches n'eurent rien de général. Le gouvernement de l'empire, - Titus régnait en ce temps-là, - sembla d'abord s'intéresser au sort de ces malheureuses populations ; on parla même de rebâtir les villes détruites. Mais la mort de Titus et peut-être la crainte de nouveaux désastres empêchèrent que ces projets fussent jamais mis à exécution.
Peu à peu l'oubli s'étendit sur la mémoire de ces villes que la cendre ensevelissait si profondément ; c'est à peine si quelques curieux, dans l'antiquité, y firent faire des fouilles. A la longue, d'autres malheurs plus actuels et plus sensibles, l'appauvrissement de l'Italie, la ruine de l'empire lui-même, enfin l'invasion des barbares, achevèrent ce que le temps seul eût suffi à accomplir : on n'y pensa plus.
A peine si le nom transmis traditionnellement dans la bouche des hommes du pays, quelque mention succincte gisant au fond des bibliothèques monacales, ou la rencontre hasardeuse d'un marbre, d'un bronze, d'une pierre antique faite par un paysan remuant la terre, pouvaient encore apprendre au monde que là, à quelques pieds sous le sol, gisaient tout entières des villes qui avaient été grandes et florissantes, et que quelques coups de bêche suffiraient à tirer de leur long sommeil.
Des siècles s'écoulèrent.
En 1592, le gouvernement napolitain fit creuser un canal pour dériver le Sarno ; il se trouva qu'il traversait de part en part les ruines de Pompéi. Pour l'exécuter, il fallait à chaque instant percer des pans de murailles, écarter les pierres de l'ancienne ville. Qui croirait que de pareilles rencontres passèrent en quelque sorte inaperçues, et qu'à une époque où l'on s'occupait si activement d'exhumer les restes de la civilisation et des arts antiques, on ne songea pas à reconnaître les ruines que l'on venait de heurter par hasard ?
Un siècle plus tard, ou peu s'en faut, un boulanger de Portici creusait un puits. Il tomba juste au milieu du théâtre d'Herculanum : l'envie de se procurer des objets d'art anciens éveilla l'attention du prince d'Elbeuf, qui se trouvait alors dans le pays à la tête d'une armée impériale. Il acheta le terrain, fit continuer les fouilles et trouva plus qu'il ne pensait. Il cherchait quelques marbres et rencontra une ville. Cette fois, Herculanum était découverte.
La chose fit du bruit dans le monde. On entrait alors dans le dix-huitième siècle, siècle de fécondes recherches et d'inquiète curiosité. Quoique le gouvernement de Naples eût fait d'abord suspendre les fouilles ; sous la pression de l'opinion publique on dut bientôt les reprendre. Avec un esprit d'avidité plutôt que de science, on déblaya une partie de la ville, recueillant les oeuvres d'art et les objets précieux, fouillant à la hâte les maisons, les temples, les théâtres qui apparaissaient successivement. Le butin ramassé, on se hâtait de recouvrir de nouveau les précieux restes qui un instant avaient revu le jour. Les objets d'art que l'on avait trouvés étaient eux-mêmes traités avec une négligence impardonnable ; on ne les sauvait de l'oubli que pour les livrer, en partie, à une définitive destruction.
Cependant, ces résultats, si imparfaits qu'ils fussent, avaient déjà levé une rumeur considérable dans le monde des savants. Des travaux nombreux paraissaient de jour en jour, des opinions diverses étaient soutenues à l'occasion de ces précieux restes de l'antiquité. Une découverte nouvelle vint donner aux recherches et aux études une décisive impulsion.
Un cultivateur, labourant au lieu dit la Cività, heurta un bronze ancien. On chercha tout autour. C'était plus facile qu'à Herculanum ; là-bas, il fallait à coup de pioche briser la lave durcie par le feu ; ici, la pelle suffisait pour écarter les cendres et les petites pierres. Les travaux allèrent vite ; ce qu'on trouvait d'ailleurs était fait pour les activer. On avait découvert Pompéi.
Dès lors les travaux d'Herculanum furent presque totalement abandonnés ; tous les efforts furent dirigés vers la ville nouvellement apparue. Les gouvernements successifs s'appliquèrent avec plus ou moins de zèle à fournir les fonds nécessaires pour que le travail ne fût jamais totalement interrompu. Il faut mentionner en particulier la direction donnée par le général Championnet en 1709, lors de l'occupation française ; le soin que mit J. Murat à suivre cette impulsion, et enfin l'attention qui porte le gouvernement actuel à ne pas l'interrompre.
Dès 1824, la belle publication du Museo Borbonico pouvait donner une connaissance générale de l'ensemble des recherches et faire pénétrer intimement dans de nombreux détails ; depuis lors, le courant de publications importantes n'a pas tari. Italiens, Français, Anglais, Allemands ont rivalisé de zèle ; et de nos jours, M. Fiorelli, mis par le gouvernement italien à la tête des fouilles, ne manque pas de tenir fréquemment le monde des curieux au courant des nouvelles découvertes.
Il faut avouer pourtant que, eu égard à la facilité du travail, l'impatience publique pourrait demander plus d'activité encore. Un siècle entier n'a pas suffi pour arracher de ses cendres Pompéi tout entière. Un auteur qui a écrit sur la matière se console de cette lenteur par une observation qui ne manque pas de justesse. Les restes de ces anciennes villes maintenant remises au grand jour se trouvent par là même de nouveau sous l'influence de toutes les causes ordinaires de disparition qui peuvent frapper les oeuvres des hommes. Elles sont donc maintenant condamnées inévitablement à une destruction à laquelle elles échappaient sous leurs cendres. Nous ne pouvons déjà apprécier que trop l'étendue de la rapidité du mal nouveau qui les frappe. Intempéries ou folles curiosités, incendies ou rapacités humaines ont suffi pour en détruire une bonne part. N'y aurait-il pas une sorte d'égoïsme à vouloir ravir trop vite à nos descendants le plaisir que nous avons nous-mêmes et que nos pères ont éprouvé à voir revivre, au moins pour un instant, dans toute leur fraîcheur et avec leur parfum d'actualité en quelque sorte, ces témoins de civilisation romaine ? Ménageons-leur une pareille jouissance.
Elle ne dure qu'un instant et s'échappe pour ne plus revenir.
Quelle que soit la valeur de cette piquante observation, il est heureux pour nous que l'état actuel soit assez avancé et que les fouilles aient porté sur des points assez importants pour que nous puissions nous faire une idée absolument complète de l'apparence de la ville ancienne, des moeurs et des usages de ses habitants.
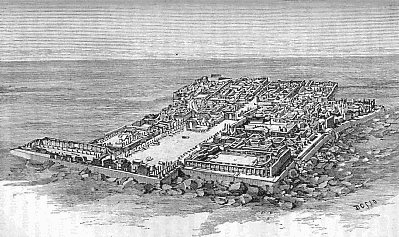 |
Une idée capitale et qu'il ne faut point perdre de vue dans l'étude des ruines de Pompéi, c'est que nous n'avons affaire ici qu'à une ville de troisième ordre. Auprès des colossales cités que nous avons étudiées jusqu'ici, auprès des pylônes de Thèbes, des murailles de Ninive, de la légendaire antiquité de Troie, de l'histoire dramatique de Carthage, certes, ces nouvelles cités paraitront bien modestes. Leur désastre seul les a rendues célèbres. Sans l'éruption de l'an 79 qui parlerait de Pompéi et d'Herculanum ?
Peut-être cependant, à le bien prendre, que leur importance, plus minime, n'est pas sans contribuer au charme qui nous attire vers elles. Il faut remarquer en effet que la soudaineté même de la catastrophe qui les a fait disparaître, a produit ce résultat heureux que la nature des restes est en quelque sorte proportionnée au peu de renom de ces cités italiennes.
C'est justement la vie intime, journalière, les petits faits de la civilisation, tout ce qui échappe au souvenir et ce qui se perd absolument, parce que l'histoire trouve indigne d'elle de s'en occuper, c'est là surtout ce qui a survécu au naufrage général des générations anciennes par le subit envelissement de ces foyers peu importants et par leur récente découverte. S'il se fût agi de quelque Rome, ou le désastre eût été réparé, - une grande ville ne meurt pas facilement ; ou, au milieu de l'énorme entassement de faits qu'une découverte moderne eût présenté à l'étude, on se fût attaché de préférence aux traits dominants, aux monuments importants, aux grandes traces historiques que les recherches faites là n'eussent pas manqué de rencontrer à chaque pas.
Ici rien de tout cela. Chaque fait si minime qu'il soit attire l'étude, et la mérite. Il est relativement heureux qu'à côté des grandes ruines et des grands souvenirs qu'ont laissés d'autres lieux plus importants, ceux-ci nous aient fourni une somme de renseignements plus intimes et parfois plus directement émouvants. C'est aussi une sorte de bonheur que, dans cette contrée heureuse et fertile, sous ce beau ciel de Naples, au milieu même de la Grande Grèce, la richesse des habitants, l'élégance de la nature, l'état avancé de la civilisation aient toujours entretenu le goût des arts, l'amour du beau, de sorte que, comme a pu le dire Bulwer, «Pompéi ait offert le tableau en miniature de la civilisation du siècle. Elle renfermait dans l'étroite enceinte de ses murs un échantillon de chaque objet de luxe que la richesse et la puissance pouvaient se procurer. Dans ses boutiques petites, mais brillantes, ses palais resserrés, ses bains, son forum, son cirque, dans l'énergie au sein de la corruption, et la civilisation au sein du vice qui distinguaient ses habitants, on voyait un modèle de tout l'empire».
C'est donc le tableau d'une ville de province que nous allons donner ici ; mais d'une ville pleine de luxe, de confortable et d'élégance. N'oublions pas que c'est le lieu que Cicéron avait choisi pour sa retraite, et dont Sénèque parlait avec attendrissement au souvenir des belles années de sa jeunesse qui s'y étaient écoulées.
Pompéi était une ville fortifiée d'une assez médiocre étendue. Le mur qui l'entourait lui donnait une forme assez sensiblement ovale, le plus grand axe se dirigeant de l'Ouest à l'Est, et le plus petit du Sud au Nord. Au dehors de l'enceinte fortifiée, dans la direction d'Herculanum s'étendait un faubourg de création relativernent moderne, qui portait le nom de Pagus Augustofelix. Ce fut là que Sulla d'abord, Auguste plus tard cantonnèrent des colonies de vétérans chargés de surveiller la ville qui, comme le reste de la Campanie, avait pris part à la guerre sociale.
Ce faubourg est lui-même prolongé par la célèbre voie dite des Tombeaux. C'était là, comme sur les côtés de la voie Appia à Rome, que les riches Pompéiens élevaient à leurs morts de somptueux monuments funéraires : c'est par là que les touristes pénètrent habituellement dans la ville. Nous ne pouvons malheureusement dans ce trop court examen suivre l'itinéraire du voyageur plus intéressant peut-être et plus varié, mais à coup sûr moins clair et moins fait pour donner au lecteur une idée nette de la nature des découvertes et de l'ensemble des résultats auxquels on est parvenu jusqu'ici.
Nous allons tout simplement énumérer les monuments principaux sur lesquels s'est portée jusqu'ici l'attention des archéologues.
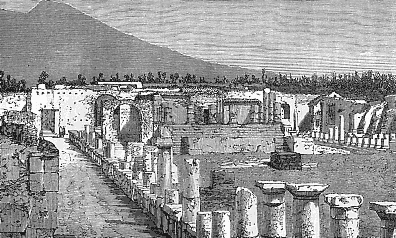 |
Plaçons-nous d'abord au point central de la cité : au forum. C'est là que se passaient les actes les plus importants de la vie publique qui, chez les anciens, tenait bien plus de place que chez nous. Là se discutaient les intérêts de la république ou du municipe, là se traitaient les affaires entre particuliers. Sous ses bruyants portiques se réunissaient les gens à nouvelles, tant ceux qui les cherchaient que ceux qui faisaient profession de les conter aux survenants ; là se rencontraient les plaideurs : le tribunal était à deux pas. Sans qu'il y eût besoin d'huissier, les parties en faisaient elles-mêmes l'office, et traînaient s'il le fallait devant le juge leur adversaire récalcitrant.
Temples, bourses, maisons d'école, cercles de fabricants et de marchands étaient établis dans le voisinage. Tous les intérêts publics se coudoyaient.
Les statues des dieux, des ancêtres, des magistrats et des bienfaiteurs de la cité s'élevaient silencieuses au milieu de cette agitation perpétuelle, inspiraient par leur présence les bons conseils, et rappelaient de nobles exemples.
Le forum à Pompéi n'était pas situé au milieu de la ville. On l'avait mis comme il était d'usage dans toute ville maritime, du côté le plus voisin de la mer.
C'était une grande place de forme rectangulaire, mesurant 157 mètres de longueur sur 55 mètres de large. Elle était dallée en travertin, pierre dure et grisâtre très en usage en Italie. Tout autour elle était entourée d'une colonnade formant portique, sauf sur le côté septentrional où s'élevait la façade du temple de Jupiter.
On pénétrait dans le forum par plusieurs entrées débouchant de préférence aux angles de la place. La plus importante de toutes, la seule par laquelle les voitures pussent pénétrer se trouvait à l'extrémité septentrionale et aboutissait près du temple de Jupiter. Elle terminait la rue du Forum, et était fermée par un arc de triomphe ornée de colonnes et de statues.
Du milieu du forum avant devant nous le temple de Jupiter nous tournons le dos à la campagne, nous regardons la ville. De tous côtés près de nous, nous voyons les ruines des monuments publics les plus importants, à droite :
1° La maison d'école avec le renfoncement où se tenait le professeur, et les niches pratiquées dans la muraille, où les élèves mettaient livres et provisions.
2° Un édifice de forme singulière, de destination problématique auquel on a donné, du nom de la femme qui l'a élevé, l'appellation d'édifice d'Eumachia. Des inscriptions que l'on a trouvées sur les murs de ce bâtiment nous apprennent qu'il a été construit aux frais de cette dame, elle-même prêtresse publique. On a découvert à l'intérieur de l'édifice une statue de femme en marbre, qui est précisément le portrait d'Eumachia et dont le piédestal porte l'inscription suivante : «A Eumachia fille de Lucius, prêtresse publique, les foulons». Cette inscription et les dispositions générales de la construction ont fait penser que l'on avait affaire ici à une sorte de bourse, où les foulons, nombreux à Pompéi, se réunissaient pour traiter de leurs affaires ; à un édifice où s'assemblait selon un usage très répandu dans l'antiquité la corporation, qui, dans sa reconnaissance, éleva à sa bienfaitrice la statue dont nous venons de parler. Lorsqu'on découvrit ce monument vers 1820, on trouva dans ses ruines deux squelettes, l'un coiffé d'un casque, l'autre écrasé sous la chute d'une colonne. Peut-être est-ce le premier de ces squelettes, - sûrement celui d'un militaire, - qui a fourni à Bulwer l'épisode intéressant de ce soldat mourant à son poste sans bouger, pour ne pas enfreindre la consigne qui lui a été donnée, tandis que tout le monde fuit autour de lui.
3° Après l'édifice d'Eumachia vient le temple de Quirinus, ou de Mercure (car on ne sait au juste à quel dieu il était dédié). On y a trouvé un très curieux autel en marbre blanc sur lequel se trouvent sculptées les principales scènes d'un sacrifice.
4° Puis vient un autre édifice qu'on suppose être l'endroit où les magistrats de la ville se réunissaient, la Curie ; mais il est dans un état de ruine presque absolue.
5° Nous nous trouvons maintenant dans la région des grands temples : le Panthéon, le temple de Jupiter, et le temple de Vénus qui par leur importance et leurs formes variées nous arrêteront plus longtemps.
Avant d'entrer dans le détail, il convient de dire en deux mots ce qu'était un temple antique et ce que se proposait de faire un architecte à qui on commandait un de ces édifices.
La religion des anciens était surtout une religion domestique et particulière. Les cérémonies communes et publiques étaient rares. Elles se rattachaient à quelque idée spéciale, à l'existence de corporations ayant un but particulier, plutôt qu'elles n'étaient l'occasion d'une réunion de fidèles rendant un même culte à une même divinité. Il suit de là que la construction des monuments religieux ne devait avoir en rien le caractère qu'affectent généralement les édifices du même genre qu'a motivés l'introduction de la religion chrétienne. Ici en effet la base de tout le culte est l'alliance, la communion des fidèles dans une même Eglise qui embrasse dans son orbe le ciel et la terre. Il fallut donc chercher, dès que cette nouvelle conception religieuse l'emporta, des types appropriés aux nouveaux dogmes et aux nouveaux besoins. Nous verrons tout à l'heure quels furent ceux des édifices construits antérieurement qui s'adaptèrent le plus facilement au nouveau culte. Il suffit d'observer ici que ce ne furent point les temples des anciens qui purent devenir le lieu de réunion des chrétiens. Sauf des cas exceptionnels leurs dimensions relativement restreintes ne le permettaient pas.
Le caractère originaire du temple dans l'antiquité était de représenter un endroit où un simulacre de la divinité fût à l'abri et protégé d'une manière sûre. Tout d'abord on se contenta d'une simple clôture (septum). Bientôt on couvrit cette clôture d'un toit et on eut un temple (naos, oedis). L'idée dominante qui préside à la construction d'un temple est celle du secret, du mystère et de l'inaccessibilité. C'est ce qui fait que le temple n'a pas de fenêtres. Il est probable que des idées du même genre contribuèrent à répandre l'emploi des vitraux dans les cathédrales du moyen âge. C'était mettre aussi l'obscurité et le mystère dans ces asiles de la foi, que la grande quantité des fidèles rendait si vastes et que les nécessités de la construction faisaient percer de si nombreuses et si larges ouvertures.
Dans les temples antiques, la porte seule, qui était très grande, permettait à la lumière du jour de pénétrer à l'intérieur. Au-devant de cette porte on s'habitua de bonne heure à construire une partie extérieure ouverte et libre. Là on trouvait un abri et de l'ombre, choses si précieuses dans cette vie extérieure habituelle aux populations de l'Europe méridionale. On en vint ainsi à diviser les temples selon la forme de ces portiques et de ces colonnades, selon leurs dispositions autour de la nef : on eut des temples à antes ou à pilastres dont le pronaos, c'est-à-dire la partie élevée en avant de la nef, repose sur deux pilastres dans le prolongement des murs latéraux, et sur deux colonnes élevées au milieu de la façade antérieure ; on eut le temple prostyle, dont le portique antérieur ne repose que sur des colonnes ; le temple périptère avec des colonnades régnant tout autour ; le pseudopériptère avec des demi-colonnes, dans lequel la colonnade qui règne autour de l'édifice est remplacée sur trois côtés par une demi-colonnade appliquée aux murs latéraux. Le temple diptère avec une double colonnade, et pseudodiptère avec une simple colonnade de largeur double sur les côtés, tandis que la façade conserve la double rangée de colotunes. Ainsi, avec d'autres combinaisons qui se rattachent au nombre de colonnes et à l'ordre architectural employé dans les proportions et dans l'ornementation de la colonne, les architectes anciens obtinrent les effets les plus variés dans la disposition d'édifices dont la forme partait du principe le plus simple et semblait peu susceptible de modifications.
Revenons maintenant à Pompéi et aux temples dont la façade donnait sur le forum.
«Ab Jove principium». Le plus important de ces temples, tant par son élégance que par sa situation, était le temple de Jupiter. Il occupait toute la face septentrionale du forum. Sur un degré élevé de treize marches était une plate-forme qui servait de soubassement au pronaos ou vestibule. Cette plate-forme était décorée à chacune de ses extrémités de deux statues, dont on a retrouvé les pieds chaussés de cothurnes. Elle formait elle-même un enfoncement de 12 mètres de large sur près de 15 mètres de long. Cet enfoncement était surmonté d'un toit en prolongement du toit de la cella.
Ainsi la façade présentait au visiteur un pronaos soutenu par six colonnes corinthiennes en avant et trois autres colonnes en retour de chaque côté. Des antes ou pilastres amorçaient le mur de la cella ou du sanctuaire. Le sanctuaire se trouvait donc réduit à une longueur de 18m 50 hors oeuvre. Pénétrons dans l'intérieur par la grande porte, qui tournait sur des gonds de fer encore scellés dans la muraille. L'aspect devait être vraiment imposant.
Au fond se dressait une statue colossale de Jupiter, avec les cheveux et la barbe peints en rouge. Des statues, des groupes en bronze décoraient les parois, et les entrecolonnements du rez-de-chaussée. Ce rez-de-chaussée était divisé en trois nefs, dont une seule, celle du milieu, était large et haute ; les bas côtés étaient surmontés d'un étage accessoire formant tribune. Les murs étaient couverts de peintures d'ornement, du plus éclatant effet ; les cannelures des colonnes, les sculptures des chapiteaux et des frises ajoutaient à cette décoration si riche des jeux d'ombre et de lumière que l'éclat des couleurs, le vert, le rouge, le bleu, l'amarante, que le marbre et la mosaïque étendus sur le sol ne faisaient qu'accroître et affirmer encore. Derrière le sanctuaire se cachaient d'étroites chambres voûtées dans lesquelles reposaient probablement le trésor et les archives du temple. Un escalier dont la cage se trouvait près de ces chambres conduisait aux tribunes de l'étage supérieur.
Pour compléter l'idée d'un temple antique telle que Pompéi nous permet de la concevoir si clairement, sortons du temple de Jupiter et pénétrons dans les deux édifices qui forment les angles du forum, l'un à droite, l'autre à gauche de celui que nous venons de visiter.
A gauche, c'est le Panthéon, ou le temple d'Auguste, que nous n'avons fait qu'indiquer tout à l'heure. La façade de cet édifice, dont la destination n'est pas encore parfaitement connue, s'ouvrait sur le portique du forum. Aussi, comme l'emplacement était précieux pour le commerce, on avait fait pour cet édifice ce que nous voyons faire pour quelques-uns de nos monuments publics : on avait établi des boutiques prenant jour sous la colonnade. Ces boutiques, placées de chaque côté de la porte d'entrée, semblaient servir de préférence aux changeurs ou banquiers qui aimaient à se trouver à proximité du forum, centre des affaires. Dans l'une d'elles on a trouvé un grand nombre de pièces de monnaies de diverses espèces. La porte à double vanteau conduisait dans une cour rectangulaire assez vaste, ornée tout autour d'un portique, qu'on était en train de réparer lors du désastre. Les parois de ces portiques étaient décorées de riches peintures, représentant des chasses, des courses, des fabriques et quelques sujets tirés de la mythologie, Ulysse et Pénélope, Psyché, les combats de Thésée.
De chaque côté de cette cour, étaient construites des chambres de dimensions à peu près analogues entre elles. Mais les unes s'ouvraient à l'intérieur et étaient à ce qu'il semble, les pièces réservées au collège de prêtres qui desservaient le temple ; les autres, au contraire, donnaient sur une petite rue avoisinante et formaient encore des boutiques. Là étaient installés des marchands de fruits, de fleurs, un boulanger, un pharmacien, des orfèvres. C'était évidemment le quartier important, comme le Palais-Royal de Pompéi.
Au centre de la grande cour rectangulaire ainsi entourée de toutes parts, on a retrouvé douze piédestaux dont la forme et la disposition en cercle ont vivement excité la curiosité des antiquaires, et ont été l'origine de toutes les controverses sur la destination de l'édifice. Les uns y ont reconnu des bases de colonnes sur lesquelles s'élevait un édicule circulaire abritant la statue u dieu unique adoré dans le temple ; ce dieu, dans ce cas, serait Auguste divinisé. On sait, en effet, par les inscriptions, qu'il existait un temple d'Auguste à Pompéi. Les chambres que nous avons indiquées plus haut seraient, dans ce cas, le logement du collège des Augustals.
Pour d'autres, au contraire, ce sont là des piédestaux sur lesquels se dressaient les douze statues des grands dieux rangées en cercle. L'édifice serait un Panthéon.
Les sacrifices se faisaient dans une sorte de chapelle placée au fond de la cour. Une statue en occupait le fond ; quatre autres statues étaient disposées dans des niches ; on a retrouvé deux d'entre elles, mais on peut à volonté y reconnaitre des dieux ou des membres de la famille impériale. Des chambres vastes s'ouvraient à droite et à gauche de la chapelle ; dans l'une on a cru reconnaître un orchestre, dans l'autre on a trouvé un trésor enfermé dans une caisse garnie de serrures. Plus de onze cents pièces de monnaie, tant en bronze qu'en argent, le composaient. On a aussi, paraît-il, retrouvé en cet endroit des morceaux de verre à vitres ; cette découverte semble moins intéressante. Elle l'est davantage peut-être, si l'on considère que la question a été longtemps débattue, de savoir si les anciens si habiles dans le maniement du verre, s'en servaient pour fermer les édifices publics ou privés. Cette découverte et quelques autres faites à Pompéi, ont décidément tranché la question en faveur de l'affirmative. Toutes les parois de ces salles étaient, comme celles de la cour, ornées de peintures.
On voit que cet édifice, quelque nom qu'on veuille lui donner, était, par ses dispositions générales, très éloigné de la figure ordinaire d'un temple antique. Aussi d'autres auteurs n'ont voulu y reconnaître qu'un lieu public où se réunissaient les magistrats de la cité. Mais cette hypothèse semble répondre encore moins à la nature de l'édifice. Il est donc mieux, jusqu'à plus ample informé, de s'en tenir à l'une ou l'autre des deux premières, en faisant d'ailleurs cette remarque qu'on trouve ici les éléments premiers et originaires d'un temple, c'est-à-dire un enclos abritant un ou plusieurs simulacres des divinités, avec un lieu spécial où pouvaient se faire les sacrifices.
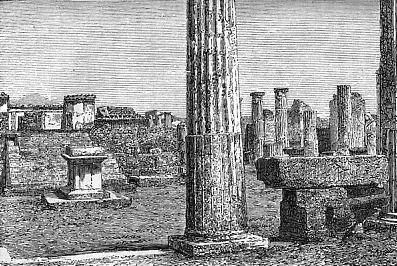 |
En sortant du temple d'Auguste ou Panthéon par la porte qui donnait sur le Forum, on voyait se dérouler en face de soi la colonnade latérale du plus grand temple de Pompéi, le temple de Vénus. C'est à cette déesse que la ville entière était consacrée. Rien que de naturel à ce que ce bel édifice lui fût dédié par ses habitants.
Il n'avait pas sa porte d'entrée sur le Forum, mais sur une petite rue adjacente qui le séparait de l'édifice voisin, la basilique. Quoique les proportions de l'enceinte sacrée fussent considérables, la part réservée au tabernacle était relativement restreinte. La cella n'avait que 20 mètres de long sur 11 mètres de large, tandis que le mur qui l'entourait et le partageait (disposition assez fréquente et que nous trouverons une fois encore à Pompéi), mur dit du péribole, enfermait un espace de 64 mètres sur 52 mètres à l'intérieur. La cour ou area comprise entre le mur du péribole et le sanctuaire était occupée par un splendide portique élevé sur quarante-huit colonnes d'ordre dorique et surmonté d'un élégant chéneau où les têtes de lions alternaient avec les palmettes. Des peintures donnaient encore à cette architecture polychrome une gaieté et un charme duquel la vue de nos monuments noirâtres nous a tout à fait désaccoutumés. Des statues en forme de Termes s'appuyaient à quelques-unes de ces colonnes. Au pied du perron par lequel on montait au temple, se trouvait un vaste autel où se déposaient les offrandes.
On montait les treize marches du perron ; on se trouvait alors dans le pronaos d'un temple périptère ; le sol était décoré d'une mosaïque de marbre bordée d'un méandre. Une porte s'ouvrait sur la cella ; au fond, se dressait la statue de la déesse, dont les débris informes gisent encore sur le sol. L'intérieur était aussi couvert de peintures ; mais là, point d'étages, point de triple nef ; du moins l'état des ruines ne permet point de croire que ces divisions aient jamais existé. Enfin, derrière la cella, quelques chambres, dans l'une desquelles a été trouvée l'une des phis belles peintures de Pompéi (Bacchus et Silène), communiquaient avec le Forum et avec une ruelle adjacente.
Ici se célébrait le culte de la grande déesse que la voluptueuse Pompéi avait prise pour protectrice. Il ne faut pas croire d'ailleurs que les souvenirs brutaux de l'amour physique se rattachassent seuls aux cérémonies et aux sacrifices qui avaient lieu en l'honneur de cette déesse. Des conceptions mythologiques, anciennes, compliquées et respectables s'appliquaient aux mythes qui prenaient pour objet la déesse mère de l'Italie. N'était-ce pas elle qui avait conduit ici la civilisation de l'Orient en protégeant les pérégrinations de son fils Enée ? N'était-elle pas la mère des Jules, d'où était descendu le plus illustre des Romains, César ? N était-ce pas elle que les plus sages des poètes italiens avaient chantée ?
Que quoniam rerum naturam sola gubernas,
Sec sine te quicquam dias in luminis oras
Exoritur, neque fit lunum, neque amabile quicquam.
«Car c'est toi, ô déesse, c'est toi seule qui gouvernes la nature, et sans toi, rien, rien ne naît sous la divine lumière, rien de ce qui fait la joie, rien de ce qu'on aime».
Pour les Italiens du temps de la catastrophe c'étaient là les vieux cultes, les cultes respectables. Tant de nouveautés qui venaient de l'Orient pénétraient la religion d'un esprit exagéré, ridicule ou terrible, que les sages craignaient, comme l'annonce d'un crépuscule ! C'était peut-être l'aurore d'une grande révolution.
Auprès du temple de Vénus, en traversant une rue étroite (la rue de la Marine), on pénétrait dans un édifice important à cette époque, important surtout à nos yeux par les destinées que l'avenir réservait au type sur lequel on l'avait bâti, c'était la Basilique. Qu'était-ce que la Basilique ? Le nom, d'origine grecque, ne nous apprend pas grand'chose : Maison du roi, qu'est-ce qu'un tel nom dans un pays où depuis des siècles on n'avait pas connu de souverains ?
Qui était le roi en Italie ? - C'était le peuple. Il se trouva donc que cet édifice d'origine royale devint la maison du peuple, en changeant de quelques degrés en latitude. Mais le nom était resté. Il n'y avait rien de trop beau pour lui d'ailleurs. Vitruve dit en propres termes : «Les basiliques peuvent réunir tout ce qu'il y a de magnifique et de majestueux dans l'architecture».
Entrons dans quelques détails. Les peuples anciens, nous l'avons dit, vivaient beaucoup hors de chez eux. Le ciel, la tournure des esprits, la chaleur d'un sang méridional emplissaient continuellement les rues et les places publiques. Le forum était le lieu de réunion habituel tant pour les affaires politiques que pour le commerce et le loisir. Mais, malgré la douceur du climat, il y avait des jours où la réunion au dehors, même sous les portiques du forum, était impossible. La pluie, le froid, le vent chassaient parfois badauds et gens d'affaires. C'est en prévision de ces cas que l'on construisait les basiliques.
La basilique était donc par excellence un vaste édifice où la réunion des groupes et la circulation des individus devait être facile, et où l'on trouvait un abri contre les intempéries des saisons, pour traiter à l'aise les affaires qui se faisaient ordinairement sur le forum.
Vitruve nous a hissé de curieux détails sur les basiliques, en particulier sur celle de Fano, qu'il a construite lui-même. Celle de Pompéi semble s'éloigner quelque peu du plan généralement adopté. Cependant son étude donnera des notions assez suffisantes sur un genre d'édifices destiné à un avenir si considérable.
Selon les règles elle donnait sur le forum. Cinq entrées permettaient aux allants et venants de circuler aisément entre les colonnes de la façade. Deux autres entrées donnaient sur des rues latérales. Du côté du forum, la basilique était précédée d'une chalcidique, sorte de prolongement et d'abri recommandé par Vitruve. A l'intérieur, la basilique, entourée de murs, présentait la forme d'une longue salle à peu près rectangulaire mesurant 67 mètres de long sur 27 de large. Cette salle qui devait être couverte (quoiqu'on ait soutenu que la partie centrale était à jour), cette salle était divisée en trois nefs par des colonnes d'une grande hauteur qui formaient par leur alignement la nef intérieure. Des colonnes engagées, plus basses, s'appuyaient aux parois de la salle. La nef du milieu devait donc avoir toute la hauteur de l'édifice, laissant voir probablement l'enchevêtrement de la charpente du toit. Les nefs latérales, au contraire, plus étroites, étaient aussi moins hautes, en ce sens qu'un étage de tribune était disposé au-dessus d'elles et régnait tout autour de la salle. Ces galeries étaient garnies d'une balustrade «assez élevée, dit Vitruve, pour que les personnes qui s'y trouvent ne puissent être vues par ceux qui sont en bas».
Des fenêtres étaient probablement percées dans les parois des tribunes. Un toit unique couvrait le tout et reposait sur les murs latéraux et sur les deux rangées de colonnes déterminant la nef centrale. Au fond de la basilique se trouvait un endroit spécialement réservé et distingué de la salle commune par une enceinte de colonnes et formant comme une petite salle ouverte. Là on a retrouvé les restes d'un stylobate élevé de deux mètres au-dessus du niveau de la salle et sur lequel s'appuyaient six petites colonnes qui probablement étaient autrefois surmontées d'un étage comme les nefs latérales de la basilique. A cet endroit s'asseyait le magistrat qui rendait la justice. La hauteur du stylobate le protégeait, comme la disposition de la salle l'écartait un peu du tumulte ordinaire. Quant aux accusés, il n'était pas nécessaire d'aller les chercher très loin. Sous la tribune même, on a retrouvé un véritable cachot voûté. On y pénétrait par une porte pratiquée dans l'épaisseur de la muraille. L'air et la lumière n'y parvenaient que par d'étroits soupiraux qui s'ouvraient au dehors, mais qui, comme on le voit encore aujourd'hui, étaient scellés de gros barreaux de fer.
Tel était l'aspect général de la basilique. Les peintures qui décoraient les murailles étaient simples. Elles étaient toutes barbouillées par les plaisanteries et les caricatures qu'y inscrivaient les plaisants de Pompéi. On a pu déchiffrer quelques-unes de ces inscriptions, qui, par leur parfum d'actualité locale, transportent si vivement l'esprit du visiteur moderne à l'époque même du désastre et de la vie interrompue.
Pour terminer ce qui nous reste à dire de la basilique, il suffit d'indiquer l'importance que ce genre d'édifices prit dans les siècles postérieurs. Dans ces grands et commodes monuments, les chrétiens trouvaient une place naturellement indiquée et des constructions toutes faites pour leurs nombreuses réunions. On pouvait facilement circuler entre ces colonnes. Hommes et femmes s'y séparaient naturellement en deux troupes. Sous le portique ou les chalcidiques, les néophytes et ceux qui n'étaient pas de l'église pouvaient attendre et prendre leur part aux cérémonies du culte. La tribune du magistrat était un endroit tout indiqué pour être le siège de l'évêque. Les fidèles qui l'assistaient dans les offices, le choeur, pouvaient s'asseoir près de lui aux places jadis destinées aux assesseurs. Tout s'adaptait pour le mieux aux besoins encore modestes d'un culte naissant. Aussi, dès que le christianisme, après avoir traversé victorieusement l'ère des persécutions, fut monté sur le trône avec Constantin, il s'empara rapidement des basiliques déjà construites. Les nouveaux édifices que l'on fit bâtir se modelèrent tout naturellement sur un plan si simple et si commode. Telle fut l'origine des cathédrales chrétiennes. On peut, depuis la plus haute antiquité chrétienne, suivre la lente transformation de ce type, qui, plus tard, en se perfectionnant, couvrit l'Europe de tant de merveilleux monuments.
Le quatrième côté du forum de Pompéi était occupé par trois salles de dimensions moyennes et de grandeur inégale. Une sorte d'abside en demi-cercle terminait le rectangle qui formait la salle principale. On a cru reconnaître des Tribunaux dans ces ruines, d'ailleurs peu importantes.
Après avoir étudié dans le forum et dans les monuments qui l'entouraient, le centre de la ville, gagnons un autre point non moins curieux et où les Pompéiens devaient se rendre avec non moins d'empressement, c'est la région des théâtres. Elle se trouvait à l'extrémité sud-est de la ville, à droite du forum et un peu en arrière. Pour nous y rendre, nous suivrons la rue de l'Ecole, en jetant un coup d'oeil sur les ruines des maisons qui prennent jour sur elle. C'était un des quartiers les plus agréables de la ville, non loin du forum, aux pieds des collines, avec de grands jardins, où les Pompéiens venaient se reposer de leurs travaux. C'est un des endroits où l'on a rencontré le plus de squelettes. Dans un souterrain qui se trouve aux environs, on a trouvé, en 1826, sept corps de Pompéiens qui étaient morts là étouffés. On a relevé auprès d'eux l'argent et les objets précieux qu'ils emportaient dans leur fuite. C'est à ce fait que Bulwer a emprunté le dénouement de son récit.
Nous tournons à gauche, nous suivons la rue de la Reine, la ruelle du Théâtre et, faisant un petit coude à gauche, nous débouchons sur la seconde place de Pompéi : le forum triangulaire. On a cru, probablement avec raison, que c'était là le premier noyau de Pompéi, l'ancienne Acropole qui avait d'abord concentré et protégé les origines de la ville naissante. La hauteur du lieu, la proximité de la mer, avec laquelle on communiquait en descendant un escalier, la présence du temple le plus ancien qu'on ait retrouvé dans les ruines, tout confirme cette hypothèse.
On entrait dans ce forum par un élégant propylée de huit colonnes. Il était lui-même presque entouré d'un portique, sur lequel les citoyens de Pompéi prétendaient avoir seuls la deambulatio, ou droit de promenade. Le plus grand côté du triangle qui formait la place s'appuyait à l'amphithéâtre ; aussi une magnifique colonnade nommée les cent colonnes (hecatonstylon) se déroulait de ce côté et offrait un refuge aux spectateurs dans les mauvais temps.
A l'un des angles du forum triangulaire on a trouvé une sorte de petite enceinte sacrée nommée bidental et qui était protégée par un édicule circulaire.
Enfin le milieu même de la place est occupé, nous l'avons dit, par le temple grec, que l'on considère comme le plus ancien monument de la ville et qui probablement était déjà en ruines lors de l'ensevelissement. Les restes que l'on a retrouvés sont tout à fait insuffisants pour qu'on puisse supposer qu'il était encore complet, et pour que l'on puisse reconstituer facilement son ancienne physionomie.
Près de ce forum, derrière le grand théâtre, et voisin de l'enceinte, se trouvait un grand édifice de forme régulière où l'on a reconnu après quelques hésitations la caserne des militaires. Cette caserne se composait d'une grande cour faisant portique, autour de laquelle étaient disposés en rectangle les bâtiments où logeaient soldats et officiers. Dans l'une des chambres on a trouvé de nombreuses et très riches armes de gladiateurs, qui font penser qu'une troupe de ces gens habitait la caserne. La proximité des théâtres suffit d'ailleurs pour assurer cette conjecture.
Les théâtres : Les représentations scéniques jouaient un rôle très important dans la vie des anciens. Grecs et Romains mettaient ces plaisirs au plus haut rang. C'était le premier devoir des magistrats en entrant en charge de disposer d'immenses réjouissances publiques dans lesquelles ils faisaient assaut de luxe et de prodigalité.
A ce point de vue, les villes de province suivaient l'exemple donné par Rome et nous voyons à Pompéi, par un grand nombre d'inscriptions, que les magistrats ne pouvaient se dispenser de cet onéreux devoir qu'en prenant en échange la charge plus onéreuse encore de construire tout ou partie d'un théâtre ou d'un hippodrome.
Dès le temps de la république, on avait fait de tels efforts pour satisfaire en ce point le goût du public, que le tribun Curio, désespérant de dépasser le luxe asiatique du théâtre construit par Aemilius Scaurus (on comptait sur sa scène plus de 5000 statues en bronze), en était réduit, pour faire du nouveau, à construire deux théâtres en bois placés dos à dos, mais disposés de telle sorte qu'en les faisant tourner l'un et l'autre sur des pivots ils se réunissaient de manière à former un amphithéâtre. Pompée construisit un théâtre en pierre qui pouvait contenir 40 000 spectateurs. Le chef-d'oeuvre du genre fut le Colisée, bâti par les Flaviens et dont les ruines gigantesques sont encore un des plus nobles spectacles qu'il soit donné à l'homme de contempler. Le grand cirque de Rome avait 682 mètres de long et 150 mètres de large ; des galeries formant trois étages l'entouraient. Ces galeries avaient des gradins en pierre dans les étages inférieurs et en bois dans les étages supérieurs. Il contenait, à l'époque de Trajan, environ 500 000 spectateurs.
Ce n'était pas dans de pareilles proportions certainement qu'étaient construits les théâtres et l'amphithéâtre de Pompéi ; mais, dans des proportions moins grandes, ils nous présentent une image très complète et très remarquable de ce qu'étaient ces édifices dans l'antiquité romaine.
Il faut tout d'abord prendre garde de ne pas confondre le théâtre et l'amphithéâtre. Le théâtre servait exclusivement aux représentations scéniques. Il se partageait essentiellement en deux parties : la scène, et l'endroit où s'asseyaient les spectateurs, la cavea, ou hémicycle. En principe, le théâtre antique n'avait pas de toit. Cependant il y avait une forme de théâtre, généralement plus petite, qui était couverte. C'était ce qu'on appelait un odéon. L'amphithéâtre était réservé aux courses, aux jeux violents, aux combats de gladiateurs. Quelquefois on fermait hermétiquement toutes les issues, on emplissait d'eau la partie inférieure, jusqu'à une certaine hauteur, et, sur ce lac improvisé, on représentait des naumachies, c'est-à-dire des simulacres de combats navals. Le luxe des jeux, comme on le voit, n'avait pas de bornes.
Pompéi possédait un type de chacun des édifices que nous venons de décrire rapidement. Les deux théâtres étaient établis près du forum triangulaire, et n'étaient séparés l'un de l'autre que par une galerie ou passage couvert.
L'amphithéâtre était tout à fait à l'extrémité de la ville, dans la même direction que les théâtres, mais beaucoup plus loin, dans l'angle formé par l'enceinte entre la porte de Stabie et la porte du Sarno.
Donnons quelques détails sur chacun de ces édifices. Le grand théâtre se composait : 1° de la scène, de forme rectangulaire, qui elle-même comprenait le proscenium ou avant-scène : c'était là que les acteurs jouaient, la figure couverte d'un masque et le corps élevé sur de hautes chaussures. La scène proprement dite, qui était une sorte de décoration architecturale fixe très richement ornée, avec des effets de perspective et des dispositions acoustiques parfaitement aménagées ; la scène formait en quelque sorte le fond du théâtre. Le postcenium, ou derrière de la scène, formait comme les coulisses. Il communiquait avec le proscenium par trois portes percées dans la scena. Un rideau, que l'on ne levait pas, mais qu'on baissait pour découvrir la scène, cachait celle-ci aux yeux des spectateurs, quand il était levé.
Les spectateurs étaient assis sur des étages en gradins faisant le demi-cercle ou le fer à cheval (comme à Pompéi) en face de la scène, que nous venons de décrire. Les places étaient d'autant plus honorables qu'elles étaient plus près de l'orchestre. On appelait ainsi un demi-cercle laissé vide entre la cavea (ou ensemble des gradins) et le proscenium. Le dernier rang de gradins, la dernière precinction, comme on disait, était ornée en arrière d'un portique richement décoré, qui terminait heureusement l'aspect général de l'édifice.
Des escaliers, au nombre de six dans le grand théàtre de Pompéi, permettaient de descendre et de monter le long des gradins. Ils partageaient ainsi l'hémicycle en coins (cunei). Des tribunes réservées aux magistrats étaient disposées dans l'angle des cunei les plus voisins de la scène.
Les gradins du théâtre de Pompéi étaient au nombre de vingt-neuf ; ils étaient en marbre de Paros. Les spectateurs assis sur ces gradins n'étaient pas, comme on peut le croire, exposés à toutes les intempéries des saisons. Sauf dans les cas de grand vent, un système très habilement combiné de poulies et de câbles, permettait d'étendre au-dessus deux un immense voile qui les abritait du soleil et de la pluie, tandis qu'ils écoutaient à l'aise les vers de Plaute ou de Sophocle.
On ajoutait à cet agrément le charme de nombreux parfums répandus fréquemment sur la scène ; et même par instants une pluie fine chargée d'essence était lancée sur les assistants et les aidait à supporter les ardeurs des chauds soleils du Midi.
On sortait du théâtre par de longs corridors ou vomitoires communiquant à des galeries voûtées. Ces corridors donnaient, à l'extérieur, sur un portique porté par six colonnes d'un bon style. L'aspect de l'extérieur présentait un édifice circulaire à plusieurs étages, élevé en raison de la hauteur des gradins, et laissant à son rez-de-chaussée de larges entrées pour le va-et-vient des spectateurs.
Les spectateurs faisaient la queue autour de ces portiques et l'on a pu lire encore les inscriptions plaisantes dont, pour se désennuyer, ils avaient chargé les murs de l'un et l'autre des théâtres pompéiens.
 |
Nous ne dirons qu'un mot du petit théâtre, l'Odéon. Réservé aux représentations d'hiver et peut-être aussi aux fêtes musicales, aux lectures ou récitations si fréquentes â l'époque de l'empire, il était couvert tout entier. Ses gradins supérieurs ne formaient qu'un segment de cercle et non un cercle entier. Il semble que sa décoration était moins élégante que celle du grand théâtre. Il ne pouvait guère contenir que 1500 spectateurs.
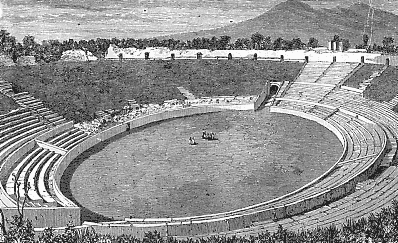 |
Gagnons maintenant l'amphithéâtre. Les amphithéâtres, quoique leur nom soit grec (amphi theatron, double théâtre), semblent être d'origine italienne. Les Grecs étaient, comme les Romains, amateurs des jeux violents du cirque. Mais, chez eux, la course, les luttes d'homme à homme tenaient la place la plus importante ; tandis que les Romains ne trouvaient un spectacle complet que s'il était assaisonné du régal sanglant d'un combat de gladiateurs ou d'une chasse de bêtes féroces. La disposition des édifices n'était pas la même chez les deux peuples. Les Grecs avaient le stade. Les Italiens l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, comme son nom l'indique, était composé de deux théâtres se joignant par leur partie droite, de sorte que l'ensemble de l'édifice avait la forme d'une ellipse.
Les diverses parties d'un amphithéâtre sont : 1° l'arène, où se livraient les jeux et les combats ; sa forme elliptique était favorable aux courses, aux mouvements d'attaque et de poursuite ; l'arène communiquait avec les endroits où se préparaient les gladiateurs, où l'on conservait les objets d'équipement, où étaient enfermées les bêtes féroces destinées au spectacle ; 2° l'ensemble des gradins où s'asseyaient les spectateurs.
Ces rangées de gradins se divisaient elles-mêmes en parties différentes. Il y avait le podium, c'est-à-dire le gros mur des sièges ; les différents étages des gradins (gradationes) avec leurs escaliers ; les différents corridors qui séparaient les étages l'un de l'autre (praecinctiones). Ces corridors communiquaient avec les vomitoires (vomitoria). Sous cet énorme édifice des gradins, de nombreux couloirs, soit parallèles, soit rangés les uns au-dessus des autres, étaient ménagés et servaient à la circulation du public. Ces corridors voûtés débouchaient à l'extérieur sous un portique.
Du dehors on pouvait contempler l'imposant spectacle des trois étages ou trois ordres de colonnes qui formaient la ceinture extérieure de l'édifice. Sur le plus haut de la muraille, s'élevait encore un portique qui régnait autour de l'amphithéâtre. C'était là qu'étaient établies les poutres auxquelles s'accrochaient d'immenses voiles que l'on tendait au-dessus des spectateurs.
Tel était en général l'aspect d'un amphithéâtre. Tel devait être en gros l'aspect de celui de Pompéi. Comme il était d'usage, on avait profité, pour le construire à moindres frais, de la disposition du terrain au pied d'une éminence. 20 000 spectateurs pouvaient s'y asseoir. Des places honorables étaient réservées aux prêtres, aux prêtresses et aux magistrats.
La coupe des gradins, avec une moulure nettement profilée, était plus élégante qu'elle ne l'est généralement dans les édifices du même genre. Des scènes de luttes et de chasse étaient sculptées tout autour du podium et s'y entremêlaient aux inscriptions disant les noms des magistrats qui, à leurs frais, avaient achevé les parties diverses de l'édifice. A l'entrée des couloirs, dans les couloirs eux-mêmes, on voyait les statues de ces mêmes magistrats protégées par des grilles de fer.
Les descriptions, la vue des ruines, même de la partie actuellement restaurée de l'amphithéâtre, ne peuvent donner qu'une idée vague de tout ce qu'il y avait de luxe et d'éclat dans la décoration de cet édifice. Des cylindres en ivoire mobiles et des réseaux en or s'étendaient autour du podium ; le portique du haut était couvert de dorures ; au-dessus des spectateurs flottaient les immenses tentures teintes des plus riches couleurs ; des tapis ornaient les gradins réservés aux magistrats. Qu'on imagine, en outre, le murmure confus d'une salle pleine de 20 000 spectateurs, l'éclat et le bruit des armes des combattants, le rugissement des bêtes féroces et le cri des victimes, le sang coulant sur l'arène, et, au-dessus de tout, le chaud éclat et la grande lumière du soleil d'Italie, tel était le spectacle que ces anciens peuples aimaient avec passion, à l'occasion duquel s'élevaient parfois des cabales qui divisaient l'empire.
Au moment de la catastrophe, l'arnphithéâtre de Pompéi était abandonné depuis plusieurs années. Une querelle qui s'était élevée dans cet édifice même entre les Pompéiens et leurs voisins les Nucériens, venus pour assister aux jeux, s'était terminée par une rixe sanglante. Les Pompéiens, plus nombreux, avaient eu l'avantage. Mais le Sénat de Rome les avait punis en interdisant les jeux pendant dix ans. Ainsi s'explique l'abandon de l'édifice, qui avait souffert des tremblements de terre antérieurs à la catastrophe. Ainsi se trouve démenti le récit du romancier, qui, d'après un historien mal renseigné, fait coïncider le moment soudain de la catastrophe avec une représentation donnée à l'amphithéâtre.
Nous venons de passer en revue les principaux types d'édifices publics que les fouilles ont mis à la lumière. Nous avons pu relever, à chaque instant, la trace de ces habitudes de vie extérieure que les textes de la littérature classique nous permettaient déjà de reconnaître chez les anciens. Si ces preuves n'étaient suffisantes, si la richesse et la splendeur relative des monuments publics dans une ville de province, n'étaient pas assez remarquables pour nous convaincre, on trouverait un nouvel argument dans l'étude des maisons privées, que les lapilli du Vésuve recouvraient en si grand nombre.
C'est là peut-être la partie la plus curieuse et la plus originale des renseignements que la découverte de Pompéi a ajoutés à l'histoire de l'antiquité. On a pu enfin pénétrer dans le détail particulier et intime de la vie de chaque citoyen. L'ingénieuse hvpothése du Diable boiteux, qui, pour faire pénétrer le lecteur dans tous les secrets d'une grande ville, enlève d'un seul coup tous les toits des maisons, s'est trouvée réalisée à la lettre. Toutes ces maisons nous sont ouvertes. L'accident tragique a pris leurs habitants d'une façon si brusque que rien ou presque rien n'a été changé dans leur état habituel. Tout ce qui n'est pas en bois ou en matière susceptible de périr par l'action combinée du feu et du temps, tout cela a subsisté dans l'état et à la place même où on l'avait mis il y a dix-huit siècles.
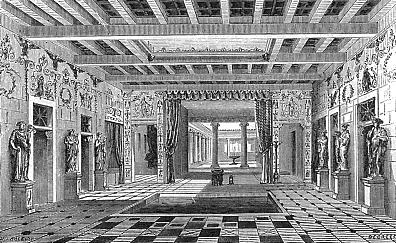 |
Nous ne pouvons malheureusement prétendre dépeindre une à une, avec le soin minutieux qui serait convenable, chacune de ces habitations, qui toutes présentent leur côté intéressant. Nous ne pouvons, - faute de la place suffisante, - conduire successivement le lecteur chez l'édile Pansa, qui faisait inscrire ses louanges sur la porte même de sa maison ; chez le riche et voluptueux Salluste, qui réservait la plus belle part de sa demeure aux parties fines, aux plaisirs de la table et peut-être de la débauche ; dans la magnifique villa de Diomède, assise à proximité de la campagne, entourée de portiques et de jardins, avec ses bains richement aménagés, son péristyle somptueux, ses cabinets d'étude retirés, ses vastes caves où le bon vin était dressé dans les amphores.
C'est là que s'est passé le drame le plus émouvant que nous aient révélé les fouilles faites dans la ville ensevelie. Cette maison était une des plus voisines du Vésuve. Peut-être a-t-elle été enfouie la première, peut-être ses habitants ont-ils cru trouver dans la solidité de sa construction un plus sûr abri. Quoi qu'il en soit, dans un des souterrains sur lesquels elle était bâtie, on a trouvé, en 1763, dix-sept corps de femmes et d'enfants. Autour des squelettes, encore voilés des vêtements dont ils s'étaient couvert le visage, on a retrouvé les bijoux, les objets précieux qu'ils avaient emportés dans leur fuite. Ils avaient aussi réuni des provisions que la rapidité du désastre ne leur laissa pas le temps d'entamer, et qu'on a retrouvées aussi. La nature de leur mort fut si singulière et si prompte qu'on a pu relever jusqu'aux empreintes que leurs cadavres avaient laissées dans la cendre durcie autour d'eux ; et on raconte qu'on put ainsi reconnaître le corps d'une jeune fille d'une admirable beauté ; la forme de son corps, le pli et le tissu de ses vêtements apparaissaient encore dans les empreintes que la cendre avait moulées si finement et si exactement il y avait dix-sept siècles. Ses bijoux étaient restés autour de son squelette, et on a pu, de leur richesse, conclure que l'on était en présence du cadavre de la fille même du propriétaire de cette riche maison. Non loin de là, dans un jardin, on a reconnu le squelette du maître lui-même. Accompagné d'un esclave qu'il avait chargé d'argent et d'objets précieux, il essayait de gagner la campagne, lorsqu'un dernier effort du volcan le surprit. Il tomba là, tenant entre ses mains les clefs incrustées d'argent de sa demeure. Plus loin encore dans la campagne, on trouva neuf autres cadavres.
Heureusement toutes les maisons de Pompéi n'ont pas été le lieu de si lamentables découvertes. On peut dire que, lors du désastre, la ville était relativement déserte. Quelques retardataires malheureux ou avides, des malades peut-être, d'autres qui crurent trouver dans les maisons un abri plus sûr que dans la campagne, durent être les seules personnes qui ne purent échapper.
Revenons à la description de la ville elle-même ; et puisqu'il ne nous est pas loisible de donner des détails sur toutes les habitations privées, prenons-en une comme type et, à son occasion, essayons de reconnaître les parties principales d'une maison particulière chez les anciens.
En façade sur la rue dite de la Fortune qui semble être une des rues importantes de Pompéi, occupant un îlot entier de forme rectangulaire, entourée de rues sur ses quatre côtés, se trouvait l'importante maison d'un Pompéien riche et homme de goût, mais dont le nom est inconnu ; c'est la maison du Faune, ainsi nommée d'une charmante statue de bronze qu'on y a trouvée. Elle a été découverte en 1850, et on a pu reconnaître avec soin tous les détails de son aménagement.
|
Jusque dans les dispositions de la maison romaine on reconnait combien la vie extérieure était prédominante aux yeux des anciens. La maison était un endroit retiré où l'on ne séjournait que le temps nécessaire au repos et au besoin de la vie. Aussi les chambres étaient-elles en général petites et peu confortables. On remarque surtout l'absence presque absolue de cheminées, absence que n'explique pas suffisamment la nature du climat : car il y a des journées très froides, même sous le ciel de Naples. Les anciens, comme nos contemporains de cette région, faisaient probablement un grand usage du réchaud à charbon, le brasero. On a supposé aussi que les maisons étaient chauffées au moyen de tuyaux renfermant de l'eau chaude. |
 |
A l'extérieur, la maison ancienne présentait en général un aspect sombre et triste. Peu d'ouvertures sur le dehors, de grands murs blancs percés d'une baie étroite, et couverts d'un toit en tuiles rouges. Tout au plus comme ornementation deux colonnes ou deux pilastres appliqués s'appuyant aux deux côtés de la porte d'entrée.
Si nous entrons, un chien de garde montre les dents et grogne ; l'esclave-concierge (ostiarius) traînant sa chaîne, examine le nouvel arrivant. Quelquefois à vrai dire le concierge manquait, et le chien était simplement représenté en figure, comme le Suisse peint du château de Scudéry ; c'est le cas dans une des plus jolies maisons de Pompéi, où une mosaïque élégante représentait un chien aboyant, avec l'inscription : «cave canem». Prends garde au chien.
Allons plus loin encore. Toute maison bien conçue se divise en trois parties ; l'une encore publique en quelque sorte, là où vont et viennent les esclaves, où les étrangers attendent, où les clients arrivent dès la pointe du jour pour présenter leurs hommages au patron. C'est la région de l'atrium et de ses dépendances.
La seconde partie de la maison romaine se groupe autour du péristyle. C'est là l'endroit où se tient le maître, c'est là que donnent les entrées des salons, des salles à manger, des chambres à coucher.
Derrière enfin s'étendaient les jardins et les appartements d'été.
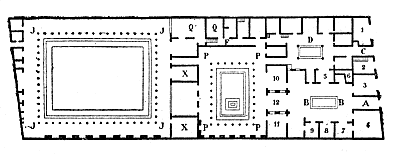 |
Nous allons, dans la maison du Faune, rencontrer ces trois grandes divisions et les étudier avec un peu de détail. Avant d'entrer par la porte principale qui ouvrait sur la rue de la Fortune, observons qu'à Pompéi, comme dans nos villes modernes, le rez-de-chaussée des maisons privées était souvent occupé par des boutiques n'ayant que peu ou point de communication avec l'intérieur. C'est le cas dans la maison du Faune, où quatre boutiques étaient ménagées dans la façade (1, 2, 5, 4). Nous entrons par le corridor ou prothyrum (A). Ce corridor est coupé en deux par une porte double. Il est pavé en marbre de diverses couleurs. Les murs sont peints de façon à imiter le marbre.
Ce corridor ouvre sur l'atrium (B), c'est une espèce de cour intérieure, au milieu de laquelle se trouve une fontaine ou un bassin nommé compluvium. C'est au centre du compluvium que, sur un piédestal, se trouvait la statue du Faune qui a donné son nom à la maison. L'atrium avait des formes et des noms différents. Il était toscan quand il n'y avait point de colonnes ; tétrastyle, quand il y avait quatre colonnes seulement, une dans chaque coin ; corinthien, lorsqu'il était entouré d'un portique ; en carapace (testudinatum), lorsqu'il présentait au milieu une sorte d'abri porté sur des piliers, et vêtu d'un toit de tuiles ayant quelque analogie avec l'écaille d'une tortue.
Tout autour de l'atrium sont disposées des chambres (5, 6, 7, 8, 9) qui servaient probablement l'une de loge au concierge, les autres de demeure aux esclaves et aux gens de service. Deux de ces chambres du fond avaient une disposition particulière et portaient un nom spécial. C'étaient les alae. C'étaient des espèces d'antichambre ou de salles d'attente, décorées avec goût et où le maître du logis donnait audience aux personnes qui ne pénétraient pas dans l'intérieur.
Dans les ailes de la maison du Faune, le pavé était fait de mosaïques très élégantes que l'on conserve maintenant au musée de Naples, et qui représentent des oiseaux, des pigeons, des canards, des cailles.
Avant de pénétrer plus loin dans l'intérieur de l'habitation, il convient de remarquer que la maison du Faune présentait une particularité qui n'est pas ordinaire aux autres maisons de Pompéi. C'est qu'elle avait une double entrée sur la rue, et un double atrium. L'autre entrée était en C. L'atrium D plus petit que le premier était de forme différente. Il était tétrastyle. Cette partie de la maison semble avoir été réservée plus particulièrement à la réception des hôtes. On a trouvé dans les chambres qui entouraient l'atrium des pieds de lit en ivoire, des cassolettes, et des boîtes à parfum.
Ce second atrium communiquait d'ailleurs avec le premier par une sorte de vestibule. D'autre part il donnait entrée à droite de l'habitation sur une série de chambres et d'appartements qui formaient ce qu'on appelle aujourd'hui les communs. On a cru pouvoir y reconnaître des chambres d'esclaves, un pressoir pour les vins, une buanderie, une boulangerie, une cuisine. Toutes ces chambres donnaient sur un long corridor (fauces F) qui longeait le péristyle et qui conduisait directement du petit atrium au jardin.
Revenons dans le premier atrium et, pour pénétrer dans la partie la plus intime de la maison, traversons le tablinum (12) espèce de galerie où se trouvaient les titres de la famille et les images des aïeux. On sait que c'était un des plus vieux et des plus respectables usages des Romains de conserver ainsi la figure de ceux dont les exemples et les souvenirs honoraient la maison et servaient de modèle à leurs descendants.
Tota licet veteres exornent undique cerae
Atria. Nobilitas sola est atque unica virtus.
(Juvénal)
«Que les images de cire des aïeux emplissent ton atrium. La noblesse, la seule noblesse, c'est la vertu». A droite et à gauche du tablinum sont deux chambres (10 et 11) qu'on suppose avoir été les salles à manger (triclinia). C'était d'ailleurs la place où ces salles se trouvaient d'habitude. Dans l'une et dans l'autre, le pavé était décoré de très belles mosaïques, les unes et les autres représentant des sujets «de salle à manger», comme nous disons aujourd'hui ; dans l'une était représenté un Bacchus à cheval sur une panthère, dans l'autre des poissons, des écrevisses, etc.
En traversant le vestibule ou tablinum, nous entrons dans le péristyle (P) qui, large de 24 mètres et profond de 20 mètres, avait un portique soutenu par 28 colonnes cannelées d'ordre ionique. Au milieu de ce péristyle se trouvait un petit bassin carré rempli d'eau, c'était là le point véritablement central et réservé de la maison antique. «Les conversations de l'atrium n'arrivent pas jusqu'au péristyle», dit Térence. Quelquefois, le bassin du milieu était remplacé par une corbeille de fleurs, le péristyle était toujours richement décoré.
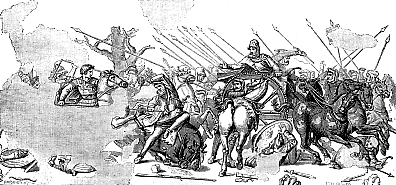 |
Entre le péristyle et le jardin ou xyste se trouvaient plusieurs chambres de repos ou de communication (exèdres, X). C'est dans l'une d'elles que l'on a trouvé le 24 octobre 1851, une magnifique mosaïque représentant un sujet de combat entre Grecs et Barbares, dans lequel on croit reconnaître une des batailles d'Alexandre contre Darius. Cette mosaïque forme un tableau de 5m 50 sur 2m 72. On y compte 15 chevaux et 26 guerriers au quart du naturel ; elle est maintenant au musée de Naples. Le sujet principal de l'action est un cavalier qui transperce de sa lance un autre cavalier richement vêtu au moment où celui-ci roule avec son cheval abattu. Près de là un écuyer semble tenir un cheval de rechange tandis qu'un corps de Barbares, cavaliers ou montés sur des chars, prennent la fuite dans le plus grand désordre. La beauté de l'exécution, la hardiesse des raccourcis, la vie répandue sur toute la scène, font de cette mosaïque l'une des pièces d'art à la fois les plus curieuses et les plus belles que nous ait laissées l'antiquité.
Cette chambre une fois traversée on pénètre dans le jardin (J) qu'entourait un superbe portique soutenu par 56 colonnes doriques. Au milieu de ce portique se trouvait une area divisée probablement en plates-bandes, et sur laquelle étaient répandus des marbres et des bronzes, en particulier un sphinx accroupi qui est maintenant un des ornements du musée. Le fond du jardin qui donnait sur la ruelle de Mercure, était occupé par des chambres d'esclaves avec sortie sur la ruelle.
Il n'est pas douteux que la plupart des constructions de la maison du Faune, dont il ne reste plus aujourd'hui que le rez-de-chaussée étaient surmontées d'un premier étage où se trouvaient les chambres à coucher. Car, outre les nombreux débris que l'on en retrouve encore, on voit dans une des salles du fond du jardin, les premières marches d'un escalier.
On peut maintenant se rendre compte du luxe qui présidait à la construction et à l'aménagement des maisons particulières des riches Pompéiens. Les dispositions principales de la maison du Faune, on les retrouve dans la maison de Pansa, dans la maison de Diomède, dans la maison du poète, dans la maison de Salluste, variées seulement selon le goût de leurs propriétaires, ou la disposition du terrain. La maison de Diomède plus voisine de la campagne était remarquable par son riche jardin, par ses bains parfaitement aménagés. Elle rappelle plus que les maisons du centre de la ville, la description de la villa de Pline que cet écrivain nous a laissée dans ses Lettres.
Nous avons donné une idée générale des monuments publics et des maisons privées de Pompéi, mais que ne nous reste-t-il pas à faire pour compléter le tableau de la ville antique, telle qu'elle était autrefois, et telle qu'elle apparaît encore aux visiteurs. Nous n'avons rien dit des monuments de second ordre, comme les arcs de triomphe, les casernes, les prisons, les bains publics. Ces derniers forment certainement l'un des plus curieux restes de la civilisation dans laquelle ils tenaient une place si considérable. Nous n'avons pas parlé non plus de ce côté si particulier et si intime de la vie antique que nous a révélé la découverte successive des boutiques, boulangeries, fabriques de savons, boutiques de barbiers ou de parfumeurs, tavernes, fabriques de produits chimiques, etc.
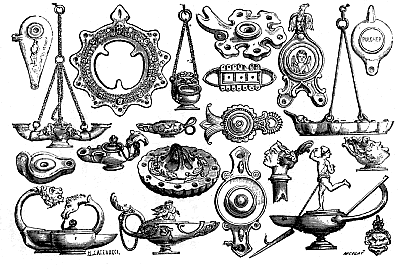 |
Surtout nous n'avons pas insisté assez sur cette innombrable quantité d'objets d'art qui ont complété par une moisson si abondante, les traces de cet amour du beau si généralement répandu chez les peuples de la Grande Grèce. Nous ne finirions pas à décrire ces marbres, ces bronzes, ces peintures, ces mobiliers richement ornés, ces bas-reliefs, ces bijoux où l'art et l'industrie de nos jours vont chercher le meilleur de leurs inspirations.
Mais ici comme à Thèbes, nous terminerons par les tombeaux et les demeures des morts ; étude qui convient pour clore le récit que nous avons fait de la mort et de la résurrection des nécropoles antiques.
 |
Pour aller à Herculanum en suivant le faubourg Augusto Felix, on prenait la célèbre voie des Tombeaux. Là les Pompéiens, selon l'habitude romaine, avaient disposé, des deux côtés de la route la plus fréquentée, les élégants monuments où reposaient leurs morts, au milieu des bouquets d'arbres et des jardins. Chaque monument avait sa forme particulière, depuis l'opulente masse du tombeau de Scaurus, jusqu'à la simple borne du tombeau de l'une des Tyché. A côté de la plupart d'entre eux se trouvaient autrefois, et se voient encore aujourd'hui, des sièges en pierre ou en marbre, s'offrant à l'entrée même de la ville à la fatigue du voyageur.
C'est cet endroit même qui inspire à notre illustre contemporain, M. Renan, l'une de ses pages les plus charmantes : «Nous visitâmes surtout cette rue des Tombeaux, un des lieux les plus poétiques du monde ; nous nous assîmes sur ces sièges hospitaliers que le mort offre aux vivants comme pour lui conseiller le repos (Oh ! le bon conseil que donnent les morts !). Nous allions saluer à la porte de la ville la place où fut trouvé le soldat fidèle, victime de son devoir, quand un de nos compagnons nous arrête brusquement : «Tout est changé, nous dit-il, ce petit réduit n'est plus, comme on le croyait, une guérite ; c'est bien à tort qu'on a voulu voir dans le cadavre qui y fut trouvé les restes d'une sentinelle qui aurait péri à son poste, acceptant le danger évident de l'asphyxie plutôt que de fuir. Cet homme ne méritait pas les honneurs qu'on lui a rendus ; c'était peut-être un voleur». Cela nous rendit pensifs. Quoi ! même après la mort, un héros du devoir peut, selon les caprices de l'archéologie, être confondu avec un voleur ; le cadavre d'un voleur peut usurper, durant des années, par suite d'une erreur des antiquaires, les honneurs dus au héros ! Combien un jugement dernier est nécessaire pour reviser tout cela ! Mais dans celui-ci encore, que d'erreurs possibles !» Et plus loin, poursuivant cette même idée du repos offert aux vivants par les morts, le même auteur fait allusion à un autre détail non moins pittoresque des tombeaux pompéiens. La présence de sorte de salles à manger, triclinia, près des monuments funéraires : «N'avez-vous pas remarqué, me dit mon guide, dans la rue des Tombeaux, ces bancs en hémicycle, disposés exprès en forme de scholae pour que les passants y vinssent se reposer, causer et disputer ? C'est une pensée aimable du mort qui offre à ses survivants une minute agréable et par-dessus tout ce bon conseil de goûter les joies honnêtes de la vie sans s'imaginer qu'elles dureront toujours. Et le festin funèbre, ne croyez-vous pas que c'était un acte pieux à sa manière ? - Certainement, répondis-je, et chez ceux de nos ancêtres qui conservèrent plus longtemps les moeurs barbares, ce repas devait aller jusqu'à l'ivresse, jusqu'à des batailles sanglantes. Il en est encore ainsi en Irlande, en Bretagne aussi ; on croirait manquer au mort si l'on revenait des funérailles avec sa pleine raison».
Parmi les plus remarquables des tombeaux pompéiens nous citerons celui de Scaurus composé d'un cippe de pierre élevé sur trois gradins portés eux-mêmes sur un large soubassement. Sur le cippe se trouvait l'inscription annoncant que le tombeau avait été élevé à la mémoire du duumvir Aricius Scaurus, en partie aux frais de la ville de Pompéi. Tout autour du soubassement régnaient des rangées de bas-reliefs représentant des combats de gladiateurs. Ils ont fourni les plus curieux détails sur ces sortes de spectacles si chers au peuple romain. Malheureusement ils sont aujourd'hui en mauvais état et presque détruits. Le soubassement recouvrait la salle funéraire ou columbarium entourée de quatorze niches dans lesquelles les urnes avaient dû être déposées.
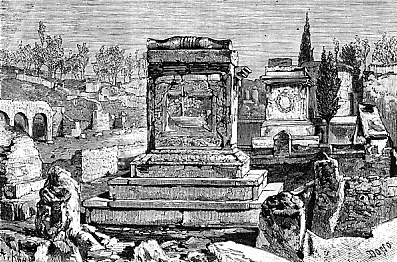 |
Le tombeau de Naevoleia Tyché était un magnifique monument en marbre blanc, ayant à peu près la même disposition extérieure que le tombeau de Scaurus. Les bas-reliefs qui se trouvaient sur le cippe représentaient un convoi funèbre. Sur un des côtés était sculptée une barque arrivant au port, symbole du repos qui suit l'agitation de la vie. Dans le columbarium placé au-dessous de l'autel, on a retrouvé des urnes de vitrage enfermées dans d'autres en plomb et contenant les cendres et les os des morts ; près de ce tombeau il y avait un triclinium funèbre.
On pourrait citer encore le tombeau rond dont l'autel avait la forme d'une tour, la tombe souterraine, où l'on a trouvé de beaux vases d'albâtre, le cénotaphe de Calventius, l'hémicycle couvert, tous entremêlés aux boutiques et aux hôtelleries des faubourgs.
Mais nous poursuivons notre route et jetant un dernier regard sur la ville encore à demi ensevelie dans son triste linceul, nous gagnons la porte d'Herculanum, nous dirigeons nos pas vers cette autre ville qui a été la soeur de Pompéi dans la vie et qui est restée sa soeur dans le malheur et dans la gloire.
L'importance des fouilles à Herculanum est beaucoup moins grande que celle des fouilles faites à Pompéi. Et pourtant Herculanum a été découverte la première ; et le peu que l'on connait d'elle fait espérer que la moisson artistique peut être encore plus heureuse ici que là. En effet Herculanum était la ville des amateurs et des rentiers, tandis que Pompéi était la ville des travailleurs, des marins et de la bourgeoisie active.
Mais une raison grave a suspendu et retardé indéfiniment les travaux d'Herculanum. Tandis que Pompéi s'est trouvée, ainsi que nous l'avons dit, ensevelie sous une couche de lapilli, petits cailloux qui mêlés à la cendre sont faciles à enlever, Herculanum au contraire, plus voisine du Vésuve, s'est trouvée enfouie et moulée pour ainsi dire, sous un torrent de laves. La lave a durci, et si elle a conservé d'une façon vraiment étonnante les objets qu'elle recouvre, par contre, le travail qu'il faut faire pour la percer et la briser, est bien plus rude que celui qui permet de déblayer Pompéi. De là la cause de la lenteur et des interruptions des recherches à Herculanum.
D'ailleurs la physionomie générale que pouvait présenter cette ville, quoique plus riche que sa voisine, ne devait pas en différer notablement. Le peu que l'on a vu des maisons et des édifices d'Herculanum concorde absolument avec ce que nous connaissons déjà. Les seuls éléments nouveaux qu'offrent les parties bien minimes d'Herculanum qui sont aujourd'hui mises au jour porte plutôt sur les détails que sur l'ensemble. Nulle part on n'a trouvé de plus beaux bronzes, de plus beaux marbres. Tout fait espérer que des recherches entreprises avec méthode amèneront la découverte d'un véritable musée d'antiquités sans égales.
Malheureusement, il faut le dire, les fouilles, telles qu'elles ont été entreprises à la fin du dix-huitième et au début du dix-neuvième siècle, ont été très mal dirigées ; les ruines à peine déblayées ont été recouvertes. Les plans et les figures ont été mal pris ou mal conservés. Les pièces d'art elles-mêmes et les inscriptions ne nous sont pas toutes parvenues en bon état.
Aussi, après avoir indiqué rapidement l'existence d'une Basilique (que les anciens archéologues ont pris pour le forum), et d'un Théâtre immense pouvant contenir plus de 10 000 spectateurs, mais analogue dans sa forme générale à celui de Pompéi, nous donnerons quelques détails seulement sur la plus importante des découvertes faites à Herculanum, la Maison des Papyrus.
Cette maison fut mise au jour en 1750 par un particulier qui creusait un puits. Charles III y fit poursuivre des fouilles pendant près de dix ans. On découvrit ainsi presque en entier la plus importante des maisons privées qui soit sortie des fouilles entreprises aux environs du Vésuve. Malheureusement le plan qui fut levé, dit-on, à cette époque, n'a pas été publié, et l'on en est réduit, pour se faire une idée de sa disposition, à citer le passage que Winckelmann lui a consacré : «Cette maison de campagne, dit-il, renfermait une grande pièce d'eau longue de deux cent cinquante-deux palmes de Naples (66m 30) et large de vingt-sept palmes (7m 10), dont les extrémités se terminaient en portion de cercle. A l'entour de cet étang, il y avait ce que nous nommons des compartiments de jardin, et il régnait tout le long de l'enceinte un rang de colonnes de briques revêtues d'une couche de stuc, au nombre de vingt-deux sur le côté le plus long et de dix dans la largeur. Ces colonnes portaient des solives appuyées par un bout sur le mur de clôture du jardin, ce qui formait une feuillée ou berceau autour de l'étang. On trouvait sous cet abri des cabinets de formes différentes, soit pour la conversation, soit pour prendre le bain ; les uns en demi-cercle, les autres carrés par leur plan ; des bustes ainsi que des figures de femmes en bronze étaient placés alternativement entre les colonnes. Un canal d'une médiocre largeur circulait le long de la muraille du jardin, et une longue allée conduisait au dehors à un cabinet ou pavillon d'été de forme ronde et percé de toutes parts, lequel s'élevait de vingt-cinq palmes de Naples (6m 60) au-dessus du niveau de la mer. Au sortir de la longue allée, on montait quatre marches et l'on parvenait ensuite à un pavillon où l'on a trouvé un beau pavé de marbre d'Afrique et de jaune antique».
Cette maison est ornée de tout ce que l'art antique a produit de plus beau et de plus raffiné. Les collections qui s'y trouvaient rassemblées étaient d'un si haut prix que les anciens eux-mêmes avaient essayé en fouillant la lave d'en reprendre quelque partie. Mais ils se découragèrent vite, et ce qui nous en reste dépasse probablement de beaucoup ce qu'ils ont pu emporter.
|
C'est par centaines que l'on compte les bronzes et les marbres aujourd'hui conservés au musée de Naples, et qui proviennent de cette maison. C'est le merveilleux Faune ivre, qui était dans le jardin entre deux statues représentant des coureurs ; c'est l'Aristide, d'une beauté sans égale, et dont la seule présence dans les fouilles mériterait de faire donner à cette maison le nom de Maison du Philosophe ; ce sont les bustes de Sapho, Platon, Epicure, Héraclite, Démocrite, d'Auguste, de Livie, d'Agrippine, de Caligula, de plusieurs Ptolémées, ce sont des satyres, des sylènes, des animaux, des oiseaux en bronze et en marbre ; ce sont encore des peintures parmi lesquelles le célèbre camaïeu sur marbre représentant des femmes jouant aux osselets. |
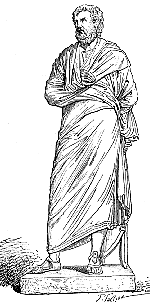 |
Ces découvertes si importantes ont été complétées d'une façon aussi heureuse qu'inattendue par celle de la bibliothèque faite le 5 novembre 1785. On retrouva là près de 2000 volumes de papyrus, que la lave avait protégés en endommageant seulement les parties extérieures. Il faut, pour se rendre compte de ce fait, ne pas oublier que les livres des anciens prenaient leurs noms de volumina (du verbe volvere), de ce qu'ils étaient réellement roulés, à peu près comme nos rouleaux de papiers de tentures ou comme nos cartes géographiques. On n'écrivait que sur un seul côté du papyrus, et les volumes, une fois roulés, étaient posés les uns sur les autres dans des armoires qui servaient de bibliothèques.
Quoique les manuscrits trouvés à Herculanum fussent en apparence collés et en partie carbonisés, il a été possible, grâce à un procédé ingénieux, inventé par un savant italien, de les dérouler en les appliquant au fur et à mesure sur une peau de baudruche. Ainsi, on a pu lire quelques centaines de manuscrits qui, par le choix, ont bien prouvé ce que nous disions plus haut, d'après le choix des bronzes, de la nature d'esprit du mondain raffiné qui, dans les temps anciens, réunit cette précieuse collection. En effet, ce sont surtout les oeuvres des philosophes, la plupart écrites en grec, qui composaient sa bibliothèque. Nous citerons un fragment du traité d'Epicure, les oeuvres de Philodème, épicurien du temps de Cicéron, et seulement, comme oeuvres latines, un poème attribué à Rabirius.
En somme, au point de vue littéraire, si l'on en juge par ce que l'on connaît déjà, la découverte n'a pas été aussi importante qu'on eût pu l'espérer tout d'abord.
Malgré les résultats considérables amenés par les recherches entreprises au dix-huitième siècle, les fouilles furent suspendues à Herculanum, dès que Pompéi fut découverte. Le peu qui en avait été fait, d'ailleurs, ne donna pas lieu de regretter qu'elles n'aient point été poursuivies à cette époque. Si nous en croyons Winkelmann, elles avaient été conduites dans le plus déplorable esprit. A titre de preuves, nous lui emprunterons l'anecdote suivante : «Au-dessus du théâtre, dit l'antiquaire allemand, il y avait un quadrige, c'est-à-dire un char attelé de quatre chevaux ; la figure placée dans le char était de grandeur naturelle ; ce monument était de bronze doré et l'on voit encore la base de marbre blanc sur laquelle il était assis. Quelques personnes assurent qu'au lieu d'être un char à quatre chevaux, il y en avait trois à deux chevaux chacun ; variété dans les rapports qui prouve le peu d'intelligence et de soin de ceux qui ont conduit cette fouille. Ces ouvrages de sculpture, comme on le croira sans peine, avaient été renversés par la lave, écrasés, mutilés ; cependant quand on les a découverts toutes les pièces existaient encore. Mais de quelle façon s'est-on conduit lorsqu'on a recueilli ces précieux débris ? On les mit pêle-mêle sur un chariot qui les transporta à Naples ; on les déchargea dans la cour du château, où ils furent jetés indistinctement dans un coin. Ce métal demeura longtemps dans cet endroit, regardé comme de la vieille ferraille ; ce ne fut que lorsqu'on se fut aperçu que plusieurs morceaux manquaient pour avoir été dérobés, qu'on résolut de mettre en honneur ce qui en restait, et voici en quoi l'on fit consister cet honneur ; on fondit une grande partie du métal pour former en grand les deux bustes du roi et de la reine !»
Cependant, à une époque plus moderne, on a repris le travail des fouilles à Herculanum. Cette nouvelle entreprise date de 1828, on a pu découvrir ainsi les rues qui conduisaient au théâtre et quelques maisons importantes, en particulier, la maison d'Argus, ainsi nommée d'une belle peinture représentant Mercure devant Argus et Io. On a pu compléter aussi les études sur le théâtre, et surtout remarquer combien les fouilles d'Herculanum pourraient produire de résultats supérieurs à ceux de Pompéi, du moins au point de vue de l'art et de la parfaite conservation. Mais le travail ici sera pénible. Et il ne nous reste plus qu'à nous associer au voeu récemment formulé par un critique, que quelque riche archéologue s'applique à la recherche des antiquités d'Herculanum. Il y a une ville moderne à démolir, beaucoup d'argent à dépenser et, certainement «beaucoup de gloire à acquérir».
 |