Le colosse de Rhodes

Le colosse de Rhodes
Lithographie de Ferdinand Knab
publiée dans Munchener Bilderbogen, 1886
Ce qui ne reste pas du colosse et ce qui reste des chevaliers
Le 16 avril 1876, jour de Pâques, le
Béhérah vient mouiller devant le port du
Pirée. Il doit repartir le même jour, pour
Alexandrie, mais en faisant escale à Rhodes. Nous
allons grossir le nombre de ses passagers.
Le Pirée est dans une fiévreuse agitation. En
effet, quelques jours auparavant, une frégate russe,
venant d'Egypte, a manqué l'entrée du port et
s'est piteusement échouée au rivage. Il faisait
nuit au moment de l'accident ; mais le temps était
beau, la mer calme. Le commandant avait confondu,
paraît-il, les lumières de la ville avec les
feux qui marquent la passe étroite du port.
La frégate, peu avariée du reste, a vainement
tenté de se dégager. Une corvette russe, en
station au Pirée, s'est la première
portée à son aide. Assistance insuffisante.
Puis on a appelé trois petits paquebots grecs ; et
tous, de compagnie, ont tiré, toujours sans aucun
résultat. La frégate a bougé non plus
que les rochers qui la retiennent prisonnière. Pauvre
frégate ! Elle n'a pas une mine bien triomphante. De
ses trois mâts, deux sont à demi
démontés, et plusieurs des canons les plus
lourds ont été portés à terre. Le
navire, pour s'alléger, se transforme en ponton. C'est
chose pitoyable que cette citadelle blindée,
cuirassée, toute de fer, à présent
inclinée sur le flanc et appelant à son secours
tous ces petits bateaux qu'un seul de ses boulets broierait
sans peine. Quelques pierres ont suffi à rendre
impuissante cette puissance formidable ; et les rats
maintenant doivent délivrer le lion.
Le Béhérah paraît, c'est un dernier
espoir. Il va renforcer l'attelage déjà
nombreux. Six cheminées fument furieusement ; on tire.
Enfin la frégate s'ébranle, elle remue, elle se
redresse. La voilà délivrée. Un hourrah
général retentit ; et la flottille des canots
s'agite comme une famille de canards en émoi. Au
Béhérah revient l'honneur d'avoir
décidé la victoire.
Les câbles, désormais inutiles, sont
ramenés à bord. L'équipage les
traîne et les roule, en accompagnant son labeur d'une
mélopée brutalement rythmée. Sur le Nil,
les matelots des dahabiéhs s'encouragent ainsi de
refrains monotones, soit qu'il faille pousser les gaffes ou
manoeuvrer les avirons.
Le Béhérah est un vaillant navire ; ce
sauvetage si heureusement accompli en est un éclatant
témoignage. Bien qu'il porte le pavillon ottoman, il
est de construction anglaise. Il a une machine puissante
comme il convient à sa masse vraiment imposante. Au
reste, le commandant s'empresse à nous
célébrer les mérites de son vaisseau. La
frégate russe n'est pas la première que le
Béhérah sauve d'un mauvais pas ; il coule aussi
à l'occasion les paquebots trop lents à lui
faire place, mais il les coule proprement, en toute aisance,
avec grâce.
Quelques jours avant mon arrivée en Grèce, un
abordage avait eu lieu près du cap Matapan.
L'Agrigento, paquebot italien, heurté par un paquebot
anglais, avait coulé bas, trente-quatre personnes
avaient péri. Le paquebot anglais, fort avarié
lui-même, avait pu gagner le Pirée, mais non
sans s'être allégé, en jetant à la
mer une partie de son chargement. Interné, mis sous
séquestre, jusqu'au jour où une enquête
judiciaire aurait décidé à qui incombait
la responsabilité de la catastrophe, le paquebot
enfonceur se trouvait ancré dans le port et montrait
à son avant une blessure toute béante. -
«Mauvais navire, disait notre commandant, il ne peut
crever les autres sans se crever lui-même, à
demi. Le Béhérah à la bonne heure ! il
crève, il coule les autres, mais sons jamais se faire
une écorchure. - C'est bien agréable pour les
autres», ajouta un passager en manière de
conclusion.
Le Béhérah présentait un curieux
assemblage des races et des nations les plus diverses, dans
son équipage et dans le personnel de ses passagers. Le
commandant était Dalmate d'origine ; les matelots
étaient Turcs pour la plupart. Il y avait des Grecs,
des Juifs, des Arméniens, quelques beys
égyptiens, un officier français qui allait
rejoindre à Alexandrie notre stationnaire, un
contre-maître français aussi. Puis on avait
parqué sur le pont deux troupeaux de femmes et de
fillettes. Troupeau est un terme très juste en cette
circonstance et qui ne paraîtra pas impertinent
à qui connaît un peu les hommes et les choses de
l'Orient. C'était là, en effet, un article de
commerce, et les fillettes allaient chercher acquéreur
aux harems de Rhodes ou d'Alexandrie. En attendant, tout ce
petit monde multicolore campait.
On avait dressé des tentes à l'arrière
du bateau, comme on aurait fait en plein désert et,
sous ce frêle abri que le vent parfois secouait
brutalement, c'était un entassement confus de jupes
jaunes, de foulards rouges, de ceintures bleues, de colliers
d'or, de pieds bronzés, de mains mignonnes, de pots,
de malles, de paquets, de coffres, de casseroles et de
guitares, de fleurs et de babouches, de guenilles et
d'oranges, d'enfants rieuses et de vieilles farouches. De
là sortaient des sons nasillards, unis au
bourdonnement d'un tambour, à l'aigre
gémissement d'un violon. Puis la toile s'agitait ; on
aurait dit que la tente tout entière allait entrer en
danse, et les yeux noirs scintillaient aux déchirures
béantes.
La nuit est complète, lorsque le Béhérah
mouille en vue de Rhodes ; aussi le mot vue est-il ici
une expression impropre. Les phares seuls, étoiles aux
feux changeants, annoncent la ville qu'enveloppent
d'insondables ténèbres.
Mais si de notre navire nous ne voyons pas Rhodes, de Rhodes
on voit notre navire. Les barques aussitôt viennent
l'assaillir. On se dispute bruyamment et nos personnes et nos
bagages. Nous débarquons à tâtons.
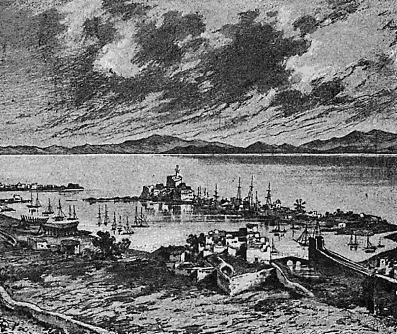 |
Vue d'un des ports de Rhodes
A peine
avons-nous mis pied à terre qu'un homme surgit de
l'ombre. C'est un douanier gradé, galonné ; un
lieutenant pour le moins. Au reste, il n'a pas
l'indiscrétion d'examiner quoique ce soit.
Obséquieux, humblement poli, il nous souhaite la
bienvenue et tend la main à quelque aumône. La
modique somme d'un franc vingt-cinq centimes que j'y
dépose, nous vaut de nouveaux compliments et le salut
le plus respectueux. Les douanes sont un des revenus les plus
considérables de l'empire ottoman et le plus
régulièrement perçu.
On nous conduit à travers un dédale de ruelles
fort étroites jusqu'à un passage qui donne dans
une cour. La cour aboutit à un escalier, l'escalier
mène à une chambre, la chambre renferme deux
lits. Là seulement une chandelle fumeuse nous montre
nettement où nous sommes. Notre première
promenade, à travers les rues de Rhodes s'est faite
dans la nuit la plus noire.
Si la nuit a été impitoyablement
ténébreuse, le jour, dès son apparition,
fait rage. C'est un embrasement furieux de toutes choses.
Rhodes se révèle environnée du plus
magnifique azur, Rhodes, chère au soleil,
«Rhodes, chante Pindare, la demeure du père des
rapides rayons, du maître des coursiers aux narines de
feu».
Nous sommes logés dans un petit hôtel que tient
un Grec, brave homme fort obligeant et qui offre à ses
hôtes une hospitalité presque écossaise.
Nous avons des galeries de bois qui forment portique en avant
des bâtiments d'habitation ; et partout, sur le sol,
les cailloux noirs et les cailloux blancs,
ingénieusement opposés, composent une
agréable mosaïque. C'est là un
procédé d'ornementation
généralement adopté à Rhodes.
Galeries, bâtiments, cour et petit jardin ne manquent
pas d'une pittoresque originalité.
Rhodes se partage en deux villes parfaitement distinctes,
indépendantes l'une de l'autre, on pourrait dire
ennemies. La ville où nous avons pris gîte est
à peu près exclusivement habitée par des
Chrétiens indigènes et des résidents
étrangers. Elle n'a nulle fortification qui la
protège et s'étale en toute liberté sur
un terrain plat, à peu de distance d'une grève
sablonneuse que les staticés égaient de leurs
bouquets bleus. Les rues sont tortueuses, elles vont de ci,
de là, comme pour échapper à l'invasion
d'un soleil trop ardent, au reste elles semblent plus propres
qu'il n'est ordinaire dans les villes orientales. Le sol
porte une armature de galets. Les maisons, petites pour la
plupart, n'ont le plus souvent qu'un rez-de-chaussée,
jamais plus d'un étage. Quelques grands mats,
dressés sur les terrasses, et qui, les jours de
fête, portent des pavillons, indiquent les demeures des
consuls. Il n'est rien qui présente un
intérêt spécial.
Arrivés sur le rivage, nous nous dirigeons dans la
direction de la ville de Rhodes proprement dite, de la Rhodes
du Colosse et des Chevaliers. Nous ne tardons pas à
rencontrer quelques débris antiques, épaves
affreusement mutilées, restes informes qui sans doute,
avant de venir échouer là dans la
poussière, ont passé à travers bien des
désastres, bien des pillages, bien des
dévastations. Car de la Rhodes antique rien ne
subsiste qui garde sa place primitive. Tout a
été broyé, dispersé. Et
Chrétiens et Musulmans se sont fait des armes de ce
qu'avait laissé l'antiquité païenne ; les
temples sont devenus des bastions, les statues sont devenues
des boulets. On s'est jeté à la face les
héros et les dieux.
Voilà cependant quelques fûts de marbre, mais
couchés côte à côte comme les
cadavres des vaincus ; puis c'est un bas-relief à
peine reconnaissable, puis un lion d'un travail grossier. Je
ne sais quelle fantaisie a fait placer ce pauvre animal au
faite de la muraille qui enclôt le jardin du pacha. Il
a l'air d'un chat endormi. Le jardin, plus plaisant à
la vue, resplendit sous le soleil ; c'est une vaste corbeille
de fleurs. Les géraniums y forment des buissons
écarlates.
La mer que nous longeons dessine une baie gracieusement
arrondie. Les bâtiments dits de la Santé, la
limitent d'un côté ; de l'autre s'avance une
digue que termine une tour féodale. Un phare, de
construction toute moderne, a pris pour piédestal sa
terrasse crénelée. Quelques bateaux,
très peu nombreux, sont mouillés près de
là. Quelques autres, de médiocres proportions,
et encore inachevés, montrent leurs squelettes sur le
rivage. Il est des platanes qui répandent, autour de
leur trône noueux, de larges taches d'ombre.
Les colonnes que tout à l'heure nous heurtions au
passage, nous rappelaient la Rhodes païenne ; maintenant
ce sont des canons que nous trouvons gisants, et c'est de la
Rhodes chrétienne qu'ils gardent le souvenir. Il y a
peu de temps, ces canons, montés sur leurs
affûts, passaient encore leurs gueules à travers
les embrasures des remparts. Tous sont de bronze et d'une
patine verdâtre tout à fait belle ; tous, ou
presque tous remontent à l'âge des Chevaliers.
Ils ont sans doute obéi au grand-maître Villiers
de l'Isle-Adam et vomi force boulets aux janissaires de
Soliman.
Aujourd'hui le gouvernement Turc, pressé par des
besoins d'argent, les vend au poids du métal. Mesure
barbare et sotte. Bien que les plus beaux canons aient
été enlevés depuis longtemps et
donnés en présent à plusieurs souverains
de l'Europe (quelques-uns sont à notre musée
d'artillerie), parmi ceux que Rhodes conservait, il en
était encore de fort remarquables et que les
collections publiques auraient certainement achetés
plus cher qu'un fondeur. On s'aide du feu pour briser les
plus grands, plusieurs mesurent jusqu'à cinq ou six
mètres de longueur. J'en vois qui portent le lion
ailé de Saint-Marc, d'autres des écussons,
d'autres des inscriptions turques, un enfin, qui de la
culasse à la gueule, est décoré de
grandes fleurs de lis. Titres de noblesse, fières
devises écrites dans le bronze, glorieuses armoiries,
ciselures délicates, car, au seizième
siècle on voulait de la grâce et de la
beauté jusque dans les engins de mort, tout, à
l'heure où paraîtront ces pages, aura sans doute
subi une honteuse métamorphose. Les canons seront
devenus de la monnaie, et les soldats, les employés,
toute la légion famélique des créanciers
de la Sublime Porte n'en recevront pas une piastre de
plus.
Ainsi, aujourd'hui c'est le tour des canons. Combien d'autres
curieux monuments de la domination des Chevaliers, les
avaient précédés dans cette
déroute lamentable ! Rhodes avait une magnifique
collection d'armes des quinzième et seizième
siècles et, sous ces carapaces de fer, on croyait voir
réunis pour une revue solennelle, les héros de
tant de sièges fameux. Tout cela a été
dispersé ; les Anglais de Malte ont pris la plus
grande part. Quant aux archives, tout a été
jeté aux quatre vents. La curiosité rapace des
archéologues et des collectionneurs a trouvé
une complicité facile dans l'incurie et l'ignorance
des Musulmans. Ces pauvres Turcs, ils sont une proie pour
tous ; on leur prend leurs antiquités, en attendant
qu'on leur prenne leurs provinces. Sans doute il faut, en
échange du butin enlevé, laisser des bakchichs
; mais qu'est-ce donc que quelques piastres,
gaspillées aussitôt que reçues,
auprès de tant de précieux débris
à jamais perdus ? Appauvrir un pays pour enrichir
quelque pacha imbécile, le beau calcul ! Le vendeur
joue toujours le rôle de dupe dans ces pitoyables
marchés.
La ville de Rhodes, par bonheur pour elle, renfermait des
choses moins portatives que des cuirasses ou des parchemins.
Ses remparts subsistent, et ils suffisent à nous
raconter son orageuse histoire. Cette même incurie qui
laissait égarer les menus objets, a été
ici la cause essentielle d'une heureuse conservation.
En tout autre pays, le génie militaire aurait voulu
améliorer, transformer, renverser peut-être. Des
bastions, des tours dont les plus jeunes comptent plus de
trois siècles, ce sont là des vieilleries peu
redoutables aujourd'hui ; les canons Krupp n'en feraient
qu'une bouchée. Mais les Turcs, même dans les
choses militaires, n'ont pas la manie du progrès.
Telles étaient les fortifications au jour où
Villiers de l'Ile-Adam les remit à Soliman, telles
nous les retrouverons aujourd'hui.
La maison qui sert de siège au gouvernement,
s'élève sur la plage, entre la Rhodes
chrétienne, cosmopolite, que nous habitons, et la
Rhodes aujourd'hui turque par droit de conquête. C'est
le seul trait d'union d'une cité à l'autre.
Cette maison dépassée, nous suivons une
chaussée qui affecte, grâce à des
plantations toutes récentes, une apparence de
boulevard, puis nous apercevons bientôt les
remparts.
Ils sont flanqués de tours, hérissés de
créneaux. Nous franchissons deux portes aux
voûtes ogivales. Les planches des ponts-levis
résonnent bruyamment sous le pied ; les orties
envahissent les fossés où l'eau ne vient plus.
A notre droite est une tour plus ventrue que les autres. Des
chevaliers, armés de pied en cap y sont
sculptés dans le marbre et, sous leurs pieds, leurs
écussons se groupent fraternellement. Mais le marteau
les a mutilés : les Turcs ont voulu exercer comme une
vengeance posthume sur les images et les emblèmes de
ceux qui les avaient si longtemps arrêtés.
Nous voici sur un petit quai ; c'est ce qu'on nomme la
Marine, endroit pittoresque, le plus animé et le plus
agréable de Rhodes. Là sont quelques
cafés, les postes, les agences des paquebots. Les
Turcs en turban, les Grecs qui souvent portent une calotte
rouge d'une hauteur énorme, y restent attablés
de longues heures. Ils ne parlent guère et pensent
moins encore. Chacun a son narguillé posé
à terre, et l'eau, imprégnée de
fumée, s'agite, clapote à chaque aspiration du
fumeur, dans la carafe de verre. Quelques enfants, importuns
parasites, font métier de cirer les chaussures,
étrange industrie dans un pays où ceux qui ne
vont pas pieds nus, ne portent que des babouches. Il y a
certainement à Rhodes plus de décrotteurs que
de souliers.
Sur la gauche s'étend le port proprement dit, assez
petit et peu profond. Quelques caboteurs y viennent mouiller,
et la flottille des caïques se presse tout alentour. Une
digue s'avance que terminait une tour, portant quatre
tourelles en encorbellement. Le tremblement de terre de 1863
l'avait rudement secouée. Il aurait fallu entreprendre
une restauration complète ; l'administration turque a
trouvé plus simple de tout jeter bas.
Dans tous les panoramas de Rhodes que la gravure a
vulgarisés, cette tour, dite de Saint-Michel, occupe
le premier plan. Aussi, ignorant sa destruction
récente, la cherchions-nous obstinément ; elle
laisse un vide fâcheux dans l'ensemble de la
cité.
Ce n'est pas la première fois que les tremblements de
terre ravagent Rhodes : Rhodes, dans l'antiquité,
avait souvent éprouvé la redoutable puissance
de ce fléau. Dès l'an 224 avant notre
ère, le fameux colosse était renversé et
brisé. Il y avait à peine cinquante-six ans
qu'il se dressait sur ses jambes d'airain. Il ne fut jamais
relevé et les Romains n'ont pu en admirer que la
ruine. «Tout abattue qu'est cette statue, dit Pline,
elle excite l'admiration : peu d'hommes en embrassent le
pouce, les doigts sont plus gros que la plupart des statues.
Le vide de ses membres rompus ressemble à de vastes
cavernes. Au dedans on voit des pierres énormes par le
poids desquelles l'artiste avait affermi sa statue en
l'établissant. Elle fut achevée, dit-on, en
douze ans et coûta trois cents talents, (environ un
million et demi de francs) provenant des machines de guerre
abandonnées par le roi Démétrius
qu'ennuya la longueur du siège de Rhodes. La
même ville a cent autres colosses plus petits, mais
dont un seul suffirait à illustrer tout lieu où
on le placerait. Outre cela elle a cinq colosses de dieux
faits par Bryaxis».
 | Aulu-Gelle nous parle du siège de Rhodes inutilement entrepris par le grand preneur de villes, Démétrius Poliorcète. La ville était bloquée, serrée de près et déjà attaquée par les hélépoles, tours de bois que l'on roulait jusqu'au rempart et qui permettaient aux assiégeants d'attaquer les assiégiés corps à corps ; Démétrius, dit-on, les avait inventées. Cependant Rhodes résistait et Démétrius était d'autant plus irrité qu'il avait coutume de vaincre. Il médite d'attaquer et de détruire quelques édifices publics situés hors de l'enceinte de la ville et qui n'enfermaient qu'une faible garnison. Sans doute il espérait par un premier exemple, prouver combien terribles pouvaient être ses vengeances et provoquer ainsi la reddition de Rhodes. |
Un des
édifices menacés abritait un tableau
représentant Jalyse fils de Cercophus et fondateur
d'une ville dans l'île de Rhodes ; ce tableau, oeuvre
de Protogène, passait pour un chef-d'oeuvre
merveilleux. Les Rhodiens voient sa perte imminente et
députent vers Démétrius :
«Pourquoi livrer aux flammes ce tableau ! lui font-ils
dire, si tu triomphes, la ville est à toi tout
entière et la victoire remet en tes mains le tableau
sans outrage. Si tu es contraint de lever le siège,
crains qu'on ne dise à ta honte que, ne pouvant
vaincre les Rhodiens, tu as fait la guerre à
Protogène».
Démétrius épargna le tableau et peu de
temps après il se retirait. Ainsi le passage du
conquérant ne coûta pas à Rhodes la
destruction d'une oeuvre d'art dont elle était
fière. Tout au contraire, Démétrius,
sans le prévoir sans doute, contribua à la
splendeur de la cité victorieuse ; car c'est du bronze
de ses machines, avons nous dit, qu'on fit le colosse, le
plus fastueux monument de triomphe qui fut jamais
élevé.
Lucien le personnifie et le met en scène dans son
Jupiter tragique :
«Et qui oserait me disputer le premier rang, lui
fait-il dire, à moi qui suis le soleil et dont la
taille est si gigantesque ? Si les Rhodiens n'eussent pas
voulu me donner une grandeur énorme et prodigieuse,
ils se seraient fait seize dieux d'or pour le même
prix. Je puis, donc, avec quelque raison, passer pour le plus
riche ; d'ailleurs l'art et la perfection de l'ouvrage
s'unissent en moi à une pareille grosseur.
- Que dois-je faire, Jupiter ? reprend Mercure. La chose est
difficile à juger. Si je considère la
matière, il n'est que d'airain ; mais si je calcule
combien de talents il a coûté à
fabriquer, il aura le pas sur ceux qui auront cinq cents
médimnes de revenu.
- Qu'avait-il besoin de venir, celui-là, riposte
Jupiter, pour faire ressortir la petitesse des autres et
déranger foule rassemblée ? Dis-moi donc,
excellent Rhodien, en supposant que tu l'emportes de beaucoup
sur les dieux d'or, comment ferais-tu pour t'asseoir au
premier rang, à moins d'obliger les autres à se
lever et à t'y laisser seul ? Sur le Pnyx tout entier
tu ne pourrais t'asseoir que de profil...»
Ampélius, dans son livre mémorial, parle aussi
du colosse de Rhodes : «A Rhodes il est une statue
colossale du soleil, placée avec un quadrige au sommet
d'une colonne de marbre. La colonne a cent
coudées».
Le même Ainpélius parle encore d'une statue de
Diane dont Rhodes s'enorgueillissait. «A Rhodes,
poursuit-il, il est une statue de Diane fort belle, et bien
qu'elle soit placée en plein air, jamais la pluie ne
la touche».
Le dévot prêtre d'Esculape, Aelius Aristide dans
son Oratio Rhodiaca, composée à la suite
d'un tremblement de terre qui avait dévasté
Rhodes sous Marc-Aurèle, s'écrie : «Il y
avait là plus de statues d'airain que dans la
Grèce tout entière».
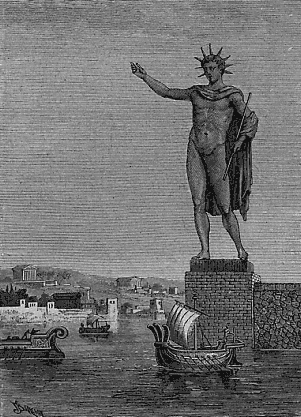 |
Le colosse de Rhodes
Les Rhodiens, en
effet, étaient fort habiles dans l'art de fondre les
métaux. Le fameux colosse en est un témoignage.
Ce colosse, oeuvre de Charès de Lindos,
élève de Lysippe, mesurait trente-deux
mètres de hauteur. On a prétendu qu'il se
dressait à l'entrée du port, le pied droit sur
une digue et que les galères passaient, voiles
déployées, entre ses jambes. C'est là
une fable extravagante qui paraît avoir pris naissance
au seizième siècle dans l'imagination fantasque
d'un certain Blaise de Vigenères, commentateur et
traducteur de Philostrate, mais que les auteurs anciens ont
ignorée et qu'ils contredisent formellement.
Les récits de quelques voyageurs et non pas toujours
sans autorité, puis les gravures, conceptions d'une
haute fantaisie, ont longtemps vulgarisé cette
légende du colosse enjambant le port et les
vaisseaux.
C'est ainsi que dans la cosmographie d'André Teuvet,
vaillant voyageur, mort cosmographe de Henri III, on voit la
ville de Rhodes tapie aux pieds d'un colosse invraisemblable.
La légende a fait fortune : elle est venue
jusqu'à nous. On trouverait plus d'un esprit
crédule qui n'imagine pas le colosse autrement
qu'ouvrant libre passage aux vaisseaux entre ses jambes. Dans
une féerie des sept merveilles du monde que l'on
jouait en notre première enfance, les
décorateurs n'avaient pas manqué de
représenter le colosse selon la tradition populaire.
Comme dernier argument contre cette fable, nous signalerons
une médaille Rhodienne, frappée sous
Tibère probablement et qui représente sur son
revers un Apollon debout, nu, le front ceint de rayons, la
main droite s'avançant comme en un geste de
protection, la main gauche appuyée au flanc et
retenant une draperie légère qui descend de
l'épaule. Il paraît vraisemblable que l'on peut
reconnaître là une reproduction sommaire du
fameux colosse, et c'est d'elle dont l'artiste s'est
inspiré dans sa restauration.
Les fragments du colosse restèrent sur le sol,
là où les avait semés le tremblement de
terre, jusqu'au jour où le kalife Moaviah I les vendit
à un Juif ; on y trouva, dit-on, la charge de neuf
cents chameaux. Cela se passait en 672.
Lucien parle encore de fastueux portiques que peuplaient de
nombreuses statues. De toutes ces oeuvres de la sculpture
rhodienne si renommée autrefois, il reste deux
monuments et les plus considérables que la sculpture
antique nous ait laissés : le groupe fameux, dit du
taureau Farnèse, et le Laocoon. Le
premier décorait les thermes de Caracalla à
Rome, et décore aujourd'hui le musée de Naples.
Apollonius et Tauriscus, tous deux Rhodiens, l'avaient
taillé dans un seul bloc de marbre. Le Laocoon
est l'oeuvre collective des Rhodiens Agésandre,
Polydore, Athénodore.
Mais Rhodes même ne garde rien de ses splendeurs et
c'est seulement dans le cuivre des robinets de ses fontaines
que l'on pourrait peut-être trouver quelque parcelle de
son colosse.
Une population joyeusement bariolée de couleurs
éclatantes, fourmille sans cesse sur la marine. Elle a
peu souci de tant de richesses détruites, de tant de
grandeurs disparues. Il est des chiens fauves, des
ânes, des poules, trop peu nombreuses, paraît-il,
pour les coqs. Aussi, deux de ces sultans emplumés se
livrent un furieux combat. Ils jouent de leurs ergots, et les
chevaliers de Saint-Jean ne jouaient pas plus vaillamment de
la lance. La foule s'amasse, et les deux rivaux semblent
trouver une excitation nouvelle dans l'attention dont ils
sont l'objet, lis se heurtent avec rage, puis tombent
à la renverse, l'un de ci, l'autre de là. Ils
se relèvent, prennent du champ et s'abordent encore.
Ils s'arrachent les plumes, le sang ruisselle de leurs
crêtes. Enfin un homme, le maître sans doute, peu
désireux de voir sa volaille avariée, accourt ;
un vigoureux coup de pied sépare les combattants et
les envoie rouler dans la poussière. Le tournoi est
fini et nos héros sont renvoyés à la
basse-cour. Deux hercules de foire ne sont pas plus penauds,
lorsqu'un gendarme interrompt leurs exploits et
impartialement les emmène l'un et l'autre en
prison.
Quelques mûriers s'alignent sur le quai, formant comme
le décor de cette tragédie. Le soleil se joue
gracieusement dans leur feuillage.
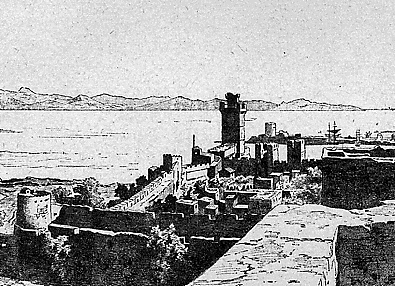 |
Port de Rhodes
Le rempart partout
domine le port ; quelques échopes boiteuses s'y
adossent comme des nids. Voici encore une porte ; elle est
flanquée ou plutôt écrasée de deux
tours rondes. Larges créneaux, meurtrières
perfides, mâchicoulis béants leur composent un
formidable diadème. Et toujours des écussons,
des anges soutenant respectueusement des casques de
chevaliers, des couronnes de comtes ou de marquis. Que
d'emblèmes triomphants et qui sont aujourd'hui des
monuments de défaites !
Nous trouvons bientôt le bazar. Il n'a pas de portes et
ne forme pas une cité distincte dans la cité,
ainsi qu'il arrive souvent en Orient. Les marchandises, pour
la plupart, proviennent de nos manufactures
européennes, c'est dire qu'elles n'offrent aucun
intérêt particulier. On trouve encore parfois,
au fond de quelque boutique, des plats émaillés
et coquettement décorés de feuillages, de
fleurs fantastiques ; mais ces produits, fort remarquables,
d'une industrie aujourd'hui complètement perdue,
deviennent de plus en plus rares. L'Europe enlève
tout, et l'on peut prévoir le jour prochain où
cette céramique rhodienne, florissante au temps des
Chevaliers, n'aura plus de spécimens que dans nos
musées, ou dans les collections de quelques riches
amateurs.
Le bazar de Rhodes n'est pittoresque que dans son ensemble et
par son cadre. Les ruelles caillouteuses s'y entrecroisent,
faisant des carrefours inattendus. Les boutiques sont
encombrées de sacs, de caisses, de paquets en
désordre, et le marchand disparaît au milieu de
ses marchandises. Quelques rares fontaines larmoient, et
près d'elles les vieux mûriers répandent
un peu d'ombre.
Non loin du bazar, un bâtiment s'élève,
robuste et d'aspect tout féodal. C'est encore,
à n'en pas douter, une construction de l'époque
des Chevaliers. Ils avaient là, dit-on, leur salle
d'armes. Les Turcs, modifiant peu la destination de
l'édifice, en ont fait une caserne et le siège
du commandant militaire.
La porte est ogivale. Quelques nervures l'encadrent, et les
boulets de marbre, amoncelés en pyramides, tiennent
lieu de bornes. Un passage voûté, un peu sombre,
conduit dans une cour carrée que des portiques
entourent. Les arcs très surbaissés sont
sillonnés de nervures puissantes, décoration un
peu massive, un peu lourde, non sans caractère
cependant. Il n'est qu'un étage ; il déploie
une galerie superposée aux portiques du
rez-de-chaussée. Une charpente inclinée la
recouvre. On nous montre à l'intérieur une fort
belle salle que huit arcs en ogive partagent en deux nefs. Le
plafond accuse à nu le bois de ses solives, et les
fenêtres, fort petites, ne laissent
pénétrer qu'une lumière adoucie.
Là où s'alignaient les armures, là
où s'étalaient les fastueuses panoplies,
couchent maintenant les soldats turcs. Le sol disparaît
sous un entassement confus de paillasses poudreuses, de
couvertures, de gamelles, de sabres, de guenilles, de fusils
; quelques hommes étendus s'y livrent aux douceurs de
la sieste.
 |
Rue des chevaliers à Rhodes
La
ville de Rhodes couvre un emplacement, non pas uni, non pas
très escarpé, mais incliné ; et c'est
par une pente régulière, relativement assez
douce, que l'on gagne les quartiers hauts. Une rue y conduit,
rue célèbre et que tous les voyageurs
s'empressent à voir, c'est la rue dite des Chevaliers.
Encore les Chevaliers, toujours les Chevaliers ! Tout
à Rhodes parle d'eux. Les Turcs semblent ici des
intrus insolemment campés au logis d'autrui. Les
véritables maîtres sont absents ; la cité
les attend, on ne serait pas surpris si, au tournant d'une
ruelle, paraissait quelque preux, casque en tête, lance
au poing et suivi de l'écuyer qui porte sa
bannière.
La rue des Chevaliers est droite et
régulièrement alignée ;
l'édilité rhodienne voulait parfois de la
symétrie. Un grand nombre de chevaliers avaient
là leurs maisons, ou plutôt leurs hôtels.
Des couronnes héraldiques sont taillées aux
claveaux des portes ogivales ; et les blasons nous disent la
noblesse des premiers propriétaires. Souvent ce sont
des créneaux qui forment le couronnement. Rhodes
était avant tout une citadelle, et tout devait y
prendre un aspect guerrier.
Bien des écussons ont été
enlevés, quelques-uns par les Turcs, un plus grand
nombre à l'instigation et aux frais de certaines
vieilles familles d'Europe, désireuses de prouver, par
un instrument authentique, qu'elles eurent des aïeux
parmi les Chevaliers de Saint-Jean. Cependant, quels que
soient les ravages que l'insouciance et la vanité
aient pu faire, beaucoup de ces pierres illustres restent en
place. La fleur de lis de France y apparaît souvent,
seule ou associée à d'autres emblèmes.
On voit même encore sculptés des chapeaux de
cardinal.
Ces nobles demeures n'ont plus que des hôtes
plébéiens. De pauvres familles turques se les
sont partagées ; et voulant accommoder les logis
à leurs moeurs, elles ont caché les
fenêtres derrière les moucharabiehs de
bois et ouvert des lucarnes entre les gargouilles
grimaçantes. Des guenilles pendent là où
flottaient les étendards. Et, par contraste, quelques
tourelles font saillie comme aux vieux manoirs
chrétiens ; une chaire extérieure subsiste
où prenait place sans doute quelque prêtre,
lorsqu'il fallait prier pour ceux qui allaient mourir.
Les rues qui débouchent dans la rue des Chevaliers,
sont beaucoup plus étroites. Des arcs souvent les
enjambent. De petites herbes ont germé entre les
pierres noires de la voûte, et la brise les balance
comme des festons légers.
Ce n'était pas assez des sièges, des
tremblements de terre, des pillages réglés ou
déréglés ; un autre fléau a
failli compléter, il y a peu d'années, la
dévastation de Rhodes. La poudrière
établie par les Turcs dans le haut de la ville, sauta,
emportant tout un quartier, une partie de la rue des
Chevaliers, le palais des Grands-Maîtres et plusieurs
centaines de personnes.
Sur l'emplacement du palais détruit, se trouve
maintenant la prison. Nous y pénétrons. Les
ferrures terribles grincent devant nous, les portes s'ouvrent
lourdement, lentement, comme à regret. Il est une cour
au-dessous de laquelle régnent de vastes citernes.
Quelques soupiraux permettent d'en sonder du regard les
mystérieuses profondeurs. - Les prisonniers
s'empressent autour de nous, cortège peu
agréable. Presque tous traînent des
chaînes pesantes ; un affreux bruit de ferrailles les
précède. Ils sont nombreux, et quelles faces
patibulaires ! Aussi ne faisons-nous pas long séjour
dans cet enfer. Je ne sais quelle vague inquiétude y
obsède la pensée, et les portes se sont si vite
refermées derrière nous, qu'en
vérité nous avons quelque crainte qu'elles ne
veuillent plus se rouvrir. C'est avec joie que nous nous
retrouvons dans la rue, respirant le grand air.
Non loin de la prison, mais un peu plus bas,
s'élève une mosquée que couronne une
assez vaste coupole. Un minaret, rond et surmonté d'un
petit toit pointu comme les minarets de Constantinoplc, fait
sentinelle sur la gauche. Un portique borde la façade
principale ; le sol en est dallé de marbre. Une
fontaine qu'un vieux mûrier ombrage, quelques
cyprès noirs, complètent heureusement le
tableau.
La porte, toute de marbre blanc, est un ouvrage de la
Renaissance, et certainement antérieur à la
fondation de la mosquée. Elle a dû être
enlevée de quelque église ou de quelque demeure
princière. Les deux colonnes qui la flanquent,
coiffent des chapiteaux délicatement ciselés.
De petites guirlandes se suspendent à leur fût,
et les pieds droits déroulent des frises charmantes.
Des armes pittoresques des instruments de musique, des
rinceaux capricieux y sont groupés au gré d'une
imagination charmante. Des fleurs, des fruits égaient
le cintre.
Mais cette jolie porte est peu hospitalière aux
infidèles ; pour obtenir qu'elle nous soit ouverte, il
nous faut de longues et laborieuses négociations. Nous
l'emportons enfin, mais pourquoi avoir pris tant de peine ?
la mosquée intérieurement est misérable
et sans intérêt, aux jours où les Turcs
s'installèrent victorieusement à Rhodes, l'art
musulman était en pleine décadence. Les
vainqueurs n'ont rien fait ici qui mérite un
souvenir.
Saint-Jean, l'ex-cathédrale, occupait la partie la
plus élevée de la ville. L'explosion de la
poudrière l'a ruinée de fond en comble. Seul le
clocher est resté debout, bâtisse fort
disgracieuse qui superpose deux rangs de colonnes. Une
école doit prendre la place du temple détruit.
On y travaille en ce moment, et des prisonniers,
amenés de la geôle voisine, font l'office
d'ouvriers, sous la surveillance débonnaire de
quelques soldats. Au reste, les fers qui leur brident les
jambes, rendraient vaine toute tentative
d'évasion.
Les fouilles entreprises pour asseoir les fondations du
nouvel édifice, ont mis à découvert de
nombreux débris de la cathédrale et même
quelques fragments beaucoup plus anciens. Quelques pierres
tumulaires ont reparu ; les unes portant la figure d'un
chevalier armé de toutes pièces ; les autres la
figure d'un moine endormi les mains jointes. Un chapiteau
dorique atteste que ce lieu fut consacré aux cultes
païens, longtemps avant de connaître la foi
chrétienne.
L'église de Saint-Jean renfermait les tombes de
presque tous les grands maîtres ; mais elles avaient
élé violées et pillées avant que
l'explosion les eût mises en poussière.
Rhodes, avons-nous dit, était avant tout une
citadelle, un poste avancé élevé par la
Chrétienté contre l'Islamisme et confié
à la fidélité des plus vaillants
héros. Toute l'importance de la ville, tout son
intérêt était dans ses fortifications. De
ces fortifications, nous avons vu une partie près des
ports ; nous allons les explorer sur un autre point et nous
entreprendrons de faire le tour complet de l'enceinte. Rien
ne nous donnera une idée plus exacte, et de l'assiette
de la cité, et de sa position stratégique, et
de sa topographie intérieure.
Lorsque Rhodes tomba au pouvoir des Turcs, en 1525,
l'artillerie avait déjà pris un grand
développement ; aussi les remparts sont-ils
disposés pour être armés de canons. Ce
n'est plus une enceinte telle que le moyen-âge les
concevait, quand les arcs et les arbalètes
étaient encore en usage ; et ce n'est pas une enceinte
telle que Vauban et ses élèves l'auraient
conçue plus tard. C'est un système mixte et qui
rappelle bien une époque où les Chevaliers,
tout en s'associant des artilleurs, n'avaient pas encore
complètement abdiqué devant eux. On
échangeait des boulets, mais aussi des coups
d'épée, et les canons ne portaient pas si loin
que la lance ne pût parfois aussi se mettre de la
partie.
C'est ainsi que les créneaux alternent avec les
embrasures. Nous trouvons des bastions qui projettent leur
triangle dans la campagne, et des tours qui ne
dépareraient pas un manoir féodal. Les
fossés sont très profonds, doubles, triples
parfois ; les vaches y broutent, peu soucieuses des
mâchicoulis béants. Là où se
rencontre une porte, il est tout un assemblage
compliqué de ponts, de poternes, de passerelles, de
tourelles, de barbacanes, de chaussées. L'architecte
s'est ingénié à rendre le passage aussi
difficile que possible ; c'est une entrée sans doute,
mais il semble que l'on se soit repenti de l'avoir
ouverte.
Voilà des casemates à l'épreuve des
bombes du seizième siècle. Dans la voûte
sont ménagés des soupiraux qui jettent sur le
sol des taches de lumière ; puis au-dessous des
casemates, s'enfoncent des souterrains qu'habitent
d'éternelles ténèbres. Les
décombres, les herbes embarrassent les escaliers qui y
donnent accès. Quelques fleurs, joyeusement
épanouies, s'étalent aux premières
marches ; puis ce ne sont plus que quelques fougères,
puis des mousses seulement, puis rien ; la vie
s'éteint graduellement avec la lumière.
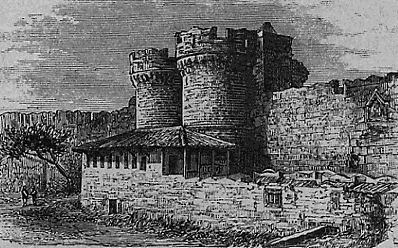 |
Tour de la forteresse à Rhodes
Au milieu d'une sorte d'enceinte
particulière, car il est murs sur murs, fossés
sur fossés, enceintes sur enceintes, un donjon
carré s'élève. Sur celle de ses faces
qui regarde la campagne, un saint Georges, armé de
pied en cap, chevauche et transperce de sa lance le dragon
légendaire. Quatre écussons accompagnent ce
bas-relief. Au reste, on ne trouve pas une tour, pas un
bastion, pas un pan de mur, qui n'ait son écusson.
Chaque chevalier voyait ainsi marqué, pour lui et pour
ses hommes son poste de bataille.
Une végétation puissante prospère
partout, et ses assauts sont plus triomphants encore que ceux
des Turcs. L'herbe tapisse les terrasses et festonne les
créneaux. Et cependant les Turcs, qui se croient sans
doute encore au temps de Soliman, prennent toujours au
sérieux ces fortifications plus pittoresques que
redoutables. Ce n'est pas chose aisée d'y obtenir
libre accès ; et le gouverneur militaire peut seul
donner l'autorisation indispensable.
Partout des canons sont en batterie, et quels canons ! aussi
vénérables que les remparts qui les portent.
Ils menacent de leur gueule de fonte (car les canons de
bronze ont disparu), la campagne qui sourit splendidement
fleurie, comme si elle comprenait l'inanité de cette
menace. Auprès des affûts boiteux, à demi
ensevelis sous les herbes folles, s'élèvent en
pyramides symétriques, des boulets, des biscaïens
que la rouille dévore. Nous trouvons même des
boulets de marbre et leur blancheur s'oppose brutalement au
vert du gazon.
La promenade est longue pour faire le tour de la ville ; mais
le spectacle change sans cesse et reste toujours admirable.
Les glacis servent de cimetière ; les stèles y
portent le turban, emblème des vrais croyants. Sans
doute les braves, tombés dans la mêlée
furieuse des assauts, reposent là, au pied du mur que
d'autres plus heureux devaient conquérir. Quelques
platanes étalent comme une tente de feuillage,
au-dessus de ce champ de mort. Puis des maisonnettes blanches
scintillent au milieu des blés, tandis que de rares
palmiers montrent leur tête empanachée.
Détournons-nous les yeux ? c'est la ville que nous
découvrons. Les bâtisses s'y entassent
confusément. Tours, clochers, terrasses, minarets
pointus qui annoncent les mosquées, s'étagent
et descendent vers la mer au loin rayonnante. Les côtes
d'Asie-Mineure, bleuâtres, mollement arrondies,
s'alignent aux limites dernières de l'horizon.
Toujours cheminant de murs en murs, de bastions en bastions,
de créneaux en créneaux, nous gagnons les
parties basses de la ville. Les maisons y sont plus
clairsemées ; elles ont pour la plupart jardin ou
verger. Les orangers, les figuiers composent des bosquets
ombreux, et les oliviers projettent leur ramure noueuse
jusqu'au chemin de ronde. Nos regards indiscrets sondent
librement ces intérieurs qu'une méfiance
jalouse nous aurait certainement interdits. Ici, les femmes
s'empressent aux soins multiples du ménage ; on lave,
on suspend aux arbres quelques guenilles
vénérables ; plus loin le feu flambe, on
procède aux préparatifs du prochain repas ; les
enfants jouent bruyamment, et leurs voix joyeuses parviennent
jusqu'à nous.
Nous arrivons au rivage ; le flot expire au pied même
du rempart et les algues traînantes s'accrochent aux
premières assises. Quel silence cependant ! non pas
dans la ville mais sur son enceinte, quelle solitude !
L'herbe ne garde nulle part vestige de pas. Plus d'hommes
d'armes en sentinelle, plus d'appels
répétés de tours en tours, plus de fiers
guerriers, plus rien qu'un souvenir illustre dans le
passé et les misères d'un présent sans
gloire.
Rhodes a son théâtre, ou, pour mieux dire,
Rhodes avait son théâtre lorsque nous y
séjournions. Quel théâtre ? Un
théâtre antique sans doute, contemporain du
colosse ? - Non pas, un théâtre moderne. -
Voilà certes, une surprise et qui trouvera bien des
incrédules.
Une troupe d'artistes des deux sexes était venue
s'échouer dans l'île, nous ne saurions dire
à la suite de quelle tempête : la vie de
l'acteur est féconde en traverses bizarres, surtout en
Orient. Ces malheureux, presque tous Italiens au moins
d'origine, avaient entrepris de faire montre de leur talent
devant le public. Un public à Rhodes ! Quel
rêve! Une trentaine de personnes, en comptant consuls
et vice-consuls, tous Européens, pouvaient seuls en
fournir les éléments, car les indigènes
sont peu curieux d'art dramatique.
Il fallait trouver un local. Une grande maison turque,
aujourd'hui inhabitée et située un peu en
dehors de la ville, avait été choisie et
disposée en vue de cette destination fort nouvelle. Au
reste, tous les travaux avaient consisté à
séparer en deux parties inégales la plus vaste
salle de la maison, puis à surélever avec des
tréteaux la partie la plus petite pour en faire la
scène, en réservant l'autre pour le
public.
Le soir venu, nous nous acheminons vers le
théâtre, ou, pour parler comme au temps
passé, nous allons à la comédie ; nous
avons eu soin de nous faire précéder par un
serviteur de l'hôtel qui porte nos chaises ; car chacun
doit apporter la sienne s'il ne veut rester debout.
Quelques chandelles fumeuses composent l'éclairage. Le
rideau réunit, dans une alliance étrange, un
croissant bleuâtre qui a la prétention de
représenter la lune, un disque qui simule le soleil,
des étoiles et force taches d'huile qui remplacent
sans doute la voie lactée. Des ficelles, d'un jeu
capricieux, manoeuvrent non sans accrocs, ce firmament
mobile. L'assistance est peu nombreuse ; on dirait une
réunion de famille, car les maris sont venus avec les
femmes ; les femmes avec les enfants même les
nourrissons. Les acteurs eux-mêmes donnent l'exemple de
cette touchante fraternité ; du plus grand au plus
petit, tous prennent part à la représentation.
Ceux qui ne peuvent chanter, parlent ; ceux qui ne peuvent
parler, sautent, dansent ou posent. Le programme a du moins
le mérite de la variété. On nous sert
des comédies au dialogue heureusement panaché
de grec et d'italien, un intermède musical, des
danses, des pantomimes avec force cascades, puis des
exercices de gymnastique, exécutés au milieu
même du public, non sans danger pour les crânes
et les chignons. Enfin, viennent les tableaux vivants,
à l'usage sans doute de ceux qui, ignorants du grec et
de l'italien, ne comprennent que par les yeux. Toute la
troupe figure, y compris un enfant de quelques mois à
peine. Ce sont divers épisodes des récits
bibliques qui deviennent l'objet de cette parodie naïve.
Pauvres gens ! Ils jouent au prophète, ils se
déguisent en patriarche ; ils se transforment tour
à tour en Abraham, en Joseph, en Elie, en Agar, en
Rebecca, en Assuérus ; et Abraham n'a pas une tente,
et Assuérus attend peut-être la recette pour
dîner. En vérité, toute cette
misère prête moins à rire qu'à
pleurer.
Durant les entr'actes les femmes viennent solliciter la
générosité de leurs rares spectateurs.
Ainsi que faisaient autrefois nos troupes de
comédiens, dans leurs courses vagabondes :
Molière jouait dans des granges, et les chefs-d'oeuvre
de Corneille n'eurent pas de cadre plus somptueux.
Mais à Rhodes, nous ne trouvons ni Corneille ni
Molière ; en revanche nous avons, au seuil même
de la salle de spectacle, un grand jardin tout peuplé
d'orangers, des treilles ombreuses, une piscine de marbre, un
kiosque pittoresque ; et le tout quelque peu
délabré, attend un acquéreur. On demande
dix mille francs du domaine entier et l'on donnerait, je
crois, la troupe dramatique par-dessus le
marché.
L'île de Rhodes est montagneuse, et les routes n'y sont
connues que de réputation ; aussi n'y a-t-on jamais vu
une voiture. Le cheval et l'âne sont les seuls moyens
de locomotion en usage. Bien que nous n'ayons pas eu le temps
de nous lancer dans des expéditions lointaines, deux
petites promenades, faites aux environs de la ville, nous ont
cependant donné quelque idée des campagnes
Rhodiennes. La végétation est partout d'une
grande vigueur. A peine sortis de la ville, nous trouvons des
sentiers rocailleux qui serpentent, souvent
profondément encaissés. Des murs les bordent
qui servent de clôture aux champs ; et le regard se
trouve ainsi désagréablement emprisonné
en d'étroites limites. Mais bientôt les murs
disparaissent ; campagnes, horizons lointains se
découvrent librement. Les talus portent des arbres de
Judée qui renversent leurs branches où les
fleurs ont précédé les feuilles : ils
semblent comme poudrés de rose. Les figuiers de
Barbarie entremêlent leurs raquettes épineuses.
Puis ce sont des cystes formant de grands bouquets blancs ou
pourprés. Les genêts d'or succèdent aux
lentisques, tandis que les cyprès dressent leur
pyramide noire.
Les ravins nous découvrent parfois, en des
échappées subites, et la mer azurée et
les rivages gracieux de l'Asie.
Quelques bâtisses blanches apparaissent au faite d'une
colline. Elles dépendent d'un domaine assez
considérable et qui est la propriété
d'un Français. La vigne, le blé y sont
cultivés en même temps que le mûrier, car
l'élevage des vers à soie est une des rares
industries de Rhodes. Une source abondante et d'une admirable
limpidité, porte de champs en champs la
fraîcheur et la fécondité ; quelques
grands géraniums l'encadrent de leurs touffes
fleuries. Un quinconce, planté de citronniers et
d'orangers, se déploie près de là, et
l'air est imprégné des parfums les plus doux.
Tout alentour le soleil fait rage ; le soleil était la
divinité principale de Rhodes, il s'en souvient et
règne encore en maître tyrannique.
A une heure et demie de Rhodes environ, est un tombeau
antique que les uns désignent sous le nom de tombe
d'Amdéri, les autres sous le nom de tombe de
Confovouni. Rien de plus fréquent en Orient que cette
diversité dans les noms, et rien qui soit une source
plus féconde d'erreurs, lorsqu'il s'agit de dresser ou
de consulter une carte. Il ne faut jamais oublier que la
nation ici n'est pas une, ni la race, ni la langue, ni la
religion. Les Grecs se servent d'une locution, les Turcs
d'une autre, et le mot change souvent avec la race de l'homme
qui parle.
Quel que soit son nom véritable, le tombeau que nous
visitons présente un grand rocher dégrossi,
régularisé par le ciseau et formant un cube
allongé. Sa face principale aligne dix colonnes
à demi engagées ou plutôt dix nervures
arrondies. On reconnaît vaguement quelques vestiges de
la corniche qui encadrait la porte. A l'intérieur,
nous trouvons un vestibule dont le plafond est plat, puis une
salle plus vasle dont le plafond, formant angle, imite la
double inclinaison d'un toit. Des cases régnent tout
à l'entour, creusées comme les salles
elles-mêmes, au vif du rocher. Nulle trace ni de
peinture, ni de sculpture, ni d'inscriptions. Tout
révèle dans ce monument, une haute
antiquité, et l'on peut supposer qu'il remonte
à une époque antérieure aux guerres
Médiques.
Ce sépulcre vénérable sert aujourd'hui
d'étable, vicissitude peu glorieuse. Les arbustes,
accrochés aux lézardes du roc, lui
prêtent un pittoresque couronnement, et le sol, fait de
décombres, disparaît sous les herbes. Les iris y
montrent leurs grandes fleurs d'azur, et les arums
géants déploient leurs longs cornets
rougeâtres.
De ce tombeau, poursuivant notre course, nous nous dirigeons
vers le village de Koskinoi. Le sentier monte et descend en
lacets capricieux. Les lauriers-roses égayent les
profondeurs des ravins que nous contournons. Puis voici des
chênes centenaires, frères de ceux qui
s'étalent aux champs de la Troade ; ils forment de
grands dômes de feuillage, et c'est une joie de passer
sous leur ombre. On cultive beaucoup le blé ; les
épis apparaissent déjà hauts et
gonflés de grains. Souvent le chemin disparaît,
et nous avons peine à nous frayer passage entre un
double rempart d'églantiers, de ronces, de lianes
épineuses, de liserons violets qui s'entrelacent en un
inextricable fouillis. Cette campagne est toujours d'un
aspect riant, mais plus aimable que grandiose.
Au tournant d'un vallon, nous découvrons le village.
Il trône au faîte d'une montagne comme un nid
d'aigle. Les maisons s'étagent, éblouissantes
de blancheur ; leurs murailles, passées à la
chaux, rayonnent, et l'on dirait des blocs de marbre blanc
à peine sortis de la carrière. Les ruelles
escarpées et caillouteuses, semblent avoir
élé faites pour les chèvres, non pour
les humains. Une nombreuse population y grouille cependant,
et les femmes en compagnie des chiens, et les hommes en
compagnie des ânes, et les enfants en compagnie des
porcs. Les poules vaguent librement.
Nous entrons dans quelques maisons ; on nous y accueille avec
l'empressement le plus courtois. Nous ne sommes pas au milieu
des Turcs, mais au milieu des Chrétiens moins jaloux
de l'inviolabilité de leurs pénates.
Deux des maisons que nous visitons, présentent
à l'intérieur une décoration originale ;
dans la principale salle, du sol au plafond, ce ne sont
qu'assiettes et plats. La muraille disparait sous cette
mosaïque luisante. Mais les vieux plats Rhodiens
produits des industries locales, y sont fort rares ; des
faïences grossières, des porcelaines aux
enluminures criardes, sorties des manufactures
Européennes, les remplacent et par malheur les font
regretter.
Nous venons de dire que la population du village
visité par nous est exclusivement grecque et
chrétienne. Il en est ainsi dans tous les villages de
l'île, et l'on peut ajouter, presque sans exceptions,
dans les villages de toutes les îles de l'Archipel. On
ne trouve des Turcs, à Rhodes, que dans la ville
principale. Là sont des fonctionnaires, quelques
soldats et quelques familles venues à leur suite ; la
population, réellement indigène, ne voit en eux
que des étrangers. Pour elle, la vraie patrie, le
centre autour duquel gravitent ses désirs, ses
aspirations, ses rêves, c'est non pas Constantinople,
mais Athènes. Rhodes est comme un satellite de cet
astre renaissant. Au reste, il n'y a pas qu'une sympathie
instinctive entre les membres dispersés de la grande
famille Grecque ; il y a un échange incessant
d'idées et même une sorte de
solidarité.
Les jeunes gens qui peuvent recueillir quelque modeste
pécule, vont à Athènes grossir le nombre
des élèves de l'Université ; ils
s'exaltent aux souvenirs du passé, et plus encore aux
luttes du présent, aux espérances ambitieuses
de l'avenir. Rentrés dans leur île, ils
retrouvent un pacha qui commande, des Turcs, non pas toujours
tyranniques, mais toujours pleins de mépris pour le
raya Chrétien ; et ces étudiants de la veille
deviennent autant d'apôtres des idées
d'émancipation, autant de propagateurs ardents de la
haine du Musulman. Ils n'allument pas encore l'incendie, mais
ils le préparent. C'est une croisade
prêchée tout bas de village en village, de
maison en maison.
Les maîtres d'école ne sont pas les agents les
moins puissants dans ce travail secret qui peu à peu
mine l'empire Ottoman. Beaucoup d'entre eux sont Grecs de la
Grèce libre. Ils viennent s'installer dans les villes
de la côte Asiatique où l'élément
Grec est très nombreux, ou bien dans les îles.
Le plus petit hameau a son école. Là ils sont
bien reçus, environnés d'une sympathie qui
s'affirme et par une grande considération, et par des
appointements relativement considérables, et par des
gratifications, des cadeaux de tous genres. Les enfants qui
sortent de leurs mains sont de fait des sujets Turcs, mais de
coeur des citoyens Grecs.
Il est aisé de prévoir quelle sera un jour ou
l'autre la conséquence fatale d'un semblable
état de choses. Sans accepter les rêveries un
peu extravagantes qui hantent l'esprit de quelques Grecs,
sans croire que nous verrons jamais l'empire Byzantin
rétabli, on peut dire en toute assurance que Rhodes et
les îles voisines feront retour à la
Grèce. Les Turcs y sont une anomalie. Leur race n'a
pas pu y prendre racine. Sans combats, sans luttes, par la
force même des choses, ils en sont peu à peu
refoulés. Les Grecs, exemptés du service
militaire, ne cessent de se multiplier ; les Turcs qui
doivent au contraire fournir tous les soldats de l'empire,
diminuent sans cesse. L'équilibre sera
inévitablement rompu ; les Grecs peuvent attendre en
toute confiance, l'avenir est à eux. Ils triompheront
un jour par l'école, s'ils ne triomphent pas par la
guerre.
Et pour compléter cette visite, vous pouvez voir sur la toile
- Une page de Wikipedia en anglais.