XLIX - Spartacus - Rétablissement de la puissance tribunitienne - Les pirates |
III - GUERRE DES PIRATES
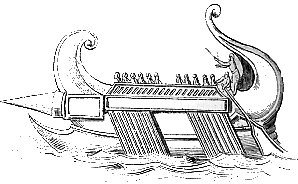
Bateau des pirates (hemiolia) |
Depuis l'ébranlement imprimé par les
Gracques à la république, il n'y avait que
trouble au dedans et révolte au dehors. Si dans cette
lutte la liberté périt, la domination du moins
fut sauvée, et les provinciaux retombèrent sous
un joug plus dur. Mais, à toutes les époques de
servitude, il y a des hommes qui aiment mieux être
bandits qu'esclaves. La mer immense, la mer libre, fut
l'asile de ceux qui refusèrent de vivre sous la loi
romaine : ils se firent pirates, et, comme le sénat
avait détruit les marines militaires sans les
remplacer, les profits étaient certains, le danger
nul. Aussi ce brigandage prit-il en peu d'années un
développement inattendu. Dans ses guerres, Mithridate
reçut d'eux d'importants services. Quand, sur l'ordre
de Sylla, il licencia ses flottes, ses matelots
allèrent augmenter leur nombre. De toutes parts on
accourait à eux, les courages aventureux comme les
coeurs avides. Enfants perdus de tous les partis et
désespérés de toutes les causes,
individus ruinés par la guerre ou par sentence de
justice, citoyens bannis de leur cité, esclaves
échappés de leur geôle, ils recevaient
tout. On vit même des personnages distingués par
leur naissance aller à cette chasse aux marchands de
l'Ionie, de l'Egypte et de la Grèce. Les flots qui
couraient de Cyrène à la Crète, de la
Crète à Délos et à Smyrne
étaient pour eux la mer d'or, tant leurs
rapides navires y faisaient de riches captures. Ils ne se
cachaient pas : l'or, la pourpre, les tapis précieux,
décoraient leurs navires ; quelques-uns avaient des
rames argentées, et chaque prise était suivie
de longues orgies au son des instruments de musique. Leurs
chants devaient être les mêmes que ceux du
Corsaire de Byron : «Aussi loin que court la
brise et que les vagues écument, aussi loin va notre
empire. Hâtons-nous de jouir. Qu'importe la mort
!»
La Cilicie, avec ses ports sans nombre et ses montagnes qui
descendent jusqu'au rivage, avait été leur
premier repaire ; mais, sur toutes les côtes, ils
avaient des arsenaux, des lieux de retraite et des tours
d'observation. On leur croyait plus de mille navires ;
déjà ils avaient pillé quatre cents
villes, Cnide, Samos, Colophon, et les temples les plus
vénérés : ceux entre autres de
Samothrace, d'Epidaure, de Neptune, dans l'isthme de
Corinthe, de Junon à Samos et à Argos, etc., et
l'on sait que les temples recevaient non seulement les
offrandes aux dieux, mais les dépôts des
fidèles. De celui de Samothrace, ils enlevèrent
1000 talents. Un poète du temps s'écrie
après le pillage de Délos : Ils ont
réduit Apollon à la misère, et de tant
de trésors qu'il avait amassés, il ne lui reste
pas une piécette d'or dont il puisse faire cadeau.
Cependant ces bandits, venus surtout de l'Asie, avaient un
culte, mais c'étaient des sacrifices barbares, les
sanglants mystères de Mithra, que les premiers ils
firent connaître à l'Occident.
Trop de Grecs se trouvaient parmi eux pour qu'ils n'eussent
pas fait la théorie de leur honnête
métier. «Il n'y a pas d'injustice, disaient-ils,
à recouvrer par l'adresse ce qui a été
arraché par la force. Les biens que les puissants nous
ont ravis tout d'une fois, nous les reprenons en
détail». C'était donc avec une conscience
tranquille qu'ils exerçaient leur fructueuse
industrie. Et l'on ne voit pas, en effet, le droit des gens
dans l'antiquité n'étant que le droit de la
force, pourquoi ces pirates organisés en
république régulière ne se seraient pas
regardés comme les maîtres aussi
légitimes de la mer que les Romains l'étaient
de la terre.
Robin Hood épargnait le pauvre Saxon et tuait le
shérif normand ; les pirates aussi étaient sans
pitié pour le Romain : ils le mettaient à
grosse rançon et le vendaient au loin quand il ne
pouvait la fournir. Parfois même, si un prisonnier
s'exclamait, avec ce cri orgueilleux que les rois
respectaient : Je suis citoyen ! ils feignaient
l'étonnement, la terreur, se jetaient à ses
genoux, lui demandaient grâce ; puis ils lui
apportaient, l'un des sandales de voyage, l'autre une toge,
afin, disaient-ils, qu'il ne fût plus exposé
à être méconnu, et, après
s'être joués longtemps de sa crédule
dignité, ils attachaient une échelle au navire
et le priaient de descendre pour regagner la Ville
éternelle. Ce fut le sort du préteur
Bellianus.
De la Phénicie aux colonnes d'Hercule, il ne passait
plus un navire qui ne payât rançon. L'Italie et
la Grèce étant tout en côtes, la
société gréco-romaine vivait au bord de
la mer, et sur le littoral se trouvaient les plus belles
villas, les plus riches cités. Que
d'inquiétudes, que de misères causées
par les soudaines incursions de ces bandits ! Deux
préteurs furent enlevés avec leurs licteurs et
leurs faisceaux ; Brindes, Misène, Gaëte, Ostie
même, aux portes de Rome, subirent le pillage. Lipara
leur payait un tribut annuel ; un de leurs chefs osa
pénétrer, avec quatre de ses navires, dans le
port de Syracuse ; un autre brûla dans Ostie une flotte
consulaire.
A ce moment Sertorius soulevait l'Espagne. Spartacus allait
armer les gladiateurs, et Mithridate préparait en Asie
une nouvelle guerre. Les pirates auraient pu servir de lien
entre tous ces révoltés. Mais cette force
immense, qui eût donné un grand pouvoir à
son chef, comme il arriva quelques années plus tard
pour Sextus Pompée, manquait de discipline et d'union
; les idées de brigandage l'emportant sur les
idées politiques, ils conduisirent bien à
Mithridate les envoyés de Sertorius, mais ils
trahirent Spartacus et causèrent sa ruine.
Tant qu'ils n'avaient pillé que des Grecs ou des
Syriens, on les avait laissés faire. L'oligarchie qui
gouvernait le monde romain se souciait peu du malheur des
sujets ; les grands mêmes y trouvaient leur compte ;
car le prix des esclaves baissait, grâce aux pirates,
qui approvisionnaient tous les marchés. Mais, quand
ils coupèrent les approvisionnements de Rome, le
peuple, affamé, commença à croire sa
dignité blessée par l'insolence de ces bandits,
et en 78 un vigoureux effort fut fait contre eux.
L'occupation de la Cilicie commencée en 103 par le
préteur Antonius n'avait pas été
continuée avec l'ardeur que les Romains mettaient
d'ordinaire à étendre leurs provinces. Le
sénat s'était contenté d'avoir en ce
pays un poste militaire, d'où il surveillait les rois
de Syrie et pouvait prendre à revers ceux de Pont et
d'Arménie, s'ils s'aventuraient dans l'Asie Mineure ;
mais il ne s'était point chargé de
détruire les établissements que les pirates
avaient formés tout le long des côtes. Sylla,
préteur dans la Cilicie en 92, ne s'occupa que de ce
qui se passait au delà du Taurus. Mithridate laissait
alors entrevoir ses ambitieux desseins et faisait oublier les
pirates, qui, durant sa grande lutte avec Rome, surtout
pendant la guerre Sociale et la guerre Civile,
multiplièrent tout à l'aise. Cependant le
dictateur ne les avait point perdus de vue ; il fit arriver
au consulat, en 79, un petit-fils de Metellus le
Macédonique, Servilius Vatia, qui, l'an
d'après, fut envoyé comme proconsul en Cilicie,
avec une puissante flotte et une armée. C'était
un homme intègre et un vaillant capitaine. Les pirates
n'avaient que des navires de course, les souris de la
mer, très rapides, mais incapables de
résister au choc des galères. Servilius en
détruisit un grand nombre dans une action navale
qu'ils eurent l'imprudence d'accepter, en vue de Patara ;
puis, durant plus de trois années, il attaqua l'une
après l'autre et rasa quantité de forteresses
qui leur servaient de repaires. Ce furent de laborieuses
campagnes où on avait à combattre la nature
plus encore que les hommes : l'été, des
chaleurs torrides et des miasmes
délétères ; l'hiver, l'air glacial qui
descendait des cimes neigeuses du Taurus ; pour fleuves, des
torrents ; pour routes, des gorges impraticables à des
troupes régulières. Bâtie aux flancs
escarpés des montagnes, chaque forteresse demandait un
siège régulier où l'acharnement des
défenseurs répondait à la
ténacité des assiégeants : à
Olympus le chef ennemi, plutôt que de se rendre, fit de
son butin un immense bûcher, y mit le feu et se
brûla lui-même. Quand Servilius crut avoir
détruit à la côte les principaux nids des
pirates de mer, il alla chercher, au delà du Taurus,
les pirates de terre, ces Isauriens dont aucun gouvernement
n'a jamais eu complètement raison. Comme l'aigle qui
fait son aire aux lieux les plus élevés pour
apercevoir de plus loin sa proie, ils avaient suspendu leur
capitale, Isaura, à une roche escarpée qui
dominait la plaine d'Iconium. Servilius s'en rendit
maître en creusant, dans la roche vive, un lit nouveau
au torrent qui donnait l'eau à la ville. Il y gagna le
surnom d'Isauricus ; mais il n'était pas rentré
à Rome en triomphe, que les souris de mer
reparaissaient partout.
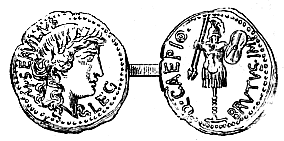
Monnaie triomphale de Servilius |
Le sénat se décida enfin à
constituer un grand commandement maritime qu'il donna au
préteur Antonius dont la soeur venait d'être
enlevée par les pirates, dans sa villa près de
Misène. L'île de Crète, au centre de la
Méditerranée orientale, était devenue,
depuis la perte de la Cilicie, le principal refuge des
pirates, qui partageaient avec les habitants les profits de
la course. Après avoir chassé les forbans des
côtes d'Italie, le préteur se dirigea sur cette
île. L'attaque mal conduite amena un désastre :
l'ennemi prit une partie de ses vaisseaux, dont les officiers
furent pendus aux vergues et les équipages vendus
comme esclaves. Antonius s'échappa, mais
survécut peu de jours à sa défaite et y
gagna le titre dérisoire de Creticus.
L'oligarchie romaine accepta cet affront sans le venger, si
ce n'est en paroles elle menaça de loin, demandant
pour faire une bonne paix avec les Crétois qu'ils
livrassent 4.000 talents, les prisonniers, les transfuges et
leurs trois amiraux qui avaient eu l'insolence de battre
Antonius.
Les Crétois n'étaient pas hommes à
donner tant d'argent sans de rudes combats. En 68, Metellus
vint le leur demander à la tête d'une bonne
armée. Ce petit peuple osa l'attendre en rase
campagne, puis l'arrêta devant chacune de ses villes :
Cydonie, Cnosse et Gortyne. Il fallut au proconsul deux
campagnes pour faire une province de ce dernier asile de la
liberté grecque : liberté peu honorable qui
sauvegardait, en Crète, beaucoup plus de vices que de
vertus.
Metellus ajouta un nouveau surnom à tous ceux que son
orgueilleuse race s'était donnés. Mais son
expédition n'étouffa point la piraterie, et il
n'est pas sûr qu'au moment même où il
expédiait à Rome ses dépêches
entourées de couronnes de laurier, quelques-unes des
nombreuses criques de la grande île n'abritassent
encore bon nombre de flibustiers. Des expéditions
isolées ne pouvaient en effet détruire ces
insaisissables ennemis chassés d'un point, ils
reparaissaient sur un autre, et, grâce à
l'habileté de leurs pilotes, à la
légèreté de leurs navires, ils se
jouaient, comme le guérillero espagnol, de toutes les
poursuites.
Cependant les convois de Sicile et de Sardaigne n'arrivaient
plus, les distributions gratuites cessaient. Pour quelques
sesterces, le peuple vendait ses suffrages ; pour 5 boisseaux
par mois, il donna l'empire. L'an 67, le tribun Gabinius
proposa qu'un des consulaires fût investi pour trois
ans, avec une autorité absolue et irresponsable, du
commandement des mers et de toutes les côtes de la
Méditerranée jusqu'à 400 stades dans
l'intérieur. Cet espace renfermait une grande partie
des terres de la domination romaine, les nations les plus
considérables, les rois les plus puissants. Les nobles
s'effrayèrent de ces pouvoirs inusités qu'on
destinait à Pompée, bien que Gabinius
n'eût pas prononcé son nom ; ils
essayèrent de tuer le tribun, et un des
collègues de Gabinius opposa son veto. Cependant telle
était leur humiliation, que Catulus ne trouva rien
à dire au peuple, si ce n'est qu'il fallait
ménager un si grand personnage, ne pas exposer sans
cesse aux périls de la guerre une si précieuse
vie : «Car enfin, si vous venez à le perdre,
quel autre général aurez-vous pour le remplacer
? - Vous-même», s'écria tout le peuple. Il
se tut, après avoir conseillé aux
sénateurs de s'assurer une retraite sur quelque mont
Sacré où ils pourraient, comme leurs
ancêtres, défendre la liberté. La foule
doubla les forces que le décret accordait au
général, cinq cents galères, cent vingt
mille fantassins, cinq mille chevaux et la permission de
prendre dans le trésor tout l'argent qu'il voudrait.
L'un des consuls, Pison, qui fit encore quelque opposition,
osa dire à Pompée : «Si tu veux imiter
Romulus, tu finiras comme lui» ; le peuple voulait le
mettre en pièces, et, à cause de son veto, le
tribun Trebellius faillit être déposé.
Mais Pompée respectait trop les formes pour attenter
violemment à la dignité consulaire et
tribunitienne. Un siècle plus tôt, Rome
n'eût pas même envoyé un consul contre de
si misérables ennemis, et l'armée, le
trésor, le pouvoir souverain, on livrait tout à
Pompée. Le peuple avait faim, il s'inquiétait
bien de la liberté. César, à qui il ne
déplaisait pas de voir le peuple s'habituer à
l'autorité monarchique, avait vivement appuyé
la proposition.
A la nouvelle de ce décret, les pirates
abandonnèrent les côtes d'Italie, le prix des
vivres baissa subitement ; et le peuple de crier que le nom
seul de Pompée avait terminé la guerre. Il
choisit pour lieutenants vingt-quatre sénateurs qui
avaient déjà commandé en chef, divisa la
Méditerranée en treize régions, et
assigna à chaque division une escadre. En quarante
jours, il balaya la mer de Toscane et celle des
Baléares. Dans la Méditerranée
orientale, nulle part non plus les pirates effrayés ne
résistèrent. Ils venaient en foule se rendre
avec leurs femmes, leurs enfants, leurs navires, et
Pompée les chargeait de poursuivre leurs anciens
complices.
Cependant les plus braves portèrent leurs richesses
dans les ports du mont Taurus et réunirent leurs
vaisseaux au promontoire Coracesius. Vaincus, puis
forcés dans une place du voisinage où ils
s'étaient réfugiés, ils livrèrent
les châteaux et les îles qui étaient
encore en leur pouvoir : cent vingt forts qui couronnaient
les cimes des montagnes, depuis la Carie jusqu'au mont
Amanus, furent renversés ; Pompée brûla
mille trois cents navires, détruisit tous les
chantiers, et suivant la politique modérée
qu'il avait montrée en Espagne, au lieu de vendre ses
prisonniers, il les établit en des villes
dépeuplées, à Soli, Adana, Epiphanie et
Mallus, à Dymes en Achaïe, même en Calabre.
Virgile enfant vit près de Tarente un de ces pirates
qui avait vécu heureux sur la terre que Pompée
lui avait donnée. Quatre-vingt-dix jours avaient suffi
pour terminer cette guerre peu redoutable, menée
à bonne fin par la douceur du général
autant que par la rapidité de ses manoeuvres. Les
Romains avaient ressaisi l'empire de la
Méditerranée, et ils pouvaient maintenant
l'appeler mare nostrum. Toutefois la piraterie ne
disparut que pour un temps ; jamais Rome, même sous les
empereurs, n'en eut complètement raison. Durant
l'expédition de Gabinius en Egypte, les côtes de
Syrie seront pillées par de nombreux forbans ; et de
nos jours encore ces mers semées de tant d'îles,
de promontoires et de ports cachés au pied des
montagnes, ont été le dernier refuge des
corsaires que les nations chrétiennes ont
chassés des coins les plus reculés de
l'Océan.
Metellus avait été chargé, avant la loi
Gabinia, d'enlever la Crète aux pirates. Quoiqu'il
eût un commandement indépendant, Pompée
prétendit qu'il avait perdu le droit de combattre sous
ses propres auspices, qu'il n'était plus qu'un
lieutenant, et il lui envoya l'ordre de suspendre les
opérations. Un officier pompéien, Octavius,
vint même encourager la résistance des villes
que Metellus assiégeait. «Il affligea
jusqu'à ses meilleurs amis, dit son biographe, par
cette mesquine jalousie, qui lui faisait regarder comme un
vol fait à sa gloire tout succès obtenu par
d'autres». Une plus criante injustice acheva de
soulever contre lui la noblesse : il arracha à
Lucullus Mithridate vaincu, pour se réserver le facile
honneur de porter au roi les derniers coups.