LVIII - La monarchie |
II - GUERRE D'ESPAGNE ; MUNDA (45) ; RETOUR DE CESAR A
ROME
Les nouvelles qui arrivaient de différents points de
l'empire interrompirent ce travail fécond. Les liens
du patronage, affaiblis dans Rome, gardaient leur puissance
dans les provinces où les grands, que les hasards de
la politique et de la guerre avaient faits patrons de
certains peuples, trouvaient chez eux assistance pour leurs
entreprises. Le sénat avait partout affermi
l'influence de l'aristocratie provinciale ; mais cette
aristocratie s'était moins attachée à la
fortune de Rome qu'à celle du proconsul qui avait eu
la charge d'organiser la province. Les chefs des cités
suivaient le parti de ceux qui leur avaient donné le
pouvoir, dans la pensée que le parti contraire ne
manquerait pas de le leur ôter. C'étaient donc
des intérêts et non pas des idées qui
décidaient de quel côté l'on passerait.
Qu'à Rome il fût question de république
ou de monarchie, de liberté ou de servitude, comme
disaient les oligarques, peu importait. La Gaule était
césarienne, parce que César y avait
distribué les charges et les faveurs ; pour les
mêmes raisons, la Syrie et l'Espagne étaient
pompéiennes. Elles avaient été dans la
clientèle du père, elles restaient dans celle
des enfants, de sorte qu'il suffisait de quelques maladresses
des lieutenants de César pour que la faction tant de
fois battue se relevât dans ces provinces
éloignées.
En Syrie, le pompéien Caecilius Bassus avait
chassé le gouverneur nommé par César et
se maintenait indépendant. En Gaule, un mouvement des
Bellovaques avait été facilement
comprimé par Dec. Brutus, mais l'Espagne était
en feu. Durant la guerre d'Alexandrie, le lieutenant
césarien dans l'Ultérieure, Q. Cassius
Longinus, avait si bien révolté les esprits par
sa dureté et ses exactions, qu'il faillit être
assassiné dans Séville et que deux de ses
légions, composées d'anciens soldats
pompéiens d'Afranius, se mutinèrent ; sans
l'intervention du gouverneur de la Citérieure, une
guerre civile eût éclaté. Ces
événements furent de grande conséquence.
Les rebelles, rentrés dans le devoir, n'en redoutaient
pas moins une expiation sévère, et ils crurent
que le plus sûr moyen d'y échapper était
de manquer une seconde fois au serment militaire, en
changeant de parti dès que l'occasion s'en
présenterait. Lorsque les débris de Pharsale se
réunirent en Afrique, les mécontents d'Espagne
firent de secrètes ouvertures à Caton, et, pour
suivre de plus près ces négociations,
l'aîné des fils de Pompée, Cneus,
s'empara des Baléares. Après Thapsus, il
débarqua dans la péninsule, où
arrivèrent d'Afrique son frère Sextus, Labienus
et Varus. En peu de temps, il eut treize légions et
battit tous ceux qui essayèrent de s'opposer à
ses projets.
A Pharsale, les grands s'étaient réunis
à Pompée pour renverser César, sauf
à l'obliger ensuite à compter avec eux. En
Afrique, ils avaient lutté pour eux-mêmes ; et,
afin d'être sûrs que les fils de l'ancien
Agamemnon ne recueilleraient pas les fruits de leur
persévérance, ils avaient éloigné
l'un et donné à l'autre un rôle obscur.
Mais en Espagne c'était le nom de Pompée qui
avait rallié une armée, et le mot d'ordre
n'était plus Rome ou Liberté,
mais la Piété filiale ; c'était
Cneus qu'il avait fallu reconnaître pour
général, et qu'il faudrait, après la
victoire, reconnaître pour maître. Et quel
maître dur, impitoyable, toujours menaçant du
glaive ! Aussi beaucoup se disaient-ils qu'il n'y avait plus
qu'il choisir entre deux tyrannies, l'une douce, l'autre
violente. En partant de Rome à la fin de septembre 46,
César emportait avec lui les voeux de ses anciens
ennemis.
Les légions pompéiennes avaient
été formées de soldats d'Afranius
licenciés après Lérida, des mutins de
Longinus, des débris de l'armée d'Afrique,
d'esclaves affranchis et d'aventuriers de tous pays qui,
à la faveur de l'état de guerre, pouvaient
donner cours à leurs instincts de pillage et de
meurtre. De ces treize légions, quatre seulement
méritaient qu'on en tînt compte, grâce aux
vétérans qui fournissaient des cadres solides.
Ces troupes mal aguerries et peu disciplinées
étaient capables de bien recevoir l'ennemi un jour de
bataille, mais elles ne l'étaient pas de faire une
campagne savante. Aussi Cneus Pompée n'osa les
conduire dans la Citérieure pour disputer à
César les ports des Pyrénées. Il ne
défendit même point les passages difficiles qui
mènent dans la vallée du Guadalquivir (Baetis)
et il laissa les césariens arriver en vingt-trois
jours près d'Ulia qu'il assiégeait et de
Cordoue dont il avait fait sa place d'armes. Ce pays
était en contraste absolu avec celui où avait
eu lieu la dernière campagne ; mais, par des raisons
différentes, il était tout aussi difficile d'y
frapper rapidement un coup décisif, en forçant
l'ennemi à recevoir la bataille, quand il ne le
voulait pas. Montueux et fertile, il permettait de prendre
des positions inexpugnables, et l'on y trouvait partout de
l'eau et des vivres. Plusieurs mois se passèrent en
sièges de villes et en escarmouches. La cruauté
de Cneus et l'impatience du dictateur d'être
arrêté par ces pompéiens qu'il avait
déjà écrasés deux fois,
donnèrent à cette guerre un caractère de
férocité que la lutte n'avait pas encore eu :
Cneus faisait égorger tous les suspects, et
César lui rendit meurtre pour meurtre. L'action
décisive s'engagea enfin le 17 mars 45 sous les murs
de Munda. Les Commentaires sont loin de montrer cette
lassitude des légions qui, selon d'anciens
écrivains, aurait forcé César à
se jeter tête nue au-devant de l'ennemi en criant
à ses vétérans prêts à fuir
: Vous voulez donc livrer votre général
à des enfants ? Il ne perdit que mille des siens ;
trente mille pompéiens périrent, et parmi eux
Labienus et Varus : les aigles des treize légions
furent prises. Cneus gagna Carteia, d'où il fut
bientôt obligé de fuir. Blessé à
l'épaule et à la jambe, empêché
par une entorse de marcher, il allait de montagne en
montagne, porté dans une litière. Un jour
enfin, à bout de force, il se cacha dans une caverne
où, trahi par les siens, il fut égorgé.
Son frère, qui n'avait pas assisté à la
bataille, parvint à trouver un asile dans les
Pyrénées ; il y resta jusqu'à la mort de
César, et on le verra relever pour quelque temps la
fortune de sa maison.
Un des principaux chefs pompéiens, Scapula,
s'était réfugié à Cordoue. Il n'y
avait pas cette fois à compter sur la clémence
de César : ceux qui avaient ordonné tant
d'égorgements devaient périr. Scapula le savait
; il se souvint de Caton et fit compte lui, mais mourut en
épicurien. Il se fit dresser un bûcher, puis
commanda un festin splendide, distribua entre ses esclaves
tout ce qu'il possédait, et, couvert de ses plus
riches vêtements, parfumé de nard et de
résine, il soupa joyeusement. A la dernière
coupe, il se fit tuer par un des siens, tandis que le plus
aimé de ses affranchis mettait le feu au bûcher.
Ces voluptueux sanguinaires, habitués à
contenter toutes leurs passions, n'avaient plus rien à
faire dans la vie quand arrivait l'adversité ; et ils
s'en allaient acceptant, suivant le conseil du maître,
un mal moindre, l'anéantissement, pour éviter
un mal pire, la misère.
De tous les personnages qui, en 49, siégeaient pleins
d'espérances et de menaces au sénat
républicain de Thessalonique, il en restait bien peu ;
et ceux qui avaient survécu à tant de combats
invoquaient la clémence de César. Ainsi se
termina dans un flot de sang, dit un historien anglais, la
guerre civile que les sénateurs avaient entreprise
contre César, pour échapper aux réformes
dont les menaçait son second consulat. Ces hommes
avaient pourtant servi leur pays en rendant pour toujours
impossible cette constitution républicaine où
les élections étaient une moquerie, les
tribunaux une insulte à la justice, les provinces des
fermes à engraisser une aristocratie avide.
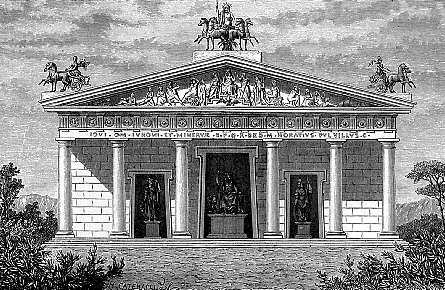
Temple de Jupiter Capitolin - Restauration de Canina |
A Rome, l'enthousiasme officiel éclata de
nouveau au récit de ces succès. Le sénat
décréta cinquante jours de supplications, et
reconnut à César le droit de reculer le
pomoerium, puisqu'il avait reculé les bornes de
l'empire. Des décrets gravés en lettres d'or
sur des tables d'argent, et déposés aux pieds
de Jupiter dans le Capitole, portaient : Le dictateur
conservera en tous lieux l'appareil triomphal et la couronne
de laurier, on l'appellera le père de la patrie, et le
jour de sa naissance sera célébré par
des sacrifices.

César père de la patrie |
Chaque année la république fera pour
lui des voeux solennels ; on jurera par sa fortune, et tous
les cinq ans des jeux seront donnés en son
honneur. Après Thapsus, il était
passé demi-dieu ; après Munda, on le fit dieu
tout à fait. Une statue lui fut dressée dans le
temple de Quirinus, avec cette inscription : Au dieu
invincible, et un collège de prêtres, les
Juliens, lui fut consacré. Est-ce à dessein que
son image fut aussi placée à côté
de celles des rois, entre Tarquin le Superbe et l'ancien
Brutus ? Quelques-uns y virent une menace et un
présage ; le plus grand hombre un honneur.
César n'était-il pas un second Romulus ? Le
sénat du moins le déclarait, en ordonnant de
célébrer, aux Palilies, avec l'anniversaire de
la fondation de la ville, celui de la victoire de Munda, la
renaissance de Rome. En effet des temps nouveaux
commençaient, et n'accusons pas trop ces hommes d'une
honteuse bassesse, quand nous les entendons appeler
César libérateur et vouer un temple à la
Liberté ; n'avait-il pas délivré le
monde de l'anarchie et du pillage ? Le repos, l'ordre, la
sécurité, n'était-ce pas aussi une
liberté nécessaire ?
Le 13 septembre, le dictateur parut aux portes de Rome, mais
il ne triompha qu'au commencement d'octobre. Cette fois, il
n'y avait plus ni roi ni chef barbare pour cacher des
victoires gagnées sur des citoyens. Mais César
ne croyait plus avoir de ménagements à garder ;
puisque l'Etat, c'était lui, ses ennemis, quelque nom
qu'ils portassent, étaient ceux de l'Etat. Du reste
les fêtes, les jeux, les festins de l'année
précédente, recommencèrent avec plus
d'éclat peut-être. Le peuple s'était
plaint de n'avoir pu tout voir, les étrangers de
n'avoir pu tout entendre ; on divisa les jeux ; chaque
quartier de la ville eut les siens, et chaque nation des
pièces en sa langue. C'était justice ; est-ce
que Rome n'était pas maintenant la patrie de tous les
peuples ? Que toutes les langues du monde retentissent donc
dans la capitale du monde, comme on y voit les hommes et les
choses de tous les pays. Cléopâtre y tient
encore sa cour dans les jardins de César, au
delà du Tibre, où Cicéron ne craint pas
de se montrer. Les rois maures et les princes de l'Asie y ont
leurs ambassadeurs. C'est, au pied du trône qui
s'élève, le concours des nations. Elles
viennent saluer le dieu sauveur ; et ce que suivent leurs
regards avides, ce ne sont ni les courses du cirque ni les
jeux de l'amphithéâtre mais les anciennes
puissances naguère si redoutées qui montrent
elles-mêmes leur humiliation : les chevaliers, les
sénateurs, jusqu'à un tribun du peuple, qui
descendent dans l'arène. Laberius joua, comme mime,
une de ses pièces. Hélas ! disait le
vieux poète dans son prologue, après
soixante ans d'une vie sans tache, sorti chevalier de ma
maison, j'y rentrerai mime, ah ! J'ai trop vécu d'un
jour. Ne vous apitoyez pas trop sur son sort : en
rentrant dans sa maison équestre, il y trouva 500.000
sesterces que César lui avait promis et l'anneau d'or
qui lui fut rendu.