LVIII - La monarchie |
I - NOUVEAU SEJOUR DE CESAR A ROME (46). TRIOMPHES,
FETES ET REFORMES
Lorsque Caïus Gracchus, réfugié dans le
temple de Diane sur l'Aventin, vit tous ceux qui l'avaient
suivi massacrés par les mercenaires d'Opimius, il se
jeta à genoux, et tendant les mains vers la
déesse, il la supplia de punir les Romains de leur
ingratitude en leur donnant un maître. Ce
n'était certainement pas une pensée de
vengeance qui occupait alors l'esprit du tribun
réformateur et pacifique. Comme il arrive, dit-on, au
moment suprême, il eut sans doute une perception de
l'avenir ; il entrevit que Rome ne pouvait se sauver qu'en
s'arrachant des mains d'une minorité aristocratique
qui repoussait les réformes les plus
nécessaires et, sans droit, sans jugement,
égorgeait ceux qui les avaient demandées.
Si, en effet, pour étudier l'histoire de Rome depuis
les Gracques, on laisse de côté les
préjugés d'école et les
déclamations d'une rhétorique ignorante, on
voit clairement que les Romains avaient perdu, à
conquérir le monde, leur liberté, et que la
république, autrefois la chose de tous, était
devenue la propriété d'une oligarchie
étroite et jalouse qui entendait vivre dans la
mollesse aux dépens de l'univers. Contre cette
l'action avide et incapable, avaient fini par s'élever
les chefs populaires qui réclamèrent pour le
peuple, pour les alliés, pour les sujets. Ce fut
l'ère des essais de réforme. Les
réformes n'ayant pas réussi, la
révolution devint inévitable : éternelle
histoire des gouvernements qui ferment les yeux à
l'avenir. Chez nous la monarchie étant le passé
qu'on voulait détruire, la république, tout
naturellement, en hérita ; à Rome, le mouvement
insurrectionnel étant dirigé contre
l'aristocratie républicaine, la monarchie devait lui
succéder. La logique de l'histoire le voulait ainsi,
et cette logique, qui est celle des événements
et des esprits, finit toujours par avoir raison.
Comme les chefs populaires avaient péri par la
violence, l'influence et l'action passèrent aux chefs
militaires. D'abord, ils s'unirent pour consolider l'empire
de Rome, Pompée en Orient, César en Occident ;
et ils durent à l'éclat de leurs services une
place à part dans l'Etat. Pompée n'était
qu'un soldat dont l'oligarchie n'avait rien à
craindre, à condition de satisfaire sa puérile
vanité. Dans César, elle pressentait un
politique de la famille des Gracques, un de ces hommes qui
rêvaient une cité nouvelle, faite des ruines de
l'ancienne ; César lui était donc un mortel
ennemi. Pour l'abattre, elle accorda à Pompée,
contrairement à la constitution, cette royauté
de parade qui suffisait à l'homme dont l'intelligence
ne pouvait concevoir un ordre de choses différent de
celui qui lui valait tant d'honneurs. Depuis bientôt un
siècle, république signifiait meurtres et
proscriptions, guerres civiles et bouleversement des
fortunes, partout l'insécurité, nulle part ni
pour personne le plaisir de vivre. Voilà ce que
César voulait faire cesser, et, comme nous aimons
autant les ambitions fécondes que nous
détestons les ambitions stériles, nous sommes
avec lui contre les incapables qui siégeaient à
la curie, se disaient la loi et la violaient tous les jours.
Après avoir provoqué la guerre civile, ils
n'avaient pas su la conduire. Pharsale les avait
chassés de la Grèce ; Thapsus les chassait de
l'Afrique, et, pour le moment, César ne voyait plus,
sur toute la surface du monde romain, un seul adversaire en
armes. Il était donc libre enfin de commencer ses
réformes ; donnons-nous-en le spectacle, pour savoir
s'il méritait sa fortune.
Après avoir levé sur la province 200 millions de sesterces, réuni à l'Afrique, sous le gouvernement de l'historien Salluste, la Numidie orientale, partagé le reste de ce royaume entre Bocchus, qui eut le pays de Sétif, et Sittius, qui obtint Cirta avec ses dépendances, César revint à Rome vers la fin de juillet 45. Le sénat avait déjà décrété quarante jours de supplications pour sa victoire. Son char de triomphe sera traîné par des chevaux blancs, comme l'avait été celui de Camille, le second fondateur de Rome, et on le placera dans le Capitole, en face de l'autel de Jupiter. Il lui sera élevé une statue d'airain, le globe du monde sous les pieds, avec cette inscription : César demi-dieu ; et au Cirque il donnera le signal des courses. Pour reconstituer la république, reipublicae constituendae causa, il aura pendant dix ans la dictature qui lui donne l'initiative des lois, avec l'imperium militaire ou le commandement des armées dans la ville et dans les provinces ; pour trois ans, la censure sans collègue, sous le nom nouveau de préfecture des moeurs, c'est-à-dire le droit de réviser le sénat et l'ordre équestre, par conséquent, le moyen de récompenser et de punir un grand nombre. A l'exception du consulat, qu'on lui donne pour l'année 45 sans collègue, il nommera à la moitié des charges curules ; il déterminera quelles seront les provinces prétoriennes, et décidera de la paix et de la guerre, c'est-à-dire que le peuple sera dépouillé en sa faveur de sa puissance élective, le sénat, de son pouvoir administratif. Dans le sénat, il siégera entre les deux consuls sur une chaise curule plus élevée, signe de son autorité plus haute, et il dira le premier son avis, c'est-à-dire qu'il dirigera à son gré les délibérations du corps qui avait à peu près concentré dans ses mains, depuis les troubles, tout le pouvoir législatif. |
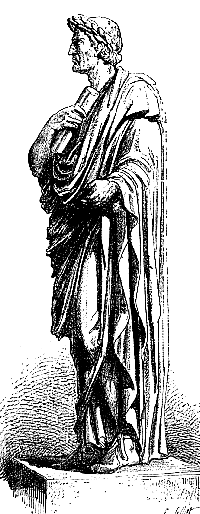
Jules César - Musée du Louvre |
Il célébra quatre triomphes à
plusieurs jours d'intervalle. La première fois, il
triompha des Gaulois ; la seconde, des Egyptiens ; la
troisième, de Pharnace ; la quatrième, de Juba.
Ni Pharsale ni Thapsus n'étaient nommés ; et
devant son char on ne voyait que les images des rois et des
généraux vaincus, celles des villes prises, ou
des fleuves et de l'Océan qu'il avait
traversés. Parmi les captifs, pas un Romain, mais la
soeur de Cléopâtre, Arsinoé, le fils de
Juba, le grand chef gaulois, Vercingétorix, que les
triumvirs attendaient au Tullianum pour l'égorger.
Rien ne rappelait Pompée ; seulement, sur le tableau
qui représentait la fuite du fils de Mithridate et de
l'armée pontique, on lisait la fameuse
dépêche : Veni, vidi, vici, qui semblait
dire : Là, pour vaincre, il m'a suffi d'un jour ;
à mon rival il avait fallu des années. Il eut
moins de ménagements envers les vaincus d'Afrique,
dégradés en quelque sorte de leur titre de
citoyens par leur alliance avec un roi barbare. Il exposa
Caton, Scipion et Petreius se perçant de leur
épée. A cette vue, bien des coeurs, sans doute,
se serrèrent ; mais la tristesse se perdit dans
l'éclat de la fête. Et la foule n'eut garde de
songer à tous ces morts quand, sous ses yeux
éblouis, on fit passer, spectacle plein de promesses,
60.000 talents (plus de 300 millions de francs) en argent
monnayé, et deux mille huit cent vingt-deux couronnes
d'or. Qu'importait au peuple une indigente et
mensongère liberté, quand le maître lui
promettait de splendides festins ? On n'entendit que les
soldats, usant de leur vieux droit, railler, en des chants
grossiers, l'ami de Nicomède et des Gaulois qu'il
menait derrière son char, mais pour les conduire au
sénat. Fais bien, criaient-ils, tu seras
battu ; fais mal, tu seras roi, ou bien encore : Gens
de la ville, gardez vos femmes, nous ramenons le galant
chauve. Dion raconte que, pour détourner par un
acte d'humilité la colère de
Némésis, la déesse ennemie des fortunes
trop grandes, César monta à genoux les marches
du Capitole.
Dans cette ville pleine encore du souvenir des meurtres par
lesquels l'oligarchie avait cru assurer son pouvoir et
où vivaient les fils des proscrits de Marins et de
Sylla, pas une tête ne tomba, pas même une larme,
partout le plaisir et la joie. Après le triomphe de
César, tout le peuple romain se coucha autour de
vingt-deux mille tables à trois lits qu'on servit
comme pour les grands. Le chio, le falerne, coulaient ; et le
plus pauvre put goûter à ces lamproies, à
ces murènes tant vantées. Si, loin de ces
tables où tout le peuple s'enivrait, quelques vieux
républicains se tenaient à l'écart, la
honte au front et la haine dans le coeur, du moins
devaient-ils se souvenir, en face de cette domination qui
commençait par des fêtes, que d'autres,
naguère, avaient commencé avec du sang.
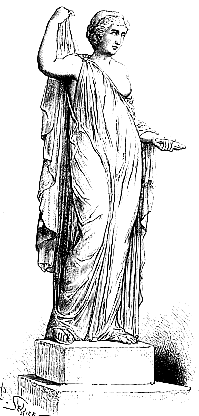
Venus Genitrix - Galerie de Florence |
Le soir, le triomphateur traversa la ville entre quarante éléphants qui portaient des lustres étincelants, et le lendemain vinrent les distributions : à chaque citoyen, 105 deniers, 10 boisseaux de blé, 10 livres d'huile ; à tous les pauvres, remise d'une année de loyer que sans doute le trésor public paya ; aux légionnaires, 5000 deniers par tête ; aux centurions, le double ; aux tribuns, le quadruple. Les vétérans reçurent des terres. Les jours suivants, les fêtes continuèrent au nom de sa fille Julia et de Vénus, auteur de sa race. Durant la guerre des Gaules, il avait acheté, au prix de 60 millions de sesterces, un vaste emplacement dont il avait fait un nouveau forum, sans souvenirs républicains, et plein de la gloire de son nom. Il y avait élevé un temple à Venus Genitrix, dont il fit alors la dédicace, et il y plaça une belle image de Cléopâtre qu'on y voyait encore deux siècles plus tard. |
Des spectacles de tout genre firent accepter du
peuple cette apothéose de la maison julienne : des
représentations scéniques, des jeux troyens,
des danses pyrrhiques, des courses à pied et en char,
des luttes d'athlètes, des chasses où l'on tua
des taureaux sauvages, une girafe, la première qu'on
ait vue à Rome, et jusqu'à quatre cents lions ;
une naumachie entre des galères de Tyr et d'Egypte ;
une bataille enfin entre deux armées ayant chacune
cinq cents fantassins, trois cents cavaliers et vingt
éléphants. Cette fois les gladiateurs
étaient éclipsés : des chevaliers, le
fils d'un préteur, descendirent dans l'arène ;
des sénateurs voulaient combattre. Il fallut que
César éloignât de son sénat cette
flétrissure. De tous les coins de l'Italie on
était accouru à ces jeux. Telle était la
foule, que l'on campait dans les rues et les carrefours, sous
des tentes, et que nombre de personnes, parmi elles deux
sénateurs, périrent étouffées.
Au-dessus de l'amphithéâtre, pour abriter les
spectateurs des rayons du soleil, flottait un velarium
en soie, étoffe alors à peu près
inconnue à Rome et qui se vendait plus cher que
l'or.
Au milieu de ces fêtes dont le dictateur payait sa
royauté, il n'oubliait pas qu'il avait à
légitimer son pouvoir, en assurant l'ordre.
Jusqu'à son consulat, c'était dans le peuple et
au milieu des chevaliers qu'il avait placé son point
d'appui ; pendant son commandement en Gaule et durant la
guerre civile, il l'avait pris dans l'armée ;
maintenant il voulait le chercher dans un gouvernement sage
et modéré, qui réunirait les partis,
oublierait les injures, et provoquerait la reconnaissance par
une administration habile et bienveillante. Quoique en
Afrique il se fût montré plus
sévère qu'à Pharsale, il était
décidé à persévérer dans
la clémence. Il avait accordé au sénat
le rappel de l'ancien consul Marcellus, à
Cicéron celui de Ligarius ; il avait jeté au
feu les papiers compromettants trouvés dans les camps
ennemis, et il ne prononça la confiscation des biens
que contre les citoyens enrôlés dans les troupes
du roi numide, ce qu'il appelait une trahison envers Rome, ou
contre les officiers pompéiens ; encore conserva-t-il
aux femmes leur dot et aux enfants une partie de
l'héritage ; enfin, par une amnistie
générale, il essaya, en 44, d'effacer les
dernières traces de la guerre civile. Mais,
malgré son nom, amnêstia, qui signifie
l'oubli, l'amnistie n'a jamais rien fait oublier : quelques
semaines après, César était
assassiné.
Cette douceur s'alliait à la fermeté : des
légionnaires, croyant leur règne arrivé,
avaient réclamé contre les dépenses du
triomphe, comme si cet argent leur eût
été volé : il en fit mettre un à
mort. Lorsqu'il donna des terres à ses
vétérans, il eut soin que les lots fussent
séparés, afin de prévenir les violences
qu'une masse de soldats, réunis sur un même
point, auraient commises contre leurs voisins ; et, en
doublant la solde de ceux qui restaient sous les enseignes,
900 sesterces au lieu de 480 (225 francs au lieu de 120), il
avait cédé, non pas à de
séditieuses réclamations, mais à une
nécessité que le renchérissement de
toutes choses imposait.
Voilà pour les soldats. Quant au peuple, trois cent
vingt mille citoyens vivaient à Rome aux dépens
de l'Etat, et tous les mendiants de l'Italie accouraient dans
la ville pour profiter des distributions : il réduisit
le nombre des parties prenantes à cent cinquante
mille, en excluant des distributions ceux qui pouvaient s'en
passer et en offrant aux autres des terres dans les provinces
: quatre-vingt mille acceptèrent. Du même coup,
il diminuait la foule famélique qui encombrait la
ville, où elle était un danger permanent, et il
créait dans les provinces des foyers de civilisation
romaine. C'était résoudre, à la
manière antique, qui est restée jusqu'à
présent la meilleure, par des colonies, le
problème du prolétariat auquel l'Angleterre et
l'Allemagne cherchent à échapper aujourd'hui
par l'émigration en masse. Mais il conserva l'annone,
grande institution de bienfaisance au profit des pauvres qui,
malgré leur origine fort peu romaine,
représentaient les conquérants des provinces
frumentaires et avaient hérité de leur droit
à jouir du fruit de ces victoires. Tous les ans, le
préteur dut remplacer les morts en inscrivant de
nouveaux noms sur la liste. Deux édiles, aediles
cereales, dirigèrent cette administration à
la tête de laquelle Auguste mettra un praefectus
annonae. Une autre mesure tendit au même but : la
diminution du nombre des mendiants oisifs ; il obligea les
propriétaires à entretenir sur leurs fonds un
tiers de travailleurs libres, loi déjà
édictée et toujours éludée, parce
que Rome n'avait pas eu de pouvoir permanent
intéressé à son exécution.
La population libre décroissait ; pour en augmenter le
nombre, il mit en jeu deux puissants mobiles,
l'intérêt et la vanité. Au père de
trois enfant à Rome, de quatre en Italie, de cinq dans
les provinces, il accorda l'exemption de certaines charges
personnelles ; à la matrone qui pouvait se glorifier
de sa fécondité, le droit d'aller en
litière, de s'habiller de pourpre et de porter un
collier de perles.
Il supprima toutes les associations formées depuis la
guerre civile, qui servaient aux mécontents et aux
ambitieux soit à cacher leurs complots, soit à
les exécuter ; désormais aucune ne put
s'établir que de l'aveu du gouvernement. Une loi
restreignit peut-être le droit d'appel au peuple. Les
tribunaux furent réorganisés aux dépens
de l'élément populaire, car il exclut les
tribuns du trésor des charges de juges, qu'il
réserva aux sénateurs et aux chevaliers ; mais
il avait admis dans ces deux ordres tant d'hommes nouveaux !
Le règlement relatif aux associations enlevait aux
nobles un moyen de troubler l'Etat ; des dispositions plus
sévères furent ajoutées aux lois contre
les crimes de majesté et de violence, et le
gouvernement d'une province fut fixé à une
année pour un préteur, à deux pour un
proconsul. Une loi somptuaire, tout aussi inutile, il est
vrai, que celles qui l'avaient précédée,
essaya de diminuer le faste insultant des riches, et il
commença la réorganisation des finances en
rétablissant les douanes en Italie pour les
marchandises étrangères.
Ainsi la balance était tenue égale entre toutes
les classes : aucun ordre n'était élevé
au-dessus des autres, et l'Etat avait enfin un chef qui
mettait l'intérêt général
au-dessus de l'intérêt d'un parti. Mais ces
lois, nous l'avons trop souvent répété,
n'étaient que des palliatifs. César n'eut pas
le temps de rendre ses idées durables, en leur faisant
prendre corps dans des institutions. Auguste fera comme
César, sans avoir la même excuse ; et, par la
faute de ses deux fondateurs, l'empire aura des lois
innombrables, mais point d'organisation politique.
Les troubles des cinquante dernières années
avaient augmenté d'une façon déplorable
la décadence de l'agriculture et la
dépopulation des campagnes ; les hommes libres
venaient de toute part chercher fortune à Rome, ou
allaient dans les camps et dans les provinces. César
défendit à tout citoyen de vingt à
quarante ans de rester plus de trois ans hors de l'Italie,
sauf le cas de service militaire dont il diminua la
durée. Dans la distribution des terres, il favorisa
ceux qui avaient une famille nombreuse ; trois enfants
donnaient droit aux champs les plus fertiles ; on a vu qu'il
prescrivit aux herbagers d'avoir parmi leurs pâtres au
moins un tiers d'hommes libres, et qu'il chassa de Rome la
moitié de ses pauvres. C'était la pensée
des Gracques : faire refluer dans les campagnes et multiplier
dans la péninsule la race des hommes libres. Les
colons de Sylla avaient bien vite changé leurs terres
contre quelque argent, aussitôt dissipé, et
cette soldatesque ruinée s'était
aisément vendue aux factieux. Pour rendre un nouveau
Catilina impossible, César interdit à ses
vétérans l'aliénation de leurs lots, si
ce n'est après une possession de vingt ans.
Une cause de perpétuels désordres existait dans
le désaccord du calendrier établi sur
l'année lunaire de 355 jours avec l'année
solaire, qui en a 365. Les grands y avaient trouvé
leur compte pour avancer ou reculer à leur gré
les élections et les termes d'échéance
des fermes publiques. Anciennement le collège des
pontifes maintenait l'accord entre l'année lunaire et
l'année solaire en ajoutant à la
première des jours intercalaires ; mais les troubles
du dernier siècle de la république avaient mis
le désordre dans les choses du ciel comme dans celles
de la terre : les pontifes avaient négligé la
précaution nécessaire, et l'année
légale, de plus de deux mois (67 jours) en
arrière sur l'année normale, commençait
alors en octobre, de sorte que les fêtes de la moisson
ne tombaient plus en été, ni celles des
vendanges en automne. César chargea l'astronome
d'Alexandrie, Sosigène, de mettre le calendrier
d'accord avec le cours du soleil. Il fallut donner à
l'année 45, qu'on appela la dernière
année de la confusion, 445 jours, c'est-à-dire
les 67 dont on était en retard et les 23 du mois
intercalaire habituel.
Caton aurait pu dire, et ce qu'il restait du parti
oligarchique disait, que toutes ces choses excellentes
devenaient mauvaises, étant accomplies par un homme,
non par la république. Mais la république avait
été mise en demeure, durant un siècle,
d'exécuter ces réformes, et elle ne les avait
point faites.