LXXX - Hadrien (117-138) |
III - ADMINISTRATION
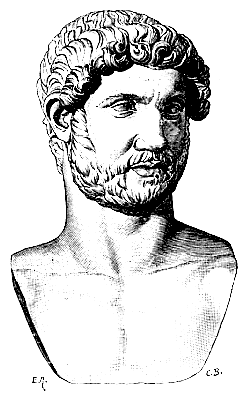
Buste du Vatican |
Le monde n'avait pas encore connu une pareille prospérité. Et ces richesses créées par l'industrie ou le commerce de l'univers, on en jouissait avec sécurité ; car la terrible loi de majesté ne menaçait plus la tête ou la fortune des riches, et les fonctionnaires étaient sévèrement surveillés. Naguère encore, la curie avait retenti d'accusations que les députés de la Bétique, de l'Afrique et de la Bithynie étaient venus porter devant le sénat dans les premières années de Trajan. On avait revu de monstrueuses dilapidations, la liberté, la vie même de chevaliers romains vendues à prix d'argent. Avec un prince qui fit trois ou quatre fois le tour de l'empire, et qui, dans chaque province, demeurait assez longtemps pour tout entendre, avec la volonté de tout savoir, ces crimes n'étaient plus possibles. Il y eut cependant des exécutions ; des gouverneurs de province, des intendants de finance, ou procurateurs, furent condamnés. Quand les victimes de ces magistrats infidèles se taisaient par crainte, Hadrien suscitait lui-même des accusateurs. |
Mieux valait prévenir que réprimer.
Hadrien traça aux gouverneurs de province des
règles invariables. Les lois, les édits, les
sénatus-consultes, les rescrits des princes, formaient
un pêle-mêle de décisions souvent
contradictoires, dont quelques-unes d'ailleurs ne
s'appliquaient qu'à des cas particuliers ou à
de certaines provinces. Par l'ordre de l'empereur, le
préteur Salvius Julianus, un des jurisconsultes dont
les ouvrages ont servi aux rédacteurs des
Pandectes autant que ceux de Papinien, réunit
les anciens édits prétoriens et tous les
travaux faits sur la lex Annua, que depuis longtemps
les préteurs se transmettaient sans y beaucoup changer
; il en coordonna les dispositions qui formèrent, sous
le nom déjà ancien d'Edit
perpétuel, une sorte de code de la juridiction
prétorienne et un règlement
général de procédure. Hadrien provoqua
un sénatus-consulte qui, en l'année 131, donna
force de loi à ce nouvel Edit perpétuel.
Les préteurs, les gouverneurs de province et tous les
magistrats chargés de rendre la justice durent s'y
conformer, sauf à ajouter, pour les espèces
nouvelles qui viendraient à se produire, des
règles de forme et des articles accessoires
conçus dans l'esprit de l'oeuvre législative
dont le sénat et le prince venaient de consacrer
l'autorité. C'était la loi substituée
à l'arbitraire, un bienfait assuré aux
provinces, et la première édition de ce grand
livre qui est devenu le Corps des lois romaines.
Hadrien n'entendait point arrêter par cette
codification, comme il est arrivé en d'autres temps et
en d'autres pays, la vie juridique qui avait pris un si
brillant essor. Il encouragea, au contraire, les
études des prudents, en confirmant par un
rescrit l'autorité de leurs réponses
officielles, auxquelles il donna force de loi lorsqu'elles
étaient unanimes.
La paix sur les frontières, l'ordre dans les
provinces, l'économie au palais, même à
l'armée, la justice partout, enfin cette bonne
politique qui donne de bonnes finances, permirent que le
prince, sans charger les peuples, embellît les
cités, pensionna des lettrés et des artistes,
dégrevât les provinciaux des frais d'entretien
de la poste impériale, et augmentât l'assistance
accordée par Trajan aux enfants pauvres. Mais s'il
voulait que l'Etat secourût la misère ou le
malheur, il n'entendait pas que le contribuable se fît
à lui-même des largesses aux dépens du
trésor public. Quelques mois après son
avènement, il avait brûlé toutes les
créances du fisc depuis seize ans, qui montaient
à l'énorme somme d'environ 200 millions de
francs. Un tel chiffre d'arrérages donnerait à
penser que l'administration financière était
bien mal conduite ou que les guerres de Trajan avaient
obéré le peuple et les provinces. Afin de
prévenir le retour de tels abus, Hadrien créa
une charge nouvelle, celle d'avocat du fisc, qui fut, pour
les intérêts financiers de l'Etat, ce que notre
ministère public est pour les intérêts de
la société et le respect de la loi. Dans chaque
province, l'avocat du fisc rechercha ceux qui retenaient
injustement un revenu ou un bien du domaine et les poursuivit
devant le procurateur du prince, ou au tribunal du
gouverneur. Mais on peut être assuré que si le
nouveau magistrat montra dans sa fonction de la vigilance, il
n'y mit point de dureté, car il eût agi contre
les désirs du prince qui refusait les héritages
des citoyens ayant des enfants, laissait aux fils des
condamnés à la confiscation une partie de la
fortune paternelle, quelquefois la totalité, en disant
ces mots qu'on lit encore au Digeste : «J'aime
mieux enrichir l'Etat d'hommes que d'argent».
C'était de la part d'Hadrien une protestation
généreuse et intelligente contre la coutume de
la confiscation que nous avons mis dix-sept siècles
à abolir.
On prête à Hadrien une réforme
considérable : il en aurait fini avec l'hypocrisie du
gouvernement impérial, en constituant franchement la
monarchie, et Aurelius Victor prétend que la
réorganisation administrative qu'il opéra
subsistait encore à la fin du quatrième
siècle, sauf quelques changements introduits par
Constantin. Dans cette opinion trop absolue, il faut voir le
souvenir persévérant de la sagesse d'Hadrien ;
c'est un hommage rendu au prince qui mieux qu'aucun autre eut
le sentiment de l'ordre à mettre dans toutes les
parties de l'Etat. Il n'a point fait au deuxième
siècle l'oeuvre du quatrième, mais il l'a
préparée. On connaît, à cet
égard, deux faits importants : il réorganisa le
consilium municipis et il retira les offices du palais
aux affranchis, qui, depuis Auguste et surtout depuis Claude,
avaient été les véritables chefs de
l'administration : tous les secrétaires de l'empereur
furent pris dans l'ordre équestre. Or placer dans les
offices du palais, au lieu d'affranchis, serviteurs aveugles
de leur maître, des chevaliers romains qui devenaient
les fonctionnaires de l'Etat, et, par une conséquence
nécessaire, réorganiser, les bureaux du
gouvernement, c'était changer la maison du prince,
jusqu'alors peu différente d'une riche maison
particulière, en une grande administration
publique.
Cette réforme en amena une autre. En s'obstinant
à vivre loin de Rome, Hadrien aurait paralysé
le mouvement des affaires publiques, s'il ne s'était
rendu comme présent dans sa capitale par un conseil de
gouvernement investi d'une autorité légale.
Auguste avait constitué un conseil privé qui,
si Dion n'a pas transporté au commencement de l'empire
ce qu'il avait sous les yeux, était investi
déjà d'attributions étendues. Mais ce
conseil ne semble pas avoir survécu au premier
empereur, du moins avec le caractère que celui-ci lui
avait donné. On ne sent nulle part son action, et ce
qui en subsistait n'était qu'une réunion
accidentelle et changeante, formée au hasard des
amitiés impériales. Hadrien le reconstitua, en
demandant aux sénateurs de donner leur approbation aux
désignations qu'il fit de personnages
considérables, jurisconsultes fameux, chevaliers,
préteurs, mêmes consuls. Le choix de l'empereur
et la sanction du sénat donnèrent à des
fonctions jusqu'alors d'ordre privé, ou du moins
indécises, le caractère d'une sorte de
magistrature permanente. Les questions étudiées
par les bureaux qu'il venait de réorganiser
arrivèrent à ce conseil et y reçurent
une solution. L'empereur pouvait donc, sans nulle
inquiétude, courir le monde et chercher à
Athènes ou en Egypte des hivers plus doux, en Gaule ou
dans l'Illyricum des étés moins brûlants
; les Pères avaient fait dans ses mains comme une
seconde abdication, et, en son absence, les membres du
conseil de gouvernement, suppléant au besoin le
sénat par la délégation qu'ils en
avaient reçue, et l'empereur dont ils avaient la
confiance, assuraient l'expédition des affaires, la
tranquillité de Rome et la sécurité du
prince. Ce n'était pas un ministère, car les
Romains répugnaient, comme nos anciens rois, au
partage des attributions ; mais quand des hommes tels que
Salvius Julianus, Ulpien, Papinien ou Paul
siégèrent au consilium, on put croire
qu'un ministre de la justice s'y trouvait. Il n'y a donc
point à s'étonner qu'on ait fait remonter les
commencements de la transformation monarchique,
opérée sous Dioclétien, à
l'époque où les affranchis rentrèrent
dans l'ombre, les chevaliers dans l'administration centrale,
les sénateurs, ou du moins quelques-uns d'entre eux,
dans le gouvernement effectif de l'empire.
La haute juridiction civile et criminelle, confiée, en
Italie, à quatre consulaires, et la multiplication des
curateurs, annoncent aussi l'approche des temps où les
anciens droits, les vieux privilèges, vont
disparaître devant l'égalité dans
l'obéissance. Marc Aurèle remplacera les
consulaires d'Hadrien par des juridici, magistrats de
moindre dignité, investis seulement de la juridiction
civile ; mais il donnera la juridiction criminelle au
préfet de la Ville dans la région suburbicaire
(jusqu'au centième mille), au préfet du
prétoire dans le reste de l'Italie. Ainsi, par respect
pour cette vieille terre qui avait porté les fortes
populations dont Rome avait formé ses légions,
on évitait, tout en lui faisant la condition des
provinces, de lui en donner le nom.
Les voyages d'Hadrien ne changeaient rien à cet ordre
: la poste impériale lui apportait rapidement l'avis
de son conseil. D'ailleurs il emmenait avec lui une partie de
ceux qui le composaient ; de sorte que le gouvernement le
suivait dans ses pérégrinations. Rome,
dit Hérodien, est là où se trouve
l'empereur.
J'omets quantité de réformes sans importance.
Hadrien avait la manie de tout réglementer, comme il
avait celle de tout savoir, même les secrets des
familles. Sa police, qu'à raison de ses continuels
voyages il dut rendre très active, écoutait aux
portes, regardait dans l'intérieur des maisons et
lisait, par-dessus l'épaule, la lettre qu'une femme
écrivait à son mari, non, comme Tibère,
par esprit de soupçon, mais, comme Louis XV, pour se
distraire et rire. S'il multiplia les édits sur les
vêtements, les voitures, les bains, les
matériaux de démolition, les sépultures,
qu'il interdit dans l'intérieur des villes, etc., il
en fit aussi pour fermer les ergastula, où tant
d'esclaves, même tant d'hommes libres, enlevés
par surprise, étaient retenus et torturés ;
pour ôter aux maîtres le droit de vie et de mort
sur leur bétail humain et le protéger contre
leurs sévices, pour leur interdire, à moins
d'une autorisation du magistrat, une spéculation
infâme : la vente de ces malheureux, hommes et femmes,
à un propriétaire de mauvais lieu ou d'une
école de gladiateurs ; pour défendre de mettre
indistinctement à la question tous les esclaves d'un
maître assassiné, même ceux qui n'avaient
pas été à portée de voir ou
d'entendre, et qui par conséquent n'avaient pu le
secourir. Une matrone maltraitait cruellement ses femmes : il
la condamna à cinq années de relégation
; les sacrifices humains au Baal carthaginois continuaient :
il les proscrivit encore ; enfin, mettant la logique au
service de l'humanité, il décida que la femme
qui aurait été libre à un moment
quelconque de sa grossesse donnerait nécessairement le
jour à un enfant libre, et que cet enfant
naîtrait Romain lorsque ses deux auteurs,
pérégrins au jour de la conception, auraient
obtenu la cité avant l'accouchement. Il
améliora aussi la condition de la femme, l'autorisa
à tester, et reconnut à celle qui avait le
jus trium liberorum le droit de recueillir la
succession de ses enfants morts intestats. On a vu Trajan
restreindre les droits de la patria potestas ; une
décision d'Hadrien, rendue pour un cas particulier,
prépara cependant la ruine de l'autorité du
père en tant que juge domestique. Un fils avait
commerce avec sa belle-mère, le père l'attira
à la chasse et l'y tua. Le prince le condamna à
la déportation, non pour avoir usé des vieux
droits de l'autorité paternelle, mais pour avoir agi
en brigand des bois.
Une inscription cite une loi d'Hadrien sur le colonat ; nous
ne l'avons malheureusement pas. Mais cette seule mention
prouve la clairvoyance du prince qui réglementait une
condition nouvelle des populations rurales, destinée
à remplacer peu à peu l'ancienne
servitude.
Voilà des édits et des sentences qui feraient
excuser bien des travers. Jamais pareil et plus
généreux effort n'avait été fait
par le législateur pour diminuer cette plaie de
l'esclavage, point purulent qui minait le corps social. La
législation d'Hadrien nous achemine à la
transformation que va subir l'ancien mode de servitude : un
grand nombre d'esclaves seront bientôt des
colons.
A Rome, beaucoup de simplicité dans la vie, de
dignité dans la tenue, quoiqu'il renvoyât bien
loin ceux qui voulaient l'envelopper d'ennui, sous
prétexte de la majesté du rang ; et si
Antinoüs avait eu des successeurs, le vice du moins se
dérobait à la pudeur publique. Au palais, les
esclaves, les affranchis, retenus dans l'ombre ; point de vin
sur la table, mais les repas assaisonnés de
conversations variées, de lectures
intéressantes ou de représentations
scéniques. Des réceptions aux jours de
fête ; ordinairement le calme et le silence dans la
demeure impériale. Cependant aucune affectation
d'austérité ; il prenait part aux plaisirs de
ses amis et aussi à leurs douleurs ; il chassait avec
eux et les visitait dans leurs maladies, sans leur permettre
d'abuser de son affection ni leur donner un crédit
dont ils pussent trafiquer, ainsi qu'ont coutume de le faire
les césariens et tous ceux qui entourent les
empereurs. En public, pour cortège, les citoyens les
plus respectés, et point d'avances à la foule,
afin d'en tirer ces acclamations si faciles à obtenir
et qui si souvent trompent ceux qui les reçoivent.
Lorsqu'il revenait du Forum ou de la curie, c'était
habituellement en litière, pour qu'on ne le
suivît point.
Jusqu'à la fin il eut pour les sénateurs les
mêmes égards. Arrivait-il des ambassadeurs
étrangers, il les présentait lui-même au
sénat, exposait leur demande, prenait les avis de
chacun, et, après avoir recueilli les voix,
rédigeait la réponse dans le sens de la
majorité. Avec le peuple il était comme avec
les soldats, plutôt sévère qu'affable. Un
jour que, durant les jeux, on lui réclamait avec
insistance une grâce qu'il ne crut pas juste
d'accorder, il la refusa, et, toute l'assistance se
récriant, il commanda par le héraut qu'on
fît silence et que les jeux continuassent. Une autre
fois le peuple le pressait avec grand bruit de donner la
liberté à un conducteur de char. Il
écrivit sur ses tablettes : La dignité du
peuple romain ne lui permet pas de demander que
j'affranchisse l'esclave d'un autre, ni de contraindre son
maître à l'affranchir lui-même ; et il
jeta ces tablettes à la foule. D'autres fois il se
tirait d'une importunité par un bon mot. Un
solliciteur dont la tête commençait à
blanchir et qui n'avait pu obtenir une grâce reparut
quelque temps après, les cheveux teints et demandant
la même place : Mais je l'ai déjà
refusée à votre père, dit le
prince.
Il aimait, avons-nous dit, à rendre la justice, et
surtout à la faire ; quand il siégeait sur son
tribunal, c'était entouré non de ses amis ou de
ses familiers, mais des plus savants jurisconsultes, tels que
le sénat lui-même n'aurait pu mieux choisir,
Julius Celsus, Salvius Julianus, Neratius Priscus. Dion, qui
ne lui est pas favorable, remarque cependant que jamais il ne
dépouilla personne injustement de ses biens ; et
l'historien ajoute avec une naïveté qui est
malheureusement une vue nette de certains caractères :
«Il n'avait point de colère, même pour les
gens de peu qui lui rendaient service en agissant contre son
sentiment». Mais il n'entendait pas que les juges
violassent la loi ; et sa vigilance, celle qu'il imposait
à l'administration, rendirent les
prévarications bien difficiles. Il voulait que
l'intention, et non le fait, fît le coupable, et si, en
lui, l'homme a eu des moeurs mauvaises, le prince a su
récompenser les bonnes en refusant de punir le
meurtrier d'un individu qui avait commis de honteuses
violences sur l'accusé ou sur les siens.
Il est malheureux que le grammairien Dosithée, qui
nous a conservé des lettres et sentences d'Hadrien, ne
soit qu'un maître d'école prenant au hasard les
exemples qu'il propose à ses élèves.
Mieux choisis et plus nombreux, ces fragments auraient permis
de lever un coin du voile qui cache la vie habituelle du
prince. Tels qu'ils sont, ils le montrent rendant justice ou
donnant conseil à tout venant, sous le vestibule de
son palais, comme les rois et les cheiks de l'Orient aux
portes de leur ville ; et, malgré leur insignifiance,
ils aident à saisir le véritable
caractère de cette magistrature impériale,
faite des prérogatives bien déterminées
des anciennes charges républicaines et des pouvoirs
indéfinis de l'autorité patriarcale.
Un individu veut s'enrôler : «Où
désires-tu servir ? - Au prétoire. - Mais
quelle taille as-tu ? - Cinq pieds et demi. - Entre dans les
cohortes urbaines, et si tu es bon soldat, la
troisième année, tu pourras passer aux
prétoriens». (§ 2.)
Un vieux soldat vient au palais : «Mes fils, seigneur,
ont été pris pour la milice. - C'est fort bien.
- Mais ils sont très ignorants : aussi j'ai peur
qu'ils n'agissent pas selon les règlements et qu'ils
ne me laissent dans la misère. - Pourquoi craindre ?
Ne sommes-nous pas en paix ? Leur temps de milice se passera
tranquillement. - Permettez, seigneur, que je les suive,
fût-ce comme leur serviteur. - Par les dieux ! n'en
fais rien ; il ne convient pas que tu deviennes le valet de
tes fils ; mais prends ce ceps de vigne, je te fais
centurion». (§ 13.)
Un autre jour, il condamne un fils à nourrir son
père vieux et infirme, un tuteur à fournir des
aliments à son pupille. Un homme et une femme qui
n'avaient pas contracté de justes noces,
c'est-à-dire un mariage légitime, se disputent
un enfant pour avoir sa part dans les distributions
publiques. L'empereur fait venir l'enfant :
«Auprès de qui demeures-tu ? - Chez ma
mère». Alors le prince se tournant vers l'homme
: «Méchant ! laisse ce congiaire qui ne
t'appartient pas». (§ 11.)
Comme il assistait à la distribution de ce que nous
appellerions les bons de pain, une femme s'écrie :
«Je te supplie, seigneur, d'ordonner qu'on me donne une
portion du congiaire de mon fils qui m'abandonne». Le
fils était présent. «Moi, seigneur, je ne
la reconnais pas pour ma mère. - Eh bien, moi, si tu
persistes, je ne te reconnaîtrai plus pour
citoyen». (§ 14.)
Un citoyen expose qu'il a le cens équestre et qu'il
avait sollicité la concession du cheval d'honneur
(equum publicum), mais n'a pu l'obtenir à cause
d'une accusation portée contre lui : «Celui qui
demande le cheval d'honneur doit être à l'abri
de tout reproche ; prouve que ta vie est sans tache».
(§ 6.)
Il ne se trouve en tout cela rien de bien important pour le
droit ou pour l'histoire. Cependant, si Tacite avait lu les
fragments de Dosithée, il n'aurait pas reproché
à Tibère sa présence dans les tribunaux.
L'empereur était un chef militaire, imperator,
mais il était aussi de cet âge où la
société voit surtout dans le prince un
justicier à la façon de Salomon ou de saint
Louis. Aux mains d'un sage, cette faculté de faire le
droit, condere jura, à tout propos et sur toute
question, est sans inconvénients ; aux mains d'un
débauché, d'un violent ou d'un fou, elle a
été déjà et elle redeviendra
terrible. Hadrien, heureusement, était de la
catégorie des sages.
Un tel prince méritait d'être bien servi, et il
le fut, parce qu'il avait la qualité qui, chez le
prince, peut remplacer toutes les autres : il savait
découvrir les hommes utiles et les mettre à la
fonction qu'ils étaient en état de remplir le
mieux. Mais les écrivains, qui nous ont gardé
si peu de choses de l'empereur, ne nous disent rien de ses
lieutenants. Il en avait cependant qui étaient dignes
des anciens temps. Ainsi Marcius Turbo, son meilleur
général, devenu préfet du
prétoire, étonnait la mollesse des grands de
Rome par son activité et sa vie austère. Il
passait tout le jour à travailler au palais, et
souvent retournait près du prince au milieu de la
nuit. Jamais on ne le vit, même malade, s'enfermer dans
sa maison, et Hadrien le pressant de prendre quelque repos,
il répondit par le mot de Vespasien : Un
préfet du prétoire doit mourir
debout.
Sulpicius Similis était un autre gardien
sévère de la discipline. Un jour, Trajan
l'ayant appelé dans sa tente, lui simple centurion,
avant les tribuns, il dit au prince : C'est une honte,
César, que tu t'entretiennes avec un centurion, tandis
que les tribuns sont debout à ta porte et
attendent. Il prit malgré lui la préfecture
du prétoire, la déposa dès qu'il le put,
passa aux champs le reste de sa vie, sept années, et
fit écrire sur son tombeau : Ci-gît Similis,
qui exista soixante-seize ans et en vécut
sept.
Le vainqueur des Juifs, Julius Severus, homme aussi
d'autorité, mais en même temps de justice, avait
gagné si bonne renommée dans soir gouvernement
de Bithynie, que, plus d'un siècle après, son
nom y était encore vénéré. Arrien
est une autre preuve de la sûreté des choix
d'Hadrien. Ecrivain distingué, historien exact, bon
général, chef habile et prévoyant d'une
province frontière, il mérita l'estime de son
prince, et il a gagné celle de la
postérité.
Cependant on reproche à Hadrien une basse jalousie et
de la cruauté ; mais il est aisé de
reconnaître d'où venaient ces reproches. Durant
ses interminables voyages, il promenait avec lui le
gouvernement sur tous les grands chemins de l'empire.
Auparavant, la réalité du pouvoir restait au
moins dans la capitale, et, de loin, on voyait mal la
distance qu'il y avait du Palatin à la curie. Avec
Hadrien, l'illusion n'était plus possible. Que
faisaient donc les délaissés de Rome, les vieux
politiques sans emploi, la jeunesse dorée sans guerre,
sans commandements obtenus avant la première barbe ?
Que disait-on sous les portiques du forum de Trajan, le long
de la voie Sacrée et dans toutes les maisons
patriciennes ? Que le petit Grec était encore un petit
esprit ; que ce provincial se plaisait avec les gens de son
espèce ; que ce grand ami de la paix avait peur de la
guerre. On ne lui reprochait pas ses vices, qui
étaient ceux de tout le monde, et pas encore sa
cruauté, puisque personne ne voyait
d'exécutions ; mais on insinuait qu'il avait bonne
envie de faire des victimes et l'on exagérait ses
travers ; on élevait à la hauteur d'affaires
d'Etat des querelles de ménage entre lui et les
sophistes dont il s'entourait.

L'impératrice Sabine, buste du Capitole |
Enfin, comme son mariage était demeuré stérile, on prêtait à l'impératrice Sabine d'abominables propos, et, sans se mettre en frais d'imagination, on lui faisait répéter le mot attribué déjà au père de Néron : D'elle et de moi, il ne peut naître qu'un monstre fatal au genre humain. Il ne faisait pas bon conspirer contre un prince qui avait pour lui le dévouement absolu de trente légions. Aussi ne le fit-on qu'à son avénement, quand on le croyait mal affermi, et à la fin, lorsque, la mort approchant, on pensa que son esprit et sa main faiblissaient. Mais on se dédommageait par des médisances : petite guerre dont Antonin s'était tant effrayé, qu'il n'avait point osé, durant tout son règne, sortir de Rome. |
Or, ces médisances, les badauds les
écoutaient avidement et les ramassaient pour d'autres
qui les écrivirent. Voilà comment nous les
retrouvons dans les pauvres historiens de ce temps, Spartien
et Dion, surtout le Dion du moine Xiphilin. Avec de tels
écrivains, on est forcé de ne tenir aucun
compte des accusations vagues, des affirmations sans preuves,
lorsqu'elles sont en contradiction avec le caractère
bien constaté des hommes, ou avec les
événements connus. Ainsi Dion, attribuant
à la jalousie l'abandon des conquêtes de Trajan
et la destruction du pont sur le Danube, fait preuve d'autant
d'ineptie que lorsqu'il montre Hadrien envieux des morts,
même d'Homère, et se guérissant une
première fois de son hydropisie en épuisant,
à l'aide de la magie et des enchantements, l'eau qui
enflait son corps. Spartien dit sérieusement que
l'empereur avait de telles connaissances en astrologie qu'il
écrivait le soir des calendes de janvier tout ce qui
devait lui arriver dans l'année. Plus loin, il accuse
la violence de sa cruauté naturelle, vim
crudelitatis ingenitae, et il ajoute : idcirco multa
pie fecisse. Pour admettre cette cruauté
naturelle, qui aurait eu le singulier effet d'être le
mobile de ses bonnes actions, il faudrait autre chose que ces
phrases d'où rien ne sort quand on les presse. Nous
avons eu trop d'exemples de cette manie malheureuse avec un
écrivain de génie comme Tacite, pour accepter
sans preuves les affirmations d'auteurs de décadence,
à qui manquent complètement le sens critique,
le goût de l'ordre et de la précision, mais qui,
en échange, sont déjà doués de la
plus niaise crédulité.
On lit dans Dion : «Sa jalousie contre les talents
supérieurs ruina un grand nombre de gens et causa la
perte de quelques-uns. C'est ainsi qu'il chercha à se
défaire de Favorinus le Gaulois et de Denys le
Milésien». On pourrait croire, d'après
ces paroles, qu'il arriva à ces deux hommes quelque
fâcheux accident. Or Denys fut fait chevalier romain et
Favorinus mourut plein de jours dans les dernières
années d'Antonin. Repris une fois par le prince au
sujet d'une expression, il s'était aussitôt
rendu, et, ses amis le raillant d'avoir cédé si
vite, il avait répondu : «Vous ne me persuaderez
jamais que l'homme le plus savant de l'univers ne soit pas
celui qui commande à trente légions». Il
serait juste de laisser ce mot au compte de la
lâcheté du sophiste ; on le met à la
charge du prince, qui apparaît alors comme incapable de
supporter la plus légère contradiction. On
rapporte du même personnage qu'il s'étonnait de
trois choses : Gaulois, il parlait grec ; eunuque, il avait
été accusé d'adultère ; enfin,
haï de l'empereur, il vivait encore. L'eunuque
n'était point modeste, en se vantant d'avoir
été l'objet de la haine d'un empereur ; et s'il
conserva, comme il semble, la faveur d'Antonin, c'est
qu'Hadrien ne l'avait pas même chassé de sa
cour. Tout le mal peut-être qu'il en avait reçu
avait été de se voir préférer
d'autres sophistes. Denys de Milet et le philosophe
Héliodore perdirent aussi de leur crédit ; mais
Epictète garda le sien, et Arrien, son disciple, fut
tiré des livres pour être fait consul.
Nous savons qu'Hadrien aimait à s'entourer de
lettrés et d'artistes, race autrefois disputeuse et
république pleine d'orages, parce que la vanité
y était toujours surexcitée. «Le prince
peut te donner des richesses et des charges, disait Denys
à Héliodore, qu'Hadrien venait de prendre pour
secrétaire, mais jamais il ne fera de toi un
orateur». Que cette humeur difficile l'ait, à
certains jours, fatigué, et que, dans ses disputes
avec eux, sur un point de grammaire ou de philosophie, il
leur ait rappelé, par une réplique
impérieuse, la qualité de leur contradicteur,
on ne devrait pas s'en étonner. Il aimait à
rire et excitait des batailles où il rendait vers pour
vers, trait pour trait, sans toujours en émousser la
pointe. Un de ces sophistes réclame les
immunités que la loi accorde aux philosophes : Lui,
un philosophe ! répond Hadrien, quelle erreur
! et il refuse. Le mot était dur et le
procédé désobligeant ; mais d'une
parole, même acérée, à un coup de
hache, la distance est grande, et je ne crois pas qu'elle ait
été franchie par le prince, qui aimait trop les
lettres pour en persécuter les
représentants.
Il honora et enrichit, dit son biographe, tous ceux qui se
livraient à l'enseignement, et en éloigna, mais
après les avoir comblés de biens, ceux qui
n'étaient pas capables de soutenir la renommée
de leur profession. C'est notre mise à la retraite
avec tous les honneurs de la vétérance.
Remarquons, sans nous arrêter à leur histoire,
que sous ce règne florissaient : Plutarque, un des
maîtres d'Hadrien ; Suétone, son
secrétaire, qu'il disgracia pour une offense à
l'impératrice ; Phlégon, son affranchi, qui
écrivit, sous la dictée du maître, son
histoire ; Arrien, habile et savant capitaine ;
Ptolémée, l'illustre géographe ;
Pausanias, Aulu-Gelle ; enfin un grammairien fameux,
Apollonius Dyscole ou le Bourru. Juvénal venait de
mourir, et Lucien, Apulée, n'avaient encore rien
écrit. Ainsi l'érudition domine et la grande
littérature est morte, car bien que tout le monde
fasse des vers ou déclame, on ne trouve ni un orateur
ni un poète.

Buste du Vatican |
Nous avons pu faire bon marché des querelles
d'Hadrien avec les sophistes, mais il resterait une tache
odieuse sur son nom, s'il était vrai qu'Apollodore
eût été mis à mort en
représailles de critiques contre un projet de temple
dessiné par l'empereur. J'ai peine à croire
à cette méchante action, et ce qui s'y rapporte
est fort obscur. On dit que, du vivant de Trajan, Apollodore
se brouilla avec le futur empereur, en le renvoyant à
ses peintures un jour qu'Hadrien voulait lui parler de
constructions, et l'on fait de cette rudesse le motif de sa
disgrâce. Cependant il resta encore en faveur, puisque
le nouveau prince le chargea de faire un colosse qu'il
voulait consacrer à la Lune, pour le placer à
côté de celui de Néron qu'il avait
dédié au Soleil. Le récit de Dion
Cassius, ou plutôt de l'abréviateur Xiphilin,
est rempli d'invraisemblances. Hadrien, dit-il, bannit
Apollodore, mais demeura en correspondance avec lui ; il lui
demanda même de composer sur les machines de guerre le
livre dont nous avons parlé et qui commence ainsi :
«Seigneur, j'ai lu ta lettre au sujet des machines, et
je suis heureux que tu m'aies jugé digne
d'exécuter une pareille oeuvre». Plus loin, il
ajoute : «Dans des jours meilleurs pour moi, quand nous
étions ensemble à l'armée...» Ces
paroles tristes, mais douces, n'annoncent point beaucoup de
haine dans le coeur de l'exilé pour le
persécuteur, ni cette demande du prince une bien vive
irritation contre le persécuté. Il y a
là quelque chose qui nous échappe. Si
l'empereur ne mettait pas un terme à cet exil, c'est
peut-être que le sénat l'avait prononcé
à la suite d'une faute dont le souvenir subsistait.
Dion assure qu'Hadrien finit par ordonner sa mort pour avoir
dit d'une statue que le prince voulait mettre assise dans un
temple : Elle est trop grande : en se levant, elle
briserait la voûte. L'habile artiste n'a pu faire
à un connaisseur expert une objection si contraire aux
idées des anciens sur la statuaire des dieux, et qui
eût été la condamnation de Phidias en
même temps que celle d'Hadrien. Il est tout aussi
difficile d'admettre que le meurtre du grand architecte soit
passé inaperçu. Or Spartien, qui ne
ménage pas au prince les accusations de
cruauté, et qui parle d'Apollodore, ne fait aucune
allusion à sa mort violente. Eutrope et Aurelius
Victor ne la connaissent pas davantage, ou du moins n'en
disent mot. Si le fait est vrai, il faut qu'on lui trouve
d'autres motifs que ceux qu'on donne, car ce meurtre, tel
qu'il est raconté, aurait été un acte de
folle cruauté, et nous avons le droit de dire
qu'Hadrien ne commettait pas de ces actes là.
Il est une question que, à l'époque où
nous sommes arrivés de l'histoire de l'empire, il faut
se faire au sujet de chaque prince : Quelle conduite a-t-il
tenue à l'égard de ceux qu'on appelait les
désespérés et qui à
l'apothéose de l'empereur opposaient celle du
crucifié ?
La croyance qui finit se rencontre avec celle qui commence,
et elles se mêlent comme deux fleuves arrivés
à leur confluent : des sectes chrétiennes
différaient si peu des païennes que, à
regarder de loin et vite, on distinguait mal les
dévots des deux religions. On a lu une lettre
d'Hadrien dont nous avons omis, pour le reprendre ici, un
passage qui se rapporte aux chrétiens. «En
Egypte, dit-il, les chrétiens sont des adorateurs de
Sérapis, même ceux qui se disent les
évêques du Christ. Dans ce pays, il n'y a ni
rabbin juif, ni samaritain, ni prêtre chrétien
qui ne soit astrologue, devin et charlatan. Le patriarche
même, lorsqu'il vient en Egypte, est forcé par
les uns d'adorer Sérapis, par les autres le
Christ». Ces paroles attestent une certaine
préoccupation de la question religieuse dont le monde
était alors troublé. Il est évident
qu'Hadrien prit quelque souci des problèmes qui
s'agitaient au-dessous de lui ; mais, comme les puissants et
les heureux du jour, qui regardent de loin et
dédaignent les idées nouvelles, il a vu, sans
bien comprendre, et, comme beaucoup d'autres aussi, il
confondit avec le bien des chrétiens celui dont les
Lagides avaient fait le Dieu suprême de la vie, de la
mort et de la résurrection.
Cependant l'empereur aurait dû être mieux au
courant des dogmes chrétiens, car, à
Athènes, il avait admis Aristide, philosophe converti,
et l'évêque Quadratus, le premier apologiste,
à lui présenter la défense de leur foi
(126). L'Eglise, avec son organisation et ses rites, alors
fort simples, ne pouvait inspirer d'inquiétude
à un prince qui, dans ses voyages, avait
rencontré tant de systèmes, de croyances et de
cultes divers, que le vieil esprit romain, étroit et
dur, avait été tué en lui pour faire
place à l'esprit de tolérance. Les
chrétiens, qui prétendaient guérir des
malades et ressusciter des morts, lui semblaient avoir autant
de droit à vivre tranquilles que les prêtres de
Sérapis, qui s'attribuaient le même pouvoir. Il
n'avait nulle envie de les accuser, comme Domitien, de
judaïser, comme Trajan, de former des
sociétés secrètes, et il rattachait leur
dogme de la Trinité aux doctrines les plus pures de
Platon. Les chrétiens, dont les apologistes se
présentaient devant lui avec le manteau des
philosophes, lui semblaient former une école
philosophique, à laquelle il devait donner la
liberté qu'il laissait à toutes les autres.
S'ils étaient possédés de l'esprit de
prosélytisme, tout le monde alors l'avait, à ce
point que nous pouvons considérer
Sénèque, Epictète, Dion Chrysostome,
comme des directeurs de conscience ; que beaucoup tenaient
Apollonius de Tyane pour un messie ; et que les chemins, les
rues, étaient encombrés de philosophes
prêcheurs dont Lucien nous a laissé un portrait
qui, sauf l'habit, semble fait à la ressemblance de
certains prédicants de carrefours au moyen
âge.
Hadrien, qui avait changé les anciennes façons
de régner, changea donc aussi les vieilles maximes de
gouvernement ; et, puisqu'il mettait le salut de l'empire
dans la vigilance et la fermeté de l'empereur,
incessamment portées sur tous les points du
territoire, c'est-à-dire dans une sagesse toute
terrestre, il n'avait plus besoin de le mettre dans la
protection de la religion officielle. Malgré son titre
de souverain pontife, il laissa les dieux d'Auguste se
défendre tout seuls. Néanmoins il faut toujours
faire cette réserve, que dans cet empire immense il a
pu se trouver quelques villes où des chrétiens
aient été victimes soit des emportements d'une
populace ameutée, soit de la haine religieuse d'un
magistrat imbécile ; que la police du culte
appartenait aux décurions et qu'ils croyaient
défendre leurs dieux en accusant ceux qui les
attaquaient. C'étaient des violences locales contre
lesquelles les provinciaux étaient sans
défense. Ceux qui, en très grand nombre
à cette époque, avaient le titre de citoyens,
étaient seuls à l'abri de ces jugements
précipités qui tourmentaient la conscience de
certains fonctionnaires. Plusieurs, entre autres Licinius
Silvanus Granianus, proconsul d'Asie, écrivaient
à l'empereur qu'il ne leur paraissait pas juste de
mettre un homme à mort parce que la populace criait :
Le chrétien aux bêtes ! Nous avons une
des réponses d'Hadrien, celle qui fut adressée
à Minucius Fundanus, successeur de ce sage personnage.
Saint Justin l'a insérée en entier dans sa
première Apologie, et Eusèbe en a mis
une traduction grecque dans son Histoire
ecclésiastique. Sans retirer les instructions si
précises de Trajan à Pline, ce qui aurait
été l'équivalent d'une reconnaissance
officielle du christianisme, Hadrien semble avoir
cherché, par le vague de sa réponse, à
fournir aux juges un prétexte de ne frapper les
chrétiens que pour des délits de droit commun.
«Si quelqu'un, dit-il, accuse les chrétiens et
prouve qu'ils font quelque chose contre les lois, jugez-les
selon la faute qu'ils auront commise ; s'ils sont
calomniés, punissez le calomniateur».
On dira que c'était n'accorder rien, puisque les lois
de l'empire condamnaient les chrétiens. Sans doute,
mais d'abord, par son rescrit, Hadrien interdisait la
violence, les exécutions tumultuaires, et faisait une
obligation de la procédure légale ; ensuite,
dans un gouvernement absolu, les lois valent ce que vaut
l'esprit qui les applique ; et il faut bien que, sous les
termes équivoques dont Hadrien s'était servi,
l'administration impériale ait mis la tolérance
qui était dans la pensée de son chef, puisque
saint Justin trouvait que ce rescrit contenait tout ce que
les chrétiens pouvaient demander aux empereurs.
Antonin ne songera pas plus que son
prédécesseur à donner au christianisme
une existence légale, incompatible avec les lois et la
constitution même de l'empire, mais il leur accordera
la tolérance de fait, qui devait d'abord lui
suffire.
Que serait-il advenu si cette politique avait
été continuée par les successeurs de ces
deux princes ; si les uns n'avaient pas cherché
à étouffer le christianisme dans le sang ; si
les autres ne lui avaient pas livré le gouvernement en
le faisant asseoir à côté d'eux sur le
trône ? On eût évité tous les
crimes commis par la persécution, qui exalta
l'héroïsme des martyrs, mais aussi la haine
contre la société païenne, ses arts, sa
littérature ; et le christianisme, s'infiltrant peu
à peu dans les esprits, eût paisiblement
transformé le monde, sans se faire d'abord pouvoir
public, ensuite puissance territoriale, ayant la force et en
usant, faisant des martyrs après en avoir
donné. Alors il eût été pour
l'empire un élément de
régénération, au lieu d'être une
cause de dissolution. Mais le gouvernement du monde
appartient à la passion bien plus qu'à la
sagesse, et cette idée de la séparation du
temple et du forum, ou, pour l'appeler par son nom moderne,
la séparation de l'Eglise et de l'Etat, qui n'entra
jamais dans une tête grecque ou romaine, est un fruit
qui aura mis des milliers d'années à
mûrir.
Pour Hadrien, il lui reste l'honneur d'avoir agi comme s'il
avait eu le respect réfléchi de la conscience
religieuse. Sous lui, nul, par ordre du prince, ne souffrit
pour ses croyances, dans sa personne ou dans ses biens. Il
eut cependant une guerre atroce de religion. Aux premiers
jours de son règne, ses généraux avaient
écrasé l'insurrection juive qui avait
éclaté sous Trajan, à Cyrène, en
Egypte, dans l'île de Chypre, où l'exploitation
des mines de cuivre, concédée par Auguste
à Hérode, à condition d'en partager les
revenus avec le fisc impérial, avait attiré un
très grand nombre de Juifs. Comme dans toutes les
guerres faites au nom du ciel, il avait été
commis de part et d'autre d'abominables cruautés. En
Chypre seulement, deux cent quarante mille personnes avaient
péri ; et défense avait été faite
aux Juifs, sous peine de mort, de mettre le pied dans
l'île : celui même que la tempête y jetait
n'obtenait pas merci. Ailleurs, pareilles cruautés :
on parle non seulement de tortures, mais d'immenses
égorgements, de cadavres mangés. Dans la
Cyrénaïque, dit Orose, presque toute la
population avait péri, et, si Hadrien n'y avait
envoyé de nombreux colons, la terre y serait
restée vide d'habitants et inculte.
Cette fois, c'étaient les colonies qui avaient pris
les armes. Epuisée de sang, et d'ailleurs contenue par
de puissantes garnisons, surveillée par d'habiles
généraux, la mère patrie n'avait pas eu
la force de recommencer la grande guerre par les armes ; mais
elle continuait la lutte par l'esprit, et, sur les ruines de
la patrie matérielle, quelques hommes s'étaient
donné la lâche de refaire la patrie morale du
peuple hébreu.
Après la chute de Jérusalem, les docteurs de la
loi qui avaient survécu à l'épouvantable
catastrophe s'étaient réfugiés à
Iabné (Jamnia), plus tard à Tibériade,
et y avaient ouvert des écoles qui entretenaient le
zèle pour la loi parmi ces vaincus que rien ne pouvait
abattre, parce qu'ils se sentaient en possession d'une
doctrine supérieure à la force qui les avait
accablés. Ce peuple était comme le roseau de
Pascal : quand le monde l'écrasait, il se croyait
encore plus grand que le monde, et il avait raison de le
croire, car à la fin il l'a vaincu, en lui imposant
son dogme.
C'est par les écoles, par la science telle qu'on
l'entendait alors, que le mouvement national fut
préparé, et c'est en elles que les Juifs
placèrent leurs espérances de salut. La
légende d'Akiba, le plus célèbre de ces
docteurs de la loi, en est un touchant témoignage.
Dans sa jeunesse le nouveau Moïse gardait les troupeaux
de Kalba Schéboua. La fille du maître,
frappée de la vertu du jeune berger, lui proposa de
l'épouser, mais à la condition qu'il irait
auparavant s'instruire et gagner des disciples. Akiba partit
; au bout de douze ans, il revenait suivi de douze mille
disciples, lorsqu'en approchant de la maison de sa
fiancée il entendit le père qui disait avec
colère à sa fille : «Insensée !
Jusques à quand veux-tu attendre, dans le veuvage,
celui qui t'a quittée ?» Et elle
répondait : «Si mon époux veut faire
selon mon désir, il passera douze années encore
à étudier». Akiba aussitôt retourne
à ses livres, et, après le temps prescrit,
revient avec vingt-quatre mille disciples. Sa fiancée
court à la rencontre de celui qui est devenu le plus
célèbre des docteurs de la loi, se prosterne
à ses pieds et embrasse ses genoux. Les disciples
veulent écarter cette femme en haillons, dans laquelle
ils n'ont pas reconnu la patrie en deuil ; mais le
maître s'écrie : «Que faites-vous ? C'est
à elle que nous devons tous notre
science».
Jusqu'alors, parmi les Juifs, l'enseignement avait
été oral, traditionnel ; la loi seule
était écrite. L'école de
Tibériade, prévoyant de nouveaux malheurs et
une nouvelle dispersion, résolut de rédiger,
après les avoir discutées une dernière
fois, toutes les décisions des docteurs, toutes les
prescriptions que l'usage avait introduites, toutes les
règles de conduite que la sagesse avait
trouvées. C'était le code des lois civiles et
religieuses, la Mishna ou loi
répétée, que l'école
rédigeait pour constituer, à travers le temps
et l'espace, le lien moral de la nation.
Quand l'école de Tibériade eut
préparé cet immense travail, une
dernière tempête pouvait s'élever et les
Juifs de la Palestine périr dans les combats ou dans
les supplices : la nationalité juive était
sauvée.
Pour prévenir le retour de ces insurrections qui
mettaient en péril la paix de l'Orient, Hadrien
n'avait pas recouru à la persécution religieuse
contre les individus. Il crut qu'il les ferait renoncer
à leurs indestructibles espérances dans la
venue d'un messie, s'il leur prouvait l'inanité de ces
promesses en effaçant jusqu'au nom de
Jérusalem. Sur les ruines du temple campait, depuis le
grand siège, une partie de la légion Xa
Fretensis ; Hadrien l'occupa à déblayer le
sol, et, en l'année 122 (?), une colonie nombreuse
vint s'établir au pied de la montagne de Sion. La
cité de David prit le nom de l'empereur et de Jupiter
Capitolin, Aelia Capitolina. Aux lieux où
chaque année les fidèles venaient adorer
Jéhovah, le Dieu unique, ils trouvèrent les
autels de toutes les divinités de l'Olympe. Le signe
même de leur foi fut proscrit : la police
impériale défendit aux Juifs de pratiquer leur
baptême sanglant sur des hommes de race
étrangère.
Les Juifs paraissaient résignés à la
perte de leur indépendance politique ; ils se
soulevèrent pour venger l'outrage fait à leur
Dieu (132). Des insurrections éclatèrent sur
différents points ; puis tout le peuple s'arma sous la
conduite d'un homme qui montra tant de courage et d'audace,
que les Juifs, encore une fois trompés par
l'éternelle illusion, virent en lui le sauveur promis,
l'étoile qui devait sortir de Jacob. Akiba,
reconnaissant en lui le messie promis à Israël,
lui remit, en présence des chefs de la nation, le
bâton de commandement et lui tint l'étrier
lorsque le fils de l'Etoile, Bar Kokaba, monta son cheval de
guerre.
Les Romains surpris éprouvèrent d'abord des
échecs qu'on dissimula, et, durant trois
années, le chef national fut maître dans la
montagne royale, chaîne de hauteurs qui s'étend
de la Samarie à l'Idumée : nous avons encore
des monnaies qu'il fit frapper et qui sont datées par
les années de la délivrance. Les
chrétiens, comme au temps du siège de
Jérusalem, se tenaient à l'écart ;
accusés de trahir la cause commune, ils furent
persécutés et mis à mort, quand ils
refusaient l'abjuration. Mais des auxiliaires accoururent de
tous les pays voisins, et ce que l'empereur avait d'abord
regardé comme un de ces désordres locaux dont
les Romains ne se troublaient pas apparut comme un
péril public qui exigeait les plus énergiques
mesures. Il appela du fond de la Bretagne son meilleur
capitaine, Julius Severus, lui donna d'habiles lieutenants,
des forces suffisantes et l'ordre d'éviter les actions
générales, d'avancer lentement, mais
sûrement, en ne laissant debout derrière lui ni
un homme ni une maison. Plus de neuf cents gros villages
furent détruits, cinquante places fortes prises et
rasées ; cent quatre-vingt mille hommes
périrent les armes à la main. Mais qui
comptera, dit l'historien, ceux qui succombèrent
à la faim, aux misères ou dans la flamme des
incendies ? La Judée ne fut plus qu'un désert.
Bar Kokaba eut la mort du soldat, il tomba en combattant ;
les docteurs de la loi, qui s'étaient enfermés
dans la dernière forteresse de l'insurrection,
Béther, moururent au milieu des supplices ; Akiba fut
déchiré avec des dents de fer rougies au feu,
et les fêtes des amphithéâtres romains
furent rassasiées de la chair des captifs. A ceux
qu'on n'avait pu tuer ou vendre on interdit l'approche
d'Aelia Capitolina ; un jour seulement chaque
année, il leur fut permis de venir pleurer sur les
ruines de la cité sainte.
Lorsque, en voyant le chef de l'insurrection, Akiba
s'était écrié : Voilà le
Messie ! un docteur lui avait répondu : Akiba,
l'herbe aura poussé entre tes mâchoires avant
que le Messie paraisse ; et il semblait que cette dure
parole fût vraie pour la race elle-même. L'oeuvre
de sang avait échoué, et l'on pouvait croire ce
peuple anéanti mais l'oeuvre de l'esprit
triompha.
On eut beau les disperser sur tous les continents et
déchaîner contre eux toutes les colères,
comme Enée, emportant des ruines de Troie les dieux
pénates et le feu sacré pris au foyer national,
les fugitifs étaient partis avec une nouvelle arche
d'alliance. L'école de Tibériade,
continuée dans l'ombre, acheva le grand travail de la
Mischna ; et la commune patrie se retrouva partout où
fut porté le livre qui la représentait.
Grâce à lui, des rives du Gange aux bords du
Tage, du fond de la Pologne au pied de l'Atlas, les Juifs
gardèrent si bien leur langue et leur loi, qu'en plein
moyen âge leurs docteurs allaient d'un bout de l'Europe
à l'autre en trouvant partout des concitoyens.
Le peuple de l'Unité, qui jamais n'a voulu qu'un seul
Dieu et un seul temple, n'a eu besoin que d'un seul livre
pour ne pas périr. Quel triomphe de la pensée
sur la force !
Cependant Hadrien avançait en âge ; les
années sombres étaient venues avec la
vieillesse et les infirmités ; il fallait songer au
futur empereur. Se souvint-il des paroles de Tacite :
Naître d'un prince est un fait du hasard, mais
l'adoption va au plus digne, parce que celui qui adopte sait
ce qu'il fait et a pour guide l'opinion publique ? Ou
bien de celles de Pline le Jeune disant à Trajan :
C'est entre tous qu'il faut choisir celui qui doit
commander à tous ? Ce système excellent,
mais si difficile à pratiquer, fut heureusement
imposé à Hadrien par la nature. Comme tous les
princes depuis César, à l'exception de Claude
et de Vespasien, Hadrien n'avait pas eu de fils. Il se fit
autoriser par le sénat à nommer son successeur,
autorisation qu'il était habile de demander, dangereux
d'obtenir, car si elle donnait d'avance la
consécration légale à l'élu du
prince, ce qui était une garantie d'ordre, elle
mettait en mouvement toutes les ambitions et suscitait des
espérances que la déception devait changer en
mécontentement. De là à des paroles
imprudentes, à des intrigues coupables, la pente
était facile, et au bout se trouvait le prince
irrité, avec le devoir de défendre son
successeur et lui-même, c'est-à-dire la paix
publique.
Il hésita longtemps, et comme un de ses amis s'en
étonnait : «Il vous est bien aisé,
reprit-il, de parler ainsi, à vous qui cherchez un
héritier pour vos biens et non pour l'empire».
Enfin, il se décida en faveur de L. Ceionius Commodus
Verus, gendre de ce C. Avidius Nigrinus qui avait
conspiré contre lui. Etait-ce une réparation
accordée à la famille d'un homme qu'il avait
aimé et une protestation contre la hâte du
sénat à le faire mourir ? Dans tous les cas,
Hadrien, par cette résolution, se montrait au dessus
des rancunes d'une âme vulgaire. Un don de 300 millions
de sesterces aux soldats et de 100 millions au peuple
garantit leur assentiment.
Verus, d'une vieille famille d'Etrurie, avait, dit son biographe, une beauté royale, et cette beauté servit de prétexte aux mauvaises langues de Rome pour expliquer son adoption. L'homme qui, après Verus, assura l'empire à Antonin et à Marc-Aurèle, ne peut avoir été décidé par les ignobles motifs que l'on donne. D'ailleurs Verus avait de l'éloquence, des talents, quoiqu'il menât la vie élégante et voluptueuse des riches patriciens. Il avait déjà trouvé le mot de Louis XIV sur le rôle respectif des reines et des maîtresses du roi, et il répondait à sa femme qui lui reprochait quelque infidélité : Le nom d'épouse est un titre pour la dignité, non un droit pour le plaisir. Envoyé, après son adoption, dans la Pannonie, il s'y comporta bien. En l'éloignant de Rome, Hadrien avait voulu le mettre à l'abri des complots qui allaient s'y former, et il lui avait donné le commandement des légions pannoniennes pour avoir en main, par son fils d'adoption, l'armée la plus voisine de l'Italie. |
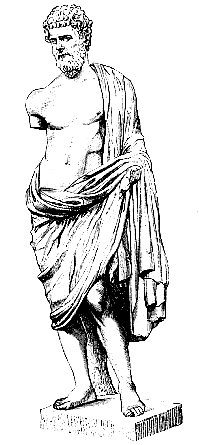
Aelius Verus Caesar en Bonus eventus |
Le choix, en effet, qu'Hadrien venait de faire, et la
santé chancelante de l'empereur, sa présence
à Rome ou aux portes de la ville, dans son palais de
Tibur, par conséquent la facilité de frapper un
coup, avaient encouragé l'aristocratie romaine
à reprendre ses vieilles et chères habitudes :
elle conspira, et les complots firent des victimes. Ces
tragédies sont pour nous fort obscures. Il est certain
que des têtes tombèrent et que le sénat
s'irrita ; mais il ne l'est point que le plus
modéré des empereurs ait renoncé sans
cause à sa modération. Ces changements à
vue dans le caractère et la conduite d'hommes
mûris par l'âge et l'expérience ne se font
que dans les écoles des rhéteurs. Le prince
qui, durant vingt années, n'avait frappé
personne, qui, offensé par de certaines gens, au lieu
de les punir, se contentait d'écrire en leur province
qu'il leur retirait son amitié, ne devint pas soudain
un bourreau ; il dut rester ce que nous savons qu'il
était : un justicier.
Dion ne lui impute que deux condamnations : au commencement
de son règne, celle des quatre consulaires mis
à mort par le sénat à l'insu du prince ;
à la fin, celle de Servianus et de son petit-fils
Fuscus, qui avaient désapprouvé, dit-il,
l'élection de Verus. Servianus, beau-frère du
prince, lui avait joué d'assez mauvais tours. Quand,
à la mort de Nerva, Hadrien courut annoncer à
Trajan qu'il était empereur, Servianus avait
employé tous les moyens de le retarder, pour
empêcher qu'il n'arrivât avant le courrier que
lui-même expédiait. Une autre fois il avait
réussi à indisposer Trajan, en
révélant à l'oncle des dettes du neveu.
Hadrien n'avait pourtant pas gardé souvenir de ces
mauvais procédés, et en maintes occasions il
avait honoré Servianus par des marques publiques de
déférence ; Spartien prétend même
qu'il l'avait déclaré digne de l'empire. A
quatre-vingt-dix ans, Servianus était trop
âgé pour y prétendre, sans être
assez sage pour éviter les apparences d'une ambition
dangereuse. Il se bornait sans doute à désirer
que l'empereur adoptât son petit-fils. Mais Fuscus,
âgé de dix-huit ans en 137, n'en ayant par
conséquent que quatorze ou quinze quand s'agitait la
question de la succession à l'empire, ne pouvait
être choisi par un prince qui voyait déjà
les signes avant-coureurs de sa fin. La faveur croissante de
Verus indisposa Servianus, qu'un troisième consulat en
134 ne put calmer. Fuscus, encore moins
réservé, se laissait troubler par de
prétendus prodiges qui lui promettaient la souveraine
puissance. Il faut qu'autour d'eux se soit formé un
parti capable de créer à Verus des embarras et
dans l'empire des désordres, pour que le prince
sensé que nous connaissons ait fait tuer ce jeune fou
et n'ait pas attendu la fin naturelle d'un vieillard
arrivé à l'extrême limite de la vie. Ces
deux exécutions n'en font pas moins tache dans la vie
d'Hadrien.
Spartien mentionne d'autres personnages tombés
à cette occasion dans la disgrâce du prince,
deux individus qu'il força de se donner la mort,
même des soldats et des affranchis qu'il
persécuta. Mais étaient-ce des accès de
colère aveugle ou l'exécution de justes
sentences ? Faute de renseignements, l'on ne peut
répondre à cette double question. Seulement,
cet auteur écrit que l'adoption d'Antonin
déconcerta beaucoup de prétendants ; que
Catilius Severus, préfet de la Ville, qui cherchait
à se frayer le chemin du trône, fut privé
de sa dignité ; et, en voyant punir jusqu'à des
affranchis et des soldats, il faut bien dire que nous
trouvons réunis les éléments habituels
d'une conspiration véritable.
On parle aussi de la mésintelligence qui existait
entre Hadrien et l'impératrice. Ces détails de
ménage ne regardent pas l'histoire politique ;
cependant, comme Dion rapporte des mots cruels de Sabine et
qu'on est allé jusqu'à supposer que son
époux l'empoisonna, il faut bien faire remarquer ici
encore une invraisemblance. En 120, du fond de la Bretagne,
Hadrien lui marque son affection ou son estime en destituant
un des secrétaires impériaux, Suétone,
un préfet du prétoire, Septicius Clarus, et
beaucoup d'autres personnages qui avaient manqué
d'égards envers l'impératrice. Rien ne nous
assure qu'il ne l'ait pas emmenée dans tous ses
voyages ; nous savons du moins qu'elle fut certainement du
dernier, le grand voyage d'Orient, ce qui n'annonce pas une
union où la vie en commun aurait été
insupportable. Le public ne croyait pas à ces
querelles de famille : on frappait des monnaies à la
double effigie du prince et de l'impératrice ; on
gravait des inscriptions où, sous leurs noms
réunis, on écrivait : Aux bienfaiteurs de la
cité. L'apothéose qu'Hadrien lui
décerna n'était qu'une cérémonie
officielle ; mais nous avons de lui des lettres intimes qui
montrent un intérieur où régnaient les
bons sentiments et non pas les orages. Un jour il
écrit à sa mère : «Salut,
très chère et excellente mère, tout ce
que tu demandes aux dieux pour moi, je le demande pour toi.
Par Hercule, je me réjouis que mes actes te paraissent
dignes d'éloge. C'est aujourd'hui mon jour de
naissance ; il faut que nous soupions ensemble. Viens donc,
bien parée, avec mes soeurs. Sabine, qui est à
notre villa, a envoyé sa part pour notre repas de
famille». Une autre lettre, fort amicale, écrite
à Servianus, son beau-frère, en l'année
134, quand il venait de lui donner un troisième
consulat, se termine ainsi : «Je t'envoie des coupes
à couleurs changeantes, que le prêtre du temple
m'a données ; je les ai réservées tout
particulièrement pour toi et pour ma soeur, et je
désire que vous vous en serviez dans vos
réunions aux jours de fête. Prends garde
cependant que notre Africanus (sans doute quelque enfant de
la famille) n'en use avec trop de complaisance». La
mort de Sabine, en 137, est donc encore un crime dont il faut
décharger la mémoire d'Hadrien. Cette justice
n'aurait pas fait le compte des salons de Rome, où
avaient couru des médisances même contre Plotine
; où il en courra bien d'autres contre les deux
Faustine, et il est tout naturel qu'ils aient poursuivi
Hadrien dans sa vie privée, avec autant de
vérité sans doute qu'ils l'attaquaient dans sa
vie publique.

Aelius Verus Caesar |
Verus ne vécut que peu de temps après son adoption. Je me suis appuyé sur un mur croulant, dit Hadrien, et il chercha un autre successeur. Dion raconte qu'il convoqua au palais les plus considérés des sénateurs, et leur parla ainsi : «Mes amis, la nature ne m'a pas accordé de fils, mais vous m'avez permis par une loi d'en adopter un, sachant bien que souvent la nature donne au père un enfant estropié ou imbécile, tandis que, cherchant avec soin, on peut en trouver un qui soit aussi bien constitué de corps que d'esprit. C'est ainsi que j'avais d'abord choisi Lucius, qui était tel que je n'aurais pu espérer qu'il naquit de moi un fils pareil à lui. Puisque les dieux nous l'ont enlevé, j'ai choisi pour le remplacer un empereur d'une naissance illustre, doux et prudent, de commerce facile, que son âge met à distance égale des témérités de la jeunesse et des négligences des vieillards ; soumis aux lois et aux coutumes de nos aïeux, n'ignorant rien de ce qui concerne le gouvernement et résolu à user honnêtement du pouvoir. Je parle d'Aurelius Antoninus que voici. Bien que je sache sa profonde aversion pour la vie publique, j'espère qu'il ne refusera ni à moi ni à vous de se charger d'un pareil fardeau, et que, malgré son désir contraire, il acceptera l'empire». Ce sont là paroles de prince, et le choix était décidé par des raisons sérieuses. En cherchant cette scène dans Aurelius Victor, on verra ce que les anecdotiers font de l'histoire.

Antonin - Buste du Vatican |
Antonin n'était ni le parent ni l'ami
particulier du prince ; il fallut même lui laisser
quelque temps pour qu'il se décidât à
prendre ce qui n'était pour lui que des chaînes
dorées. Comme il n'avait plus de fils, Hadrien usa de
son autorité supérieure pour lui constituer une
famille légale : il lui fit adopter le fils du
César qui venait de mourir, et M. Annius Verus, dont
l'esprit supérieur et le grand caractère
l'avaient déjà frappé ; aussi se
plaisait-il à l'appeler, en jouant sur son nom, le
très véridique, Verissimus.
Ces choix réfléchis qui ont donné aux
Romains deux de leurs meilleurs princes et au monde un grand
homme, cette double adoption qui garantit l'empire, durant
deux générations, contre les révolutions
de caserne, ne sont pas d'un esprit étroit et jaloux.
Il faut admirer la prévoyance d'Hadrien et lui tenir
compte d'une vertu peu commune : il n'a pas craint de prendre
des successeurs qui pouvaient l'éclipser.
L'adoption de Verus avait fait des victimes, celle d'Antonin
ne fit que des mécontents, entre lesquels se trouva le
préfet de la Ville, Catilius Severus, qui
s'était préparé les voies à
l'empire. Le cas était grave, car Severus tenait Rome
par ses cohortes, le sénat par ses relations, et sa
dignité lui assurait en réalité le
premier rang dans l'empire après l'empereur. Les
récentes sévérités lui avaient
donné de la prudence ; ses menées
n'allèrent pas bien loin, et il en fut quitte pour
abandonner sa place, ce qui n'était pas d'une grande
rigueur. Mais cette indulgence n'étonnera que ceux
qui, sur de vagues accusations, croient à la
cruauté d'Hadrien.
Les affaires de l'Etat réglées, le prince
voulut terminer les siennes ; il souffrait cruellement et
demandait avec instance du poison ou une épée,
et, comme on les lui refusait, il se plaignit de n'être
pas libre de s'ôter la vie, quand il avait encore pour
les autres le pouvoir de donner la mort. Il mourut (10
juillet 138) en se moquant des médecins dont on ne rit
d'ordinaire qu'en santé ; quelques jours auparavant il
avait fait ces vers très dignes d'avoir Fontenelle
pour traducteur :
Ma petite âme, ma mignonne, |
Cette boutade était bien de l'homme qui, en
adoptant Verus, disait : Je vais faire un dieu ! Et
qui volontiers aurait dit avec Rabelais : Je vais chercher
un grand peut-être.
Nous croyons avoir mis dans son vrai jour la figure originale
de ce prince, et lui avoir restitué la physionomie que
ses maladroits biographes n'ont pas su tracer. Ainsi ce
pacifique, qui, durant un règne de vingt et un ans, ne
fit pas une seule guerre, est de tous les empereurs celui qui
maintint dans les légions la plus rigoureuse
discipline, et dans l'Etat la paix la plus profonde. Cet
Athénien à qui l'on ne passe point certain vice
dit temps, mais à qui l'on passerait volontiers un peu
de mollesse, était plus sobre que Caton. Ce voyageur
qui ne semble occupé que de la beauté des sites
et des monuments, ce philosophe qui se plaît aux
discussions d'école, regarde à tout :
administration civile, administration militaire, et en tout
il met un ordre excellent. Vaniteux, assure-t-on, il
dédaigna les titres et la pompe ; envieux de tous les
talents, il leur fournit plus d'occasions que nul autre de se
produire ; lettré irascible et jaloux, il honora les
lettres et pensionna les savants. Enfin, si l'histoire avait
le moyen de contrôler certains actes cruels qu'on lui
impute, elle n'aurait probablement à montrer en lui
qu'un justicier.
Par le monument de Lambèse, par Dion Cassius et
Spartien, nous savons ce qu'Hadrien demandait à ses
soldats ; par le Périple d'Arrien, ce qu'il
exigeait de ses capitaines ; par la
Poliorcétique d'Apollodore, ce qu'il attendait
de ses ingénieurs ; par les inscriptions, par les
médailles, ce qu'il s'imposait à lui-même
de sollicitude vigilante pour les provinces. Pausanias nous a
montré comment il embellissait les cités, et le
rempart Calédonien de quelle manière il
défendait les frontières. Les
sénatus-consultes conservés au Digeste
nous ont donné l'esprit de sa législation, et
le rescrit pour les chrétiens, un exemple de sagesse
politique. Enfin, en songeant qu'il fit en outre une
importante réforme de gouvernement et une codification
des lois romaines, il faut bien reconnaître en lui
l'activité féconde d'une intelligence
supérieure et non l'agitation stérile d'un
esprit inquiet.
Son règne marque, entre ceux d'Auguste et de
Constantin, le second âge de la monarchie
impériale, celui qui fut tout à la fois le plus
brillant et le plus heureux. Nous en avons la preuve dans ces
constructions qui se voient encore au désert de Syrie
et jusque dans les oasis africaines. Ces colonnades sans fin,
ces rues monumentales, ces restes de temples gigantesques, et
les ruines majestueuses de Palmyre, de Baalbeck, de
Gérasa, etc, qui sont de l'âge des Antonins, ont
été l'oeuvre d'un peuple heureux et riche.
«Après la grande terreur de l'an mil, dit un
écrivain du moyen âge, la confiance et la
sécurité revenant, on se mit partout à
rebâtir les basiliques, et le monde revêtit la
robe blanche des églises». Il en avait
été de même dans l'empire et par des
causes analogues. Cette floraison de l'art qui
s'épanouit en monuments splendides, des bords du
Rhône à ceux de l'Euphrate, c'est le produit de
la paix romaine. Depuis deux siècles, point de guerres
étrangères, ou du moins point
d'inquiétudes sérieuses sur les
frontières ; à l'intérieur, sauf les
désordres qui suivirent la mort de Néron, point
de guerres civiles ; dans les cités, point
d'émeutes. Docilement rattachée à
l'ordre social par les bénéfices de la
clientèle, à ses institutions municipales par
les habitudes de bienfaisance ou les
libéralités vaniteuses des riches, à
l'empire par le bien-être qu'elle devait au
développement de l'industrie, du commerce, des travaux
publics et de la colonisation, la populace ne songeait pas
à troubler la double aristocratie de naissance et
d'argent qui remplissait les charges, mais payait en
largesses la rançon de son pouvoir et de son orgueil.
Le règne d'Hadrien est le point culminant de cette
prospérité où, grâce à lui,
son successeur put retenir le monde ; et, contre l'habitude,
les contemporains, sinon à Rome du moins dans les
provinces, en eurent le sentiment et en conçurent de
la reconnaissance. Parmi les douze cents médailles que
l'on connaît d'Hadrien un grand nombre furent le
produit de flatteries officielles ; mais peut-on dire que
quelques-unes ne reflétaient pas l'opinion vraie des
populations, celles, par exemple, qui portent la
légende : Felicitati Aug. Sur l'une de ces
monnaies, Hadrien et la Félicité publique, tous
deux debout, se donnent la main ; sur une autre,
l'Allégresse, représentée par une belle
jeune femme, écarte de ses deux mains le voile qui lui
couvrait le visage, afin de laisser voir la joie du peuple
romain : gracieux symboles où tout n'était
point mensonge !
Hadrien aurait-il pu faire davantage ? Nous avons
reproché au premier empereur, alors qu'il était
le maître du jeu du monde, de n'avoir pas donné
à son empire la forme d'une pyramide
inébranlable, en le construisant par assises
superposées : à la base, les curies de ville
avec la liberté municipale ; au-dessus, les
assemblées de province avec des pouvoirs effectifs ;
plus haut, le sénat en rapport étroit avec
l'aristocratie provinciale et s'y recrutant ; au sommet,
l'empereur couvert et contenu par des institutions
monarchiques.
Hadrien pouvait encore accomplir ce qu'Auguste n'avait
osé entreprendre, et avec plus de facilité,
parce qu'il connaissait mieux les provinces, qu'il y avait
une popularité meilleure et qu'elles-mêmes
comptaient alors plus de citoyens romains. Mais il n'eut que
le vague sentiment de cette nécessité, et ses
institutions tendirent seulement à mettre dans le
gouvernement plus d'ordre et de justice, sans rien ôter
au pouvoir absolu, de sorte que, après comme avant
lui, la fortune de l'empire dépendra des
qualités ou des vices de l'empereur. Par ce
côté, Hadrien se confond dans la foule de ses
prédécesseurs, dont aucun n'avait su voir que
les peuples qui ont connu, ne fut-ce qu'un jour, la
liberté peuvent bien consentir à abandonner au
prince la puissance publique, lorsqu'ils reçoivent
l'ordre en échange, mais qu'ils se
désaffectionnent, lorsqu'il faut remettre en ses mains
jusqu'à leurs intérêts de cité et
de province. Aussi l'indifférence des populations
succédera bientôt à leur amour ; et,
quand viendront les jours de malheur, elles n'auront pas plus
de dévouement que de force pour défendre un
empire qui, après avoir pris leur liberté
politique, finira par prendre leur liberté
civile.
Cependant l'on ne peut exiger d'un homme qu'il ait
été un puissant réformateur ; et l'on
reste juste, en se bornant à examiner comment il a
vécu dans le milieu où il se trouvait
placé, quel parti il a su tirer des circonstances que
l'histoire avait produites. A ce compte, malgré son
idéal imparfait de gouvernement, Hadrien restera un
grand prince. Et si l'on me demandait quel empereur a fait le
plus de bien, quel méritait le plus d'être
imité, je répondrais : Ce prince intelligent et
ferme, sans lâches complaisances envers les soldats et
le peuple, qui avait de la tolérance pour les
idées et n'en avait pas pour les abus ; qui fit
régner la loi et non l'arbitraire ; qui constitua une
armée formidable, non pour d'inutiles conquêtes,
mais afin que, derrière cet inexpugnable rempart, le
génie de la paix fécondât toutes les
sources de la richesse publique ; qui, enfin, aussi
prévoyant à la dernière heure qu'il
avait été habile durant son règne,
assura au monde romain deux générations
d'excellents chefs. Quand la gloire des princes se mesurera
au bonheur qu'ils ont donné à leurs peuples,
Hadrien sera le premier des empereurs romains.