LXXXI - Antonin et Marc-Aurèle (138-180) |
I - ANTONIN (138-161)
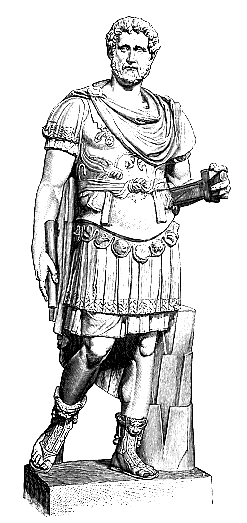
Antonin le Pieux - Vatican |
«J'aurais souhaité, dit un de nos vieux
chroniqueurs, qu'il me fût échu en partage
une éloquence pareille à celle des anciens
; mais on puise difficilement à une source dont
les eaux tarissent. Le monde se fait vieux, la pointe de
la sagacité s'émousse, et aucun homme de
cet âge ne saurait ressembler aux orateurs des
temps passés». Cette tristesse conviendrait
aux compilateurs de l'Histoire Auguste, car ils
n'ont ni la flamme qui échauffe et éclaire,
ni le patient courage de ceux qui savent au moins amasser
des matériaux pour de plus habiles. La biographie
d'Antonin le Pieux par Julius Capitolinus est encore plus
maigre que celle d'Hadrien par Spartianus. Elle enferme
en quelques pages l'histoire d'un règne de
vingt-trois ans, et nous réduit à dire de
cet empereur ces seuls mots, qui sont assez pour sa
gloire, mais trop peu pour notre curiosité :
transiit benefaciendo, il a passé en
faisant le bien. |
Après sa mort, le sénat, insensible aux
prières du nouveau prince, refusa de décerner
à Hadrien les honneurs de l'apothéose, tant il
était affligé de la perte d'un si grand nombre
de ses membres ! Mais lorsqu'il vit reparaître tout
à coup ceux dont il déplorait le trépas,
chacun, après avoir embrassé ses amis, finit
par accorder ce qu'il avait refusé d'abord».
Voilà les contes bleus que la malignité avait
fait circuler, que la sottise acceptait, et qui nous donnent
la mesure du respect dû à de pareils
esprits.

Faustine I, épouse d'Antonin le Pieux |
Les ancêtres d'Antonin, originaires de Nîmes, avaient exercé à Rome les plus hautes charges et s'y étaient fait remarquer par la dignité de leur vie. Cinq fois les faisceaux consulaires avaient été portés dans sa maison, et l'on disait de son père qu'il était un homme intègre et de moeurs pures, de son aïeul qu'on n'aurait pas su trouver un reproche à lui faire, homo sanctus. Ce dernier, Arrius Antoninus, était cet ami de Nerva qui plaignait le vieux consulaire d'échanger une condition paisible contre celle d'empereur. Antonin hérita de ces vertus et de cette modération. Il fut consul (120), proconsul d'Asie (128 ou 129), juge (judex) d'une des quatre provinces italiennes et membre du consistoire impérial, fonctions qui prouvent que depuis longtemps l'attention d'Hadrien s'était arrêtée sur lui. Sa femme, la première Faustine, lui avait donné quatre enfants, dont deux fils, morts avant son avénement. De ses deux filles, il perdit l'une durant son proconsulat d'Asie ; l'autre fut la seconde Faustine, qui épousa Marc-Aurèle. |
Bon ménager de son patrimoine, Antonin
augmenta sa fortune par l'économie, non par l'usure,
car il prêtait au-dessous du taux légal ; il
l'employa à aider ses amis, bien plus qu'à ses
plaisirs, et, une fois prince, il en consacra les revenus aux
besoins de l'Etat. A son avénement, il refusa
l'aurum coronarium, que l'Italie voulait lui donner,
et ne prit que la moitié de ce que les provinces lui
offrirent ; de sorte qu'il fut obligé de
prélever sur son propre bien une partie des
gratifications dues, dans cette circonstance, aux soldats et
au peuple. Il avait du goût, de l'éloquence, et
gouvernait son esprit comme sa maison en maître qui
voulait que tout y fût bien rangé. Il
écoutait beaucoup, délibérait longtemps,
et, la décision prise, y persistait avec
fermeté ; on n'administre bien qu'à cette
condition. Il estimait la popularité ce qu'elle vaut,
n'agissait qu'en vue du devoir, et s'inquiétait peu du
reste : c'était un sage.
Il avait cependant un défaut fâcheux pour un
prince, il s'arrêtait aux petites choses : il aurait
voulu couper en quatre un grain de cumin, et on
prétendait qu'il était avare ; mais ce sont de
mauvaises langues qui le disent, et ces propos ne furent
peut-être que la rançon de sa bonne
renommée. Au consilium il opinait toujours pour
les résolutions les plus douces, et, durant son
règne, il garda cette disposition à faire
grâce : vertu royale, quand il s'agit de pardonner une
offense au prince, mais dangereuse si cette bonté
affaiblit l'autorité de la loi. Comme tous ceux que
nous appelons les Antonins, il vécut moins en empereur
qu'en riche particulier, souffrant la liberté de
parole de ses amis, même les violences du peuple.
Durant une disette la foule lui jeta des pierres, il
répondit par un discours. Il admirait, chez un de ses
familiers, certaines colonnes et demanda d'où elles
venaient : Quand tu entres dans la maison d'autrui, sois
muet et sourd, répondit l'autre brutalement, et
l'empereur ne s'en fâcha point.
Arrivant à Smyrne, sous le règne d'Hadrien,
comme proconsul, il descendit chez le rhéteur
Polémon, alors absent ; la nuit venue, le sophiste
rentra et fit un tel bruit des embarras qu'on lui causait,
qu'Antonin déguerpit sur l'heure. A quelques
années de là, un acteur vint se plaindre de ce
que Polémon, président des jeux Olympiques,
l'avait chassé du théâtre en plein jour.
Et moi, dit le prince, il m'a bien chassé en
pleine nuit. Une autre fois, les courtisans s'indignaient
de voir Marc-Aurèle pleurer son précepteur mort
; il les en reprit vivement : Permettez-lui d'être
homme, leur dit-il, car la philosophie ni l'empire ne
doivent dessécher le coeur. Plus d'une fois on
l'entendit répéter qu'il voulait se conduire
avec le sénat comme il avait désiré,
étant sénateur, qu'on se conduisît avec
lui : pensée qui semblait l'annonce du grand principe
moral qu'Alexandre Sévère inscrira sur les murs
de son lararium : Ne fais pas à autrui ce que tu ne
voudrais pas qu'on te fît à
toi-même.
Nous aurions à raconter beaucoup d'actes de sa
munificence, beaucoup de libéralités faites par
lui à des particuliers, au peuple de Rome, aux
cités des provinces, qu'il secourut ou embellit ; nous
voyons en effet, par quantité d'inscriptions, qu'il
suivit l'exemple de son prédécesseur. Tout cela
est d'un excellent naturel, et sur ce point il n'y a pas
à lui marchander les louanges ; mais le prince fut-il
au niveau de l'homme ? La réponse est difficile ; car,
si les éloges unanimes qu'il a reçus pour ses
qualités de coeur nous permettent de lui donner, au
milieu des païens, la place de saint Louis parmi nos
princes, son histoire politique est si obscure, qu'il se
présente à nous, comme chef d'empire, avec une
figure à demi effacée, dont les contours se
perdent dans l'ombre.
Il avait cinquante-deux ans, l'âge qui donne la pleine
maturité, sans ôter encore l'activité et
la force. L'activité d'Hadrien avait paru quelquefois
inquiète et bruyante ; celle d'Antonin fut silencieuse
et discrète. Son prédécesseur
était toujours en course ; durant près d'un
quart de siècle, il ne quitta pas un jour Rome ou ses
environs, excepté pour un rapide voyage en Asie. Au
belliqueux Trajan avait succédé un pacifique ;
l'empereur nomade fut remplacé par un prince
sédentaire. C'est la loi des contrastes, qui
plaît aux peuples comme aux artistes. Quelques
inconvénients d'un régime en masquent, aux yeux
de la foule, les avantages, et on se jette dans un autre
système par la seule raison qu'il plait de
changer.
Hadrien était mort fort impopulaire au sénat ;
on a vu que les reproches qui lui sont faits viennent de la
sourde irritation des Pères contre un prince dont la
cour errante portait loin d'eux l'éclat et la
réalité du gouvernement, de sorte que le
néant de leur autorité n'était
même plus caché derrière des apparences.
Ils voulaient lui refuser l'apothéose,
c'est-à-dire le déclarer tyran et annuler ses
actes. Antonin refusa de se faire le complice de cette
iniquité, qui d'ailleurs eût infirmé ses
droits. Ses prières n'auraient peut-être pas
triomphé du mauvais vouloir de ces sénateurs
petitement haineux et jaloux, si, derrière le prince
débonnaire, ils n'avaient aperçu un orateur
bien autrement persuasif, le soldat, qui n'entendait pas
qu'on fit cet outrage à la mémoire du chef
qu'il avait aimé. Suivant Dion, toute opposition tomba
devant la crainte de l'armée. Hadrien fut donc mis au
rang des dieux ; Antonin lui éleva un temple à
Pouzzoles, lui donna des flamines, et institua en son honneur
un concours quinquennal. L'apothéose et le temple
étaient pour le prince défunt affaires
d'étiquette impériale. Ces honneurs rendus
à la mémoire d'Hadrien ne méritaient
donc pas au nouvel empereur que les sénateurs lui
décernassent le surnom de Pius, mais comme ils
avaient usé avec les autres toutes les
épithètes de louange, ils ne trouvèrent
que celle-là qui fût restée disponible ;
et puis le prince ne s'étant pas associé
à leur haine contre Hadrien, ils s'associaient, en lui
donnant ce titre, à son respect filial. Ces volte-face
bien réussies, cette habile stratégie
d'antichambre, étaient tout l'art qui restât aux
descendants des grands généraux de Rome,
devenus les plus intrépides des courtisans.
Durant ce règne de vingt-trois ans, l'empire jouit
d'une paix profonde, et les sujets reconnaissants
regardèrent l'Etat comme une grande famille
gouvernée par le meilleur des pères. Un
contemporain, Pausanias, voulait que l'empereur fût
appelé le Père du genre humain.
Dans son désir d'éviter tout bruit, tout
mouvement qui dérangeât le bel ordre mis dans
l'empire par son prédécesseur, il reprit la
règle de Tibère pour la longue durée des
magistratures, mais en l'exagérant. Il conserva leurs
fonctions à ceux qui les tenaient d'Hadrien ; quand il
eut de nouveaux choix à faire, il n'éleva aux
charges que des hommes expérimentés, et
souvent, dit son biographe, il les laissa mourir dans leur
place. Ainsi, son ami M. Gavius Maximus commanda pendant
vingt années les cohortes prétoriennes ;
Orfitus garda la préfecture de la Ville tant qu'il lui
plut et ne fut remplacé que sur sa demande ; des
gouverneurs restèrent sept ans, même neuf
années dans leur gouvernement. P. Pactumeius Clemens,
légat de Cilicie sous Hadrien, fut élevé
au consulat, et maintenu néanmoins dans son
commandement. L'empereur avait changé le rang officiel
de la province plutôt que de ne pas y laisser le
magistrat qui connaissait le mieux ses besoins. Cette
politique était excellente, à la condition
pourtant de ne pas aller trop loin dans cette voie, car le
plus actif s'alanguit dans des fonctions toujours les
mêmes ; comme la vie s'éteint au milieu des eaux
dormantes, l'administration où l'on n'entretient pas
une certaine action de renouvellement arrive bien vite
à la sénilité. Le règne d'Antonin
nous en fournira peut-être la preuve.
Le droit civil lui doit beaucoup, et les Pandectes
renferment plusieurs fragments de ses constitutions ou
rescrits. Une est célèbre sous le nom de
quarte Antonine ou réserve établie en
faveur de l'adopté sur les biens de l'adoptant. En
preuve de son esprit libéral, on mentionnera encore la
décision qui permit aux enfants d'un nouveau citoyen,
lorsqu'ils n'optaient point pour la nationalité de
leur père, de conserver leurs droits sur son
héritage. Auparavant, le Grec, obtenant le jus
civitatis et dont les enfants restaient provinciaux,
était obligé de léguer sa succession
à des citoyens ou de la laisser au fisc, comme bien
tombé en déshérence. Des publicains
avaient exercé le droit d'épaves. Je suis le
seigneur du monde, répondit-il aux
naufragés qui réclamaient contre cette
cruauté ; mais il y a une loi de la mer, celle que
les Rhodiens ont faite ; qu'on décide d'après
elle. Et le fisc eut tort. Par un rescrit d'application
difficile, mais très juste dans son esprit, il
n'autorisa le mari à poursuivre sa femme comme
adultère qu'autant que lui-même avait
gardé la fidélité conjugale. La
condition des esclaves fut encore adoucie. Antonin
déclara que le maître qui, pour un motif
frivole, tuait son esclave serait puni de la
relégation ou de la mort ; que celui qui l'aurait
maltraité outre mesure serait forcé de le
vendre, et qu'il ne pourrait ni le racheter ni écrire
au contrat une clause qui lui permît de le poursuivre
de sa colère jusque dans la servitude d'autrui, telle
que celle-ci : Défense de l'affranchir ; ou
cette autre : Il, ou elle, sera livré à la
prostitution. Un de ses rescrits porte : «Il est de
l'intérêt des maîtres qu'un appui contre
la faim, la cruauté et une intolérable
injustice ne soit pas retiré aux esclaves qui
l'implorent justement».
Dans l'administration financière, il retrancha les
dépenses inutiles, les pensions servies à des
gens qui rongeaient l'Etat sans lui rendre aucun service ; il
vendit des villas du domaine impérial, des bijoux, des
meubles précieux : capital mort, dont il fit
bénéficier le trésor public ; comme
Hadrien il accorda encore la remise des
arriérés d'impôts, et Marc-Aurèle,
Aurélien, feront comme lui. Son économie lui
donna les moyens de développer l'institution
alimentaire et de venir au secours de villes
désolées par l'incendie ou par un tremblement
de terre, comme Rome, Antioche, Narbonne et Rhodes. Je ne
parle point des constructions faites par lui ou sous son
règne dans la Grèce et l'Ionie, dans la Syrie
et à Carthage, à Lambèse, dont plusieurs
monuments datent de cette époque, à Tarragone
pour son port, à Gaëte pour son phare, à
Nîmes pour les Arènes et le pont du Gard,
à Baalbek pour son temple du Soleil.
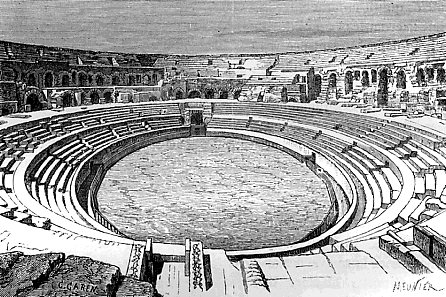
Intérieur des arènes de Nîmes |
Tous les empereurs étaient de grands
bâtisseurs. C'était une dette qu'ils payaient
dans Rome, au peuple entier, en décorant la
cité de monuments nouveaux ; aux pauvres, en leur
donnant du travail ; à leur
prédécesseur, en lui élevant le temple
exigé par l'apothéose ; dans les provinces,
c'était la condition de leur popularité. En
outre, chaque empereur, comme les princes d'Orient, voulait
avoir sa demeure vierge de tout souvenir. Ainsi Néron
avait délaissé le palais des Césars ;
Vespasien détruisit la Maison d'Or, et Antonin
ne voulut point habiter la villa Tiburtine. L'âge des
Antonins fut un temps de fête pour les architectes, car
on démolissait incessamment pour reconstruire. Mais il
faut répéter que, hors de Rome, les travaux
étaient surtout l'oeuvre des riches cités,
où ils étaient payés avec les revenus
municipaux, les dons des citoyens, et souvent une subvention
impériale. Cette observation est d'autant plus
nécessaire pour ce règne, que
Marc-Aurèle dit de son père adoptif qu'il
n'aimait point à bâtir.
Comme Hadrien, Antonin créa de nouvelles chaires de
rhétorique et de philosophie dans beaucoup de villes,
en allouant aux titulaires un traitement qui leur fut
payé par l'Etat, quand les ressources locales se
trouvèrent insuffisantes. A l'argent il ajouta des
honneurs : dans les petites villes, cinq médecins,
trois sophistes et trois grammairiens ; dans les grandes, dix
médecins, cinq sophistes et cinq grammairiens furent
exemptés des charges municipales ; et il couronna la
déclamation même en donnant, dans l'année
143, le consulat à deux rhéteurs fameux, le
Grec Hérode Atticus et le Latin Cornelius Fronto. Mais
les poètes ne lui paraissaient pas aussi
nécessaires ; du moins, il réduisit la pension
qu'Hadrien avait faite au poète lyrique
Mésomède.
Il se trouva pourtant des sénateurs pour conspirer
contre ce prince qui faisait de la félicité
publique l'unique objet de son gouvernement. Cette fois on ne
doute plus, comme sous Hadrien, de la réalité
du crime ; les Pères, qui, par eux-mêmes ou par
leurs affranchis transformés en historiens, faisaient
dans la postérité la réputation des
princes, admettent pour le favori du sénat un
péril dont ils avaient nié l'existence pour
l'ami des provinciaux. Il n'y eut pas d'exécution :
Atilius Titianus en fut quitte pour la perte de ses biens ;
Priscianus se tua lui-même ; Avidius Cassius, qui se
révolta sous Marc-Aurèle, eut au moins le
désir de renverser Antonin ; Celsus enfin, que nous ne
connaissons pas, fit quelque entreprise sérieuse,
puisque, vingt, ou trente ans après, la seconde
Faustine en rappelait le souvenir à son époux.
Le sénat mettait un grand zèle à
rechercher les coupables, Antonin l'arrêta. Que
gagnerai-je, répondit-il à ceux qui le
pressaient de sévir, que gagnerai-je à ce
qu'on sache qu'un certain nombre de mes concitoyens me
haïssent ?
Antonin n'aimait pas la guerre. Mieux vaut, disait-il,
sauver un citoyen que tuer mille ennemis. Il
n'entreprit par lui-même aucune expédition, mais
ses lieutenants eurent à livrer des combats
défensifs : en Afrique, contre les nomades, sur la
frontière des Carpates et du Danube, contre des Daces
réfugiés dans les montagnes, et contre des
peuplades germaines établies au voisinage de la
Pannonie. Capitolin dit que les Juifs firent encore quelque
émeute, et qu'il y eut des rébellions en Egypte
et en Grèce. Une émeute en Grèce, au
lendemain d'Hadrien, se comprend mal, à moins qu'il ne
s'agisse d'une conspiration, celle de Celsus par exemple,
dont nous ne savons ni le lieu ni la date, ou de quelque
tumulte populaire auquel Lucien semble faire allusion (157) ;
et une révolte des Juifs aurait été, ce
semble, bien difficile, après tout le sang que Trajan
et Hadrien avaient tiré à ce peuple. En Egypte,
l'affaire fut plus sérieuse, puisque le préfet
Dinarchos fut tué (147-8), et que, au dire d'un
ancien, l'empereur se crut obligé de faire le voyage
d'Orient : ce fut la seule fois qu'il quitta Rome pour aller
plus loin que la Campanie.
Dans la Bretagne, Lollius Urbicus, qui s'était
distingué en Judée sous Hadrien, réprima
les Brigantes (140), et, se trouvant à l'étroit
derrière le Vallum Hadriani, reporta la ligne
des défenses de la province plus au nord, jusqu'au
rempart d'Agricola, le Graham's dike, levée de terre
gazonnée, courant entre les deux golfes de la Clyde et
du Forth. En récompense, Lollius obtint plus tard la
première charge de l'Etat, celle de préfet de
la Ville. Les Parthes préparaient une
expédition contre l'Arménie, une lettre
d'Antonin les arrêta.
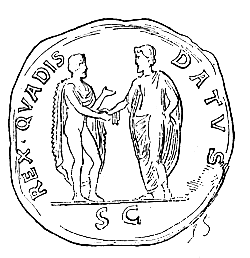
Antonin donne la main
|
Les Lazes, les Quades, les Arméniens, acceptèrent les rois qu'il leur donna ; sa protection couvrit les Grecs des bords de l'Euxin contre les Scythes du voisinage et l'Arménie contre les brigandages des Alains.
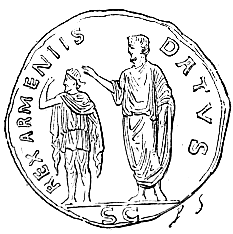
Antonin pose la tiare sur la tête
|
Appien raconte qu'il vit à Rome les
députés de peuplades barbares qui demandaient
à être reçues au nombre des sujets de
l'empire ; Antonin refusa : c'était la politique
d'Auguste et d'Hadrien. Il y vint aussi des ambassades de la
Bactriane et de l'Inde : preuve que les relations de commerce
avec ces régions lointaines continuaient.
En somme, les guerres sous Antonin furent sans importance et
les émeutes sans périls. «Alors, dit son
biographe, toutes les provinces étaient
florissantes... et aucun prince ne fut autant respecté
des Barbares». Un contemporain, le rhéteur
Aristide, montre quelle confiance inspirait cette longue paix
: «Le continent tout entier est en repos, et l'on ne
croit plus à la guerre, même lorsqu'elle
sévit sur quelque point
écarté».
Plus respectueux qu'Hadrien envers les vieux usages et les
antiques légendes, il croyait trouver un
intérêt de conservation sociale en des choses
où son prédécesseur n'avait vu qu'un
intérêt de curiosité sceptique. Il
essayait comme Auguste de ranimer le patriotisme expirant, en
remettant à la mode les origines merveilleuses du
peuple romain ; quelques-unes de ses monnaies
représentent la fuite d'Enée, la fondation
d'Albe, Mars et Rhéa, Romulus et les premières
dépouilles opimes, Horatius Coclès
défendant le pont du Janicule, ou Esculape arrivant
dans l'île du Tibre sous la forme d'un serpent
(Glycon).
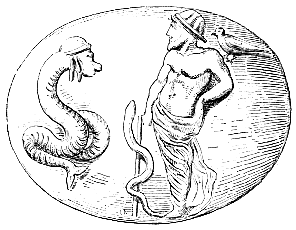
Esculape et Glycon |
Pour raffermir les dieux sur leurs autels
chancelants, il remplissait scrupuleusement ses fonctions
pontificales, ramenait aux temples la foule avide de
spectacles et méritait que les Pères,
abusés par ces apparences de restauration religieuse,
fissent graver une inscription avec ces mots : Le
sénat et le peuple romain au très bon,
très grand et très juste prince Antonin
Auguste, ob insignem erra caerimonias publicas curam ac
religionem. En même temps, il essayait
d'arrêter le progrès des conversions juives, par
le renouvellement des peines édictées sous
Vespasien contre ceux qui pratiquaient la circoncision sur
des hommes étrangers à la race
hébraïque.
En lui voyant cette disposition d'esprit, on pourrait
craindre qu'il n'eût cruellement traité les
chrétiens. Il n'en fut rien. Il suivit, à leur
égard, la politique de son père adoptif et leur
accorda une tolérance de fait, qui fut pourtant
troublée, de loin en loin, par quelque magistrat trop
zélé, frappant une victime impatiente de
mourir. Quant au rescrit qu'Eusèbe a mis sous son nom,
on ne peut le recevoir, au moins dans sa forme actuelle,
comme authentique. Il est certain que ce prince et son
prédécesseur n'ont jamais songé à
donner droit de cité dans l'empire à la
religion nouvelle ; mais ils n'auraient pas voulu davantage
la persécuter. L'un par indifférence
philosophique, l'autre par bonté de coeur,
répugnaient à verser le sang pour des
croyances. Sous le règne d'Antonin, dit Orose, la paix
régna dans l'Eglise.
A cette époque, la foi trouva un habile et hardi
défenseur. Saint Justin représente dans
l'histoire de l'empire le moment décisif où le
christianisme, qui, avec saint Paul, avait professé
l'impuissance de la raison, et qui, avec les premiers
successeurs des apôtres, vivait dans l'ombre et le
mystère, sort au grand jour et revendique hautement
ses droits comme doctrine rationnelle. Alors ce qu'on
appelait dédaigneusement la religion des esclaves et
des femmes, des enfants et des vieillards, s'affirme, non
seulement devant le bourreau, mais devant la science, et
s'efforce d'absorber en soi la sagesse païenne
purifiée par la nouvelle
révélation.
Saint Justin était un Grec de Palestine qui avait
traversé tous les systèmes de philosophie avant
d'arriver au christianisme, et qui a raconté
lui-même, dans un dialogue à la manière
de Platon, non sans grâce, les diverses étapes
de son esprit. Il ne brûle pas, comme tant d'autres, ce
qu'il avait adoré. Le christianisme, pour lui, est une
philosophie nouvelle, plus sûre, plus utile que
l'ancienne, mais il ne renie pas celle qui l'a
précédée. «Socrate, dit-il, avait
été une incarnation du Logos, ou raison
divine répandue dans l'humanité, logos
spermatikos, car toute intelligence en contient une
parcelle. Le Christ en fut une autre plus complète,
puisqu'il est la Vérité absolue. Lorsque le
maître de Platon tenta, avec la force de la
vérité, d'enlever les hommes aux démons,
ceux-ci le firent tuer comme impie et athée. Ils l'ont
de même contre nous. Athées, nous le sommes
contre vos dieux, mais non contre le Dieu véritable,
le Père de toute vertu que nous adorons, avec le Fils
qu'il nous a envoyé pour nous instruire, avec
l'armée des bons anges, ses satellites, et l'Esprit
prophétique. Vos anciens ont enseigné certains
dogmes que nous exposons d'une manière plus divine, et
dont seuls nous prouvons la vérité. Nous
disons, comme Platon, que Dieu a tout produit et tout
ordonné ; comme les stoïciens, que le monde
périra dans les flammes ; comme vos poètes et
vos philosophes, que les bons seront
récompensés et les méchants punis. Quand
nous appelons Jésus-Christ le Logos divin, la
Raison de Dieu, nous ne faisons que lui appliquer la
dénomination donnée à Mercure... Si on
dit qu'il a été crucifié, en cela
même il ressemble à ceux des fils de Jupiter
qui, selon vous, ont eu des tourments à souffrir ;
qu'il est né d'une Vierge, il a cela de commun avec
Persée ; qu'il guérissait les boiteux, les
paralytiques, les infirmes, et ressuscitait les morts, c'est
ce que vous racontez d'Esculape... Tous ceux qui ont
vécu d'une manière conforme à la raison
sont chrétiens. Tels furent, chez les Grecs, Socrate,
Héraclite et ceux qui leur ressemblent, comme de notre
temps Musonius, et, chez les Barbares, Abraham, Ananias,
Mizaël, Elie et beaucoup d'autres.
Le christianisme était donc l'achèvement et non
la contradiction de la révélation
naturelle.
Saint Justin se défend, mais aussi il attaque. Aux
dieux incestueux et adultères du paganisme il oppose
celui des chrétiens, et aux scandaleuses leçons
de leur histoire ses saints commandements. En face de la
vieille société légalisant ses vices par
l'impôt qu'elle en tire et dressant des autels à
Antinoüs, il met la société nouvelle qui,
au lieu de têtes impures et de sacrifices sanglants, a
pour culte la prière, l'aumône, le baiser de
paix, la communion fraternelle avec le pain et le vin ; puis
il s'écrie : Cessez donc d'imputer à des
hommes purs vos débauches et celles de vos dieux
!
Comme prédication aux pauvres, aux opprimés,
mieux eût valu l'Evangile ; comme plaidoirie devant un
tribunal païen, la défense était habile
sans manquer de vérité ni de grandeur. On
trouve même dans les premiers mots de cette supplique
la mâle intrépidité d'un homme qui
acceptait le combat avec les maîtres du monde :

Antonin - Buste du musée de Naples |
A L'EMPEREUR TITUS AELIUS ANTONIN,
PIEUX, |
Cette façon de supplier, ce mot
emprunté aux stoïciens, mais qu'il retrouvait
dans son âme virile : Vous pouvez nous tuer ; vous
ne pouvez nous nuire, étaient d'un croyant
résolu à donner sa vie pour sa foi et qui la
donnera.
Depuis Trajan, le christianisme avait pris assez d'importance
pour que la première Apologie de saint Justin
ait pu parvenir à l'empereur, sans le
déterminer cependant à violer les lois de
l'empire, dont il avait la garde, par la publication d'un
édit de tolérance. Les chrétiens
restèrent donc exposés aux violences de la
populace dans les villes où ils montraient trop de
zèle contre les idoles, trop d'ardeur pour le martyre,
et, sous ce prince débonnaire, des chrétiens
périrent. Une lettre des fidèles de Smyrne aux
églises d'Asie, qu'Eusèbe a conservée,
est la vivante peinture d'une de ces scènes
abominables et sublimes. Un homme de Phrygie, de ce pays on
Cybèle exigeait des dévotions sanglantes,
Quintus, décida quelques Smyrniotes et Philadelphiens
à provoquer leur supplice pour jouir plus tôt
des béatitudes éternelles. Ils étaient
douze et montrèrent un courage héroïque au
milieu de tourments atroces que les bourreaux
s'ingénièrent à varier. Un d'eux,
Germanicus, se signala entre tous par son mépris des
tortures. Le proconsul répugnait à frapper des
hommes qui ne lui paraissaient coupables que
d'entêtement religieux ; il aurait voulu les sauver :
Aie pitié de ta jeunesse, disait-il à
Germanicus ; et lui, avide de la mort, irritait les
bêtes pour être plus vite mis en pièces.
Au moment du combat, le Phrygien trembla et renia sa foi. Il
manquait une victime à la joie du peuple, ou cria
qu'il fallait remplacer Quintus par Polycarpe. C'était
un vieillard de quatre-vingts ans et le plus illustre des
évoques d'Asie. Le gouverneur impérial qui le
connaissait bien ne l'avait jamais inquiété, et
il avait pu, sans cacher sa foi, atteindre à ce grand
âge. Il ne croyait pas qu'on dût chercher le
martyre ; au moment où avait éclaté la
fureur populaire, provoquée par les
témérités de Quintus, il avait
quitté la ville et s'était retiré dans
une maison écartée. Ou alla l'y prendre ; il
aurait pu fuir encore, mais ne le voulut pas. Le proconsul
essaya longtemps d'arracher un mot qui lui permit de
l'épargner : Jure, lui dit-il, par la
fortune de César ; dis : Otez du monde les impies, et
je te renverrai absous, et lui, répondait : Je
suis chrétien, si tu veux connaître ma religion,
donne-moi un jour : je t'en informerai. Le proconsul
ayant répliqué que c'était le peuple
qu'il fallait convaincre, Polycarpe répondit : Je
ne refuse pas de t'instruire, toi, parce que j'ai appris
à rendre aux hommes en dignité l'honneur qui
leur est dû, mais cette tourbe ne mérite pas que
je me défende devant elle.
Comme le peuple demandait qu'on jetât aux lions cet
ennemi des dieux qui voulait abolir leur culte et leurs
sacrifices, le gouverneur objecta que cela ne lui
était pas permis, parce que les jeux étaient
terminés. Alors, au bûcher ! hurla la
foule, et elle courut chercher du bois aux bains, aux
boutiques, puis elle dressa le bûcher pendant que le
vieillard se déshabillait tranquillement pour y
monter. Quand le feu eut été mis, le vent
emporta derrière lui la flamme, qui s'arrondit en
voûte au-dessus de la tête du martyr,
«ainsi qu'il enfle la voile d'un vaisseau ; et il nous
sembla voir comme de l'or ou de l'argent
éprouvé dans la fournaise. En même temps
nous sentions une agréable odeur de parfum
précieux». Le bourreau l'acheva d'un coup
d'épée.
La procédure établie par Trajan : S'ils sont
accusés et convaincus, qu'ils soient punis, avait
été suivie. Le gouverneur n'en avait point
référé à Rome et n'avait pas eu
besoin de le faire. Le peuple avait crié : Les
chrétiens aux lions ! et les chrétiens
s'offrant d'eux-mêmes à satisfaire la joie de la
foule, leur sang avait rougi l'arène.
Au dire de Justin, de pareilles scènes eurent lieu en
divers points de l'empire. Son Apologie ferait croire
à plus de supplices qu'il n'y en eut, car
l'exagération est un des caractères de ce genre
d'écrits. Mais il est certain que la haine contre les
blasphémateurs des dieux croissait dans le peuple,
avec leur nombre ; que la foi, plus confiante, devenait
téméraire, et que les officiers
impériaux doivent avoir eu la main forcée, plus
que ne l'auraient voulu des administrateurs intelligents et
sceptiques, peu préoccupés de Jupiter et
beaucoup de la paix publique.
L'empereur sut-il quelque chose de ces lointaines affaires ?
On peut en douter ; il n'est pas même sûr qu'il
ait connu dans les dernières années de son
règne l'exécution du Grec
Ptolémée et de deux autres chrétiens,
ordonnée par le préfet de Rome.
C'étaient de petites gens, qu'on n'avait point
recherchés et qui s'étaient encore
livrés eux-mêmes. Leur sort n'intéressait
personne, et, dans ce monde si dur, si prodigue de la vie
humaine, un supplice n'était point un spectacle assez
rare pour qu'il ait fait quelque bruit dans la ville.
Aux coups qui les frappaient les chrétiens
répondaient par de sourdes et irritantes menaces. La
Sibylle n'accordait à Antonin que trois successeurs et
annonçait, pour l'année 495, la destruction de
Rome, de l'Italie et de l'empire : «Oh ! Comme tu
pleureras alors, dépouillée de ton brillant
laticlave et revêtue d'habits de deuil, ô Rome
orgueilleuse, fille du vieux Latinus ! Tu tomberas pour ne
plus te relever. La gloire de tes légions aux aigles
superbes disparaîtra. Où sera ta force ? Quel
peuple sera ton allié parmi ceux que tu as asservis
à tes folies ?» A voir tant de haine
amassée des deux parts, on comprend qu'entre
l'ancienne et la nouvelle société il
s'était creusé un abîme où des
victimes devaient tomber.
Si nous savons mal ce que fit Antonin comme empereur, nous
savons bien ce que firent après lui les ennemis de
l'empire ; alors une question se pose : Antonin ne doit-il
pas être rendu responsable d'une partie des malheurs de
Marc-Aurèle ? Son père adoptif lui avait
préparé, par la forte discipline mise en tout,
un règne paisible, n'a-t-il pas légué
à son successeur beaucoup de périls par la
douceur d'une administration qui, n'aimant pas à
punir, fermait les yeux et laissa tout se relâcher ? En
trouvant après lui les légions sans discipline,
les frontières sans sécurité, les
Parthes redevenus audacieux, les Barbares franchissant
à la fois le Rhin, le Danube, les Alpes, et arrivant
jusqu'à Aquilée sur la route de Rome,
jusqu'à Elatée, au coeur de la Grèce, on
a le droit de penser qu'Antonin avait été trop
amoureux de son repos, trop appliqué, pour complaire
au sénat, à tenir une conduite
différente de celle qu'avait eue son
prédécesseur. Jamais les Barbares ne le virent
longeant lentement les frontières pour s'assurer que,
du côté de Rome, elles étaient bien
gardées et que, de l'autre, il ne se formait point
parmi eux d'associations menaçantes qui dussent
être combattues par la politique ou les armes. Jamais
il ne vint au milieu des légions examiner d'un oeil
attentif leurs besoins et leur discipline, se mêler
à leurs exercices, entretenir par sa présence
leur vertu guerrière. Inactives derrière les
remparts de leurs camps, elles ne savaient plus manier les
armes ni supporter les fatigues, et il faudra la
sévérité cruelle d'Avidius Cassius pour
arracher les soldats à leur mollesse, pour les
déshabituer des bains et des voluptés
dangereuses de Daphné, pour faire tomber de leurs
têtes les fleurs dont ils se couronnaient dans les
festins.
Antonin arrivait à un grand âge : il avait
dépassé soixante-quatorze ans, et, sans
être pris d'aucun mal, ses forces diminuaient. Aussi
faisait-on dans les temples des prières pour sa
santé. Lyon conserve un monument destiné
à rappeler qu'on y avait accompli, trois mois avant la
mort du prince, le grand sacrifice expiatoire de ce temps, un
taurobole. En mars 161, une fièvre de trois jours
l'emporta. Au moment d'expirer, il donna pour mot d'ordre au
tribun des gardes : Patience et résignation,
Aequanimitas. C'était quitter la vie en
philosophe, mais ne se peut-il pas qu'Antonin ait toujours
vécu comme il est mort ?
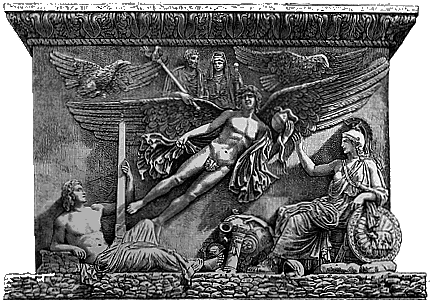
Apothéose d'Antonin et Faustine
|
On a fait de lui un mari complaisant, et même chose a été dite de son successeur : les deux Faustine ont fort mauvaise réputation. Ces accusations sont faciles à répandre, difficiles à réfuter ; et il semble que la malignité, ne trouvant pas à s'exercer sur les Antonins, ait voulu se dédommager, en se donnant carrière à l'égard des deux impératrices. Je ne me rendrai pas garant de leur vertu ; mais les accusations dont on les poursuit depuis dix-sept siècles sont vagues ou absurdes, et il ne me semble pas que ce soit par résignation philosophique que leurs époux out supporté ce qu'on appelle la honte de la famille impériale. Il n'y avait pas seulement de l'affection dans ces paroles d'Antonin à Fronton, au sujet de la première Faustine : Dans le discours que tu as consacré à ma Faustine, j'ai trouvé plus encore de vérité que d'éloquence. Car il en est ainsi ; oui, par les dieux ! j'aimerais mieux vivre avec elle à Gyaros que sans elle au palais. Sous l'amour, je sens l'estime. Lorsqu'il perdit, peu de temps après son avènement (141), la mère de ses quatre enfants, il refusa de se remarier et il lui bâtit un temple à Rome. C'était l'usage.
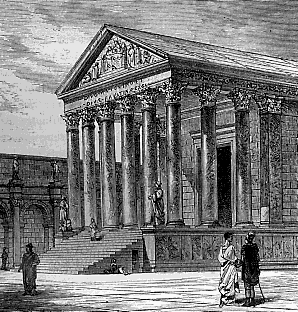
Le temple d'Antonin et Faustine - Restauration par Ménager |
Mais quand lui-même fut mort et passé
dieu, le sénat, pour conserver le souvenir de cette
mutuelle affection, réunit les deux époux en
consacrant le temple : Au dieu Antonin et à la
déesse Faustine. Il en subsiste de magnifiques
débris à San Lorenzo in Miranda, église
construite dans le temple qui était l'objet de
l'admiration des Romains.
Il fit mieux que de donner à Faustine des
prêtresses et des statues d'or : il consacra son nom
par une fondation charitable en faveur des jeunes
Faustiniennes. Une médaille à l'effigie de
l'impératrice montre, au revers, Antonin
entouré de jeunes enfants, avec ces mots à
l'exergue : Puellae Fautinianae ; et jusqu'à sa
dernière heure il soutint et accrut l'institution des
pueri alimentarii, qui sauvait les familles pauvres du
désespoir, en les empêchant de recourir à
l'antique et abominable coutume de l'abandon des
nouveau-nés.
Lorsque Antonin s'était aperçu de sa fin
prochaine, il avait fait porter la statue d'or de la
Victoire, qui ne quittait jamais le chevet des empereurs,
dans la chambre de son gendre et fils adoptif, Marcus
Aurelius Antoninus, surnommé le Philosophe.

Marc Aurèle jeune - Buste du Capitole |