[Marius et Sylla]
LXXX. Jugurtha,
après la perte de Thala, voyant que rien ne pouvait
résister à Metellus, traverse de vastes
déserts, avec un petit nombre d'hommes, et arrive
jusque chez les Gétules, nation sauvage et
grossière, qui ne connaissait pas encore le nom
romain. Il rassemble en corps d'armée cette nombreuse
population, l'accoutume insensiblement à garder ses
rangs, à suivre les drapeaux, à obéir au
commandement, enfin à exécuter les autres
manoeuvres de la guerre. En outre, pour mettre le roi Bocchus
dans ses intérêts, il gagne les ministres de ce
prince avec de grands présents et de plus grandes
promesses. Aidé de leurs secours, il s'adresse au
monarque lui-même, et l'entraîne dans une guerre
contre les Romains. Bocchus inclinait d'autant plus
facilement vers ce parti, que, dès le commencement de
la guerre contre Jugurtha, il avait envoyé des
ambassadeurs à Rome pour solliciter notre alliance, et
que cette demande, qui venait alors si à propos, fut
écartée par les intrigues de quelques hommes
qu'aveuglait la cupidité, et qui trafiquaient
également de l'honneur et de la honte. Il faut ajouter
que précédemment une fille de Bocchus avait
épousé Jugurtha (96) ; mais de telles
unions, chez les Numides comme chez les Maures, ne forment
que des liens bien légers ; chacun d'eux, selon ses
facultés, prend plusieurs épouses, les uns dix,
les autres davantage, les rois encore plus. Le coeur de
l'époux étant ainsi partagé entre un si
grand nombre de femmes, aucune d'elles n'est traitée
par lui comme sa compagne : toutes lui sont également
indifférentes.
LXXXI. Cependant les
armées des deux rois opérèrent leur
jonction dans un lieu convenu. Là, après des
serments réciproques, Jugurtha enflamme par ses
discours l'esprit de Bocchus contre les Romains : il
allègue leurs injustices, leur insatiable
cupidité : ce sont, dit-il, les ennemis communs de
tous les peuples ; ils ont pour faire la guerre à
Bocchus le même motif que pour la faire à
Jugurtha et à toutes les nations : cette passion de
commander à qui toute autre puissance fait obstacle.
Maintenant c'était à Bocchus, naguère
aux Carthaginois, puis au roi Persée, à en
faire l'expérience ; enfin quiconque paraît
puissant devient par cela même l'ennemi des Romains.
Après ce discours et d'autres semblables, les deux
rois prennent le chemin de Cirta, où Metellus avait
déposé le butin, les prisonniers et les
bagages. Jugurtha se flattait, ou de faire une conquête
importante, s'il prenait cette ville ; ou, si les Romains
venaient la secourir, d'engager une bataille ; car le
rusé Numide n'avait rien de plus pressé que
d'entraîner Bocchus à une rupture ouverte, sans
lui laisser le temps de choisir d'autre parti que la
guerre.
LXXXII. Dès qu'il eut
appris la coalition des deux rois, le proconsul ne se hasarde
plus à présenter le combat indistinctement dans
tous les lieux, comme il avait coutume de faire à
l'égard de Jugurtha, si souvent vaincu. Il se contente
d'attendre ses adversaires dans un camp retranché, non
loin de Cirta, voulant se donner le temps de connaître
les Maures, pour combattre avec avantage ces nouveaux
ennemis. Cependant des lettres de Rome lui donnèrent
l'assurance que la province de la Numidie était
donnée à Marius, dont il savait
déjà l'élévation au consulat.
Consterné de cette nouvelle plus qu'il ne convenait
à la raison et à sa dignité, Metellus ne
put ni retenir ses larmes, ni modérer sa langue. Cet
homme, doué d'ailleurs de si éminentes
qualités, s'abandonna trop vivement à son
chagrin. Les uns attribuaient cette faiblesse à
l'orgueil, d'autres au ressentiment d'une âme
honnête qui reçoit un affront ; la plupart, au
regret de se voir arracher une victoire qu'il tenait
déjà dans ses mains. Pour moi, je sais que
l'élévation de Marius, plus que sa propre
injure, déchirait l'âme de Metellus, et qu'il
eût éprouvé moins de chagrin, si la
province qui lui était enlevée eût
été confiée à tout autre
qu'à Marius.
LXXXIII. Réduit
à l'inaction par la douleur, et regardant comme une
folie de poursuivre à ses risques et périls une
guerre qui lui devenait étrangère, il envoie
des députés à Bocchus, pour lui
représenter qu'il ne devait pas, sans motif, se faire
l'ennemi du peuple romain ; qu'il avait une belle occasion
d'obtenir son alliance et son amitié, bien
préférables à la guerre ; que, quelque
confiance qu'il eût en ses forces, il ne devait pas
sacrifier le certain pour l'incertain ; que toute guerre est
facile à entreprendre, mais très
malaisée à terminer ; que celui qui la commence
n'est pas le maître de la finir ; qu'il est permis,
même au plus lâche, de prendre les armes, mais
qu'on ne les dépose qu'au gré du vainqueur
(97) ; enfin, que
Bocchus, dans son intérêt et dans celai de son
royaume, ne devait pas associer sa fortune florissante au
sort désespéré de Jugurtha. A ces
ouvertures, le roi répondit avec assez de
modération qu'il désirait la paix, mais qu'il
était touché des malheurs de Jugurtha ; que, si
son gendre était pour sa part admis à traiter,
tout serait bientôt d'accord. Metellus, d'après
cette proposition de Bocchus, lui envoie de nouveaux
députés. Le monarque agrée une partie de
leurs demandes, et rejette les autres. Ainsi, à la
faveur de ces députations successives, le temps
s'écoula, et, comme l'avait désiré
Metellus, les hostilités furent suspendues.
LXXXIV. Dès que
Marius, porté, comme nous l'avons dit, au consulat,
par les voeux ardents du peuple, en eut obtenu la province de
la Numidie, lui, de tout temps l'ennemi des nobles, il donne
un libre essor à son animosité, et ne cesse de
les attaquer (98), soit en corps, soit
individuellement. Il répétait tout haut que son
consulat était une dépouille conquise sur des
vaincus : on l'entendait, en outre, parler de lui en termes
magnifiques ; des nobles, avec l'expression du mépris.
Toutefois il s'occupe avant tout de pourvoir aux besoins de
la guerre, sollicite un supplément aux légions
(99), demande des
troupes auxiliaires aux peuples, aux rois, aux alliés,
et fait un appel à tout ce que le Latium avait de plus
vaillants soldats : la plupart lui étaient connus pour
avoir servi sous ses yeux, les autres, de réputation.
Par ses sollicitations, il force jusqu'aux
vétérans à partir avec lui. Le
sénat, malgré son aversion pour Marius, n'osait
rien lui refuser ; il avait même
décrété avec joie le supplément
demandé, dans la pensée que la
répugnance du peuple pour le service militaire ferait
perdre à Marius ou les ressources sur lesquelles il
comptait pour la guerre, ou sa popularité. Mais
l'attente du sénat fut déçue, tant
était vif chez les plébéiens le
désir de suivre Marius ! Chacun se flattait de revenir
dans ses foyers vainqueur, riche de butin, et se repaissait
des plus belles espérances. Une harangue de Marius
n'avait pas peu contribué à exalter les
esprits. En effet, dès qu'il eut obtenu les
décrets qu'il avait sollicités, au moment de
procéder à l'enrôlement, il convoqua le
peuple, tant pour l'exhorter que pour exhaler contre la
noblesse sa haine accoutumée, et parla en ces termes
:
LXXXV. «Je sais,
Romains, que la plupart de vos magistrats ont une conduite
bien différente pour briguer le pouvoir, et pour
l'exercer quand ils l'ont obtenu : d'abord actifs, souples,
modestes, puis passant leur vie dans la mollesse et dans
l'orgueil. Moi, je pense, au contraire, qu'autant la
république entière est au-dessus du consulat et
de la préture, autant on doit mettre, pour la bien
gouverner, plus de soin que pour briguer ces honneurs. Je ne
me dissimule pas combien l'insigne faveur que vous m'avez
accordée m'impose d'obligations. Faire les
préparatifs de la guerre et à la fois
ménager le trésor public, contraindre au
service ceux à qui on ne voudrait point
déplaire, pourvoir à tout au dedans et au
dehors, malgré les envieux, les opposants, les
factieux, c'est, Romains, une tâche plus rude qu'on ne
pense.
Les autres, du moins, s'ils ont failli (100),
l'ancienneté de leur noblesse, les brillants exploits
de leurs aïeux, le crédit de leurs proches et de
leurs alliés, le nombre de leurs clients, sont
là pour les protéger. Pour moi, toutes mes
espérances sont en moi seul ; c'est par mon courage et
mon intégrité qu'il me faut les soutenir : car,
auprès de ceux-là, tous les autres appuis sont
bien faibles (101). Je le vois,
Romains, tous les regards sont fixés sur moi : les
citoyens honnêtes et justes me sont favorables, parce
que mes services profiteront à la république.
La noblesse n'attend que le moment de l'attaque (102) : je dois donc
redoubler d'efforts pour que vous ne soyez point
opprimés (l03), et que son
attente soit trompée. La vie que j'ai menée
depuis mon enfance jusqu'à ce jour m'a donné
l'habitude des travaux et des périls : la conduite
qu'avant vos bienfaits je tenais sans espoir de salaire,
maintenant que j'en ai pour ainsi dire reçu la
récompense, je ne m'aviserai pas de m'en
départir. La modération dans le pouvoir est
difficile aux ambitieux qui, pour parvenir, ont fait semblant
d'être honnêtes gens ; mais chez moi, qui ai
consacré toute ma vie à la pratique des vertus,
l'habitude de bien faire est devenue naturelle. Vous m'avez
chargé de la guerre contre Jugurtha : la noblesse
s'est irritée de ce choix. Réfléchissez
mûrement, je vous prie, s'il ne vaudrait pas mieux
changer votre décret, et, parmi cette foule de nobles,
chercher pour cette expédition, ou pour toute autre
semblable, un homme de vieille lignée, qui
comptât beaucoup d'aïeux, et pas une seule
campagne : à savoir, pour que, dans une si importante
mission, ignorant toute chose, troublé, se
hâtant mal à propos, il prenne quelque
plébéien qui lui enseigne ses devoirs. Oui,
cela n'arrive que trop souvent : celui que vous avez
chargé du commandement cherche un autre homme qui lui
commande. J'en connais, Romains, qui ont attendu leur
élévation au consulat pour commencer à
lire l'histoire de nos pères et les préceptes
des Grecs sur l'art militaire : hommes qui font tout hors de
saison ; car, bien que, dans l'ordre des temps, l'exercice
d'une magistrature ne puisse précéder
l'élection, il n'en est pas moins la première
chose pour l'importance et pour les résultats (104).
Maintenant, Romains,
à ces patriciens superbes, comparez Marius, homme
nouveau : ce qu'ils ont ouï raconter, ce qu'ils ont lu,
je l'ai vu ou fait moi-même ; l'instruction qu'ils ont
prise dans les livres, je l'ai reçue dans les camps :
estimez donc ce qui vaut le mieux des paroles ou des actions.
Ils méprisent ma naissance ; moi, je méprise
leur lâcheté. On peut m'objecter, à moi,
le tort de la fortune, à eux on objectera leur infamie
personnelle. D'après mon sentiment, la nature, notre
mère commune, fait tous les hommes égaux ; le
plus brave est le plus noble. Si l'on pouvait demander aux
pères d'Albinus ou de Bestia, qui d'eux ou de moi ils
voudraient avoir engendrés, croyez-vous qu'ils ne
répondraient pas qu'ils voudraient avoir pour fils les
plus vertueux ? S'ils se croient en droit de me
mépriser, qu'ils méprisent donc leurs
aïeux, ennoblis comme moi par leur vertu. Ils sont
jaloux de mon illustration, qu'ils le soient aussi de mes
travaux, de mon intégrité, de mes périls
: car c'est à ce prix que je l'ai acquise. Mais,
aveuglés par l'orgueil, ils se conduisent comme s'ils
dédaignaient les honneurs que vous dispensez, et ils
les sollicitent comme s'ils les avaient mérités
parleur conduite. Certes, ils s'abusent d'une étrange
manière, de vouloir réunir en eux des choses si
incompatibles : les lâches douceurs de l'indolence et
les récompenses de la vertu. Lorsque, dans vos
assemblées ou dans le sénat, ils prennent la
parole, leurs discours ne roulent que sur l'éloge de
leurs ancêtres : en rappelant les belles actions de ces
grands hommes, ils pensent se donner à eux-mêmes
du relief. Loin de là ; plus la vie des uns eut
d'éclat, plus la lâcheté des autres est
dégradante. Et c'est une vérité
incontestable : la gloire des ancêtres est comme un
flambeau (105)
qui ne permet point que les vertus ni les vices de leurs
descendants restent dans l'obscurité.
Pour moi, Romains, je suis dépourvu de cet avantage ;
mais, ce qui est beaucoup plus glorieux, il m'est permis de
parler de mes exploits. Maintenant voyez quelle est leur
injustice ! Ils se font un titre d'une vertu qui n'est pas la
leur, et ils ne veulent pas que je m'en fasse un de la mienne
; sans doute, parce que je n'ai point d'aïeux, parce que
ma noblesse commence à moi, comme s'il ne valait pas
mieux en être soi-même l'auteur, que de
dégrader celle qui vous est transmise.
Certes, je n'ignore pas
que, s'ils veulent me répondre, ils ne manqueront
point de phrases élégantes et habilement
tournées ; mais, comme à l'occasion de
l'éclatant bienfait que j'ai reçu de vous, ils
nous déchirent vous et moi, en toute occasion, par
leurs mauvais propos, je n'ai pas cru devoir me taire, de
peur qu'ils prissent pour un aveu de la conscience le silence
de la modestie. Ce n'est pas toutefois que personnellement
aucun discours puisse me nuire : vrais, ils sont
nécessairement à mon avantage ; faux, ma
conduite et mes moeurs les démentent. Cependant,
puisqu'ils incriminent vos décrets, pour m'avoir
confié un honneur insigne et une importante
expédition, examinez, oui, examinez bien si vous avez
lieu de revenir sur votre décision. Je ne puis, pour
justifier votre confiance, étaler les images, les
triomphes ou les consulats de mes ancêtres ; mais je
produirai, s'il le faut, des javelines, un étendard,
des colliers, vingt autres dons militaires, et les cicatrices
qui sillonnent ma poitrine (106). Voilà mes
images, voilà ma noblesse : comme eux, je ne les ai
pas recueillis par héritage ; moi seul, je les ai
obtenus à force de travaux et de périls.
Mes discours sont sans apprêt (107) : je ne m'en
embarrasse guère. La vertu brille assez
d'elle-même ; c'est à eux qu'il faut de l'art
pour cacher par de belles phrases la turpitude de leurs
actions. Je n'ai point étudié l'art
littéraire des Grecs (lO8), me souciant peu
de l'apprendre, puisqu'il n'a pas rendu plus vertueux ceux
qui l'enseignaient. Mais j'ai appris des choses bien
autrement utiles à la république : à
frapper l'ennemi, à garder un poste, à ne rien
craindre que le déshonneur (109), à endurer
également le froid et le chaud, à coucher sur
la dure, à supporter à la fois la faim et la
fatigue. Voilà par quelles leçons j'instruirai
les soldats : on ne meverra pas les faire vivre dans la
gêne, et vivre, moi, dans l'abondance. Je ne fonderai
pas ma gloire sur leurs travaux. Ainsi le commandement se
montre tutélaire, ainsi doit-il s'exercer entre
concitoyens (110) : car se livrer
à la mollesse et infliger à l'armée les
rigueurs de la discipline, c'est agir en tyran, et non pas en
général. C'est en pratiquant ces maximes, et
d'autres semblables, que vos ancêtres ont fait la
gloire de l'Etat et la leur.
Appuyée sur leurs
noms, la noblesse, qui ressemble si peu à ces grands
hommes, ose nous mépriser, nous qui sommes leurs
émules : elle réclame de vous tous les
honneurs, non comme la récompense du mérite,
mais comme un droit acquis. Etrange erreur de l'orgueil !
Leurs ancêtres leur ont transmis tout ce qu'ils
pouvaient leur transmettre, richesses, images, souvenirs
glorieux de ce qu'ils furent ; mais la vertu, ils ne la leur
ont point léguée, et ne pouvaient la leur
léguer ; seule elle ne peut ni se donner ni se
recevoir (111).
Ils m'accusent, de vilenie et de grossièreté,
parce que je m'entends mal à ordonner les
apprêts d'un festin, que je n'ai point d'histrions
à ma table, et que mon cuisinier ne me coûte pas
plus cher qu'un garçon de charrue (112). J'en conviens
bien volontiers ; car mon père et d'autres personnages
d'une vie irréprochable m'ont enseigné que ces
futilités conviennent aux femmes, et le travail aux
hommes ; qu'il faut au brave moins de richesses que de
gloire, et que ses armes, et non ses ameublements, sont sa
parure. Eh bien donc ! qu'ils la mènent toujours,
cette vie qui leur plaît tant, qui leur est si
chère ; qu'ils fassent l'amour, qu'ils boivent, et
que, comme ils consumèrent leur adolescence, ils
passent leur vieillesse au milieu des festins, esclaves de
leur ventre et des appétits les plus honteux : qu'ils
nous laissent la sueur, la poussière, toutes les
fatigues, à nous qui les trouvons mille fois plus
douces que leurs orgies. Mais il n'en est point ainsi : ces
hommes infâmes, après s'être
souillés de toutes les turpitudes, cherchent à
ravir aux gens de bien les récompenses de la vertu.
Ainsi, par une monstrueuse injustice, la luxure et la
lâcheté, ces détestables vices, ne
nuisent point à ceux qui s'y complaisent, et perdent
la république innocente de ces excès.
Maintenant que je leur
ai répondu comme il convenait à mon
caractère, et non pas à leurs honteux
dérèglements, j'ajouterai quelques mots dans
l'intérêt de l'Etat. Premièrement,
Romains, ayez bonne opinion des affaires de la Numidie : car
tout ce qui jusqu'à présent a fait l'appui de
Jugurtha, vous l'avez écarté, je veux dire
l'avarice, l'impéritie, l'orgueil. De plus, vous avez
là une armée qui connaît le pays, mais
qui certes fut plus brave qu'heureuse, et dont une grande
partie a été sacrifiée par l'avarice ou
par la témérité des chefs. Vous donc,
qui avez l'âge de la milice, joignez vos efforts aux
miens, prenez en main la défense de la
république ; que personne désormais ne soit
intimidé par les malheurs que d'autres ont
éprouvés ou par l'arrogance des
généraux. Dans les marches, dans les combats,
guide et compagnon de vos périls, je serai toujours
avec vous : entre vous et moi tout sera commun. Et, je puis
le dire, grâce à la protection des dieux, tout
nous vient à point, le succès, le butin, la
gloire. Lors même que ces avantages seraient
éloignés ou incertains, il serait encore du
devoir des bons citoyens de venir au secours de la
république. En effet, la lâcheté ne rend
personne immortel (113), et jamais
père n'a désiré pour ses enfants une vie
éternelle, mais bien une vie pure et honorable. J'en
dirais davantage, Romains, si les paroles pouvaient donner du
courage aux lâches. Quant aux braves, j'en ai, je
pense, dit assez pour eux (114)».
LXXXVI. Ainsi parla Marius.
Voyant que par sa harangue il a affermi le courage du peuple,
il se hâte d'embarquer des vivres, de l'argent, et tous
les approvisionnements nécessaires. A la tête de
ce convoi, il fait partir son lieutenant Aulus Manlius. Pour
lui, il enrôle des soldats, non dans l'ordre des
classes, suivant l'ancienne coutume, mais indistinctement,
selon qu'ils se présentaient, et prolétaires la
plupart, faute, selon les uns, de trouver des riches ; selon
d'autres, calcul d'ambition de la part du consul (115), qui devait
à cette classe infime de citoyens son crédit et
son élévation ; et, en effet, pour qui aspire
à la puissance, les plus utiles auxiliaires sont les
plus indigents (116), qui, n'ayant rien
à ménager, puisqu'ils ne possèdent rien,
regardent comme légitime tout ce qui leur vaut un
salaire. Marius part pour l'Afrique avec des troupes plus
nombreuses même que le décret ne l'avait
autorisé, et, en peu de jours, il aborde à
Utique. L'armée lui est remise par le lieutenant P.
Rutilius. Metellus avait évité la
présence de Marius ; il ne voulait pas être
témoin de ce dont il n'avait pu supporter la
nouvelle
LXXXVII. Le consul, ayant
complété les légions et les cohortes
auxiliaires, marche vers un pays fertile et riche en butin.
Tout ce qui est pris, il l'abandonne aux soldats. Il
assiège ensuite des châteaux et des villes mal
défendues tant par leur assiette que par leurs
garnisons, et livre, tantôt dans un lieu, tantôt
dans un autre, une foule de combats, tous peu importants. Par
là, les nouvelles recrues s'accoutument à se
battre sans crainte ; ils voient que les fuyards sont pris ou
tués ; que les plus braves courent le moins de danger
; que c'est avec les armes que l'on protège la
liberté, la patrie, la famille, tous les
intérêts ; qu'elles donnent la gloire et les
richesses. Ainsi l'on ne distingua bientôt plus les
jeunes soldats d'avec les vieux : même valeur les
animait tous.
A la nouvelle de l'arrivée de Marius, les rois se
retirèrent chacun de leur côté dans des
lieux de très difficile accès. Ainsi l'avait
décidé Jugurtha, dans l'espoir de pouvoir
attaquer bientôt les Romains dispersés, qui,
délivrés de toute crainte, ne manqueraient pas,
comme il arrive presque toujours, de marcher avec moins
d'ordre et de précaution.
LXXXVIII. Cependant Metellus
était parti pour Rome, où, contre son attente,
il fut reçu avec des transports de joie. L'envie
était désarmée, et il devint
également cher au peuple et au sénat (117).
Quant à Marius, avec autant d'activité que de
prudence, il porte un oeil également attentif sur la
position de l'ennemi et sur la sienne, remarque ce qui peut
leur être réciproquement favorable ou contraire.
Il épie la marche des deux rois, prévient leurs
projets ou leurs stratagèmes, tient continuellement
les siens en haleine (118) et l'ennemi en
échec. Ainsi, les Gétules (119) et Jugurtha, qui
venaient de piller nos alliés, se virent à leur
retour attaqués et battus ; le prince lui-même,
surpris non loin de Cirta, fut contraint d'abandonner ses
armes. Bientôt, considérant que ces
expéditions, bien que glorieuses, ne terminaient pas
la guerre, Marius résolut d'assiéger
successivement toutes les villes qui, par la force de leur
garnison ou de leur position, pouvaient favoriser les projets
de l'ennemi ou contrarier les siens. Ainsi Jugurtha allait
être ou privé de ses garnisons, s'il se laissait
enlever ses places, ou forcé de combattre. Quant
à Bocchus, il avait, par ses émissaires,
donné plusieurs fois au consul l'assurance
«qu'il désirait l'amitié du peuple
romain, et qu'on n'avait à craindre de sa part aucune
hostilité». Etait ce un piège, afin de
nous surprendre avec plus d'avantage, ou inconstance de
caractère, qui le faisait pencher tantôt pour la
paix, tantôt pour la guerre ? C'est ce qu'on ne saurait
facilement décider.
LXXXIX. Le consul, suivant
son plan, attaque les villes et les châteaux
fortifiés, employant, pour les enlever à
l'ennemi, ici la force, là les menaces ou les
présents. D'abord, il s'attache aux moindres places,
dans la pensée que, pour secourir les siens, Jugurtha
se déciderait à en venir aux mains. Mais,
apprenant qu'il était éloigné, et
occupé d'autres projets, il jugea qu'il était
temps de tenter des entreprises plus importantes et plus
difficiles. Au milieu de vastes solitudes, était une
ville grande et forte, nommée Capsa, et dont Hercule
Libyen passe pour le fondateur. Exempts d'impôts depuis
le règne de Jugurtha, traités avec douceur, ses
habitants passaient pour être dévoués
à ce prince. Ils étaient protégés
contre l'ennemi par leurs fortifications, leurs armes, et le
nombre de leurs combattants, mais encore plus par d'affreux
déserts. Car, excepté les environs de la ville,
tout le reste de la contrée est inhabité,
inculte, privé d'eau, infesté de serpents, dont
la férocité, comme celle de toutes les
bêtes sauvages, devient plus teirible encore par le
manque de nourriture. D'ailleurs, rien n'irrite comme la soif
les serpents, déjà si dangereux par
eux-mêmes.
Tout dans la conquête de cette ville excite au plus
haut degré l'ambition de Marius, et son importance
pour la suite de la guerre, et la difficulté de
l'entreprise et la gloire éclatante qu'avait
procurée à Metellus la prise de Thala. En
effet, ces deux villes étaient peu différentes
par leur force et par leur position, seulement tout
près de Thala se trouvaient quelques sources, et les
habitants de Capsa n'avaient dans l'enceinte de leur ville
qu'une fontaine d'eau vive ; ils se servaient aussi d'eau de
pluie. Là, comme dans la partie de l'Afrique dont les
solitudes arides s'étendent loin de la mer, la disette
d'eau est d'autant plus supportable, que les Numides ne se
nourrissent guère que de lait et de la chair des
animaux sauvages, sans y ajouter le sel et tous ces
assaisonnements qui irritent le palais. Ils ne mangent et ne
boivent que pour la faim et pour la soif, et non pour
satisfaire une dispendieuse sensualité.
XC. Le consul, après
avoir tout examiné, se reposa, je crois, sur la
protection des dieux ; car, contre de si grandes
difficultés, qu'aurait pu la puissance humaine ? De
plus, il avait à craindre la disette de grains, parce
que les Numides aiment mieux laisser leurs terres en
pâturages qu'en céréales, et le peu qui
venait d'en être récolté, ils l'avaient,
d'après l'ordre du roi, transporté dans des
places fortes. Enfin, les champs étaient alors
dépouillés de leurs produits, car on touchait
à la fin de l'été. Toutefois Marius
concerte ses mesures aussi sagement que pouvait le permettre
la circonstance. Il confie à la cavalerie auxiliaire
la conduite de tout le bétail enlevé les jours
précédents. Il ordonne à son lieutenant,
A. Manlius, d'aller avec les troupes légères
l'attendre à Laris, où étaient
déposés le trésor et les vivres de
l'armée. Il lui promet de venir bientôt le
rejoindre, après avoir pillé le pays. Ainsi,
dissimulant son projet, il se dirige vers le fleuve
Tana.
 |
XCI. Dans la marche, il fit faire chaque jour
à son armée une distribution égale de
bétail par centuries et par escadrons, et veilla
à ce qu'on fabriquât des outres avec les peaux.
Ainsi il suppléa au manque de grains, et en même
temps, sans laisser pénétrer son secret, il se
ménagea les ustensiles dont il avait besoin. Enfin, au
bout de six jours, lorsqu'on fut arrivé au fleuve, une
grande quantité d'outres se trouva faite. Là,
Marius établit un camp légèrement
fortifié, ordonne aux soldats de prendre de la
nourriture, puis de se tenir prêts à partir au
coucher du soleil, et, débarrassés de tout leur
bagage, de ne se charger que d'eau, eux et leurs bêtes
de somme. A l'heure fixée, on décampe ; puis,
après avoir marché toute la nuit, on
s'arrête : on fait de même le lendemain ; enfin,
le troisième jour, bien avant le lever de l'aurore, on
arrive dans un lieu couvert d'éminences, et qui
n'était pas à plus de deux milles de Capsa.
Là, Marius fait halte avec toutes ses troupes, et se
tient caché le mieux qu'il lui est possible.
Aussitôt que le jour paraît, les Numides, ne
redoutant aucune hostilité, sortent en grand nombre de
la ville : à l'instant Marius ordonne à toute
sa cavalerie et aux fantassins les plus agiles de se porter
au pas de course sur Capsa, et de s'emparer des portes.
Lui-même les suit en toute hâte, mais en bon
ordre et sans permettre au soldat de piller. Dès que
les habitants s'aperçurent du danger, le tumulte,
l'excès de la crainte et de l'étonnement,
enfin, la perte d'une partie de leurs concitoyens faits
prisonniers hors des remparts, tout les oblige à se
rendre. Cependant la ville est livrée aux flammes,
tous les Numides en âge de porter les armes sont
passés au fil de l'épée, le reste est
vendu, et le butin partagé aux soldats.
Exécution sanglante, contraire au droit de la guerre,
et dont on ne doit pourtant accuser ni la cruauté ni
l'avarice du consul (120) ; mais cette
place, position très avantageuse pour Jugurtha,
était pour nous d'un difficile accès, et ses
habitants, race mobile, perfide, ne pouvaient être
enchaînés ni par la crainte ni par les
bienfaits.
XCII. Après avoir
accompli, sans perdre un seul homme, une entreprise si
importante, Marius, déjà grand et illustre,
parut plus grand et plus illustre encore : ses projets les
plus hasardés passaient pour l'effort du génie
et du courage. Ses soldats, charmés de la douceur de
son commandement, et enrichis sous ses drapeaux,
l'élevaient jusqu'au ciel ; les Numides le redoutaient
comme un être au-dessus de l'humanité ; enfin
les alliés, aussi bien que les ennemis, lui attribuant
une intelligence divine, croyaient qu'il n'agissait que par
l'inspiration des dieux. Ce succès obtenu, le consul
marche rapidement vers d'autres villes ; quelques-unes,
malgré la résistance des Numides, tombent en
son pouvoir ; beaucoup d'autres, abandonnées par les
habitants, qu'effrayait le désastre de Capsa, sont par
ses ordres livrées aux flammes : partout il porte le
carnage et la désolation.
Après s'être ainsi rendu maître de
beaucoup de villes, la plupart sans coup férir, il
forme une nouvelle entreprise, qui, sans offrir les
mêmes dangers que la conquête de Capsa, n'en
était pas moins difficile. Non loin du fleuve Mulucha,
limite entre les Etats de Bocchus et ceux de Jugurtha, dans
une plaine d'ailleurs unie, s'élevait, à une
hauteur prodigieuse, un énorme rocher, dont le sommet
était couronné par un château de
médiocre grandeur, où l'on n'arrivait que par
un sentier étroit : tout le reste du roc était
de sa nature aussi escarpé que si la main de l'homme
l'eût taillé à dessein. Dans ce
château étaient les trésors du roi;
Marius employa donc tous ses efforts pour s'en emparer ; mais
le hasard le servit mieux que ses prévisions. En
effet, ce fort, suffisamment pourvu de troupes et d'armes,
renfermait beaucoup de grains et une source d'eau vive. Les
terrasses, les tours, et les autres machines de siège
ne pouvaient être dressées sur un semblable
emplacement. Le chemin conduisant au château
était fort étroit, et de tous
côtés coupé à pic : c'était
avec un grand péril et sans nul avantage qu'on mettait
en jeu les mantelets ; car, pour peu qu'on les
approchât de la place, ils étaient
détruits à coups de pierres ou par la flamme ;
nos soldats ne pouvaient, vu l'escarpement du terrain, se
tenir en avant des ouvrages, ni travailler sans danger sous
les mantelets. Les plus entreprenants étaient
tués ou blessés, les autres perdaient
courage.
XCIII. Cependant Marius,
après bien des journées perdues en travaux
inutiles, tombe dans la perplexité : renoncera-t-il
à une entreprise jusqu'à présent sans
résultat ? ou se reposera-t-il sur la fortune, qui
tant de fois l'a si heureusement servi ? Il passe ainsi bien
des jours et des nuits, travaillé par ces
incertitudes. Enfin, un Ligurien (121), simple soldat des
cohortes auxiliaires, sorti du camp pour chercher de l'eau,
du côté de la citadelle opposé à
celui de l'attaque, remarque par hasard des limaçons
qui rampaient dans une crevasse du rocher. Il en ramasse un,
puis deux, puis davantage, et guidé par le
désir d'en trouver d'autres, il gravit insensiblement
jusqu'au sommet de la montagne. Assuré que cet endroit
était entièrement solitaire, il cède,
penchant naturel à l'homme, à la
curiosité d'observer des lieux inconnus. Là,
par hasard, un grand chêne avait poussé ses
racines dans les fentes du roc : sa tige, d'abord
inclinée, s'était ensuite redressée, et
élevée dans une direction verticale, selon la
loi commune de tous les végétaux. Le Ligurien,
s'appuyant tantôt sur les branches, tantôt sur
les saillies du rocher, peut, à loisir,
reconnaître l'esplanade du château : les Numides
étaient tous occupés à se
défendre contre les assiégeants.
Après avoir fait toutes ces remarques, qu'il comptait
bientôt mettre à profit, il descend par le
même chemin, non pas sans réflexion, comme il
était monté, mais en sondant le terrain, et en
examinant toutes choses avec soin. Aussitôt il va
trouver Marius, lui raconte ce qui lui est arrivé,
l'exhorte à faire une tentative sur le château
du côté par où il était descendu,
et s'offre à servir lui-même de guide, à
prendre la première part du péril. Marius
envoie sur-le-champ, avec le Ligurien, quelques-uns de ceux
qui étaient présents, pour s'assurer de la
créance qu'on peut accorder aux promesses de cet
homme. Chacun d'eux, selon son caractère, juge
l'entreprise aisée ou difficile. Cependant le consul
sent quelque peu se ranimer son espoir. Parmi les trompettes
et les cors de l'armée, il choisit cinq hommes des
plus agiles, et leur adjoint, pour les soutenir, quatre
centurions. Tous reçoivent l'ordre d'obéir au
Ligurien ; puis le jour suivant est fixé pour
l'escalade.
XCIV. Au temps marqué, tout est
disposé, préparé, et la petite
troupe se dirige vers l'endroit convenu. Les centurions
(122)
d'ailleurs avaient, d'après l'avis de leur guide,
quitté leurs armes et leurs insignes ; la
tête découverte pour mieux voir, les pieds
nus pour grimper plus facilement le long des rochers. A
leur dos étaient attachés leur
épée et leur bouclier fait de cuir,
à la manière des Numides, afin que le poids
en fût plus léger et le choc moins bruyant.
Le Ligurien les précède : aux pointes de
rochers et aux vieilles racines qui formaient saillie, il
attache des noeuds coulants qui retiennent les soldats et
les aident à gravir plus aisément ;
quelquefois il donne la main à ceux qu'effraye une
route si nouvelle ; quand la montée devient plus
roide, il les fait passer devant lui l'un après
l'autre, et désarmés ; puis il les suit en
portant leurs armes. Aux pas qui paraissent les plus
difficiles à franchir, le premier il sonde le
terrain, montant, descendant plusieurs fois, et se jetant
aussitôt de côté, pour inspirer son
audace à ses compagnons. |
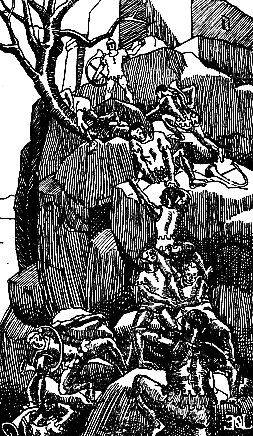 |
Les Numides, qui précédemment avaient
plusieurs fois renversé, incendié les mantelets
des assiégeants, ne cherchaient déjà
plus une défense derrière les murs du
château : ils passaient les jours et les nuits
campés au devant du rempart, injuriant les Romains,
reprochant à Marius sa folle
témérité, et menaçant nos soldats
des fers de Jugurtha : le succès les rendait
insolents. Tandis que Romains et Numides combattent tous avec
ardeur, les premiers pour la gloire et l'empire, les autres
pour leur salut, tout à coup par derrière
sonnent les trompettes. D'abord fuient et les femmes et les
enfants qu'avait attirés le spectacle du combat, puis
ceux des assiégés qui étaient le plus
près du rempart, puis tous les habitants armés
ou sans armes. Dans ce moment, les Romains pressent plus
vivement les ennemis, les renversent et se contentent de les
blesser ; puis, marchant sur le corps de ceux qu'ils ont
tués, ils se disputent à l'envi la gloire
d'escalader le rempart. Pas un seui ne s'arrête pour
piller : ainsi le hasard répara la
témérité de Marius, et une faute ajouta
à sa gloire.
XCV. Cependant le questeur
L. Sylla arrive au camp avec un corps considérable de
cavalerie levé dans le Latium et chez les
alliés, opération pour laquelle il avait
été laissé à Rome. Mais, puisque
mon sujet m'a conduit à nommer ce grand homme, il me
paraît à propos de donner une idée de son
caractère et de ses moeurs. Aussi bien n'aurai-je pas
ailleurs occasion de parler de ce qui concerne Sylla ; et L.
Sisenna (124),
le meilleur et le plus exact de ses historiens, ne me
paraît pas s'être exprimé sur son compte
avec assez d'indépendance.
Sylla était d'une famille patricienne, presque
entièrement déchue par la nullité de ses
ancêtres. Il possédait également et
à un éminent degré les lettres grecques
et latines. Doué d'une grande âme, il
était passionné pour le plaisir, mais plus
encore pour la gloire ; livré dans ses loisirs
à toutes les recherches de la volupté, jamais
pourtant il ne sacrifiait les devoirs aux plaisirs :
toutefois il viola les convenances à l'égard de
son épouse. Eloquent, adroit, facile en amitié,
sachant tout feindre avec une incroyable profondeur de
génie, il prodiguait toutes choses, et surtout
l'argent. Plus heureux qu'aucun autre mortel jusqu'à
sa victoire sur ses concitoyens (125), sa fortune ne fut
jamais supérieure à ses talents, et bien des
gens ont douté s'il devait plus à son courage
qu'à son bonheur. Quant à ce qu'il a fait
depuis, dois-je plutôt rougir que craindre d'en parler
? Je ne sais
XCVI. Sylla arriva donc en
Afrique, comme je viens de le dire, amenant à Marius
un corps de cavalerie. De novice, d'ignorant même qu'il
était dans le métier des armes, il ne tarda pas
à y devenir le plus habile de tous. Affable envers les
soldats, ses bienfaits accueillaient et souvent
prévenaient leurs nombreuses demandes ; n'acceptant de
service qu'à son corps défendant, il rendait la
pareille avec plus d'empressement qu'on n'en met à
payer une dette, sans jamais exiger pour lui de retour,
uniquement occupé qu'il était d'accroître
le nombre de ses obligés. Sérieux ou
enjoués, ses propos s'adressaient même aux
derniers soldats. Dans les travaux, dans les rangs, dans les
gardes de nuit, il savait se multiplier, et toutefois
n'attaquait jamais, défaut trop ordinaire à une
coupable ambition, la réputation du consul, ni celle
d'aucun homme estimable ; seulement, pour le conseil et pour
l'exécution, il ne pouvait souffrir que personne
l'emportât sur lui, et il était supérieur
à la plupart. Voilà par quelles
qualités, par quels moyens, Sylla devint bientôt
cher à Marius et à l'armée.
XCVII. Cependant,
après avoir perdu Capsa, d'autres places fortes et
importantes, et une partie de ses trésors, Jugurtha
envoie à Bocchus des courriers pour lui mander
d'amener au plus tôt ses troupes dans la Numidie : il
était temps de livrer bataille. Apprenant que ce
prince diffère, qu'il hésite et pèse
tour à tour les chances de la paix et de la guerre, le
Numide corrompt par des présents, comme il l'a
déjà fait, les confidents de Bocchus, et promet
à ce prince lui-même le tiers de la Numidie, si
les Romains sont chassés de l'Afrique, ou si un
traité qui laisse à Jugurtha tout son
territoire vient terminer la guerre.
Séduit par cette promesse, Bocchus, avec des forces
nombreuses, se joint à Jugurtha. Après avoir
ainsi réuni leurs armées, au moment où
Marius part pour ses quartiers d'hiver, ils l'attaquent,
lorsqu'il restait à peine une heure de jour. Ils
comptaient que la nuit, qui déjà approchait,
serait, en cas de revers, une protection pour eux, sans
devenir, en cas de succès, un obstacle, car ils
connaissaient les lieux ; dans les deux cas, au contraire,
les ténèbres seraient nuisibles aux Romains. A
peine donc le consul a-t-il été de toutes parts
averti de l'approche de l'ennemi, que déjà
l'ennemi paraît. L'armée n'a pu encore se ranger
en bataille, ou rassembler ses bagages, ou enfin recevoir
aucun signal, aucun ordre, que déjà les
cavaliers maures et gétules, non point en escadrons ni
en bataille, mais par pelotons, et comme les a
rassemblés le hasard, tombent sur nos soldats.
Ceux-ci, au milieu de la surprise et de l'effroi
général, rappelant cependant leur valeur,
prennent leurs armes ou protègent contre les traits de
l'ennemi ceux qui les prennent ; plusieurs montent à
cheval et courent faire face aux Numides : c'est une attaque
de brigands plutôt qu'un combat régulier ; ii
n'y a ni rangs ni drapeaux ; aux uns l'ennemi tranche la
tête, aux autres il perce les flancs ; tels qui
combattent vaillamment de front se trouvent attaqués
par derrière ; il n'est plus d'armes, plus de courage
qui puisse les défendre ; l'ennemi est
supérieur en nombre, et les a enveloppés de
toutes parts. Enfin, les vieux soldats romains, et les
nouveaux, qui, grâce à leur exemple, savent la
guerre, profitent ou du terrain ou du hasard qui les
rapproche, se forment en cercle, et par là, couverts
et en état de défense de toutes parts,
soutiennent le choc des ennemis.
XCVIII. Dans un moment si critique, Manus, toujours
intrépide, n'a rien perdu de son sang-froid ; avec
son escadron, qu'il a composé de l'élite
des braves plutôt que de ses favoris, il se porte
partout, tantôt soutenant ceux des siens qu'il voit
accablés, tantôt enfonçant les
ennemis là où leurs rangs sont le plus
serrés ; son bras protège les soldats,
puisqu'il ne peut, au milieu du trouble
général, leur faire entendre ses ordres.
Déjà le jour était fini, et les
Barbares ne se ralentissaient point, et,
persuadés, d'après l'ordre de leurs rois,
que la nuit leur serait favorable, ils nous pressaient
avec une nouvelle fureur. Alors Marius prend conseil de
sa position, et, voulant assurer aux siens un lieu pour
la retraite, il s'empare de deux haueurs voisines l'une
de l'autre. L'une, peu spacieuse pour un campement,
était rafraîchie par une source abondante ;
l'autre offrant une position favorable, par son
élévation et son escarpement, n'exigeait
que peu d'ouvrages pour devenir inexpugnable. Marius
ordonne donc à Sylla de passer la nuit
auprès de la source avec la cavalerie. Pour lui,
au milieu des ennemis non moins en désordre que
les Romains, réunissant de proche en proche ses
soldats dispersés, il en forme un seul corps,
qu'il conduit au pas accéléré sur la
seconde hauteur. |
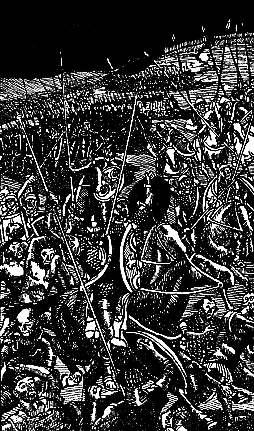 |
XCIX. Pleinement
rassuré par l'impéritie des ennemis, Marius
prescrit d'observer le plus rigoureux silence, et
défend aux trompettes de sonner, selon l'usage, pour
les veilles de la nuit ; puis, à peine le jour
commence-t-il à poindre, à peine l'ennemi
fatigué vient-il de céder au sommeil, que tout
à coup les trompettes des gardes avancées, ceux
des cohortes, des escadrons, des légions, sonnent
à la fois la charge, et les soldats, poussant un grand
cri, s'élancent hors des portes. A ce bruit effroyable
et nouveau pour eux, Maures et Gétules, subitement
réveillés, ne savent ni fuir, ni prendre leurs
armes, ni rien faire, ni rien prévoir pour leur
défense ; tant le bruit et les cris de nos soldats, et
l'abandon où ils se trouvent contre notre brusque
attaque, au milieu de cet affreux tumulte, les ont
épouvantés et comme anéantis ! Enfin ils
sont, sur tous les points, taillés en pièces et
mis en fuite ; la plus grande partie de leurs armes et de
leurs étendards tombent en notre pouvoir, et ils
eurent plus d'hommes tués dans ce combat que dans tous
les précédents : car le sommeil et
l'excès de la terreur les avaient
empêchés de fuir.
C. Bientôt Marius
continue sa route vers ses quartiers d'hiver, que, pour la
facilité des approvisionnements, il avait
résolu d'établir dans des villes maritimes.
Cependant la victoire ne lui inspire ni négligence ni
orgueil : comme s'il était en présence de
l'ennemi, il marche toujours en bataillon carré.
Sylla, avec la cavalerie, commandait l'extrême droite ;
à la gauche, A. Manlius, avec les frondeurs, les
archers et les cohortes liguriennes ; enfin, à l'avant
et â l'arrière-garde, étaient
placés des tribuns avec quelques compagnies
armées à la légère. Les
transfuges, sang vil, mais qui connaissaient parfaitement les
lieux, éclairaient la marche de l'ennemi. Le consul,
comme s'il n'eût rien prescrit, veillait à tout,
se portait auprès de tous, et distribuait, à
qui de droite l'éloge ou la réprimande ;
toujours armé, toujours sur ses gardes, il voulait que
le soldat le fût toujours aussi. Non moins vigilant
pour la défense du camp que pendant la marche, il
faisait veiller aux portes des cohortes tirées des
légions, et en avant du camp une partie de la
cavalerie auxiliaire. Il en plaçait d'autres dans des
retranchements au-dessus de la palissade d'enceinte, faisant
même la ronde en personne, non qu'il craignît
l'inexécution de ses ordres, mais afin que le soldat,
en voyant son général partager ses travaux, s'y
portât toujours de bonne volonté. Et certes,
dans cette circonstance, comme dans tout le cours de cette
guerre, ce fut par l'honneur bien plus que par le
châtiment que Marius maintint la discipline dans son
armée : désir ambitieux de flatter le soldat,
ont dit quelques-uns ; d'autres ont prétendu
qu'habitué dès l'enfance à une vie dure
il s'était fait un plaisir de tout ce qui est une
peine pour les autres. Quoi qu'il en soit, par cette
conduite, Marius servit aussi bien et aussi glorieusement
l'Etat qu'il l'eût fait par la rigueur du
commandement.
CI. Enfin, le
quatrième jour, non loin de la ville de Cirta, les
éclaireurs se montrent de tous côtés
à la fois, ce qui annonçait l'approche de
l'ennemi. Mais comme, venant de divers points, ils faisaient
tous le même rapport, le consul, incertain sur l'ordre
de bataille qu'il doit choisir, ne change rien à ses
dispositions, et, prêt à faire face de toutes
parts, il attend de pied ferme. Ainsi fut trompé
l'espoir de Jugurtha, qui avait partagé ses troupes en
quatre corps, comptant que, sur ce nombre, quelques-uns au
moins surprendraient l'ennemi en queue.
Cependant Sylla, qui se trouve atteint le premier, exhorte
les siens, en forme un escadron bien serré, et fond
sur les Maures. Le reste de ses cavaliers, gardant leur
position, se garantissent des traits lancés de loin ;
tout ennemi qui vient à leur portée tombe sous
leurs coups. Pendant que la cavalerie est ainsi
engagée (126), Bocchus attaque
l'arrière-garde des Romains avec un corps d'infanterie
que son fils Volux lui avait amené, mais qu'un retard
dans sa marche avait empêché de se trouver au
dernier combat. Marius était alors à
l'avant-garde, contre laquelle Jugurtha dirigeait sa
principale attaque. Le Numide, ayant appris l'arrivée
de Bocchus, accourt secrètement, avec quelques hommes
de sa suite, vers l'infanterie de son allié :
là, il s'écrie en latin (car il avait appris
notre langue devant Numance), que toute résistance de
la part des nôtres est inutile, qu'il vient de tuer
Marius de sa propre main ; en même temps il fait voir
son épée teinte du sang d'un de nos fantassins
qu'il avait bravement mis hors de combat. Cette nouvelle,
bien plus par l'horreur que par la confiance qu'elle,
inspire, jette l'épouvante dans nos rangs. De leur
côté, les Barbares sentent redoubler leur
courage, et poussent avec une nouvelle ardeur les Romains
abattus. Déjà les nôtres étaient
presque en fuite, lorsque Sylla, après avoir
taillé en pièces le corps qu'il avait eu
à combattre, revient et prend les Maures en flanc.
Bocchus s'éloigne aussitôt.
Cependant Jugurtha, qui veut soutenir partout les siens, et
retenir la victoire, qu'il a pour ainsi dire dans les mains,
se voit entouré par notre cavalerie ; tous ses gardes
tombent à droite, à gauche; enfin, seul, il se
fait jour au travers de nos traits, qu'il sait éviter.
De son côté, Marius, après avoir
repoussé la cavalerie, vole au secours des siens, dont
il vient d'apprendre l'échec. Enfin les ennemis sont
battus de toutes parts. Alors quel horrible spectacle dans
ces plaines découvertes ! Les uns poursuivent, les
autres fuient ; ici on égorge, là on fait des
prisonniers ; hommes, chevaux, gisent abattus ; les
blessés, et le nombre en est grand, ne peuvent ni fuir
ni supporter le repos ; un instant ils se relèvent
avec effort, et retombent aussitôt : aussi loin enfin
que la vue peut s'étendre, ce ne sont que monceaux de
traits, d'armes et de cadavres ; et dans les intervalles, une
terre abreuvée de sang.
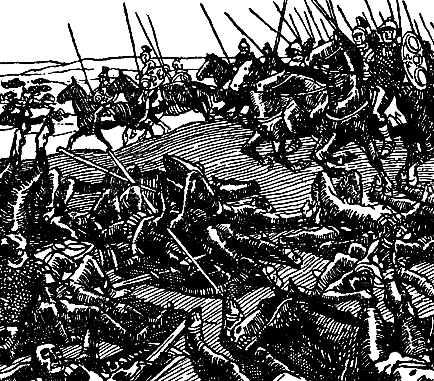 |
II. Dès lors assuré de la
victoire, le consul gagne enfin Cirta, premier but de sa
marche. Cinq jours après la seconde défaite des
Barbares, arrivent dans cette ville des députés
de Bocchus, d'après les instructions de leur roi, ils
demandent à Marius d'envoyer auprès de lui deux
hommes investis de toute sa confiance, et avec lesquels
Bocchus discutera ses intérêts et ceux du peuple
romain. Marius fait aussitôt partir L. Sylla (127) et A. Manlius.
Quoique venus sur la demande du roi, ils crurent cependant
devoir lui faire les premières ouvertures, soit pour
changer ses dispositions hostiles, s'il pensait à
rester ennemi, soit, dans le cas où il souhaiterait la
paix, pour la lui faire désirer plus ardemment.
Cédant à l'éloquence le privilège
que l'âge lui donnait, Manlius laissa la parole
à Sylla, qui adressa au roi ce peu de paroles :
«0 roi Bocchus ! notre joie est grande de voir que les
dieux aient inspiré à un homme tel que vous la
résolution de préférer enfin la paix
à la guerre, de ne pas souiller la noblesse de son
caractère en s'associant au plus détestable des
hommes, à un Jugurtha, et en même temps de nous
épargner la dure nécessité de punir
également votre erreur et sa profonde
scélératesse. Le peuple romain, d'ailleurs, a
mieux aimé, dès sa plus faible origine, se
faire des amis qu'enchaîner des esclaves, et il a
trouvé plus sûr de régner par l'affection
que par la force. Quant à vous, aucune alliance ne
vous est plus favorable que la nôtre ; d'abord
l'éloignement préviendra entre nous tout motif
de mésintelligence, sans nous empêcher de vous
servir comme si nous étions proches voisins ; ensuite,
si nous avons bien assez de sujets, nous n'avons ni nous, ni
personne, jamais assez d'amis. Et plût aux dieux qu'ils
vous eussent ainsi inspiré dès le commencement
! Certes, vous auriez aujourd'hui reçu du peuple
romain plus de bienfaits que vous n'en avez essuyé de
maux. Mais, puisque la fortune, qui maîtrise la plupart
des événements humains, a voulu vous faire
éprouver notre pouvoir aussi bien que notre
bienveillance, aujourd'hui qu'elle vous offre l'occasion,
hâtez-vous, achevez votre ouvrage. Il se
présente à vous bien des moyens faciles de
faire oublier votre erreur par vos services. Enfin,
pénétrez-vous bien de cette pensée, que
jamais le peuple romain n'a été vaincu en
générosité ; pour ce qu'il vaut à
la guerre, vous le savez par vous-même». A ce
discours, Bocchus répond avec douceur et courtoisie.
Après quelques mots de justification, il ajoute que
«ce n'est pas dans un esprit hostile, mais pour la
défense de ses Etats, qu'il a pris les armes ; que, la
partie de la Numidie d'où il avait chassé
Jugurtha étant devenue sa propriété par
le droit de la guerre, il n'a pu la laisser dévaster
par Marius ; qu'en outre, les députés qu'il
avait précédemment envoyés à Rome
pour obtenir notre alliance avaient essuyé un refus ;
qu'au reste il ne veut plus parler du passé, et que,
si Marius le permet, il va envoyer une seconde ambassade au
sénat». Cette proposition est accueillie ; mais
bientôt, à l'instigation de ses confidents, le
Barbare changea de résolution. Instruit de la mission
de Sylla et de Manlius, Jugurtha en avait craint le
résultat, et il les avait gagnés par des
présents.
CIII. Cependant Marius,
après avoir distribué ses troupes dans les
quartiers d'hiver, traverse le désert à la
tête des cohortes armées à la
légère et d'une partie de la cavalerie, et va
faire le siège d'une forteresse royale où
Jugurtha avait mis en garnison tous les transfuges. Alors
nouvelle détermination de Bocchus : soit qu'il
eût réfléchi sur la fatale issue des deux
derniers combats, soit qu'il se rendît aux conseils de
ceux de ses confidents que Jugurtha n'avait pu corrompre, il
choisit dans la foule de ses courtisans cinq hommes dont le
dévouement, les talents et la résolution lui
sont connus. Il les charge d'aller, comme
députés, auprès de Marius, puis à
Rome, si le consul y consent, avec pleins pouvoirs d'y
négocier et d'y conclure la paix à quelque prix
que ce soit.
Ils partent aussitôt pour les quartiers des Romains ;
mais, chemin faisant, ils sont attaqués et
dépouillés par des brigands gétules.
Tremblants, dans l'état le plus misérable, ils
se réfugient auprès de Sylla, que le consul,
partant pour son expédition, avait laissé en la
qualité de préteur. Sylla les reçut, non
comme des ennemis sans foi, ainsi qu'ils le
méritaient, mais avec égard et
générosité. Cette conduite fit croire
aux Barbares qu'on accusait à tort les Romains
d'avarice, et que Sylla, qui les traitait avec tant de
munificence, ne pouvait être que leur ami. En effet,
dans ce temps encore, on connaissait à peine les
largesses intéressées ; point de
libéralité qui ne passât pour une preuve
de bienveillance : tout don semblait offert par le
coeur.
 |
Ils communiquent donc au
questeur les instructions de Bocchus ; ils lui demandent en
même temps son appui, ses conseils ; ils vantent, dans
un long discours, les forces, la loyauté, la grandeur
de leur souverain ; ils ajoutent tout ce qu'ils croient utile
à leur cause ou propre à gagner la
bienveillance. Enfin, après que Sylla leur a tout
promis, et les a instruits de la manière dont ils
doivent parler à Marius et ensuite au sénat,
ils restent auprès de lui environ quarante jours,
attendant le consul.
CIV. Marius, de retour
à Cirta, sans avoir réussi dans son entreprise,
est instruit de l'arrivée des députés ;
il les fait venir, ainsi que Sylla, L. Bellienus,
préteur à Utique, et en outre tous les
sénateurs qui étaient dans la province. Avec
eux, il prend connaissance des instructions données
par Bocchus, de la demande qu'il fait au consul d'envoyer ses
ambassadeurs à Rome, et de son offre d'une suspension
d'armes pendant les négociations. Sylla et la
majorité du conseil agréent ces propositions ;
quelques-uns s'y opposent avec dureté, oubliant sans
doute l'instabilité, l'inconstance des
prospérités humaines, toujours prêtes
à se changer en revers. Cependant les Maures ont tout
obtenu ; et trois d'entre eux partent pour Rome avec Cn.
Octavius Rufus, questeur, qui avait apporté la solde
des troupes en Afrique ; les deux autres retournent vers leur
roi. Bocchus apprit d'eux avec plaisir le résultat de
leur mission, surtout la bienveillance et le bon accueil de
Sylla. Arrivés à Rome, ses ambassadeurs
(128) demandent
grâce pour l'erreur de leur maître, qui n'a
failli que par le crime de Jugurtha, sollicitent l'alliance
et l'amitié du peuple romain. On répond :
«Le sénat et le peuple romain n'oublient ni les
bienfaits ni les injures cependant, puisque Bocchus se
repent, on lui pardonne sa faute : alliance et amitié
lui seront accordées quand il l'aura
mérité».
CV. Informé de
cette réponse, Bocchus écrit à Marius
pour le prier de lui envoyer Sylla, qui prononcera comme
arbitre sur leurs intérêts communs. Sylla
reçoit ordre de partir avec une escorte
composée de cavaliers, de fantassins, de frondeurs
baléares, puis d'archers et d'une cohorte de
Péligniens ; ils sont armés comme les
vélites ; ils pourront ainsi accélérer
leur marche, et ils seront suffisamment garantis contre les
traits légers des Numides. Enfin, après une
route de cinq jours, Volux, fils de Bocchus, se montre tout
à coup dans ces vastes plaines avec mille chevaux tout
au plus. Cette troupe éparse et sans ordre
paraît à Sylla et à tous ses soldats
beaucoup plus nombreuse. On craint que ce ne soit l'ennemi.
Chacun prend aussitôt son poste, dispose ses traits,
ses armes, et se tient prêt ; mais ce léger
accès de crainte cède bientôt à
l'espérance, sentiment naturel à des vainqueurs
en présence de ceux qu'ils avaient souvent vaincus.
Cependant des cavaliers, envoyés en reconnaissance,
annoncent, ce qui était en effet, qu'on n'avait
à craindre aucune hostilité.
 |
CVI. Volux arrive, et, s'adressant au questeur, se
dit envoyé par son père au devant des
Romains pour leur servir d'escorte. Ils marchent donc
sans crainte avec lui jusqu'au lendemain. Mais le jour
suivant, à peine a-t-on établi le camp, que
tout à coup, sur le soir, le Maure, avec un air de
trouble, accourt vers Sylla. «Il vient d'apprendre
par ses éclaireurs que Jugurtha n'est pas loin, il
faut donc fuir secrètement avec lui pendant la
nuit ; il l'en conjure avec instance». |
CVII. Sylla
partage ces soupçons ; toutefois il protège le
Maure contre toute violence : il exhorte les siens
«à conserver leur courage : plus d'une fois,
leur dit-il, une poignée de braves a triomphé
d'ennemis sans nombre : moins vous vous épargnerez
dans le combat, moins vous aurez à craindre ; quelle
honte pour le guerrier, dont les bras sont armés, de
chercher une défense dans ses pieds, qui sont sans
armes, et de tourner à l'ennemi, par l'excès de
la crainte, la partie du corps qui ne peut ni voir ni parer
les coups !» Ensuite, après avoir pris le grand
Jupiter à témoin du crime et de la perfidie de
Bocchus, il ordonne à Volux, puisqu'il a agi en
ennemi, de sortir du camp. Volux le conjure, les larmes aux
yeux, «de renoncer à une telle pensée, il
lui proteste qu'il ne l'a trahi en rien : il faut tout
imputer à la sagacité de Jugurtha, qui, par ses
espions, avait eu sans doute connaissance de sa marche. Il
ajoute que Jugurtha, qui n'a point une troupe
considérable, et qui n'a de ressource et d'espoir que
dans Bocchus, n'osera rien ouvertement en présence du
fils de son protecteur : le meilleur parti lui semble donc de
passer hardiment au milieu du camp de Jugurtha. Quant
à lui, soit qu'on détache en avant, soit qu'on
laisse en arrière l'escorte de ses Maures, il ira seul
avec Sylla». Un tel expédient, dans l'embarras
où l'on se trouve, est adopté. Les Romains se
mettent en marche à l'instant. Surpris de leur
arrivée imprévue, Jugurtha hésite, reste
en suspens ; ils passent sans obstacle, et arrivent en peu de
jours à leur destination.
CVIII. Auprès de
Bocchus était alors un Numide, nommé Aspar,
admis dans son intime familiarité. Jugurtha l'avait
envoyé pour défendre ses intérêts
et pour épier avec adresse les desseins du roi maure,
sitôt qu'il avait appris que Sylla avait
été mandé par ce prince. Près de
Bocchus était aussi Dabar, fils de Massugrada, de la
famille de Masinissa (129), mais
illégitime du côté maternel, car son
père était né d'une concubine. Les
agréments de son esprit le rendaient cher et
agréable à Bocchus, qui, ayant eu plusieurs
fois l'occasion de reconnaître son attachement pour
Rome, l'envoya aussitôt annoncer à Sylla qu'il
était prêt à faire tout ce que
demanderait le peuple romain, que Sylla fixât
lui-même le jour, le lieu, le moment d'une entrevue,
aucun engagement antérieur n'entraverait leur
délibération et la présence de
l'envoyé de Jugurtha ne devait lui causer aucun
ombrage : on ne l'avait appelé que pour rendre leur
négociation plus facile ; c'était, d'ailleurs,
le meilleur moyen de prévenir les entreprises de ce
prince artificieux. Quant à moi, j'en suis convaincu,
Bocchus, agissant d'après la foi punique (130) plutôt que
d'après les motifs qu'il mettait en avant, amusait en
même temps les Romains et le Numide par
l'espérance de la paix ; longtemps il
délibéra en lui-même s'il livrerait
Jugurtha aux Romains, ou Sylla au Numide, et ses affections,
qui nous étaient contraires, ne cédèrent
qu'à la crainte, qui parla pour nous (131).
CIX. Sylla répond
qu'il dira peu de choses en présence d'Aspar : le
reste se traitera en secret, avec le roi seul, ou avec le
moins possible de témoins ; il dicte en même
temps la réponse que Bocchus devra lui faire
publiquement. L'entrevue ayant donc lieu comme il l'avait
demandé, Sylla dit qu'il a été
envoyé par le consul pour demander à Bocchus
s'il voulait la paix ou la guerre. Alors le roi, comme on le
lui a prescrit, ordonne à Sylla de revenir dans dix
jours : il n'a encore pris aucune détermination, mais
il donnera alors sa réponse ; puis ils se
séparent et retournent dans leur camp. Mais, bien
avant dans la nuit, Bocchus mande en secret Sylla ; ils
n'admettent l'un et l'autre que des interprètes
sûrs, et pour médiateur Dabar, homme
irréprochable (132), également
estimé de tous deux. Dès l'abord Bocchus
adresse à Sylla ces paroles :
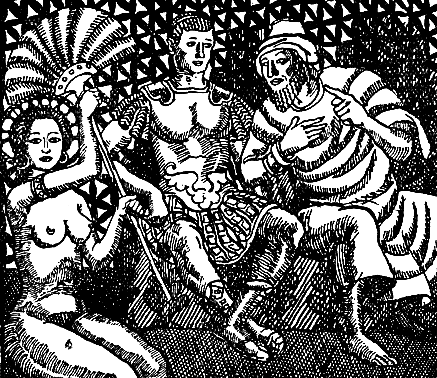 |
CX. «Monarque le plus puissant de ces
contrées et de tous les rois que je connais, je n'ai
jamais pensé que je pusse un jour avoir des
obligations à un simple particulier. Oui, Sylla, avant
de vous avoir connu, j'ai souvent accordé mon appui
aux uns quand ils me l'ont demandé, aux autres de mon
propre mouvement, et jamais je n'ai eu besoin de celui de
personne. J'ai perdu cet avantage ; mais, loin de m'en
affliger comme feraient bien d'autres, je m'en
félicite, et je m'estimerai heureux d'avoir eu besoin
de votre amitié, que mon coeur préfère
à tout. Oui, vous pouvez me mettre à
l'épreuve : armes, soldats, trésors, prenez
tout, disposez de tout ; tant que vous vivrez, ne croyez pas
que ma reconnaissance soit jamais satisfaite, elle sera
toujours entière ; enfin, quels que soient vos
souhaits, si j'en suis informé, vous ne les formerez
pas en vain ; car, à mon avis, il est plus humiliant
pour un roi d'être vaincu en
générosité que par les armes. Quant aux
intérêts de Rome, dont vous êtes
auprès de moi le mandataire, voici en peu de mots ma
déclaration. Je n'ai point fait, je n'ai jamais eu
l'intention de faire la guerre au peuple romain : mes
frontières ont été attaquées : je
les ai défendues les armes à la main ; mais je
passe là-dessus, puisque vous le désirez ;
faites comme vous l'entendrez la guerre à Jugurtha. De
mon côté, je ne franchirai pas le fleuve
Mulucha, qui servait de limite entre Micipsa et moi, et
j'empêcherai Jugurtha de le traverser. Au reste, si
vous me faites quelque demande digne de Rome et de moi, vous
n'essuierez point un refus».
CXI. A ce discours Sylla
répond, sur ce qui lui est personnel, en peu de mots
et avec réserve : il s'étend beaucoup sur la
paix et sur les intérêts des deux nations.
Enfin, il déclare franchement au roi «que toutes
ses promesses ne toucheront guère le sénat ni
le peuple romain, qui ont eu sur lui l'avantage des armes ;
il lui faut donc faire quelque chose qui paraisse plus dans
l'intérêt de Rome que dans le sien ; il en a,
dès l'instant même, le moyen, puisqu'il peut
s'assurer de la personne de Jugurtha ; s'il le livre aux
Romains, alors on lui aura de réelles obligations ;
l'amitié de Rome, son alliance, une partie de la
Numidie, qu'il peut demander dès à
présent, tout cela va sur-le-champ être à
lui». Bocchus, au premier abord, refuse vivement :
«Le voisinage, la parenté, une alliance enfin,
sont pour lui de puissants obstacles ; il craint même,
s'il manque à sa foi, de s'aliéner ses propres
sujets, qui ont de l'affection pour Jugurtha et de
l'éloignement pour les Romains». Cependant,
lassé des instances réitérées de
Sylla, il promet, d'assez bonne grâce, de faire tout ce
que voudra celui-ci. Du reste, tous deux arrêtent leurs
mesures pour faire croire à la paix, que désire
ardemment le Numide, fatigué de la guerre. Leur
perfide complot ainsi concerté, ils se
séparent.
CXII. Le lendemain, le roi
mande Aspar, l'envoyé de Jugurtha ; il lui dit qu'il
a, «par l'organe de Dabar, appris de Sylla que l'on
peut, au moyen d'un traité, mettre fin à la
guerre ; qu'il ait donc à demander à son
maître quelles sont ses intentions». Aspar,
joyeux, se rend au camp de Jugurtha. Il en reçoit des
instructions sur tous les points, et, hâtant son
retour, il arrive, au bout de huit jours, auprès de
Bocchus. Voici ce qu'il annonce : «Jugurtha
accédera volontiers à tout ce que l'on exigera
; il a peu de confiance en Marius ; plus d'une fois
déjà, ses traités, conclus avec les
généraux romains, n'ont point été
ratifiés ; au surplus, si Bocchus veut travailler pour
leurs intérêts communs, et arriver à une
paix définitive, il doit faire en sorte que toutes les
parties intéressées aient une entrevue, comme
pour négocier, et là il livrera Sylla à
Jugurtha ; dès qu'un personnage si important sera
entre ses mains, le sénat et le peuple romain voudront
à tout prix faire la paix, et n'abandonneront pas un
patricien illustre, que son zèle pour l'Etat, et non
sa lâcheté, aurait fait tomber au pouvoir de
l'ennemi».
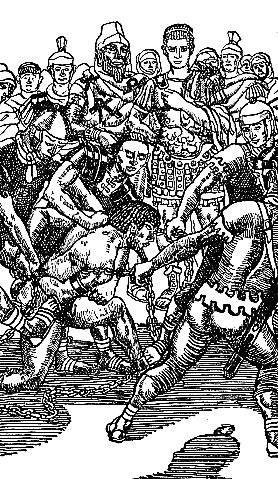 |
CXIII. A cette proposition, le Maure reste
plongé dans une longue rêverie ; il promet
enfin. Pensait-il à tromper Jugurtha ?
était-il de bonne foi ? C'est ce que nous ne
saurions décider. Chez les rois, les
résolutions sont, la plupart du temps, aussi
mobiles qu'absolues, souvent tout à fait
contradictoires. Ensuite, à des heures et dans un
lieu convenus, Bocchus mande auprès de lui
tantôt Sylla, tantôt l'envoyé de
Jugurtha ; il les accueille tous deux avec bienveillance,
et leur fait les mêmes promesses : l'un et l'autre
sont également pleins de joie et
d'espérance. Dans ia nuit qui
précéda le jour fixé pour la
conférence, le Maure appela près de lui ses
amis ; puis, prenant un autre parti, il les
congédia aussitôt. Livré ensuite,
dit-on, à mille réflexions, il changeait,
à chaque résolution nouvelle, de contenance
et de visage, trahissant ainsi, malgré son
silence, les secrètes agitations de son
âme. |
CXIV. Vers ce même temps, nos généraux Q.Cépion et M.Manlius se firent battre par les Gaulois. A cette nouvelle, toute l'Italie trembla d'effroi. Les Romains avaient alors, comme de nos jours, la pensée que tous les autres peuples doivent céder à leur courage, mais qu'avec les Gaulois, quand on combat, il ne s'agit plus de gloire, mais du salut de la République. Dès qu'on sut à Rome la guerre de Numidie terminée, et que Jugurtha y était amené chargé de chaînes, Marius, quoique absent, fut nommé consul (134), et on lui décerna le département de la Gaule. Ensuite, aux calendes de janvier, il triompha consul (135), ce qui était une haute distinction. En lui résidaient alors la force et l'espoir de la République.
| (96) Une fille de Bocchus avait épousé Jugurtha. - Quelques éditions, au lieu de Jugurthae filia Bocchi nupserat, portent Boccho nupserat, d'où plusieurs critiques et le P. d'Ottoville ont conclu que Bocchus était gendre de Jugurtha. Cette difficulté provient des manuscrits de Salluste, qui, par leur diversité, autorisent l'une et l'autre opinion. Après Cortius, le président de Brosses et M. Burnouf, je me suis déterminé par l'autorité de Florus, qui fait Jugurtha gendre de Bocchus (liv. III, 1), et par les expressions mêmes de Salluste, Jugurthae filia Bocci nupserat, telles que les a citées le grammairien Nonius, dont l'ouvrage est plus ancien qu'aucun manuscrit qui nous reste de notre historien. Ceux qui font Bocchus gendre de Jugurtha se fondent sur un passage de Plutarque (Vie de Marius), et principalement sur une médaille qui représente Bocchus livrant Jugurtha à Sylla. Or, dans cette médaille, Jugurtha, enchaîné et le visage couvert d'une longue barbe, parait plus âgé que Bocchus ; mais la circonstance a pu engager l'artiste à donner au prince captif cet air de vieillesse. | |
| (97) Au
gré du vainqueur. - Silius Italicus a
exprimé la même pensée : Non est, mihi credite, non est / Arduis in pugnas ferri labor ; una reclusis / Omnes jam portis in campum effuderit hora. / Magnum illud solisque datum, quos mitis euntis / Jupiter adspext, magnum est ex hoste reverti. Remarquons en passant combien le style du poëte est inférieur à celui de l'historien. |
|
| (98) Et
ne cesse de les attaquer. - Plutarque rapporte
à peu près dans les mêmes
termes les propos que tenait Marius contre la
noblesse. Il donne aussi la substance du discours
que va lui faire tenir directement Salluste. |
|
| (99) Un
supplément aux légions. - Ainsi
que Beauzée, j'ai dit supplément, et
non pas recrue, parce qu'il s'agit probablement
d'une augmentation que Marius fit en effet au
nombre ordinaire dont était composée
la légion. Avant lui elle était de
quatre mille hommes, et il la porta jusqu'à
six mille deux cents. |
|
| (100) S'ils
ont failli. - La même pensée se
trouve exprimée par Cicéron
(second Discours sur la loi Agraire, ch.
XXXVI) : Quemadmodum quum petebam, nulli me
vobis auctores generis mei commendarunt : sic si
quid deliquero, nullae sunt imagines, quae me a
vobis deprecentur. |
|
| (101) Tous
les autres appuis sont bien faibles. - Ici ces
mots, nam cetera infirma sunt, ont
été entendus différemment par
presque tous ceux qui m'ont
précédé : car les autres
appuis me manquent, ont-ils traduit ; mais, pesant
plutôt que comptant les autorités,
j'ai suivi le sens indiqué par Dureau
Delamalle et M. Burnouf. En effet, l'autre version
ne serait qu'une froide et inutile
répétition de mihi spes omnes in
memet sitae, qui se trouve deux lignes plus
haut. Marius est d'autant plus fondé
à dire ce que notre traduction lui
prête, que tout récemment un
Posthumius Albinus, un Calpurnius, un Galba, un
Caton, venaient d'être condamnés
à l'exil pour leurs concussions,
malgré l'éclat de leur noblesse et
tous les appuis qu'ils auraient pu trouver dans
leurs alliances et leurs nombreux clients.
(101) |
|
| (102) N'attend
que le moment de l'attaque. - Ici je
diffère de tous les traducteurs, sans en
excepter Dureau Delamalle ; mais j'ai pour moi
l'interprétation de M. Burnouf. En effet,
selon ce que Marius avait intérêt
à faire croire, ce n'était pas
seulement contre lui, mais contre le peuple entier
que la noblesse était conjurée. Ce
qui le prouve, c'est qu'il ajoute : mihi
adnilendum est ne vos capiamini ; et ici il
faut entendre capiamini dans le sens
d'opprimamini. Ce n'était pas pour
lui, mais pour ses concitoyens qu'il pouvait avouer
ses craintes. |
|
| (103) Que
vous ne soyez point opprimés. - Tous les
traducteurs ont entendu capiamini dans le
sens de decipiamini, parce qu'ils n'avaient
pas compris la portée du mot
invadendi qui précède. C'est
encore M. Burnouf qui a indiqué ce nouveau
sens. Capiamini, dit-il, ejusdem
translationis est quam invadendi. Qui enim invadit
vult capere. |
|
| (104) Pour
l'importance et pour les résultats. -
C'est encore un sens indiqué par M. Burnouf,
sur un passage qu'aucun traducteur n'avait compris
ou du moins rendu d'une manière
satisfaisante. |
|
| (105) La
gloire des ancêtres est comme un
flambeau. - Il faut encore citer ici les
poètes qui offrent une imitation de ces
belles maximes, que Salluste met dans la bouche de
Marius : Incipit ipsorum contra te stare parentum Nobilitas, claremque facem praeferre pudendis. Juvénal, sat. VIII, v. 138. Mais, fussiez-vous issu d'Hercule en droite ligne, Si vous ne faites voir qu'une bassesse indigne, Ce long amas d'aïeux que vous diffamez tous Sont autant de témoins qui parlent contre vous ; Et tout ce grand éclat de leur gloire ternie Ne sert plus que de jour à votre ignominie. (Boileau, Sat. V). |
|
| (106) Les
cicatrices qui sillonnent ma poitrine. - Si
je n'ai point d'aïeux, comptez mes
cicatrices. (Ducis, Othello, I,
5). |
|
| (107) Mes
discours sont sans apprêt - Né
sous un ciel sauvage et nourri loin des cours, / On
ne m'a point appris à farder mes discours.
(Ducis, Othello, I, 5). |
|
| (108) L'art
littéraire des Grecs. - Marius ne put
jamais souffrir aucun homme de lettres, si ce n'est
le poëte Archias, qui avait composé un
poëme sur ses conquêtes. Il croyait
aussi que les éloges d'un homme comme
Plotius devaient ajouter à sa gloire. C'est
ce qui a donné lieu à Cicéron
(pro Archia, c.IX) de remarquer qu'il n'est
point d'homme si ennemi des Muses qui ne les trouve
agréables quand elles chantent ses
louanges. |
|
| (109) Que
le déshonneur. - Summum crede nefas
animum praeferre pudori. (Juvénal, sat
VIII, v. 83). |
|
| (110) Ainsi
doit-il s'exercer entre concitoyens. -
Civile imperium, c'est-à-dire cive
dignum civibus imperante (Burnouf). Tite-Live a
dit (liv. VI, ch. CI) : sermonem minime
civilem ; c'est-à-dire un discours dans
lequel les droits des citoyens étaient
attaqués. |
|
| (111) Ni
se recevoir. - Sénèque a dit :
Bona mens nec commodatur, nec emitur ; et puto,
si venalis esset, non haberet emptorem : at mala
quotidie emitur. (Ep. XXVII.) |
|
| (112) Plus
cher qu'un valet de charrue. - «Chez nos
ancêtres, dit Tite-Live, le cuisinier
était le moindre des domestiques d'une
maison, et celui dont les gages étaient les
plus modiques. Aujourd'hui les choses sont bien
changées ; ce qui était un service
est devenu un art». (Liv. VIII, ch. II) |
|
| (113) La
lâcheté ne rend personne immortel.
- Mors et fugacem persequitur virum.
(Horat., Carm., III, 2. |
|
| (114) Assez
pour eux. - Ce discours de Marius est
peut-être le plus éloquent qu'on lise
dans Salluste ; on sait cependant que Marius
n'était rien moins que disert : aussi la
plupart des critiques n'ont pas
hésité à faire honneur
à cet historien de cette composition
oratoire. Le président de Brosses est d'un
avis tout opposé ; il trouve cette harangue
d'un style grossier, sans méthode, pleine de
redites, conforme au peu d'éducation de
Marius, et se croit obligé de s'excuser de
n'avoir pas cru devoir en user de même dam sa
traduction. Pour trouver cette harangue originale,
il se fonde sur ce que Plutarque (in Mario),
en rapportant en substance le discours de Marius,
présente des idées et même des
expressions conformes à celles que Salluste
met dans la bouche de ce général.
Mais qui saurait dire aujourd'hui que le biographe
qui vivait sous les Antonins ne les a pas
puisées dans Salluste lui-même ?
«Quoi qu'il en soit, observe le judicieux M.
Burnouf, il est certain que cette harangue est de
la main de Salluste, mais composée de telle
sorte, qu'on y retrouve la vivante image de Marius.
En effet, d'un bout à l'autre, c'est le
style de notre historien, sa manière, le
choix bizarre de ses expressions, parmi lesquelles
on reconnaît des mots dérivés
du grec que Marius n'employa certainement jamais.
Mais ces pensées sans apprêt,
grossières même, tirées de la
vie agricole, et cette censure acerbe des vices de
la noblesse qui revient sans cesse, donnent une
idée véritable de son
caractère. S'il est vrai enfin qu'il n'ait
pas prononcé ce discours, il n'en est aucune
expression qui ne lui convienne
parfaitement». |
|
| (115) Calcul
d'ambition de la part du consul. - Montesquieu
a dit : «Marius prit toutes sortes de gens
dans les légions, et la république
fut perdue». Ce grand écrivain me
semble ici énoncer dans un sens trop absolu
une observation que Salluste n'a exprimée
que d'une manière hypothétique.
Marius pouvait-il faire autrement que
d'enrôler les pauvres dont l'excessive
population surchargeait Rome, au lieu de forcer
à s'enrôler de riches
réfractaires ? Etait-il le maître d'en
agir autrement ? Si, par la suite, il ne se
fût pas servi de ces soldats pris dans les
dernières classes pour opprimer et proscrire
le parti du sénat, n'aurait-on pas dû
au contraire louer comme une mesure sage et
prévoyante de sa part l'enrôlement
d'une multitude indigente et factieuse ? |
|
| (116) Les
plus indigents - Salluste présente la
même réflexion dans la
Catilinaire, chap. XXXVIII : Egestas
facile habetur sine damno. C'est dans le
même sens que Pétrone a dit : Inops
audacia tuta est. |
|
| (117) Cher
au peuple et au sénat. - Salluste passe
un peu légèrement sur ce qui concerne
Metellus depuis son retour de Numidie. Après
un triomphe magnifique attesté par Velleius,
Aulu-Gelle et Eutrope, cet habile
général fut accusé de
concussion par le tribun Manlius ; mais les juges
ne jetèrent pas même les yeux sur ses
registres, qu'il leur présenta ; aucun d'eux
ne voulut paraître douter de la
probité de cet illustre Romain.
(Cicéron, Discours pour Corn.
Balbus.) |
|
| (118) Les
siens en haleine. - Plutarque (Vie de
Marius) et Frontin (liv. IV, ch. 1, n° 7)
donnent le détail des travaux énormes
que Marius imposait à son armée. Pour
que les chariots de bagages n'embarrassassent point
sa marche, il obligeait le soldat à porter
derrière son dos ses vivres, sa tente et
tous ses effets d'équipement roulés
en un ballot, ce qui faisait un fardeau excessif
pour des gens chargés d'une cuirasse, de
leurs javelines et d'un bouclier, et qui avaient en
outre, sur le dos, de gros pieux pour retrancher le
camp. On nomma, par plaisanterie, mulets de
Marius, les soldais de ce général
ainsi chargés. Plutarque (ibid.)
assigne une origine différente à ce
dicton. |
|
| (119) Les
Gétules. - Outre les Gétules, dit
Paul Orose, Jugurtha avait encore tiré de
l'armée de Bocchus une très grosse
troupe de cavalerie maure, avec laquelle il faisait
à tout moment des courses
précipitées, qui, tenant sans cesse
en haleine l'année romaine, la fatiguaient
au dernier point. |
|
| (120) Ni
la cruauté ni l'avarice du consul. -
Salluste, en excusant la conduite atroce de Marius,
donne la mesure de la politique romaine, qui, dans
l'intérêt de l'Etat, se croyait tout
permis contre les ennemis du dehors. C'est ce qui a
fait dire au P. d'Otteville :
«Périssent la politique et ses lois si
elles autorisent une conduite aussi barbare
!» |
|
| (121) Un
Ligurien. - Les habitants de la Ligurie
étaient extrêmement agiles, comme tous
les montagnards. Frontin (liv. III, ch. IX) a fait
un abrégé de tout cet endroit de
Salluste. |
|
| (122) Les
centurions. - Cette expression de Salluste,
qui centuriis praeerant, a fait croire
à quelques commentateurs que quatre
centuries avaient été
détachées avec leurs chefs pour
accompagner le Ligurien ; mais Cortius a
relevé cette erreur. Dix hommes seulement
furent chargés de cette entreprise, au
succès de laquelle un plus grand nombre
aurait été un obstacle. C'est pour ce
motif que Marius désignait cinq musiciens,
qui, avec le bruit de leurs instruments, devaient
porter la frayeur parmi les Numides. Cependant il
est juste d'observer que Frontin dit que les
soldats les plus agiles concoururent avec les
centurions et les musiciens à cette
périlleuse tentative ; mais de cette
addition d'un petit nombre d'hommes, à
quatre cents, il y a une différence notable.
En effet, le Ligurien aurait-il pu trouver la force
de rendre à quatre cents soldats tous les
services que Salluste énumère ? Et
les faibles appuis qui purent résister au
poids de dix ou quinze hommes, ne se seraient-ils
pas écroulés sous le fardeau
successif de quatre cents ? |
|
| (123) Former
la tortue. - Cette manoeuvre consistait
à ce que les soldats, serrant et disposant
leurs rangs en conséquence,
élevassent et joignissent leurs boucliers
sur leurs têtes, de manière à
être tous à l'abri des traits de
l'ennemi, comme la tortue sous ses écailles.
L'assemblage de la tortue était si
serré, que de fort lourds fardeaux ne
parvenaient pas à la rompre. Dion Cassius
assure qu'elle était capable de porter
même des chevaux et des chariots, et que l'on
employait quelquefois cette manoeuvre pour leur
faire traverser des ravins. Ammien Marcellin
rapporte qu'au siège des places maritimes on
formait la tortue sur des barques fortement
amarrées ensemble, afin d'attaquer la
muraille du côté de l'eau. Voyez, sur
ce point, une note très
détaillée du président de
Brosses, puis une autre de M. Burnouf, qui, ainsi
qu'il le dit lui-même, l'a puisée dans
Juste-Lipse. |
|
| (124) L.
Sisenna. - Si Salluste appelle Sisenna le
meilleur et le plus exact des historiens,
Cicéron en fait un éloge à peu
près semblable (Brutus). «On peut,
dit-il, juger de ses talents par l'Histoire qu'il a
écrite, supérieure, sans contredit,
à toutes celles qui l'ont
précédée, elle est
néanmoins bien éloignée de la
perfection». L'Histoire de Sisenna avait
vingt-deux livres, commençant à la
prise de Rome par les Gaulois, et se terminant aux
guerres civiles de Sylla. Il avait traduit les
Milésiennes d'Aristide, si l'on en
croit Ovide : Vertit Aristidem Sisenna : nec
obfuit illi / Historiae turpes inseruisse
jocos. |
|
| (125) Jusqu'à
sa victoire sur ses concitoyens. - Sylla
n'avait pas pris le surnom d'Heureux,
même après ses victoires sur
Mithridate ; il ne le prit qu'après avoir
couronné ses sanglantes proscriptions par le
meurtre du jeune Marius. «Il l'eût
porté à plus juste titre, dit
Velleius, s'il eût cessé de vivre le
jour qu'il acheva de vaincre». |
|
| (126) Pendant
que la cavalerie est ainsi engagée. - P.
Orose a donné une description de cette
bataille, assez différente de celle de
Salluste, et les probabilités de la plus
grande exactitude ne sont pas pour lui. Selon
Orose, on combattit pendant trois jours : les deux
premiers ne décidèrent rien ;
seulement les Romains, entourés par soixante
mille hommes de cavalerie, serrés sur un
espace étroit où ils ne pouvaient ni
fuir ni se défendre, firent des pertes
énormes. «Enfin, le troisième
jour, Alarius au désespoir, se fit jour avec
son bataillon à travers l'armée
ennemie, jusque sur un terrain plus spacieux,
d'où il battit en retraite. Mais la
cavalerie africaine continuait d'inquiéter
beaucoup les flancs du bataillon, et même
tuait à coups de traits un grand nombre de
soldats du centre ; outre que l'ardeur du soleil,
la fatigue et la soif achevaient d'abattre les
forces des nôtres. Par un coup du ciel
inespéré, une grosse pluie qui tomba
sur ces entrefaites fut le salut de l'armée
romaine. Elle rafraîchit et
désaltéra nos troupes, en même
temps qu'elle mouilla les armes des ennemis et les
rendit inutiles ; car leurs javelots, qu'ils ne
retiennent pas comme chez nous avec une courroie,
glissaient dans leurs mains et n'avaient plus de
force. Leurs boucliers de cuir
d'éléphant prenaient l'eau comme une
éponge, et devinrent si lourds, qu'il fallut
les jeter à terre ; alors l'épouvante
se répandit parmi eux, les nôtres
reprirent courage, les chargèrent, et les
mirent en déroute. Les deux rois prirent la
fuite, laissant leurs troupes à la merci des
Romains, qui passèrent cinquante mille
hommes au fil de l'épée. Depuis cette
défaite, le roi de Mauritanie ne voulut plus
entendre parler de continuer la guerre, et songea
à faire sa paix particulière».
(Liv. V, chap.XIV) |
|
| (127) L.
Sylla. - Il semble que dans cette guerre de
Numidie la fortune, qui voulait punir Marius de son
ingratitude envers Metellus son
général, ait ménagé
à l'heureux Sylla mainte occasion
d'éclipser celui dont il était le
questeur, sans jamais cesser de le servir avec
dévouement et loyauté. Les deux
batailles que vient de peindre Salluste avec tant
d'éclat et d'énergie en fournissent
la preuve. Dans la première, Marius, surpris
d'abord et contraint à reculer, charge son
questeur, qui commande la cavalerie, d'occuper une
hauteur rafraîchie par une source abondante,
et dont la possession, après avoir
assuré la retraite et le bien-être des
Romains, doit leur procurer pour le lendemain une
revanche complète sur les Barbares, qui, se
croyant vainqueurs, sont campés
négligemment dans la plaine. Quatre jours
après, nouveau combat contre les deux rois
africains. Jugurtha, qui se surpasse
lui-même, est près d'arracher la
victoire aux Romains qui forment le corps de
bataille, et auxquels il fait croire que Marius est
tué ; mais Sylla, toujours à la
tête de la cavalerie, après avoir
repoussé l'aile gauche des ennemis, survient
en ce moment décisif, prend Bocchus en
flanc, le réduit à fuir, et force
Jugurtha de se dessaisir d'une victoire qu'il avait
pour ainsi dire surprise. Enfin, Marius, qui
s'était porté à son
avant-garde menacée, revient pour achever
l'ouvrage si bien commencé par son
lieutenant. |
|
| (128) Arrivés
à Rome, ses ambassadeurs. - Le
président de Brosses cite un fragment
curieux de Diodore de Sicile sur cette
négociation : «Des cinq ambassadeurs
que le roi de Mauritanie avait envoyés
à Utique, trois partirent pour Rome avec
Octavius Ruson ; les deux autres
retournèrent vers leur maître,
à qui ils n'oublièrent pas de faire
le récit de la manière
généreuse dont Sylla en avait
usé à leur égard. Leurs
conseils achevèrent de décider
l'esprit du roi, déjà fort en
balance, à faire sa paix en livrant
Jugurtha, puisque Marius ne voulait entendre
à aucun traité sans cette condition.
Bocchus, pour se rendre plus sûrement
maître de la personne du roi numide,
renforça son armée, sous
prétexte d'en envoyer une partie contre les
Ethiopiens occidentaux, de qui les Maures avaient
reçu quelque insulte. Il envoya en effet
faire une course sur les terres de cette nation,
qui habite le mont Atlas, et qui est fort
différente des Ethiopiens orientaux.
Iphicrates, à propos de cette
expédition, raconte des choses fort
extraordinaires sur les curiosités
naturelles de ce pays-là ; il rapporte que
les Maures y virent des chameaux-léopards,
des serpents appelés par les naturels
thises, gros comme des éléphants et
de la figure d'un taureau (c'est peut-être le
céraste ou serpent cornu) ; des roseaux si
gros, qu'un seul de leurs noeuds contenait huit
pots d'eau (ce sont des cannes de bambou); et une
espèce d'asperge beaucoup plus grosse que
toutes celles que l'on connaît ; et dont le
roi Bocchus fit présent à sa
femme». |
|
| (129) Massugrada,
de la famille de Masinissa - Il était
frère de Micipsa. |
|
| (130) D'après
la foi punique. - Salluste me semble ici
employer bien mal à propos cette expression
injurieuse pour les ennemis de Rome, dans le
récit d'une négociation où
Sylla ne fit pas beaucoup d'honneur à la
bonne foi romaine. |
|
| (131) Qui
parla pour nous. - I1 ne sera pas sans
intérêt de reproduire les mêmes
détails présentés d'une
manière non moins piquante par Plutarque :
«Sylla, dit ce biographe traduit par Amyot,
s'alla mettre en très grand danger, en
commettant sa personne à la foi d'un roi
barbare pour en prendre un autre, attendu
mêmement que celui en qui il se fiait usait
de si grande déloyauté envers ses
plus proches alliés ; toutesfois Bocchus
ayant les deux en sa puissance, et s'étant
lui-même rangé à ce point de
nécessité, qu'il était force
qu'il trahît ou l'un ou l'autre, après
avoir longuement disputé en lui-même
lequel il ferait plus tôt, à la fin
exécuta le dessein de la première
trahison, et délivra Jugurtha entre les
mains de Sylla». |
|
| (132) Homme
irréprochable. - On ne peut, en
vérité, trop s'étonner de voir
Salluste qualifier d'une épithète si
honorable, sanctus vir, un homme
mêlé à une si honteuse
négociation. |
|
| (133) Livré
à Sylla, qui le mène à
Marius. «Il est bien vrai, dit Plutarque, que celui qui triompha de cette prise fut Marius ; mais l'envie qu'on lui portait faisait qu'on attribuait la gloire du fait à Sylla, ce qui secrètement fâchait fort Marius ; mêmement que Sylla, qui, de sa nature, était hautain, et qui lors commençait, d'une vie basse, obscure et inconnue, à venir pour la première fois en quelque lumière entre ses citoyens, et à goûter les prémices des honneurs, en devint si ambitieux et si convoiteux de gloire, qu'il en fit graver l'histoire en un anneau qu'il porta toujours depuis, et s'en servit de cachet. La gravure était le roi Bocchus qui livrait, et Sylla qui recevait Jugurtha prisonnier. Ces choses déplaisaient fort à Marius... Voilà, continue le même historien, la première source de cette pestilente et mortelle inimitié qui, depuis, fut toujours entre Marius et Sylla, laquelle pensa perdre et ruiner la ville de Rome et son empire de fond en comble : d'autant que plusieurs, portant envie à la gloire de Marius, allaient disant que cet acte de la prise de Jugurtha appartenait à Sylla... et attribuaient le commencement et les principaux exploits de cette guerre à Metellus, et les derniers, avec la consommation finale, à Sylla ; afin que le peuple ne l'eût plus en si grande estime, ni en telle recommandation, qu'il l'avait eu auparavant... Davantage l'inimitié commencée entre lui et Marius se ralluma par une occasion nouvelle de l'ambition du roi Bocchus, lequel, en partie pour s'insinuer de plus en plus en la bonne grâce du peuple romain, et en partie aussi pour gratifier Sylla, donna et dédia au temple de Jupiter Capitolin des images de la Victoire, qui portaient des trophées, et auprès d'elles l'image de Jugurtha, qu'il délivrait entre les mains de Sylla ; le tout de fin or. Cela fit sortir Marius hors de soi, de dépit et de jalousie qu'il en eut, ne pouvant supporter qu'un autre s'attribuât la gloire de ses faits, tellement qu'il était bien résolu d'abattre ces images-là et de les ôter par force. Sylla aussi, d'un autre côté, s'opiniâtrait à les vouloir maintenir au lieu où elles avaient été mises ; et il y en eut d'autres aussi qui se prirent à défendre la cause de Sylla : tellement que, pour la querelle de ces deux personnages, la ville était toute prête de tomber en grande combustion ; n'eût été que la guerre des alliés de l'Italie, qui de longtemps se couvait et fumait, s'enflamma tout à un coup contre la ville de Rome ; ce qui réprima un peu pour l'heure la sédition». Valère-Maxime présente des détails analogues sur les causes de la haine de Marius et de Sylla : «Marius, selon cet auteur (liv. VIII, ch. XIV, n° 4,) lui en voulait surtout de l'affectation que mettait son rival à se servir du cachet sur lequel était gravée la scène qui avait terminé la guerre de Numidie. Toute la vie, Sylla voulut se servir de ce cachet pour la signature de ses lettres, quoiqu'il eût depuis fait tant de choses au prix desquelles celle-ci n'était rien». Voyez, sur ces faits, Tite-Live, Epitome LXVI ; Florus, liv. III, ch. 1 ; Pline, liv. XXXVII, ch. IV. |
|
| (134) Quoique
absent fut nommé consul. - Ce fut vers
l'an 650 de Rome, un an après son premier
consulat ; c'était une double infraction aux
lois qui voulaient qu'un citoyen sollicitât
le consulat en personne, et que dix ans
s'écoulassent d'un premier consulat à
l'autre. L'exemple du premier Scipion l'Africain,
mais surtout le danger de la patrie, l'emporta sur
l'autorité des lois et des usages
(Plutarque, Vie de Marius). Cicéron,
dans le discours sur les provinces
consulaires, rapporte que les plus grands
ennemis de Marius, Crassus, Scaurus, et même
les Metellus, furent d'avis de lui conférer
cette dignité. |
|
| (135) Il
triompha consul. C'était la
première fois qu'on voyait un Romain
triompher le même jour qu'il prenait
possession du consulat. Ici Salluste termine la
guerre de Numidie ; mais il nous laisse ignorer
quel fut le sort de Jugurtha et celui de la
Numidie. Plutarque supplée à ce
silence, que justifie suffisamment la
manière impétueuse dont notre
historien conduit sa narration. Après avoir
orné le triomphe de son vainqueur, Jugurtha
fut saisi par les licteurs, qui
déchirèrent sa robe, et lui
meurtrirent les oreilles pour s'emparer de ses
anneaux ; ils le jetèrent ensuite tout nu
dans une fosse profonde. Conservant jusqu'au
dernier moment le même sang-froid qu'il avait
pris dans l'exécution des plus grands
crimes, le meurtrier d'Adherbal s'écria en
souriant : «0 dieux ! que vos étuves
sont froides !» Après avoir
lutté six jours contre la faim, il expira
enfin. Il avait environ cinquante-quatre ans. Eutrope (livre IV) et quelques autres prétendent que Jugurtha fut étranglé en prison. Sur quelques vieux manuscrits de Salluste, on lit deux vers latins portant qu'il fut précipité de la roche Tarpéienne. Si cupis ignotum Jugurthae discere lethum : Tarpeiae rupis pulsus ad ima ruit. Un autre manuscrit, cité par Cortius, offre cet autre distique : Nosse cupis vulgo non cognita fata Jugurthae : Ut Plutarchus ait, carcere clausus obit. Enfin, M. Burnouf a trouvé, dans le manuscrit A de la Bibliothèque royale, douze vers sur la mort de Jugurtha et de ses fils, dont il cite seulement ceux-ci : ...Eadem natos sors abstulit illius ambos, Culpaque perjuri traxit utrosque patris. En effet, Appien d'Alexandrie nous apprend que Masentha, l'un d'eux, gardé en prison dans la ville de Venouse, fut quelques années après, lors de la guerre Sociale, délivré par Pappius, l'un des chefs latins, qui, l'ayant revêtu des ornements royaux, se servit de lui pour engager la cavalerie numide à déserter les drapeaux des Romains. Toute la Numidie ne fut pas réduite en province romaine, après le triomphe de Marius. La partie limitrophe de la Mauritanie fut donnée au roi Bocchus. On en laissa une autre portion à Hiempsal II, fils de Gulussa, et petit-fils de Masinissa. Il eut pour successeur Juba Ier. Enfin, la partie de la Numidie qui confinait à la province romaine d'Afrique fut réunie au domaine de la république. |