Notice sur Juvénal

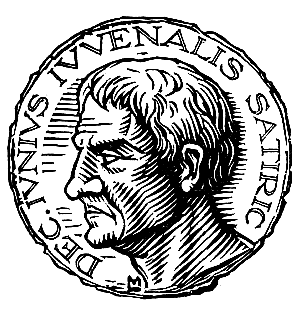 Decimus ou Decius Junius Juvenalis naquit à Aquinum, aujourd'hui Aquino, dans l'Abruzze, ou fut seulement originaire de cette ville de l'ancien pays des Volsques. Cette incertitude sur le prénom de Juvénal et sur le lieu qui le vit naître, fait déjà entrevoir qu'on a peu de lumières sur la vie de cet écrivain : il est, en effet, du nombre de ceux dont l'histoire particulière est demeurée dans l'obscurité, tandis que leurs ouvrages, environnés de gloire, ont traversé la nuit des temps avec un grand éclat. On ne sait s'il était le fils, ou s'il ne fut que l'élève d'un affranchi, qui prit soin de son enfance, et qui se chargea de sa première éducation. L'on ignore même l'époque de sa naissance ; quelques-uns la placent sous le règne de Caligula. Celle de sa mort n'est pas mieux connue ; on croit que, parvenu à un âge fort avancé, il ne termina sa carrière que sous Adrien, de sorte qu'il aurait vu cette succession rapide de onze empereurs qui, dans le cours d'à peu près quatre-vingts années, passèrent plus ou moins vite sur le trône du monde, et dont la plupart le souillèrent de leurs excès et le laissèrent marqué de leur sang. Mais, suivant toutes les apparences, ce ne fut que sous Domitien que son génie poétique éclata ; et le feu de sa verve, longtemps concentré, continua de jeter de vives flammes, et de l'illustrer sous les trois successeurs immédiats de ce prince.
Decimus ou Decius Junius Juvenalis naquit à Aquinum, aujourd'hui Aquino, dans l'Abruzze, ou fut seulement originaire de cette ville de l'ancien pays des Volsques. Cette incertitude sur le prénom de Juvénal et sur le lieu qui le vit naître, fait déjà entrevoir qu'on a peu de lumières sur la vie de cet écrivain : il est, en effet, du nombre de ceux dont l'histoire particulière est demeurée dans l'obscurité, tandis que leurs ouvrages, environnés de gloire, ont traversé la nuit des temps avec un grand éclat. On ne sait s'il était le fils, ou s'il ne fut que l'élève d'un affranchi, qui prit soin de son enfance, et qui se chargea de sa première éducation. L'on ignore même l'époque de sa naissance ; quelques-uns la placent sous le règne de Caligula. Celle de sa mort n'est pas mieux connue ; on croit que, parvenu à un âge fort avancé, il ne termina sa carrière que sous Adrien, de sorte qu'il aurait vu cette succession rapide de onze empereurs qui, dans le cours d'à peu près quatre-vingts années, passèrent plus ou moins vite sur le trône du monde, et dont la plupart le souillèrent de leurs excès et le laissèrent marqué de leur sang. Mais, suivant toutes les apparences, ce ne fut que sous Domitien que son génie poétique éclata ; et le feu de sa verve, longtemps concentré, continua de jeter de vives flammes, et de l'illustrer sous les trois successeurs immédiats de ce prince.
De savants critiques prétendent pourtant que ses premières poésies furent postérieures à Domitien ; et, si l'on s'en rapporte à l'un d'eux, qui n'est pas le moins docte, l'inspiration n'aurait embrasé que bien tard le talent de Juvénal. Son effervescence satirique, renfermée dans son sein pendant tout l'âge de la force et de la chaleur, ne se serait fait jour qu'à travers les glaces de la vieillesse ; et il n'aurait saisi le glaive de Lucilius que d'une main appesantie par le faix des années. Ce ne serait que de soixante à quatre-vingts ans qu'il aurait écrit ses satires. On adoptera peut-être plus volontiers l'avis de ceux qui ne reculent pas si loin, pour un génie si impétueux et si ardent, le moment de la composition, et qui le représentent marchant d'un pas ferme sur les traces d'Horace et de Perse, dans cette saison de la vie où la vigueur s'unit à la maturité, c'est-à-dire, de quarante à cinquante ans. Quoi qu'il en soit, ses heureuses dispositions naturelles furent cultivées par ces fortes études qui présidaient au développement du génie, et qui faisaient éclore les talents chez les Romains, depuis qu'un lien, formé par la victoire, enchaînait aux arts de la Grèce ceux qui l'avaient conquise et subjuguée. Il est vrai qu'une méthode nouvelle, introduite depuis peu, commençait à corrompre, du temps de Juvénal, la pureté des sources où puisaient les élèves de l'éloquence et de la poésie. Le système d'enseignement par la voie des déclamations, enchantait la jeunesse, et avait usurpé un grand crédit ; il flattait l'inexpérience et la vanité du premier âge, toujours plus épris de ce qui rend ses succès faciles que de ce qui les rend solides et durables ; il favorisait la charlatanerie des maîtres, toujours moins jaloux d'assurer pour l'avenir les fruits de leurs soins, sagement réglés, que de faire briller pour le moment les dispositions naissantes dont la culture leur est confiée ; il achevait enfin d'altérer, dans leurs principes, les premiers et les plus éclatants des arts de l'esprit, sur lesquels s'exerçaient encore d'autres influences non moins funestes et plus difficiles à éviter. Si le génie de Juvénal se fortifiait dans ces exercices de son siècle, son goût ne pouvait se soustraire à tant de causes de corruption.
Des critiques pensent qu'il fut disciple de Quintilien ; mais, quand le fait serait vrai, les leçons de cet illustre rhéteur qui, lui-même, fut obligé de se plier et d'obéir aux usages de son époque, étaient plutôt des protestations que des préservatifs contre le mauvais goût. Il paraît plus certain que Juvénal fréquenta l'école d'un grammairien nommé Fronton, que sûrement il ne faut pas confondre avec ce Fronton à qui Marc-Aurèle, dont il avait dirigé la jeunesse dans l'étude des lettres, éleva une statue.
Sorti des écoles, ce fut à l'éloquence que Juvénal offrit les prémices de son talent : il se montra comme orateur avant de se montrer comme poète, et déploya sur l'arène du Forum, et dans les luttes réelles de la plaidoirie, ces forces qu'il avait acquises dans les combats imaginaires de la rhétorique. Il ne reste aucun monument de ses travaux en ce genre ; mais on peut présumer qu'il s'y distingua, et il est permis de conclure, avec quelque raison, des compositions satiriques de Juvénal, qu'en lui le don de la poésie ne contrariait ni n'excluait celui de l'éloquence ; on peut même dire que la manière de ce poète se rapproche beaucoup des formes de la prose élevée, et du ton de la diction oratoire. Quintilien paraît disposé à mettre Lucain au nombre des orateurs ; peut-être eût-il assigné le même rang à Juvénal. Il est donc probable que les discours de celui-ci avaient plus d'un trait de ressemblance avec ses poésies, et qu'en conséquence ses succès dans les joutes du barreau furent le présage de ceux qu'il obtint ensuite dans la censure des moeurs et dans la peinture des ridicules.
On ne sait si, au milieu de ces occupations, qui sans doute annonçaient sa gloire, et qui constituaient son état, Juvénal sentit le besoin, comme il dut rencontrer l'occasion, de se lier avec quelques-uns des hommes supérieurs qui furent ses contemporains, et si, la causticité de l'esprit n'excluant pas les doux penchants du coeur, il eut le bonheur de chercher et de trouver un ami, parmi les Quintilien, les Pline et les Tacite. On découvre seulement qu'il existait une liaison d'amitié entre lui et l'épigrammatiste Martial, qui, comme ces grands hommes, et comme Juvénal lui-même, se livra d'abord aux affaires du Forum, dont il ne tarda pas à se dégoûter ; c'est même une épigramme de Martial, adressée à son cher Juvénal, qui nous apprend que ce sévère moraliste, cet inflexible censeur des travers et des vices de son temps, ce redoutable fléau des faiblesses humaines, assiégeait les portes et les antichambres des palais, mendiait la faveur des grands, et pliait le genou devant les autels de la fortune ; elle nous le peint haletant, couvert de sueur, dans les sentiers de l'intrigue, et ne trouvant que dans les ondulations de sa robe flottante un rafraîchissement nécessaire à ses fatigues. Juvénal ne manquait pas, à ce qu'il paraît, d'ambition ; et c'est par ce petit écrit amical que la postérité devait être instruite de cette particularité de son caractère : elle peut rappeler Sénèque écrivant en faveur du mépris des richesses, sur une table d'or, et Salluste, le plus corrompu des Romains, gourmandant effrontément son siècle, sans pourtant autoriser à confondre entièrement Juvénal, sous ce rapport, avec Salluste et Sénèque.
Vraisemblablement cet essor ambitieux, dont Martial se moquait, n'éleva pas Juvénal très haut ; et ce poète, malgré tous ces mouvements, n'avança pas beaucoup dans la carrière des honneurs. On le voit cependant partir pour l'Egypte, à la tête d'une cohorte, c'est-à-dire d'un régiment d'infanterie, avec le titre de préfet de cette cohorte ; ce qui revient au titre de colonel. Cet emploi fut reçu d'abord par Juvénal avec reconnaissance ; mais le poète, devenu guerrier, ne fut pas longtemps sans s'apercevoir qu'il était la dupe de sa vanité, et que ce qu'il avait pris pour un gage de la faveur n'était qu'un présent de la haine et qu'un artifice de la vengeance : c'était en effet un exil, dans lequel, selon quelques critiques, il mourut de douleur et de chagrin.
Mais si quelques-uns le font expirer en Egypte, ou dans la Pentapole, d'autres le rappellent à Rome, de leur pleine autorité.
L'exil et la mort de Juvénal ont excité mille contestations entre les savants. Il dit dans sa septième satire, que le comédien Pâris dispose de toutes les charges, donne à son gré tous les emplois militaires ; et ce Pâris, qui voulait se venger par où il avait été attaqué, lui en fit, comme on le voit, donner un. Le trait était piquant autant que scandaleux ; mais il est enveloppé de beaucoup d'obscurité. Plusieurs érudits n'envoient Juvénal dans la Pentapole que sous Adrien, et l'histrion Pâris, dont il est ici question, est celui que Domitien aimait tant ; ces érudits soutiennent en conséquence, qu'un autre comédien, dont on ne sait pas le nom, et que chérissait non moins follement Adrien, vit dans les vers contre Pâris une allusion contre lui-même, et s'en vengea par la plus sanglante mystification. Il s'en faut que tout cela soit suffisamment clair. Il paraît néanmoins, d'après de doctes supputations, que Juvénal mourut très vieux, soit en Egypte, soit en Italie, sous le règne d'Adrien. Mais ce qui présente un aspect moins offusqué de nuages, et plus net comme plus intéressant, ce qui n'a provoqué presque aucune dispute, et ce qui doit frapper tous les yeux, c'est le mérite vraiment incontestable qui brille dans ses satires.
Elles sont au nombre de seize, si toutefois il faut lui attribuer la seizième, qui n'est qu'un morceau incomplet, une espèce de fragment et d'esquisse, dont le coloris éteint ne semble pas digne des pinceaux brûlants de Juvénal. On est à peu près sûr que la disposition ordinale, où elles sont rangées dans toutes les éditions, conformes en cela sans doute à tous les manuscrits, ne représente pas l'ordre chronologique dans lequel elles furent composées. Au reste, quoiqu'elles portent toutes le sceau d'un grand talent, on distingue cependant entre elles, et l'on doit distinguer celles qui ont pour sujets, et si l'on veut pour titres, la Noblesse, les Voeux, les Femmes, le Turbot ; c'est là que la verve ardente du satirique bouillonne et s'épanche avec le plus d'incandescence et d'éclat, et marque tout son cours par des empreintes plus profondes ; c'est dans ces compositions du premier ordre, que se rencontrent ces fameuses peintures, qui se gravent, et, pour ainsi dire, se burinent dans l'imagination du lecteur en traits ineffaçables, ces tableaux qui l'effraient, et le poursuivent, tels que ceux de la chute de Séjan, des impudicités de Messaline, de l'avilissement du sénat ; détails admirables, que Boileau appelle si justement de sublimes beautés, et qui lui ont inspiré ces vers, si étonnamment énergiques, où il fait le portrait de Juvénal, d'un crayon que celui-ci n'eût pas désavoué, et dont il eût même envié peut-être la pureté et la précision :
Juvénal, élevé dans les cris de l'école, |
Ces beaux vers renferment tout : qu'on développe, qu'on étende un texte si riche, et l'on se formera l'idée de Juvénal, la plus complète que puisse fournir la critique littéraire. Ces cris de l'école, au bruit desquels il fut élevé, cet excès de l'hyperbole, auquel il s'abandonne, signalent avec justesse le vice principal de ses écrits, vice puisé ou du moins fortifié dans les écoles de son temps, la déclamation, qui n'est autre chose que l'exagération illimitée du vrai par l'abus effréné de l'expression, ou le paralogisme revêtu des formes trompeuses de le dialectique, et soutenu par les forces entraînantes de l'éloquence ; ces affreuses vérités, qu'indique Despréaux, sont ces images qui souillent la touche du peintre, révoltent la délicatesse du spectateur, outragent la morale, même en cherchant à la venger, insultent à la pudeur en déchirant tous ses voiles, et, par là même, blessent le goût qui toujours la protège. Les compositions de Juvénal n'en sont pas moins pleines de feu ; elles brillent, elles étincellent, elles s'élèvent jusqu'au sublime. Tel est le jugement de Boileau, qui, frappé de l'énergie de ce poète, autant qu'amoureux de la finesse naïve et de l'aimable gaîté d'Horace, s'étudia toujours à fondre, dans ses propres satires, par un difficile mélange, les grâces légères et riantes de l'un, avec la force et la sévérité de l'autre.
Jules de l'Escale, ce célèbre critique du XVIe siècle, connu sous le nom de Scaliger, réglant les droits et les rangs entre les satiriques latins, n'hésite pas à placer Juvénal fort au-dessus d'Horace; mais son discernement était moins sûr que son érudition n'était vaste. Cette préférence de Scaliger fut appuyée du suffrage de Juste Lipse, autre érudit, d'une autorité non moins suspecte en matière de poésie et d'éloquence, tandis qu'Isaac Casaubon, le troisième personnage de ce triumvirat savant, proclamait la supériorité de Perse sur Horace et sur Juvénal. Enfin, Daniel Heinsius, quoique disciple de Jules Scaliger, décerna la palme à Horace. Toutes ces disputes étaient moins utiles que pédantesques ; elles se sont renouvelées de notre temps, et probablement elles renaîtront encore quelque jour, bien que la question ait été posée avec beaucoup de justesse par La Harpe et par Geoffroy, et décidée avec non moins de justice en faveur de celui qui sut manier l'arme de la satire avec le plus de souplesse, d'aisance et de légèreté. Ces excellents juges ne firent pas même intervenir au procès le ténébreux disciple du stoïcien Cornutus, malgré l'arrêt d'Isaac Casaubon : l'obscurité que Perse affecta dans son style, dérobe presque entièrement à nos regards ses beautés reconnues par Quintilien, et ne laisse échapper que quelques traits heureux, comme des sillons de lumière dans l'ombre la plus noire ; il n'y a pas là de quoi lutter contre la diction lumineuse et les grâces charmantes d'Horace, ni même contre les éloquentes déclamations de Juvénal.
 |
DUSSAULT