Livre II - Le papyrus (1) |
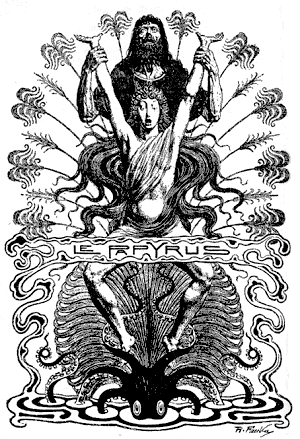 |
Thaïs était née de parents libres et pauvres, adonnés à l'idolâtrie. Du temps qu'elle était petite, son père gouvernait, à Alexandrie, proche la porte de la Lune, un cabaret que fréquentaient les matelots. Certains souvenirs vifs et détachés lui restaient de sa première enfance. Elle revoyait son père assis à l'angle du foyer, les jambes croisées, grand, redoutable et tranquille, tel qu'un de ces vieux Pharaons que célèbrent les complaintes chantées par les aveugles dans les carrefours. Elle revoyait aussi sa maigre et triste mère, errant comme un chat affamé dans la maison, qu'elle emplissait des éclats de sa voix aigre et des lueurs de ses yeux de phosphore. On contait dans le faubourg qu'elle était magicienne et qu'elle se changeait en chouette, la nuit, pour rejoindre ses amants. On mentait. Thaïs savait bien, pour l'avoir souvent épiée, que sa mère ne se livrait point aux arts magiques, mais que, dévorée d'avarice, elle comptait toute la nuit le gain de la journée. Ce père inerte et cette mère avide la laissaient chercher sa vie comme les bêtes de la basse-cour. Aussi était-elle devenue très habile à tirer une à une les oboles de la ceinture des matelots ivres, en les amusant par des chansons naïves et par des paroles infâmes dont elle ignorait le sens. Elle passait de genoux en genoux dans la salle imprégnée de l'odeur des boissons fermentées et des outres résineuses ; puis, les joues poissées de bière et piquées par les barbes rudes, elle s'échappait, serrant les oboles dans sa petite main, et courait acheter des gâteaux de miel à une vieille femme accroupie derrière ses paniers sous la porte de la Lune. |
C'était tous les jours les mêmes scènes : les matelots, contant
leurs périls, quand l'Euros ébranlait les
algues sous-marines, puis jouant aux dés ou aux
osselets, et demandant, en blasphémant les dieux, la
meilleure bière de Cilicie.
Chaque nuit, l'enfant était réveillée
par les rixes des buveurs. Les écailles
d'huîtres, volant par-dessus les tables, fendaient les
fronts, au milieu des hurlements furieux. Parfois, à
la lueur des lampes fumeuses, elle voyait les couteaux
briller et le sang jaillir.
Ses jeunes ans ne connaissaient la bonté humaine que
par le doux Ahmès, en qui elle était
humiliée. Ahmès, l'esclave de la maison, Nubien
plus noir que la marmite qu'il écumait gravement,
était bon comme une nuit de sommeil. Souvent, il
prenait Thaïs sur ses genoux et il lui contait
d'antiques récits où il y avait des souterrains
pleins de trésors, construits pour des rois avares,
qui mettaient à mort les maçons et les
architectes. Il y avait aussi, dans ces contes, d'habiles
voleurs qui épousaient des filles de rois et des
courtisanes qui élevaient des pyramides. La petite
Thaïs aimait Ahmès comine un père, comme
une mère, comme une nourrice et comme un chien. Elle
s'attachait au pagne de l'esclave et le suivait dans le
cellier aux amphores et dans la basse-cour, parmi les poulets
maigres et hérissés, tout en bec, en ongles et
en plumes, qui voletaient mieux que des aiglons devant le
couteau du cuisinier noir. Souvent, la nuit, sur la paille,
au lieu de dormir, il construisait pour Thaïs des petits
moulins à eau et des navires grands comme la main avec
tous leurs agrès.
Accablé de mauvais traitements par ses maîtres,
il avait une oreille déchirée et le corps
labouré de cicatrices. Pourtant son visage gardait un
air joyeux et paisible. Et personne auprès de lui ne
songeait à se demander d'où il tirait la
consolation de son âme et l'apaisement de son cœur. Il
était aussi simple qu'un enfant.
En accomplissant sa tâche grossière, il chantait
d'une voix grêle des cantiques qui faisaient passer
dans l'âme de l'enfant des frissons et des rêves.
Il murmurait sur un ton grave et joyeux :
- Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu là
d'où tu viens ?
- J'ai vu le suaire et les linges, et les anges assis sur le
tombeau.
Et j'ai vu la gloire du Ressuscité.
Elle lui demandait :
- Père, pourquoi chantes-tu les anges assis sur le
tombeau ?
Et il lui répondait :
- Petite lumière de mes yeux, je chante les anges,
parce que Jésus Notre Seigneur est monté au
ciel.
Ahrnès était chrétien. Il avait
reçu le baptême, et on le nommait
Théodore dans les banquets des fidèles,
où il se rendait secrètement pendant le temps
qui lui était laissé pour son sommeil.
En ces jours-là l'Eglise subissait l'épreuve
suprême. Par l'ordre de l'Empereur, les basiliques
étaient renversées, les livres saints
brûlés, les vases sacrés et les
chandeliers fondus. Dépouillés de leurs
honneurs, les chrétiens n'attendaient que la mort. La
terreur régnait sur la communauté d'Alexandrie ; les prisons regorgeaient de victimes. On contait avec
effroi, parmi les fidèles, qu'en Syrie, en Arabie, en
Mésopotamie, en Cappadoce, par tout l'empire, les
fouets, les chevalets, les ongles de fer, la croix, les
bêtes féroces déchiraient les pontifes et
les vierges. Alors Antoine, déjà
célèbre par ses visions et ses solitudes, chef
et prophète des croyants d'Egypte, fondit comme
l'aigle, du haut de son rocher sauvage, sur la ville
d'Alexandrie, et, volant d'église en église,
embrasa de son feu la communauté tout entière.
Invisible aux païens, il était présent
à la fois dans toutes les assemblées des
chrétiens, soufflant à chacun l'esprit de force
et de prudence dont il était animé. La
persécution s'exerçait avec une
particulière rigueur sur les esclaves. Plusieurs
d'entre eux, saisis d'épouvante, reniaient leur foi.
D'autres, en plus grand nombre, s'enfuyaient au
désert, espérant y vivre, soit dans la
contemplation, soit dans le brigandage. Cependant
Ahmès fréquentait comme de coutume les
assemblées, visitait les prisonniers, ensevelissait
les martyrs et professait avec joie la religion du Christ.
Témoin de ce zèle véritable, le grand
Antoine, avant de retourner au désert, pressa
l'esclave noir dans ses bras et lui donna le baiser de
paix.
Quand Thaïs eut sept ans, Ahmès commença
à lui parler de Dieu.
- Le bon Seigneur Dieu, lui dit-il, vivait dans le ciel comme
un Pharaon sous les tentes de son harem et sous les arbres de
ses jardins.
Il était l'ancien des anciens et plus vieux que le
monde, et n'avait qu'un fils, le prince Jésus, qu'il
aimait de tout son cœur et qui passait en beauté les
vierges et les anges. Et le bon Seigneur Dieu dit au prince
Jésus :
« Quitte mon harem et mon palais, et mes dattiers
et mes fontaines vives. Descends sur la terre pour le bien
des hommes. Là tu seras semblable à un petit
enfant et tu vivras pauvre parmi les pauvres. La souffrance
sera ton pain de chaque jour et tu pleureras avec tant
d'abondance que tes larmes formeront des fleuves où
l'esclave fatigué se baignera délicieusement.
Va, mon fils !
Le prince Jésus obéit au bon Seigneur et il
vint sur la terre en un lieu nommé Bethléem de
Juda. Et il se promenait dans les prés fleuris
d'anémones, disant à ses compagnons :
- Heureux ceux qui ont faim, car je les mènerai
à la table de mon père ! Heureux ceux qui ont
soif, car ils boiront aux fontaines du ciel! Heureux ceux qui
pleurent, car j'essuierai leurs yeux avec des voiles plus
fins que ceux des princesses syriennes.
C'est pourquoi les pauvres l'aimaient et croyaient en lui.
Mais les riches le haïssaient, redoutant qu'il
n'élevât les pauvres au-dessus d'eux. En ce
temps-là Cléopâtre et César
étaient puissants sur la terre. Ils haïssaient
tous deux Jésus et ils ordonnèrent aux juges et
aux prêtres de le faire mourir. Pour obéir
à la reine d'Egypte, les princes de Syrie
dressèrent une croix sur une haute montagne et ils
firent mourir Jésus sur cette croix. Mais des femmes
lavèrent le corps et l'ensevelirent, et le prince
Jésus, ayant brisé le couvercle de son tombeau,
remonta vers le bon Seigneur son père.
Et depuis ce temps-là tous ceux qui meurent en lui
vont au ciel.
Le Seigneur Dieu, ouvrant les bras, leur dit :
- Soyez les bienvenus, puisque vous aimez le prince mon fils.
Prenez un bain, puis mangez.
Ils prendront leur bain au son d'une belle musique et, tout
le long de leur repas, ils verront des danses d'aimées
et ils entendront des conteurs dont les récits ne
finiront point. Le bon Seigneur Dieu les tiendra plus chers
que la lumière de ses yeux, puisqu'ils seront ses
hôtes, et ils auront dans leur partage les tapis de son
caravansérail et les grenades de ses
jardins ».
Ahmès parla plusieurs fois de la sorte et c'est ainsi
que Thaïs connut la vérité. Elle admirait
et disait : - Je voudrais bien manger les grenades du bon
Seigneur.
Ahmès lui répondait :
- Ceux-là seuls qui sont baptisés en
Jésus, goûteront les fruits du ciel.
Et Thaïs demandait à être baptisée.
Voyant par là qu'elle espérait en Jésus,
l'esclave résolut de l'instruire plus
profondément, afin qu'étant baptisée,
elle entrât dans l'Eglise. Et il s'attacha
étroitement à elle, comme à sa fille en
esprit.
L'enfant, sans cesse repoussée par ses parents
injustes, n'avait point de lit sous le toit paternel. Elle
couchait dans un coin de l'étable parmi les animaux
domestiques. C'est là que, chaque nuit, Ahmès
allait la rejoindre en secret.
Il s'approchait doucement de la natte où elle
reposait, et puis s'asseyait sur ses talons, les jambes
repliées, le buste droit, dans l'attitude
héréditaire de toute sa race. Son corps et son
visage, vêtus de noir, restaient perdus dans les
ténèbres ; seuls ses grands yeux blancs
brillaient, et il en sortait une lueur semblable à un
rayon de l'aube à travers les fentes d'une porte. Il
parlait d'une voie grêle et chantante, dont le
nasillement léger avait la douceur triste des musiques
qu'on entend le soir dans les rues. Parfois, le souffle d'un
âne et le doux meuglement d'un bœuf accompagnaient,
comme un choeur d'obscurs esprits, la voix de l'esclave qui
disait l'Evangile. Ses paroles coulaient paisiblement dans
l'ombre qui s'imprégnait de zèle, de
grâce et d'espérance ; et la néophyte, la
main dans la main d'Ahmès, bercée par les sons
monotones et voyant de vagues images, s'endormait calme et
souriante, parmi les harmonies de la nuit obscure et des
saints mystères, au regard d'une étoile qui
clignait entre les solives de la crèche.
L'initiation dura toute une année, jusqu'à
l'époque où les chrétiens
célèbrent avec allégresse les
fêtes pascales. Or, une nuit de la semaine glorieuse,
Thaïs, qui sommeillait déjà sur sa natte
dans la grange, se sentit soulevée par l'esclave dont
le regard brillait d'une clarté nouvelle. Il
était vêtu, non point, comme de coutume, d'un
pagne en lambeaux, mais d'un long manteau blanc sous lequel
il serra l'enfant en disant tout bas :
- Viens, mon âme ! viens, mes yeux ! viens mon petit
cœur ! viens revêtir les aubes du baptême.
Et il emporta l'enfant pressée sur sa poitrine.
Effrayée et curieuse, Thaïs, la tête hors
du manteau, attachait ses bras au cou de son ami qui courait
dans la nuit. Ils suivirent des ruelles noires ; ils
traversèrent le quartier des juifs ; ils
longèrent un cimetière où l'orfraie
poussait son cri sinistre. Ils passèrent, dans un
carrefour, sous des croix auxquelles pendaient les corps des
suppliciés et dont les bras étaient
chargés de corbeaux qui claquaient du bec. Thaïs
cacha sa tête dans la poitrine de l'esclave. Elle n'osa
plus rien voir le reste du chemin. Tout à coup il lui
sembla qu'on la descendait sous terre. Quand elle rouvrit les
yeux, elle se trouva dans un étroit caveau,
éclairé par des torches de résine et
dont les murs étaient peints de grandes figures
droites qui semblaient s'animer sous la fumée des
torches. On y voyait des hommes vêtus de longues
tuniques et portant des palmes, au milieu d'agneaux, de
colombes et de pampres. Thaïs, parmi ces figures,
reconnut Jésus de Nazareth à ce que des
anémones fleurissaient à ses pieds. Au milieu
de la salle, près d'une grande cuve de pierre remplie
d'eau jusqu'au bord, se tenait un vieillard coiffé
d'une mitre basse et vêtu d'une dalmatique
écarlate, brodée d'or. De son maigre visage
pendait une longue barbe. Il avait l'air humble et doux sous
son riche costume. C'était l'évêque
Vivantius qui, prince exilé de l'église de
Cyrène, exerçait, pour vivre, le métier
de tisserand et fabriquait de grossières
étoffes de poil de chèvre. Deux pauvres enfants
se tenaient debout à ses côtés. Tout
proche, une vieille négresse présentait
déployée une petite robe blanche. Ahmès,
ayant posé l'enfant à terre, s'agenouilla
devant l'évêque et dit :
- Mon père, voici la petite âme, la fille de mon
âme. Je te l'amène afin que, selon ta promesse
et s'il plaît à ta
Sérénité, tu lui donnes le baptême
de vie.
A ces mois, l'évêque, ayant ouvert les bras,
laissa voir ses mains mutilées. Il avait eu les ongles
arrachés en confessant la foi aux jours de
l'épreuve. Thaïs eut peur et se jeta dans les
bras d'Ahmès. Mais le prêtre la rassura par des
paroles caressantes :
- Ne crains rien, petite bien-aimée. Tu as ici un
père selon l'esprit, Ahmès, qu'on nomme
Théodore parmi les vivants, et une douce mère
dans la grâce qui t'a préparé de ses
mains une robe blanche.
Et se tournant vers la négresse :
- Elle se nomme Nitida, ajouta-t-il ; elle est esclave sur
cette terre. Mais Jésus l'élèvera dans
le ciel au rang de ses épouses.
Puis il interrogea l'enfant néophyte :
- Thaïs, crois-tu en Dieu, le père tout-puissant,
en son fils unique qui mourut pour notre salut et en tout ce
qu'ont enseigné les apôtres ?
- Oui, répondirent ensemble le nègre et la
négresse, qui se tenaient par la main.
Sur l'ordre de l'évêque, Nitida,
agenouillée, dépouilla Thaïs de tous ses
vêtements. L'enfant était nue, un amulette au
cou. Le pontife la plongea trois fois dans la cuve
baptismale. Les acolytes présentèrent l'huile
avec laquelle Vivantius fit les onctions et le sel dont il
posa un grain sur les lèvres de la
catéchumène. Puis, ayant essuyé ce corps
destiné, à travers tant d'épreuves,
à la vie éternelle, l'esclave Nitida le
revêtit de la robe blanche qu'elle avait tissue de ses
mains.
L'évêque donna à tous le baiser de paix
et, la cérémonie terminée,
dépouilla ses ornements sacerdotaux. Quand ils furent
tous hors de la crypte, Ahmès dit :
- Il faut nous réjouir en ce jour d'avoir donné
une âme au bon Seigneur Dieu ; allons dans la maison
qu'habite ta Sérénité, pasteur
Vivantius, et livrons-nous à la joie tout le reste de
la nuit.
- Tu as bien parlé, Théodore, répondit
l'évêque.
Et il conduisit la petite troupe dans sa maison qui
était toute proche. Elle se composait d'une seule
chambre, meublée de deux métiers de tisserand,
d'une table grossière et d'un tapis tout usé.
Dès qu'ils y furent entrés :
- Nitida, cria le Nubien, apporte la poêle et la jarre
d'huile, et faisons un bon repas.
En parlant ainsi, il tira de dessous son manteau de petits
poissons qu'il y tenait cachés. Puis, ayant
allumé un grand feu, il les fit frire. Et tous,
l'évêque, l'enfant, les deux jeunes
garçons et les deux esclaves, s'étant assis en
cercle sur le tapis, mangèrent les poissons en
bénissant le Seigneur. Vivantius parlait du martyre
qu'il avait souffert et annonçait le triomphe prochain
de l'Eglise. Son langage était rude, mais plein de
jeux de mots et de figures. Il comparait la vie des justes
à un tissu de pourpre et, pour expliquer le
baptême, il disait :
- L'Esprit Saint flotta sur les eaux, c'est pourquoi les
chrétiens reçoivent le baptême de l'eau.
Mais les démons habitent aussi les ruisseaux ; les
fontaines consacrées aux nymphes sont redoutables et
l'on voit que certaines eaux apportent diverses maladies de
l'âme et du corps.
Parfois il s'exprimait par énigmes et il inspirait
ainsi à l'enfant une profonde admiration. A la fin du
repas, il offrit un peu de vin à ses hôtes dont
les langues se délièrent et qui se mirent
à chanter des complaintes et des cantiques.
Ahmès et Nitida, s'étant levés,
dansèrent une danse nubienne qu'ils avaient apprise
enfants, et qui se dansait sans doute dans la tribu depuis
les premiers âges du monde. C'était une danse
amoureuse ; agitant les bras et tout le corps balancé
en cadence, ils feignaient tour à tour de se fuir et
de se chercher. Ils roulaient de gros yeux et montraient dans
un sourire des dents étincelantes.
C'est ainsi que Thaïs reçut le saint
baptême.
Elle aimait les amusements et, à mesure qu'elle
grandissait, de vagues désirs naissaient en elle. Elle
dansait et chantait tout le jour des rondes avec les enfants
errants dans les rues, et elle regagnait, à la nuit,
la maison de son père, en chantonnant encore :
- Torti tortu, pourquoi gardes-tu la maison ?
- Je dévide la laine et le fll de Milet.
- Torti tortu, comment ton fils a-t-il péri ?
- Du haut des chevaux blancs il tomba dans la mer.
Maintenant elle préférait à la
compagnie du doux Ahmès celle des garçons et
des filles. Elle ne s'apercevait point que son ami
était moins souvent auprès d'elle. La
persécution s'étant ralentie, les
assemblées des chrétiens devenaient plus
régulières et le Nubien les fréquentait
assidûment. Son zèle s'échauffait ; de
mystérieuses menaces s'échappaient parfois de
ses lèvres. Il disait que les riches ne garderaient
point leurs biens. Il allait dans les places publiques
où les chrétiens d'une humble condition avaient
coutume de se réunir et là, rassemblant les
misérables étendus à l'ombre des vieux
murs, il leur annonçait l'affranchissement des
esclaves et le jour prochain de la justice.
- Dans le royaume de Dieu, disait-il, les esclaves boiront
des vins frais et mangeront des fruits délicieux,
tandis que les riches, couchés à leurs pieds
comme des chiens, dévoreront les miettes de leur
table.
Ces propos ne restèrent point secrets ; ils furent
publiés dans le faubourg et les maîtres
craignirent qu'Ahmès n'excitât les esclaves
à la révolte. Le cabaretier en ressentit une
rancune profonde qu'il dissimula soigneusement.
Un jour, une salière d'argent, réservée
à la nappe des dieux, disparut du cabaret.
Ahmès fut accusé de l'avoir volée, en
haine de son maître et des dieux de l'empire.
L'accusation était sans preuves et l'esclave la
repoussait de toutes ses forces. Il n'en fut pas moins
traîné devant le tribunal et, comme il passait
pour un mauvais serviteur, le juge le condamna au dernier
supplice.
- Tes mains, lui dit-il, dont tu n'as pas su faire un bon
usage, seront clouées au poteau.
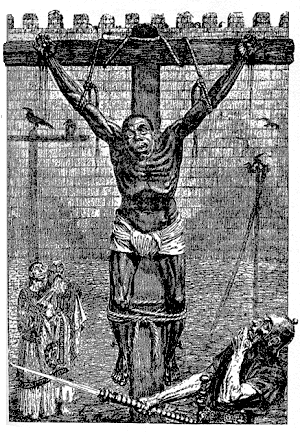 | Ahmès écouta
paisiblement cet arrêt, salua le juge avec beaucoup de
respect et fut conduit à la prison publique. Durant
les trois jours qu'il y resta, il ne cessa de prêcher
l'Evangile aux prisonniers et l'on a conté depuis que
des criminels et le geôlier lui-même,
touchés par ses paroles, avaient cru en Jésus
crucifié. On le conduisit à ce carrefour qu'une
nuit, moins de deux ans auparavant, il avait traversé
avec allégresse, portant dans son manteau blanc la
petite Thaïs, la fille de son âme, sa fleur
bïen-aimée. Attaché sur la croix, les
mains clouées, il ne poussa pas une plainte ; seulement il soupira à plusieurs reprises :
« J'ai soif ! » |
- Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu là d'où tu viens ?
Puis il sourit, et dit :
- Les voici, les anges du bon Seigneur ! Ils m'apportent du
vin et des fruits. Qu'il est frais le battement de leurs
ailes.
Et il expira.
Son visage conservait dans la mort l'expression de l'extase
bienheureuse. Les soldats qui gardaient le gibet furent
saisis d'admiration. Vivantius, accompagné de
quelques-uns de ses frères chrétiens, vint
réclamer le corps pour l'ensevelir, parmi les reliques
des martyrs, dans la crypte de saint Jean le Baptiste. Et
l'Eglise garda la mémoire vénérée
de saint Théodore le Nubien.
Trois ans plus tard, Constantin, vainqueur de Maxence, publia
un édit par lequel il assurait la paix aux
chrétiens, et désormais les fidèles ne
furent plus persécutés que par les
hérétiques.
Thaïs achevait sa onzième année, quand son
ami mourut dans les tourments. Elle en ressentit une
tristesse et une épouvante invincibles. Elle n'avait
pas l'âme assez pure pour comprendre que l'esclave
Ahmès, par sa vie et sa mort, était un
bienheureux. Cette idée germa dans sa petite
âme, qu'il n'est possible d'être bon en ce monde
qu'au prix des plus affreuses souffrances. Et elle craignit
d'être bonne, car sa chair délicate redoutait la
douleur.
Elle se donna avant l'âge à des jeunes
garçons du port et elle suivit les vieillards qui
errent le soir dans les faubourg ; et avec ce qu'elle
recevait d'eux elle achetait des gâteaux et des
parures.
Comme elle ne rapportait à la maison rien de ce
qu'elle avait gagné, sa mère l'accablait de
mauvais traitements. Pour éviter les coups, elle
courait pieds nus jusqu'aux remparts de la ville et se
cachait avec les lézards dans les fentes des pierres.
Là, elle songeait, pleine d'envie, aux femmes qu'elle
voyait passer, richement parées, dans leur
litière entourée d'esclaves.
Un jour que, frappée plus rudement que de coutume,
elle se tenait accroupie devant la porte, dans une
immobilité farouche, une vieille femme s'arrêta
devant elle, la considéra quelques instants en
silence, puis s'écria :
- 0 la jolie fleur, la belle enfant ! Heureux le père
qui t'engendra et la mère qui te mit au monde !
Thaïs restait muette et tenait ses regards fixés
vers la terre. Ses paupières étaient rouges et
l'on voyait qu'elle avait pleuré.
- Ma violette blanche, reprit la vieille, ta mère
n'est-elle pas heureuse d'avoir nourri une petite
déesse telle que toi, et ton père, en te
voyant, ne se réjouit-il pas dans le fond de son cœur ?
Alors l'enfant, comme se parlant à elle-même
:
- Mon père est une outre gonflée de vin et ma
mère une sangsue avide.
La vieille regarda à droite et à gauche si on
ne la voyait pas. Puis d'une voix caressante :
- Douce hyacinthe fleurie, belle buveuse de lumière,
viens avec moi et tu n'auras, pour vivre, qu'à danser
et à sourire. Je te nourrirai de gâteaux de
miel, et mon fils, mon propre fils t'aimera comme ses yeux.
Il est beau, mon fils, il est jeune ; il n'a au menton qu'une
barbe légère ; sa peau est douce, et c'est,
comme on dit, un petit cochon d'Acharné.
Thaïs répondit :
- Je veux bien aller avec toi.
Et, s'étant levée, elle suivit la vieille hors
de la ville.
Cette femme, nommée Moeroé, conduisait de pays
en pays des filles et des jeunes garçons qu'elle
instruisait dans la danse et qu'elle louait ensuite aux
riches pour paraître dans les festins.
Devinant que Thaïs deviendrait bientôt la plus
belle des femmes, elle lui apprit, à coups de fouet,
la musique et la prosodie, et elle flagellait avec des
lanières de cuir ces jambes divines, quand elles ne se
levaient pas en mesure au son de la cithare. Son sfil,
avorton décrépit, sans âge et sans sexe,
accablait de mauvais traitements cette enfant en qui il
poursuivait de sa haine la race entière des femmes.
Rival des ballerines, dont il affectait la grâce, il
enseignait à Thaïs l'art de feindre, dans les
pantomimes, par l'expression du visage, le geste et
l'attitude, tous les sentiments humains et surtout les
passions de l'amour. Il lui donnait avec dégoût
les conseils d'un maître habile ; mais, jaloux de son
élève, il lui griffait les joues, lui
pinçait le bras ou la venait piquer par
derrière avec un poinçon, à la
manière des filles méchantes, dès qu'il
s'apercevait trop vivement qu'elle était née
pour la volupté des hommes. Grâce à ses
leçons, elle devint en peu de temps musicienne, mime
et danseuse excellente. La méchanceté de ses
maîtres ne la surprenait point et il lui semblait
naturel d'être indignement traitée. Elle
éprouvait même quelque respect pour cette
vieille femme qui savait la musique et buvait du vin grec.
Moeroé, s'étant arrêtée à
Antioche, loua son élève comme danseuse et
comme joueuse de flûte aux riches négociants de
la ville qui donnaient des festins. Thaïs dansa et plut.
Les plus gros banquiers l'emmenaient, au sortir de table,
dans les bosquets de l'Oronte. Elle se donnait à tous,
ne sachant pas le prix de l'amour. Mais une nuit qu'elle
avait dansé devant les jeunes hommes les plus
élégants de la ville, le fils du proconsul
s'approcha d'elle, tout brillant de jeunesse et de
volupté, et lui dit d'une voix qui semblait
mouillée de baisers :
- Que ne suis-je, Thaïs, la couronne qui ceint ta
chevelure, la tunique qui presse ton corps charmant, la
sandale de ton beau pied ! Mais je veux que tu me foules
à tes pieds comme une sandale ; je veux que mes
caresses soient ta tunique et ta couronne. Viens, belle
enfant, viens dans ma maison et oublions l'univers.
Elle le regarda tandis qu'il parlait et elle vit qu'il
était beau. Soudain elle sentit la sueur qui lui
glaçait le front ; elle devint verte comme l'herbe ; elle chancela ; un nuage descendit sur ses paupières.
Il la priait encore. Mais elle refusa de le suivre. En vain,
il lui jeta des regards ardents, des paroles
enflammées, et quand il la prit dans ses bras en
s'efforçant de l'entraîner, elle le repoussa
avec rudesse. Alors il se fit suppliant et lui montra ses
larmes. Sous l'empire d'une force nouvelle, inconnue,
invincible, elle résista.
- Quelle folie ! disaient les convives. Lollius est noble ; il est beau, il est riche, et voici qu'une joueuse de
flûte le dédaigne !
Lollius rentra seul dans sa maison et la nuit l'embrasa tout
entier d'amour. Il vint dès le matin, pâle et
les yeux rouges, suspendre des fleurs à la porte de la
joueuse de flûte. Cependant Thaïs, saisie de
trouble et d'effroi, fuyait Lollius et le voyait sans cesse
au dedans d'elle-même. Elle souffrait et ne connaissait
pas son mal. Elle se demandait pourquoi elle était
ainsi changée et d'où lui venait sa
mélancolie. Elle repoussait tous ses amants : ils lui
faisaient horreur. Elle ne voulait plus voir la
lumière et restait tout le jour couchée sur son
lit, sanglotant la tête dans les coussins. Lollius,
ayant su forcer la porte de Thaïs, vint plusieurs fois
supplier et maudire cette méchante enfant. Elle
restait devant lui craintive comme une vierge et
répétait :
- Je ne veux pas ! Je ne veux pas !
Puis, au bout de quinze jours, s'étant donnée
à lui, elle connut qu'elle l'aimait ; elle le suivit
dans sa maison et ne le quitta plus. Ce fut une vie
délicieuse. Ils passaient tout le jour
enfermés, les yeux dans les yeux, se disant l'un
à l'autre des paroles qu'on ne dit qu'aux enfants. Le
soir, ils se promenaient sur les bords solitaires de l'Oronte
et se perdaient dans les bois de lauriers. Parfois ils se
levaient dès l'aube pour aller cueillir des jacinthes
sur les pentes du Silpicus. Ils buvaient dans la même
coupe, et, quand elle portait un grain de raisin à sa
bouche, il le lui prenait entre les lèvres avec ses
dents.
Moeroé vint chez Lollius réclamer Thaïs
à grands cris :
- C'est ma fille, disait-elle, ma fille qu'on m'arrache, ma
fleur parfumée, mes petites entrailles ! ...
Lollius la renvoya avec une grosse somme d'argent. Mais,
comme elle revint demandant encore quelques staters d'or, le
jeune homme la fit mettre en prison, et les magistrats, ayant
découvert plusieurs crimes dont elle s'était
rendue coupable, elle fut condamnée à mort et
livrée aux bêtes.
Thaïs aimait Lollius avec toutes les fureurs de
l'imagination et toutes les surprises de l'innocence. Elle
lui disait dans toute la vérité de son cœur
:
- Je n'ai jamais été qu'à toi. Lollius
lui répondait :
- Tu ne ressembles à aucune autre femme.
Le charme dura six mois et se rompit en un jour. Soudainement
Thaïs se sentit vide et seule. Elle ne reconnaissait
plus Lollius ; elle songeait :
- Qui me l'a ainsi changé en un instant ? Comment se
fait-il qu'il ressemble désormais à tous les
autres hommes et qu'il ne ressemble plus à
lui-même ?
Elle le quitta, non sans un secret désir de chercher
Lollius en un autre, puisqu'elle ne le retrouvait plus en
lui. Elle songeait aussi que vivre avec un homme qu'elle
n'aurait jamais aimé serait moins triste que de vivre
avec un homme qu'elle n'aimait plus. Elle se montra, en
compagnie des riches voluptueux, à ces fêtes
sacrées où l'on voyait des choeurs de vierges
nues dansant dans les temples et des troupes de courtisanes
traversant l'Oronte à la nage. Elle prit sa part de
tous les plaisirs qu'étalait la ville
élégante et monstrueuse, surtout elle
fréquenta assidûment les théâtres,
dans lesquels des mimes habiles, venus de tous les pays,
paraissaient aux applaudissements d'une foule avide de
spectacles.
Elle observait avec soin les mimes, les danseurs, les
comédiens et particulièrement les femmes qui,
dans les tragédies, représentaient les
déesses amantes des jeunes hommes et les mortelles
aimées des dieux. Ayant surpris les secrets par
lesquels elles charmaient la foule, elle se dit que, plus
belle, elle jouerait mieux encore. Elle alla trouver le chef
des mimes et lui demanda d'être admise dans sa troupe.
Grrâce à sa beauté et aux leçons
de la vieille Moeroé, elle fut accueillie et parut sur
la scène dans le personnage de Dircé.
Elle plut médiocrement, parce qu'elle manquait
d'expérience et aussi parce que les spectateurs
n'étaient pas excités à l'admiration par
un long bruit de louanges. Mais après quelques mois
d'obscurs débuts, la puissance de sa beauté
éclata sur la scène avec une telle force, que
la ville entière s'en émut. Tout Antioche
s'étouffait au théâtre. Les magistrats
impériaux et les premiers citoyens s'y rendaient,
poussés par la force de l'opinion. Les portefaix, les
balayeurs et les ouvriers du port se privaient d'ail et de
paîn pour payer leur place. Les poètes
composaient des épigrammes en son honneur. Les
philosophes barbus déclamaient contre elle dans les
bains et dans les gymnases ; sur le passage de sa
litière, les prêtres des chrétiens
détournaient la tête. Le seuil de sa maison
était couronné de fleurs et arrosé de
sang. Elle recevait de ses amants de l'or, non plus
compté, mais mesuré au médimne, et tous
les trésors amassés par les vieillards
économes venaient, comme des fleuves, se perdre
à ses pieds. C'est pourquoi son âme était
sereine. Elle se réjouissait dans un paisible orgueil
de la faveur publique et de la bonté des dieux, et,
tant aimée, elle s'aimait elle-même.
Après avoir joui pendant plusieurs années de
l'admiration et de l'amour des Antiochiens, elle fut prise du
désir de revoir Alexandrie et de montrer sa gloire
à la ville dans laquelle, enfant, elle errait sous la
misère et la honte, affamée et maigre comme une
sauterelle au milieu d'un chemin poudreux. La ville d'or la
reçut avec joie et la combla de nouvelles richesses.
Quand elle parut dans les jeux, ce fut un triomphe. Il lui
vint des admirateurs et des amants innombrables. Elle les
accueillait indifféremment, car elle
désespérait enfin de retrouver Lollius.
Elle reçut parmi tant d'autres le philosophe Nicias
qui la désirait, bien qu'il fît profession de
vivre sans désirs. Malgré sa richesse, il
était intelligent et doux ; mais il ne la charma ni
par la finesse de son esprit, ni par la grâce de ses
sentiments. Elle ne l'aimait pas et même elle
s'irritait parfois de ses élégantes ironies. Il
la blessait par son doute perpétuel. C'est qu'il ne
croyait à rien et qu'elle croyait à tout. Elle
croyait à la providence divine, à la
toute-puissance des mauvais esprits, aux sorts, aux
conjurations, à la justice éternelle. Elle
croyait en Jésus-Chrit et en la bonne déesse
des Syriens ; elle croyait encore que les chiennes aboient
quand la sombre Hécate passe dans les carrefours et
qu'une femme inspire l'amour en versant un philtre dans une
coupe qu'enveloppe ïa toison sanglante d'une brebis.
Elle avait soif d'inconnu ; elle appelait des êtres
sans nom et vivait dans une attente perpétuelle.
L'avenir lui faisait peur et elle voulait le connaître.
Elle s'entourait de prêtres d'Isis, de mages
chaldéens, de pharmacopoles et de sorciers, qui la
trompaient toujours et ne la lassaient jamais. Elle craignait
la mort et la voyait partout. Quand elle cédait
à la volupté, il lui semblait tout à
coup qu'un doigt glacé touchait son épaule nue
et, toute pâle, elle criait d'épouvante dans les
bras qui la pressaient. Nicias lui disait :
- Que notre destinée soit de descendre en cheveux
blancs et les joues creuses dans la nuit éternelle, ou
que ce jour même, qui rit maintenant dans le vaste
ciel, soit notre dernier jour, qu'importe, ô ma
Thaïs ! Goûtons la vie. Nous aurons beaucoup
vécu si nous avons beaucoup senti. Il n'est pas
d'autre intelligence que celle des sens : aimer c'est
comprendre. Ce que nous ignorons n'est pas. A quoi bon nous
tourmenter pour un néant ?
Elle lui répondait avec colère :
- Je méprise ceux qui comme toi n'espèrent ni
ne craignent rien. Je veux savoir ! Je veux savoir !
Pour connaître le secret de la vie, elle se mit
à lire les livres des philosophes, mais elle ne les
comprit pas. A mesure que les années de son enfance
s'éloignaient d'elle, elle les rappelait dans son
esprit plus volontiers. Elle aimait à parcourir, le
soir, sous un déguisement, les ruelles, les chemins de
ronde, les places publiques où elle avait
misérablement grandi. Elle regrettait d'avoir perdu
ses parents et surtout de n'avoir pu les aimer. Quand elle
rencontrait des prêtres chrétiens, elle songeait
à son baptême et se sentait troublée. Une
nuit, qu'enveloppée d'un long manteau et ses blonds
cheveux cachés sous un capuchon sombre, elle errait
dans les faubourgs de la ville, elle se trouva, sans savoir
comment elle y était venue, devant la pauvre
église de Saint-Jean-le-Baptiste. Elle entendit qu'on
chantait dans l'intérieur et vit une lumière
éclatante qui glissait par les fentes de la porte. Il
n'y avait là rien d'étrange, puisque depuis
vingt ans les chrétiens, protégés par le
vainqueur de Maxence, solennisaient publiquement leurs
fêtes. Mais ces chants signifiaient un ardent appel aux
âmes. Comme conviée aux mystères, la
comédienne, poussant du bras la porte, entra dans la
maison. Elle trouva là une nombreuse assemblée,
des femmes, des enfants, des vieillards à genoux
devant un tombeau adossé à la muraille. Ce
tombeau n'était qu'une cuve de pierre
grossièrement sculptée de pampres et de grappes
de raisins ; pourtant il avait reçu de grands honneurs
: il était couvert de palmes vertes et de couronnes de
rosés rouges. Tout autour, d'innombrables
lumières étoilaient l'ombre dans laquelle la
fumée des gommes d'Arabie semblait les plis des voiles
des anges. Et l'on devinait sur les murs des figures
pareilles à des visions du ciel. Des prêtres
vêtus de blanc se tenaient prosternés au pied du
sarcophage. Les hymnes qu'ils chantaient avec le peuple
exprimaient les délices de la souffrance et
mêlaient, dans un deuil triomphal, tant
d'allégresse à tant de douleur que Thaïs,
en les écoutant, sentait les voluptés de la vie
et les affres de la mort couler à la fois dans ses
sens renouvelés.
Quand ils eurent fini de chanter, les fidèles se
levèrent pour aller baiser à la file la paroi
du tombeau. C'était des hommes simples,
accoutumés à travailler de leurs mains. Ils
s'avançaient d'un pas lourd, l'oeil fixe, la bouche
pendante, avec un air de candeur. Ils s'agenouillaient,
chacun à son tour, devant le sarcophage et y
appuyaient leurs lèvres. Les femmes élevaient
dans leurs bras les petits enfants et leur posaient doucement
la joue contre la pierre.
Thaïs, surprise et troublée, demanda à un
diacre pourquoi ils faisaient ainsi.
- Ne sais-tu pas, femme, lui répondit le diacre, que
nous célébrons aujourd'hui la mémoire
bienheureuse de saint Théodore le Nubien, qui souffrit
pour la foi au temps de Dioclétien empereur ? Il
vécut chaste et mourut martyr, c'est pourquoi,
vêtus de blanc, nous portons des roses rouges à
son tombeau glorieux.
En entendant ces paroles, Thaïs tomba à genoux et
fondit en larmes. Le souvenir à demi éteint
d'Ahmès se ranimait dans son âme. Sur cette
mémoire obscure, douce et douloureuse, l'éclat
des cierges, le parfum des roses, les nuées de
l'encens, l'harmonie des cantiques, la piété
des âmes jetaient les charmes de la gloire. Thaïs
songeait dans l'éblouissement :
Il était humble et voici qu'il est grand et qu'il est
beau ! Comment s'est-il élevé au-dessus des
hommes ? Quelle est donc cette chose inconnue qui vaut mieux
que la richesse et que la volupté ?
Elle se leva lentement, tourna vers la tombe du saint qui
l'avait aimée ses yeux de violette où
brillaient des larmes à la clarté des cierges ; puis, la tête baissée, humble, lente, la
dernière, de ses lèvres où tant de
désirs s'étaient suspendus, elle baisa la
pierre de l'esclave.
Rentrée dans sa maison, elle y trouva Nicias qui, la
chevelure parfumée et la tunique déliée,
l'attendait en lisant un traité de morale. Il
s'avança vers elle les bras ouverts.
- Méchante Thaïs, lui dit-il d'une voix riante,
tandis que tu tardais à venir, sais-tu ce que je
voyais dans ce manuscrit dicté par le plus grave des
stoïciens ? Des préceptes vertueux et de
fières maximes ? Non ! Sur l'austère papyrus,
je voyais danser mille et mille petites Thaïs. Elles
avaient chacune la hauteur d'un doigt, et pourtant leur
grâce était infinie et toutes étaient
l'unique Thaïs. Il y en avait qui traînaient des
manteaux de pourpre et d'or ; d'autres, semblables à
une nuée blanche, flottaient dans l'air sous des
voiles diaphanes.
D'autres encore, immobiles et divinement nues, pour mieux
inspirer la volupté, n'exprimaient aucune
pensée. Enfin, il y en avait deux qui se tenaient par
la main, deux si pareilles, qu'il était impossible de
les distinguer l'une de l'autre. Elles souriaient toutes
deux. La première disait : « Je suis
l'amour ». L'autre : « Je suis la
mort ».
En parlant ainsi, il pressait Thaïs dans ses bras, et,
ne voyant pas le regard farouche qu'elle fixait à
terre, il ajoutait les pensées aux pensées,
sans souci qu'elles fussent perdues :
- Oui, quand j'avais sous les yeux la ligne où il est
écrit : « Rien ne doit te détourner
de cultiver ton âme », je lisais :
« Les baisers de Thaïs sont plus ardents que
la flamme et plus doux que le miel ». Voilà
comment, par ta faute, méchante enfant, un philosophe
comprend aujourd'hui les livres des philosophes. Il est vrai
que, tous tant que nous sommes, nous ne découvrons que
notre propre pensée dans la pensée d'autrui, et
que tous nous lisons un peu les livres comme je viens de lire
celui-ci...
Elle ne l'écoutait pas, et son âme était
encore devant le tombeau du Nubien. Comme il l'entendit
soupirer, il lui mit un baiser sur la nuque et il lui dit
:
- Ne sois pas triste, mon enfant. On n'est heureux au monde
que quand on oublie le monde. Nous avons des secrets pour
cela. Viens ; trompons la vie : elle nous le rendra bien.
Viens ; aimons-nous.
Mais elle le repoussa :
- Nous aimer ! s'écria-t-elle amèrement. Mais
tu n'as jamais aimé personne, toi ! Et je ne t'aime
pas ! Non ! je ne t'aime pas ! Je te hais. Va-t'en ! Je te
hais. J'exècre et je méprise tous les heureux
et tous les riches. Va-t'en ! va-t'en ! ... Il n'y a de
bonté que chez les malheureux. Quand j'étais
enfant, j'ai connu un esclave noir qui est mort sur la croix.
Il était bon ; il était plein d'amour et il
possédait le secret de la vie. Tu ne serais pas digne
de lui laver les pieds. Va-t'en ! Je ne veux plus te
voir.
Elle s'étendit à plat ventre sur le tapis et
passa la nuit à sangloter, formant le dessein de vivre
désormais, comme saint Théodore, dans la
pauvreté et dans la simplicité.
Dès le lendemain, elle se rejeta dans les plaisirs
auxquels elle était vouée. Comme elle savait
que sa beauté, encore intacte, ne durerait plus
longtemps, elle se hâtait d'en tirer toute joie et
toute gloire. Au théâtre, où elle se
montrait avec plus d'étude que jamais, elle rendait
vivantes les imaginations des sculpteurs, des peintres et des
poètes. Reconnaissant dans les formes, dans les
mouvements, dans la démarche de la comédienne
une idée de la divine harmonie qui règle les
mondes, savants et philosophes mettaient une grâce si
parfaite au rang des vertus et disaient : « Elle
aussi, Thaïs, est géomètre ! »
Les ignorants, les pauvres, les humbles, les timides, devant
lesquels elle consentait à paraître, l'en
bénissaient comme d'une charité céleste.
Pourtant, elle était triste au milieu des louanges et,
plus que jamais, elle craignait de mourir. Rien ne pouvait la
distraire de son inquiétude, pas même sa maison
et ses jardins qui étaient célèbres et
sur lesquels on faisait des proverbes, dans la ville.
Elle avait fait planter des arbres apportés à
grands frais de l'Inde et de la Perse. Une eau vive les
arrosait en chantant et des colonnades en ruines, des rochers
sauvages, imités par un habile architecte,
étaient reflétés dans un lac où
se miraient des statues. Au milieu du jardin,
s'élevait la grotte des Nymphes, qui devait son nom
à trois grandes figures de femmes, en marbre peint
avec art, qu'on rencontrait dès le seuil. Ces femmes
se dépouillaient de leurs vêtements pour prendre
un bain. Inquiètes, elles tournaient la tête,
craignant d'être vues, et elles semblaient vivantes. La
lumière ne parvenait dans cette retraite qu'à
travers de minces nappes d'eau qui l'adoucissaient et
l'irisaient. Aux parois pendaient de toutes parts, comme dans
les grottes sacrées, des couronnes, des guirlandes et
des tableaux votifs, dans lesquels la beauté de
Thaïs était célébrée. Il s'y
trouvait aussi des masques tragiques et des masques comiques
revêtus de vives couleurs, des peintures
représentant ou des scènes de
théâtre, ou des figures grotesques, ou des
animaux fabuleux. Au milieu, se dressait sur une stèle
un petit Eros d'ivoire, d'un antique et merveilleux travail.
C'était un don de Nicias. Une chèvre de marbre
noir se tenait dans une excavation, et l'on voyait briller
ses yeux d'agate. Six chevreaux d'albâtre se pressaient
autour de ses mamelles ; mais, soulevant ses pieds fourchus
et sa tête camuse, elle semblait impatiente de grimper
sur les rochers. Le sol était couvert de tapis de
Byzance, d'oreillers brodés par les hommes jaunes de
Cathay et de peaux de lions lybiques. Des cassolettes d'or y
fumaient imperceptiblement. Çà et là,
au-dessus des grands vases d'onyx, s'élançaient
des perséas fleuris. Et, tout au fond, dans l'ombre et
dans la pourpre, luisaient des clous d'or sur
l'écaille d'une tortue géante de l'Inde, qui
renversée servait de lit à la
comédienne. C'est là que chaque jour, au
murmure des eaux, parmi les parfums et les fleurs,
Thaïs, mollement couchée, attendait l'heure de
souper en conversant avec ses amis ou en songeant seule, soit
aux artifices du théâtre, soit à la fuite
des années.
Or, ce jour-là, elle se reposait après les jeux
dans la grotte des Nymphes. Elle épiait dans son
miroir les premiers déclins de sa beauté et
pensait avec épouvante que le temps viendrait enfin
des cheveux blancs et des rides. En vain elle cherchait
à se rassurer, en se disant qu'il suffit, pour
recouvrer la fraîcheur du teint, de brûler
certaines herbes en prononçant des formules magiques.
Une voix impitoyable lui criait : « Tu vieilliras,
Thaïs, tu vieilliras ! » Et la sueur de
l'épouvante lui glaçait le front. Puis, se
regardant de nouveau dans le miroir avec une tendresse
infinie, elle se trouvait belle encore et digne d'être
aimée. Se souriant à elle-même, elle
murmurait : « Il n'y a pas dans Alexandrie une
seule femme qui puisse lutter avec moi pour la souplesse de
la taille, la grâce des mouvements et la magnificence
des bras, et les bras, ô mon miroir, ce sont les vraies
chaînes de l'amour ! »
Comme elle songeait ainsi, elle vit un inconnu debout devant
elle, maigre, les yeux ardents, la barbe inculte et
vêtu d'une robe richement brodée. Laissant
tomber son miroir, elle poussa un cri d'effroi.
Paphnuce se tenait immobile et, voyant combien elle
était belle, il faisait du fond du cœur cette
prière :
- Fais, ô mon Dieu, que le visage de cette femme, loin
de me scandaliser, édifie ton serviteur.
Puis, s'efforçant de parler, il dit :
- Thaïs, j'habite une contrée lointaine et le
renom de ta beauté m'a conduit jusqu'à toi. On
rapporte que tu es la plus habile des comédiennes et
la plus irrésistible des femmes. Ce que l'on conte de
tes richesses et de tes amours semble fabuleux et rappelle
l'antique Rhodopis, dont tous les bateliers du Nil savent par
cœur l'histoire merveilleuse. C'est pourquoi j'ai
été pris du désir de te connaître
et je vois que la vérité passe la
renommée. Tu es mille fois plus savante et plus belle
qu'on ne le publie. Et maintenant que je le vois, je me dis :
« Il est impossible d'approcher d'elle sans
chanceler comme un homme ivre ».
Ces paroles, étaient feintes ; mais le moine,
animé d'un zèle pieux, les répandait
avec une ardeur véritable. Cependant, Thaïs
regardait sans déplaisir cet être étrange
qui lui avait fait peur. Par son aspect rude et sauvage, par
le feu sombre qui chargeait ses regards, Paphnuce
l'étonnait. Elle était curieuse de
connaître l'état et la vie d'un homme si
différent de tous ceux qu'elle connaissait. Elle lui
répondit avec une douce raillerie :
- Tu semblés prompt à l'admiration,
étranger. Prends garde que mes regards ne te consument
jusqu'aux os ! Prends garde de m'aimer !
Il lui dit :
- Je t'aime, ô Thaïs ! Je t'aime plus que ma vie
et plus que moi-même. Pour toi, j'ai quitté mon
désert regrettable ; pour toi, mes lèvres,
vouées au silence, ont prononcé des paroles
profanes ; pour toi, j'ai vu ce que je ne devais pas voir,
j'ai entendu ce qu'il m'était interdit d'entendre ; pour toi, mon âme s'est troublée, mon cœur
s'est ouvert et des pensées en ont jailli, semblables
aux sources vives où boivent les colombes ; pour toi,
j'ai marché jour et nuit à travers des sables
peuplés de larves et de vampires ; pour toi, j'ai
posé mon pied nu sur les vipères et les
scorpions ! Oui, je t'aime ! Je t'aime, non point à
l'exemple de ces hommes qui, tout enflammés du
désir de la chair, viennent à toi comme des
loups dévorants ou des taureaux furieux. Tu es
chère à ceux-là comme la gazelle au
lion. Leurs amours carnassières le dévorent
jusqu'à l'âme, ô femme ! Moi, je t'aime en
esprit et en vérité, je t'aime en Dieu et pour
les siècles des siècles ; ce que j'ai pour toi
dans mon sein se nomme ardeur véritable et divine
charité. Je te promets mieux qu'ivresse fleurie et que
songes d'une nuit brève. Je le promets de saintes
agapes et des noces célestes. La
félicité que je t'apporte ne finira jamais ; elle est inouïe ; elle est ineffable et telle que, si
les heureux de ce monde en pouvaient seulement entrevoir une
ombre, ils mourraient aussitôt
d'étonnement.
Thaïs, riant d'un air mutin :
- Ami, dit-elle, montre-moi donc un si merveilleux amour.
Hâte-toi! de trop longs discours offenseraient ma
beauté, ne perdons pas un moment. Je suis impatiente
de connaître la félicité que tu
m'annonces ; mais, à vrai dire, je crains de l'ignorer
toujours et que tout ce que tu me promets ne
s'évanouisse en paroles. Il est plus facile de
promettre un grand bonheur que de le donner. Chacun a son
talent. Je crois que le tien est de discourir. Tu parles d'un
amour inconnu. Depuis si longtemps qu'on se donne des
baisers, il serait bien extraordinaire qu'il restât
encore des secrets d'amour. Sur ce sujet, les amants en
savent plus que les mages.
- Thaïs, ne raille point. Je t'apporte l'amour
inconnu.
- Ami, tu viens tard. Je connais tous les amours.
- L'amour que je t'apporte est plein de gloire, tandis que
les amours que tu connais n'enfantent que la honte.
Thaïs le regarda d'un oeil sombre ; un pli dur
traversait son petit front :
- Tu es bien hardi, étranger, d'offenser ton
hôtesse. Regarde-moi et dis si je ressemble à
une créature accablée d'opprobre. Non ! je n'ai
pas honte, et toutes celles qui vivent comme je fais n'ont
pas de honte non plus, bien qu'elles soient moins belles et
moins riches que moi. J'ai semé la volupté sur
tous mes pas, et c'est par là que je suis
célèbre dans tout l'univers. J'ai plus de
puissance que les maîtres du monde. Je les ai vus
à mes pieds. Regarde-moi, regarde ces petits pieds :
des milliers d'hommes paieraient de leur sang le bonheur de
les baiser. Je ne suis pas bien grande et ne tiens pas
beaucoup de place sur la terre. Pour ceux qui me voient du
haut du Serapeum, quand je passe dans la rue, je ressemble
à un grain de riz ; mais ce grain de riz causa parmi
les hommes des deuils, des désespoirs et des haines et
des crimes à remplir le Tartare. N'es-tu pas fou de me
parler de honte, quand tout crie la gloire autour de moi ?
- Ce qui est gloire aux yeux des hommes est infamie devant
Dieu. 0 femme, nous avons été nourris dans des
contrées si différentes qu'il n'est pas
surprenant que nous n'ayons ni le même langage ni la
même pensée. Pourtant, le ciel m'est
témoin que je veux m'accorder avec toi et que mon
dessein est de ne pas te quitter que nous n'ayons les
mêmes sentiments. Qui m'inspirera des discours
embrasés pour que tu fondes comme la cire à mon
souffle, ô femme, et que les doigts de mes
désirs puissent te modeler à leur gré ? Quelle vertu te livrera à moi, ô la plus
chère des âmes, afin que l'esprit qui m'anime,
te créant une seconde fois, t'imprime une
beauté nouvelle et que tu t'écries en pleurant
de joie : « C'est seulement d'aujourd'hui que je
suis née ! » Qui fera jaillir de mon cœur
une fontaine de Siloé, dans laquelle tu retrouves, en
te baignant, ta pureté première ? Qui me
changera en un Jourdain, dont les ondes, répandues sur
toi, te donneront la vie éternelle ?
Thaïs n'était plus irritée.
- Cet homme, pensait-elle, parle de vie éternelle et
tout ce qu'il dit semble écrit sur un talisman. Nul
doute que ce ne soit un mage et qu'il n'ait des secrets
contre la vieillesse et la mort.
Et elle résolut de s'offrir à lui. C'est
pourquoi, feignant de le craindre, elle s'éloigna de
quelques pas et, gagnant le fond de la grotte, elle s'assit
au bord du lit, ramena avec art sa tunique sur sa poitrine,
puis, immobile, muette, les paupières baissées,
elle attendit. Ses longs cils faisaient une ombre douce sur
ses joues. Toute son attitude exprimait la pudeur ; ses pieds
nus se balançaient mollement et elle ressemblait
à une enfant qui songe, assise au bord d'une
rivière.
Mais Paphnuce la regardait et ne bougeait pas. Ses genoux
tremblants ne le portaient plus, sa langue s'était
subitement desséchée dans sa bouche ; un
tumulte effrayant s'élevait dans sa tête. Tout
à coup son regard se voila et il ne vit plus devant
lui qu'un nuage épais.
Il pensa que la main de Jésus s'était
posée sur ses yeux pour lui cacher cette femme.
Rassuré par un tel secours, raffermi, fortifié,
il dit avec une gravité digne d'un ancien du
désert :
- Si tu te livres à moi, crois-tu donc être
cachée à Dieu ?
Elle secoua la tête.
- Dieu ! Qui le force à toujours avoir l'oeil sur la
grotte des Nymphes ? Qu'il se retire si nous l'offensons ! Mais pourquoi l'offenserions-nous ? Puisqu'il nous a
créés, il ne peut être ni
fâché ni surpris de nous voir tels qu'il nous a
faits et agissant selon la nature qu'il nous a donnée.
On parle beaucoup trop pour lui et on lui prête bien
souvent des idées qu'il n'a jamais eues.
Toi-même, étranger, connais-tu bien son
véritable caractère ? Qui es-tu pour me parier
en son nom ?
A cette question, le moine, entr'ouvrant sa robe d'emprunt,
montra son cilice et dit :
- Je suis Paphnuce, abbé d'Antinoé, et je viens
du saint désert. La main qui retira Abraham de
Chaldée et Loth de Sodome m'a séparé du
siècle. Je n'existais déjà plus pour les
hommes. Mais ton image m'est apparue dans ma Jérusalem
des sables et j'ai connu que tu étais pleine de
corruption et qu'en toi était la mort. Et me voici
devant toi, femme, comme devant un sépulcre et je te
crie : « Thaïs,
lève-toi ».
Aux noms de Paphnuce, de moine et d'abbé elle avait
pâli d'épouvante. Et la voilà qui, les
cheveux épars, les mains jointes, pleurant et
gémissant, se traîne aux pieds du saint :
- Ne me fais pas de mal! Pourquoi es-tu venu ? que me veux-tu ? Ne me fais pas de mal ! Je sais que les saints du
désert détestent les femmes qui, comme moi,
sont faites pour plaire. J'ai peur que tu ne me haïsses
et que tu ne veuilles me nuire. Va ! je ne doute pas de ta
puissance. Mais sache, Paphnuce, qu'il ne faut ni me
mépriser ni me haïr. Je n'ai jamais, comme tant
d'hommes que je fréquente, raillé ta
pauvreté volontaire. A ton tour, ne me fais pas un
crime de ma richesse. Je suis belle et habile aux jeux. Je
n'ai pas plus choisi ma condition que ma nature.
J'étais faite pour ce que je fais. Je suis née
pour charmer les hommes. Et, toi-même, tout à
l'heure, tu disais que tu m'aimais. N'use pas de ta science
contre moi. Ne prononce pas des paroles magiques qui
détruiraient ma beauté ou me changeraient en
une statue de sel. Ne me fais pas peur ! je ne suis
déjà que trop effrayée. Ne me fais pas
mourir ! je crains tant la mort.
Il lui fit signe de se relever et dit : - Enfant,
rassure-toi. Je ne te jetterai pas l'opprobre et le
mépris. Je viens à toi de la part de Celui qui,
s'étant assis au bord du puits, but à l'urne
que lui tendait la Samaritaine et qui, lorsqu'il soupait au
logis de Simon, reçut les parfums de Marie. Je ne suis
pas sans péché pour te jeter la première
pierre. J'ai souvent mal employé les grâces
abondantes que Dieu a répandues sur moi. Ce n'est pas
la Colère, c'est la Pitié qui m'a pris par la
main pour me conduire ici. J'ai pu sans mentir t'aborder avee
des paroles d'amour, car c'est le zèle du cœur qui
m'amène à toi. Je brûle du feu de la
charité et si tes yeux, accoutumés aux
spectacles grossiers de la chair, pouvaient voir les choses
sous leur aspect mystique, je t'apparaîtrais comme un
rameau détaché de ce buisson ardent que le
Seigneur montra sur la montagne à l'antique
Moïse, pour lui faire comprendre le véritable
amour, celui qui nous embrase sans nous consumer et qui, loin
de laisser après lui des charbons et de vaines
cendres, embaume et parfume pour l'éternité
tout ce qu'il pénètre.
- Moine, je te crois et je ne crains plus de de toi ni
embûche ni maléfice. J'ai souvent entendu parler
des solitaires de la Thébaïde. Ce que l'on m'a
conté de la vie d'Antoine et de Paul est merveilleux.
Ton nom ne m'était pas inconnu et l'on m'a dit que,
jeune encore, tu égalais en vertu les plus vieux
anachorètes. Dès que je t'ai vu, sans savoir
qui tu étais, j'ai senti qoe tu n'étais pas un
homme ordinaire. Dis-moi, pourras-tu pour moi ce que n'ont pu
ni les prêtres d'Isis, ni ceux d'Hermès, ni ceux
de la Junon Céleste, ni les devins de Chaldée,
ni les mages babyloniens ? Moine, si tu m'aimes, peux-tu
m'empêcher de mourir ?
- Femme, celui-là vivra qui veut vivre. Fuis les
délices abominables où tu meurs à
jamais. Arrache aux démons, qui le brûleraient
horriblement, ce corps que Dieu pétrit de sa salive et
anima de son souffle. Consumée de fatigue, viens te
rafraîchir aux sources bénies de la solitude ; viens boire à ces fontaines cachées dans le
désert, qui jaillissent jusqu'au ciel. Ame anxieuse,
viens posséder enfin ce que tu désirais ! cœur
avide de joie, viens goûter les joies véritables
: la pauvreté, le renoncement, l'oubli de
soi-même, l'abandon de tout l'être dans le sein
de Dieu. Ennemie du Christ et demain sa bien-aimée,
viens à lui. Viens ! toi qui cherchais, et tu diras :
« J'ai trouvé l'amour ! »
Cependant Thaïs semblait contempler des choses
lointaines :
- Moine, demanda-t-elle, si je renonce à mes plaisirs
et si je fais pénitence, est-il vrai que je
renaîtrai au ciel avec mon corps intact et dans toute
sa beauté ?
- Thaïs, je t'apporte la vie éternelle.
Crois-moi, car ce que j'annonce est la
vérité.
- Et qui me garantit que c'est la vérité ?
- David et les prophètes, l'Ecriture et les merveilles
dont tu vas être témoin.
- Moine, je voudrais te croire. Car je t'avoue que je n'ai
pas trouvé le bonheur en ce monde. Mon sort fut plus
beau que celui d'une reine et cependant la vie m'a
apporté bien des tristesses et bien des amertumes, et
voici que je suis lasse infiniment. Toutes les femmes envient
ma destinée, et il m'arrive parfois d'envier le sort
de la vieille édentée qui, du temps que
j'étais petite, vendait des gâteaux de miel sous
une porte de la ville. C'est une idée qui m'est venue
bien des fois, que seuls les pauvres sont bons, sont heureux,
sont bénis, et qu'il y a une grande douceur à
vivre humble et petit Moine, tu as remué les ondes de
mon âme et fait monter à la surface ce qui
dormait au fond. Qui croire, hélas ! Et que devenir,
et qu'est-ce que la vie ?
Tandis qu'elle parlait de la sorte, Paphnupe était
transfiguré ; une joie céleste inondait son
visage :
- Ecoute, dit-il, je ne suis pas entré seul dans ta
demeure. Un Autre m'accompagnait, un Autre qui se tient ici
debout à mon côté. Celui-là, tu ne
peux le voir, parce que tes yeux sont encore indignes de le
contempler ; mais bientôt tu le verras dans sa
splendeur charmante et tu diras : « Il est seul
aimable ! » Tout à l'heure, s'il n'avait
posé sa douce main sur mes yeux, ô Thaïs ! je serais peut-être tombé avec toi dans le
péché, car je ne suis par moi-même que
faiblesse et que trouble. Mais il nous a sauvés tous
deux ; il est aussi bon qu'il est puissant et son nom est
Sauveur. Il a été promis au monde par David et
la Sibylle, adoré dans son berceau par les bergers et
les mages, crucifié par les Pharisiens, enseveli par
les saintes femmes, révélé au monde par
les apôtres, attesté par les martyrs. Et le
voici qui, ayant appris que tu crains la mort, ô femme ! vient dans ta maison pour t'empêcher de mourir ! N'est-ce pas, ô mon Jésus ! que tu
m'appâtais en ce moment, comme tu apparus aux hommes de
Galilée en ces jours merveilleux où les
étoiles, descendues avec toi du ciel, étaient
si près de la terre, que les saints Innocents
pouvaient les saisir dans leurs mains, quand ils jouaient aux
bras de leurs mères, sur les terrasses de
Bethléem ? N'est-ce pas, mon Jésus, que nous
sommes en ta compagnie et que tu me montres la
réalité de ton corps précieux ? N'est-ce
pas que c'est là ton visage et que cette larme qui
coule sur ta joue est une larme véritable ? Oui,
l'ange de la justice éternelle la recueillera, et ce
sera la rançon de l'âme de Thaïs. N'est-ce
pas que te voilà, mon Jésus ? Mon Jésus,
tes lèvres adorables s'entr'ouvrent. Tu peux parler :
parle, je t'écoute. Et toi, Thaïs, heureuse
Thaïs ! entends ce que le Sauveur vient lui-même
te dire : c'est lui qui parle et non moi. Il dit :
« Je t'ai cherchée longtemps, ô ma
brebis égarée ! Je te trouve enfin ! Ne me fuis
plus. Laisse-toi prendre par mes mains, pauvre petite, et je
te porterai sur mes épaules jusqu'à la bergerie
céleste. Viens, ma Thaïs, viens, mon élue,
viens pleurer avec moi ! »
Et Paphnuce tomba à genoux les yeux pleins d'extase.
Alors Thaïs vit sur la face du saint le reflet de
Jésus vivant.
- O jours envolés de mon enfance ! dit-elle en
sanglotant. O mon doux père Ahmès ! bon saint
Théodore, que ne suis-je morte dans ton manteau blanc
tandis que tu m'emportais aux premières lueurs du
matin, toute fraîche encore des eaux du baptême !
Paphnuce s'élança vers elle en s'écriant
:
- Tu es baptisée ! ... O Sagesse divine ! ô
Providence ! ô Dieu bon ! Je connais maintenant la
puissance qui m'attirait vers toi. Je sais ce qui te rendait
si chère et si belle à mes yeux. C'est la vertu
des eaux baptismales qui m'a fait quitter l'ombre de Dieu
où je vivais pour t'aller chercher dans l'air
empoisonné du siècle. Une goutte, une goutte
sans doute des eaux qui lavèrent ton corps a jailli
sur mon front. Viens, ô ma soeur, et reçois de
ton frère le baiser de paix.
Et le moine effleura de ses lèvres le front de la
courtisane.
Puis il se tut, laissant parler Dieu, et l'on n'entendait
plus, dans la grotte des Nymphes, que les sanglots de
Thaïs mêlés au chant des eaux vives.
Elle pleurait sans essuyer ses larmes quand deux esclaves
noires vinrent chargées d'étoffes, de parfums
et de guirlandes.
- Ce n'était guère à propos de pleurer,
dit-elle en essayant de sourire. Les larmes rougissent les
yeux et gâtent le teint, on doit souper cette nuit chez
des amis, et je veux être belle, car il y aura
là des femmes pour épier la fatigue de mon
visage. Ces esclaves viennent m'habiller. Retire-toi, mon
père, et laisse-les faire. Elles sont adroites et
expérimentées ; aussi les ai-je payées
très cher. Vois celle-ci, qui a de gros anneaux d'or
et qui montre des dents si blanches. Je l'ai enlevée
à la femme du proconsul.
Paphnuce eut d'abord la pensée de s'opposer de toutes
ses forces à ce que Thaïs allât à ce
souper. Mais, résolu d'agir prudemment, il lui demanda
quelles personnes elle y rencontrerait.
Elle répondit qu'elle y verrait l'hôte du
festin, le vieux Cotta, préfet de la flotte. Nicias et
plusieurs autres philosophes avides de disputes, le
poète Callicrate, le grand prêtre de
Sérapis, des jeunes hommes riches occupés
surtout à dresser des chevaux, enfin des femmes dont
on ne saurait rien dire et qui n'avaient que l'avantage de la
jeunesse. Alors, par une inspiration surnaturelle :
- Va parmi eux, Thaïs, dit le moine. Va ! Mais je ne te
quitte pas. J'irai avec toi à ce festin et je me
tiendrai sans rien dire à ton côté.
Elle éclata de rire. Et tandis que les deux esclaves
noires s'empressaient autour d'elle, elle s'écria
:
- Que diront-ils quand ils verront que j'ai pour amant un
moine de la Thébaïde ?