Chapitre 10 - Thèbes (suite) - Les
hypogées
Les tombeaux des rois - Karnac au clair de lune
Les journées du 28 et du 29 décembre ont
été employées à visiter les
hypogées, ou tombeaux souterrains, qui sont sur la
rive gauche.
Ils se divisent en deux groupes. Le premier comprend les
tombeaux de la caste militaire et de la caste sacerdotale ;
ceux-là sont situés sur le flanc oriental de la
chaîne Libyque, faisant face au fleuve ; et d'ici nous
voyons la roche blanche trouée d'ouvertures oblongues
qui, rangées à la file et à divers
étages, simulent assez bien des embrasures de
fortifications. Le second groupe et le plus important
comprend les tombeaux des rois. Ils sont situés au
fond d'une vallée qui s'ouvre derrière Gournah
; c'est la vallée de Biban-el-Molouk.
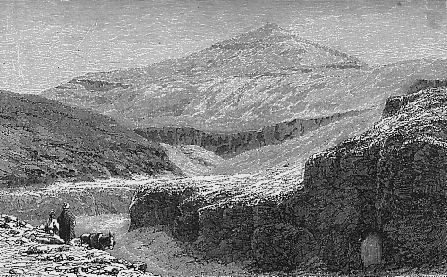 |
Quand on a traversé la plaine et atteint le pied
des montagnes, on commence à gravir, par un sentier
étroit et pierreux, des pentes inégales et
profondément bouleversées. Ce lieu
désolé s'appelle en arabe El-Assassif : c'est
apparemment le nom du petit village formé par quelques
familles logées dans ces décombres. Pas un
buisson n'ombrage ce sol déchiré et
brûlé. Çà et là
apparaissent quelques vestiges de constructions, des restes
de murs d'enceinte, et des portes qui conduisaient aux
tombeaux par une sorte d'avenue. La montagne semble avoir
été fouillée jusqu'aux entrailles : ses
débris entassés forment comme des collines qui
hérissent la pente.
La plupart des tombeaux sont creusés dans la paroi
verticale du rocher : il y en a quelques-uns cependant qui
s'ouvrent au fond de vastes excavations, où il faut
descendre comme dans une carrière. Presque toutes ces
tombes sont habitées. De misérables familles de
fellahs sont venues chercher, dans ces demeures des morts, un
abri qui a pour elles l'avantage d'être chaud l'hiver
et frais l'été. Mais il en résulte que
ces curieux monuments sont tout encombrés et
obstrués d'ustensiles de ménage, d'outils
d'agriculture, de tiges de dourah ou de maïs. On passe,
pour y pénétrer, au travers des poules, des
porcs et des enfants qui se roulent pêle-mêle
dans la poussière. Ce qu'il y a de pis, c'est que
quelquefois les fellahs y font du feu, et que la
fumée, en maint endroit, a tellement noirci les
murailles, que les peintures qui les couvrent ont à
peu près disparu.
Nous avons visité quelques-uns seulement de ces
innombrables sépulcres. Ce sont tantôt de
longues galeries formant la croix, tantôt une suite de
salles carrées réunies par de larges corridors.
Tout cela est creusé dans une roche calcaire,
médiocrement dure, très blanche et d'un grain
assez fin. Les parois et quelquefois les plafonds sont
couverts de sculptures peintes, d'un travail plus ou moins
délicat, suivant l'importance et la richesse du
personnage qui devait habiter la tombe.
Un de ces sépulcres est remarquable entre tous par son
prodigieux développement : c'est celui d'un
prêtre qui portait le nom de Pétemenof.
L'étendue occupée par la demeure funèbre
de ce prêtre est évaluée par Wilkinson
à plus de vingt mille pieds carrés. C'est sans
nul doute la plus vaste tombe que se soit faite la
vanité d'un simple particulier. Dix ou douze salles se
succèdent, reliées par des galeries, sur une
longueur de six à sept cents pieds. Les sculptures et
les hiéroglyphes qui ornent les murs sont d'une rare
perfection ; mais il faut braver pour les admirer jusqu'au
bout des milliers de chauves-souris qu'éveille la
clarté des torches, et, ce qui est pire, l'odeur
douceâtre et nauséabonde que répandent
ces animaux dans les lieux qu'ils habitent.
A côté de ces tombes où l'orgueil
posthume d'un homme s'étalait si à l'aise, il y
avait des tombeaux communs où se rangeaient côte
à côte un grand nombre de momies. Toutes ces
momies ont été enlevées, ou
brisées et mises en pièces par les chercheurs
de trésors et d'amulettes. Le sol de ces
sépulcres est jonché de leurs débris et
pavé de leurs ossements ; on heurte à chaque
pas des crânes, des tibias, des mains noircies et
encore enserrées de leurs bandelettes.
Il y a peu d'années, on a découvert un tombeau
qui pour l'étendue ne saurait être
comparé à celui du riche et puissant
Pétemenof. mais qui l'emporte sur tous ceux que l'on
connaissait parla finesse des sculptures, et surtout par
l'intérêt historique des scènes qu'elles
reproduisent. Les sculptures de cette tombe offrent, en
effet, avec plus de détail que partout ailleurs, la
représentation de nombreuses scènes de la vie
privée, de l'agriculture et de l'industrie des anciens
Egyptiens. Ici l'on voit le maître, reeonnaissable au
long bâton qu'il tient à la main (le
bâton, dans les bas-reliefs et dans la langue
hiéroglyphique, est le symbole de l'autorité),
entouré et servi par de nombreux serviteurs. Là
ses fermiers lui amènent les bestiaux
élevés sur ses terres, et lui offrent des
dattes, des figues, des ananas. Ailleurs il préside
aux diverses opérations du jardinage ou de
l'agriculture. Le labourage, les semailles, la moisson, la
vendange, l'arrosage des terres, tout est minutieusement
retracé : et ce qui frappe d'étonnement, c'est
de voir qu'à l'époque où remontent ces
sculptures, il y a trois mille ans, la civilisation
était en Egypte ce qu'elle est aujourd'hui ; il y a
trois mille ans, les Egyptiens se servaient de la même
charrue que nous avons vue ce matin conduite par un fellah ;
leur costume était ce qu'il est aujourd'hui ; comme
aujourd'hui, ils élevaient l'eau du Nil avec cette
bascule qu'on appelle une chadouf ; comme aujourd'hui, je
remarque que les femmes du peuple portaient leurs petits
enfants à califourchon sur l'épaule.
Les arts, les métiers sont représentés,
comme l'agriculture, dans une suite de tableaux du plus haut
intérêt. Toute la vie, toute l'industrie de
l'ancienne Egypte est là : on y a figuré des
meubles de toute espèce, le plus souvent d'une exquise
élégance, des vases du galbe le plus beau, des
instruments de musique, harpes, flûtes et sistes ; on y
a représenté des festins et des
divertissements, la musique et la danse, la chasse et la
pêche, jusqu'à la gymnastique et aux jeux
d'échecs.
Dans quelques-uns de ces hypogées, on a trouvé
les sculptures primitives recouvertes d'une couche de
plâtre, sur laquelle étaient peintes
grossièrement des images chrétiennes. Ces
peintures modernes ont été tracées sans
doute par la pieuse main des anachorètes qui, aux
premiers siècles de l'Eglise, venaient chercher dans
ces déserts et jusque dans ces caveaux funèbres
l'oubli du monde, la paix des passions et les contemplations
de l'éternité.
Nous avions passé de longues heures à examiner
ces curieuses peintures. L'air était étouffant.
Le soleil tombait d'aplomb au fond de ces excavations. Pas un
souffle de vent ne s'y faisait sentir ; et à la
chaleur qui régnait dans ces gorges sablonneuses on se
serait figuré être au mois de juin. Nous
n'avions pas voulu croire Agostino, qui nous avait
conseillé de nous défier du soleil de
Thèbes, et de couvrir nos chapeaux de mouchoirs blancs
: nous comprîmes alors la sagesse de ses avis. L'un de
nous, grâce à son léger chapeau de
paille, faillit attraper ce jour-là un coup de soleil,
et rentra à la cange pris d'une violente
migraine.
Les Européens s'étonnent toujours, quand ils
arrivent en Orient, de la coiffure qu'y portent les hommes.
Le turban leur paraît ce qu'il y a au monde de plus mal
approprié au climat : il est lourd et chaud, et il n'a
pas de visière pour protéger les yeux ; -
double contre-sens, à ce qu'il semble. Mais comment
croire qu'un tel usage n'ait pas sa raison d'être et sa
convenance ? Un peu de réflexion et surtout
d'expérience les fait bien vite apercevoir. Ce n'est
pas contre la chaleur, c'est contre l'action directe des
rayons du soleil qu'il importe de se défendre en
Orient. La chaleur, même extrême, n'est qu'une
gêne ; le soleil frappe et tue. Un homme est comme
foudroyé et meurt en quelques heures, pour
s'être exposé sans précaution au soleil
d'été, même du printemps. Voilà
pourquoi, par-dessus une calotte de toile blanche, les
Orientaux mettent l'épais tarbouche de laine rouge, et
par-dessus le tarbouche enroulent les replis nombreux du
turban. Quant à l'absence de visière, c'est
affaire d'habitude et rien de plus. Il n'en résulte
aucun inconvénient, et beaucoup d'Européens s'y
accoutument même assez vite.
29 décembre.
La journée d'hier a été fatigante.
Pourtant il nous faut aujourd'hui partir de bonne heure ; il
y a une heure et demie de marche d'ici aux Tombeaux des
Rois.
On passe par Gournah. Bientôt après, on entre
dans la vallée de Biban-el-Molouk : mot
dérivé de l'arabe qui signifie Portes des Rois,
mais qui paraît une traduction altérée de
l'ancien mot égyptien Biban-Ouroou,
Hypogées des Rois.
La vallée, large d'abord, se rétrécit
promptement et ne forme plus qu'une gorge sinueuse entre deux
chaînes de montagnes escarpées. Dès qu'on
a dépassé Gournah, toute
végétation cesse : le désert commence,
un désert de sable et de pierres, le plus nu, le plus
affreux qui se puisse voir. Pas un arbuste, pas un brin
d'herbe, pas un lichen n'a germé, sur cette terre
qu'on dirait maudite. Il semble que le feu du ciel ait
passé sur elle et l'ait calcinée jusqu'aux os.
Le sol est couleur d'ocre ; les pierres, jaunes et d'un
éclat métallique, sont noircies en dessus comme
par la flamme d'un incendie. Nul animal, nul oiseau ne se
montre dans cette désolation. Toute vie est absente ;
un silence de mort règne dans cette funèbre
solitude. Le lieu était bien choisi pour y dormir en
paix le sommeil de la tombe.
En suivant le sentier qui serpente au pied de la montagne, je
remarquais, non sans étonnement, que le fond de la
vallée avait l'air d'avoir été
raviné par les eaux : on eût dit du lit de
quelque torrent desséché, où le sable
s'est accumulé par places. Ce sont apparemment les
vents violents qui soufflent parfois dans ces gorges qui ont
soulevé et en quelque sorte charrié ce sable
comme auraient fait des eaux torrentueuses.
Tout au fond de cette gorge sauvage, les Pharaons
thébains de la dix-huitième et de la
dix-neuvième dynastie ont creusé, dans
l'épaisseur de la roche, les tombeaux destinés
à recevoir leurs dépouilles ; tombeaux plus
durables encore, ce semble, que les pyramides
elles-mêmes, et qui, cachés dans les flancs de
ces montagnes où pas une goutte d'eau ne tombe,
où ne filtre pas une source, devaient paraître
à la fois inviolables et indestructibles. Et pourtant,
pas plus que les constructeurs des pyramides, les Pharaons de
Thèbes n'ont, suivant le mot sublime de Bossuet,
joui de leurs sépulcres. Quand les Romains
arrivèrent dans la Thébaïde, les tombes
royales avaient été ouvertes et violées
par les Perses de Cambyse.
Depuis lors, ainsi que l'attestent d'innombrables
inscriptions, laissées par les visiteurs, en grec, en
latin ou en copte, ces Syringes (comme les appelaient les
Grecs) ont été pendant plusieurs siècles
l'objet de la curiosité des voyageurs. Plus tard,
enfouies sans doute sous les éboulements de la
montagne, elles cessèrent d'être visitées
et même connues. Belzoni, ce singulier et
intrépide voyageur, qui fut successivement
abbé, comédien, antiquaire, et qui le premier
pénétra dans l'intérieur de la pyramide
de Chéfren, fut aussi le premier à attirer
l'attention de l'Europe savante sur ces curieux tombeaux, en
découvrant le plus beau de tous, celui du père
de Rhamsès le Grand, de Séthos Ier, qui a
élevé la grande salle hypostyle de
Karnac.
Vingt et un de ces tombeaux ont été
retrouvés. Strabon dit que de son temps on en
connaissait quarante : bien des découvertes restent
donc encore à faire. L'avidité des chercheurs
de trésors y aidera au moins autant que l'amour de la
science.
Aucun ordre n'a déterminé l'emplacement des
tombeaux. Chaque Pharaon, en montant sur le trône,
choisissait le lieu où son sépulcre devait
être creusé : les travaux se continuaient
pendant tout son règne et cessaient à sa mort ;
si bien qu'on peut juger, par le degré
d'achèvement de chaque tombe, de la durée du
règne de chaque prince. Etrange peuple, qui avait
toujours présente la pensée de la mort, et chez
qui les préoccupations de l'autre vie marchaient ainsi
de front avec les travaux de la vie actuelle ! Il semble que
ce fût chez eux, comme l'a dit Mme de Staël,
«un besoin de l'âme de lutter contre la mort, en
préparant sur cette terre un asile presque
éternel à leurs cendres».
Les tombes royales sont toutes disposées sur le
même plan. On entre par une porte assez basse, qui
était destinée à être murée
: un large corridor conduit, par une pente plus du moins
rapide, à une première salle ; cette salle est
suivie de plusieurs autres, reliées entre elles par
une galerie. Sur les parois, à droite et à
gauche, se déroulent de longues inscriptions
hiéroglyphiques ; ce sont des prières à
l'intention du roi inhumé. Les salles sont
décorées de vastes tableaux symboliques et
religieux, qui couvrent non seulement les murailles, mais
même les plafonds et les piliers qui les soutiennent.
Enfin, tout au bout de ces corridors et de ces salles qui ne
sont en quelque sorte qu'une suite de vestibules, s'ouvre au
plus profond de ces catacombes une salle plus vaste que
toutes les autres, plus richement décorée,
celle que les Egyptiens appelaient la salle dorée :
c'est là que reposait le Pharaon dans son
sarcophage.
Ce sarcophage était fait d'un seul bloc, haut d'une
dizaine de pieds. Le corps, déposé dedans,
était recouvert d'un couvercle massif, de la
même matière. On a peine à comprendre
comment ces monolithes, d'un poids énorme, ont pu
être descendus à cette profondeur par des
galeries qui ont strictement la largeur nécessaire
pour leur livrer passage.
Avec le Pharaon mort étaient ensevelis, on le suppose,
quantité d'objets précieux. Ce sont ces
trésors qui ont fait violer leurs tombes. Tous les
sarcophages ont été trouvés ouverts ; le
couvercle était brisé, le cercueil vide. Quand
Belzoni découvrit l'entrée du tombeau de
Séthos, la porte lui parut intacte. Il espéra
trouver le Pharaon dormant encore dans son lit de granit. Les
galeries, les premières salles, semblaient n'avoir
jamais entendu des pas humains depuis le jour des
funérailles. Vain espoir ! Quand il arriva à la
salle dorée, il vit avec douleur le sarcophage
brisé et vide. Des recherches plus attentives firent
découvrir un boyau étroit, creusé dans
la montagne par les violateurs inconnus, et qui, d'une
vallée voisine, avait donné accès dans
la salle où était le trésor.
Il faudrait des volumes pour décrire ces tombeaux,
monuments uniques dans le monde. Champollion, qui a
habité pendant deux mois un de ces sépulcres,
en a fait, dans ses Lettres sur l'Egypte, une
description aussi complète et aussi fidèle que
possible. Je ne veux donner ici qu'une idée sommaire
de leur décoration, qui, du reste, est dans tous
systématiquement reproduite, et ne diffère que
par la délicatesse du travail ou la richesse de la
peinture.
Sur le bandeau de la porte d'entrée est sculpté
un bas-relief où le Pharaon est symbolisé dans
le soleil à tête de bélier,
c'est-à-dire le soleil couchant et entrant dans
l'hémisphère inférieur, image de la
mort. A côté de lui est sculpté le
scarabée, qui était chez les Egyptiens le
symbole de la régénération ou des
renaissances successives.
Plus loin, et comme pour rassurer le roi sur le
funèbre augure que fait naître son tombeau, on
voit le dieu Phré, c'est-à-dire le soleil dans
tout l'éclat de sa course, qui lui adresse des paroles
de consolation et lui fait de magniflques promesses :
«Nous t'accordons une longue série de jours,
pour régner sur le monde et exercer les attributions
royales d'Horus sur la terre».
Partout, le long des corridors et des salles, aux
prières et aux inscriptions pieuses se mêlent
des tableaux symboliques. Ces tableaux représentent
l'histoire de l'âme après la mort, les
épreuves qu'elle traverse, les jugements qu'elle subit
; ce que les rituels funéraires appellent la vie
après la mort. On voit, dans leur long et
pénible voyage, la foule des âmes passer
à travers l'eau et le feu ; on les voit soumises
à des supplices, mutilées,
décapitées, puis rappelées à la
vie. Ailleurs elles se reposent dans des champs couverts
d'arbres et de moissons. L'âme, qui d'abord a fait
seule sa pérégrination et a subi des
transformations diverses, finit par se réunir à
son corps, qui lui est devenu nécessaire pour la fin
du voyage. C'est pour cette raison que, chez les Egyptiens,
le soin de l'embaumement et la conservation des corps
étaient choses si importantes : il faut que
l'âme retrouve son compagnon intact et disposé
à s'associer à ses dernières
épreuves.
La salle qui précède celle du sarcophage est
consacrée aux quatre génies de l'Amenti,
l'enfer des Egyptiens : c'est là que se prononce sur
l'âme la sentence définitive. Les peintures
représentent la comparution du roi devant Osiris assis
sur son trône, et assisté de ses quarante-deux
terribles assesseurs. Chacun de ces juges divins semble
chargé de rechercher et de punir un crime ou un
péché particulier, et chacun d'eux interroge
à son tour le défunt.
Au-dessous de ce tableau sont écrites les
réponses ou justifications du roi, qui proteste de son
innocence sur chacun des chefs d'accusation.
Ces apologies des morts qui plaident eux-mêmes leur
cause devant le tribunal suprême, nous donnent tout le
code de la morale égyptienne ; et l'on est
stupéfait de voir combien cette morale était
pure, élevée, humaine, et supérieure
à celle de tous les peuples païens de
l'antiquité.
«Je n'ai pas commis de fautes, s'écrie le mort.
Je n'ai pas blasphémé. Je n'ai pas
trompé. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas
divisé les hommes par mes ruses. Je n'ai traité
personne avec cruauté. Je n'ai pas été
paresseux. Je ne me suis pas enivré. Je n'ai pas
rongé mon coeur d'envie...»
Ce qui suit est encore plus remarquable : «Je n'ai pas
retiré le lait de la bouche des nourrissons. Je n'ai
pas fait de mal à mon esclave, en abusant de ma
supériorité sur lui. J'ai fait aux dieux les
offrandes qui leur étaient dues. J'ai donné
à manger à celui qui avait faim ; j'ai
donné à boire à celui qui avait soif ;
j'ai fourni des vêtements à celui qui
était nu».
Dans le tombeau de Rhamsès le Grand, on remarque,
à côté de ce tableau du jugement dernier
de l'âme, de curieuses figures, malheureusement
effacées pour la plupart, et qui représentaient
les sept péchés capitaux. La paresse, la
luxure, la voracité, qui sont encore reconnaissables,
sont figurées par des personnages humains à
tête de tortue, de bouc et de crocodile.
Le mort s'est pleinement justifié. Son coeur a
été mis dans la balance avec la justice, et on
ne l'a pas trouvé plus lourd. Osiris rend sa sentence,
que Thoth, comme greffier du tribunal, inscrit sur son livre.
Le mort entre dans la béatitude : la
pérégrination de l'âme finit par son
intime union, par son identification avec le soleil, ce dieu
suprême de la religion égyptienne, que les
prières et les hymnes appellent «le dieu seul
vivant en vérité..., le
générateur des autres dieux..., celui qui
s'engendre lui-même..., celui qui existe dans le
commencement». C'est ainsi, contradiction
étrange ! qu'une morale admirablement pure venait
aboutir à l'absorption de l'âme en Dieu, ce qui
équivaut à la négation même de
l'individualité humaine.
J'ai dit que la salle du sarcophage est ornée de
peintures plus riches que toutes les autres. Ces peintures
couvrent des plafonds immenses, creusés en berceau et
d'une coupe très gracieuse : il est impossible,
à qui ne les a pas vues, d'imaginer quel éclat,
quelle fraîcheur ont conservés ces couleurs
posées sur la pierre il y a trente siècles. Le
tombeau dit de Belzoni offre surtout des peintures d'une
conservation vraiment miraculeuse. Ces plafonds
représentent des figures symboliques, étranges,
bizarres, qui semblent traduire ou des idées mystiques
ou des systèmes cosmogoniques encore mal connus ou mal
compris.
Comme tous les monuments égyptiens, ces admirables
tombeaux, qu'il eût été si facile de
protéger, sont en partie dégradés,
mutilés, et cette dégradation fait tous les
jours de déplorables progrès. Les curieux
creusent la roche pour enlever des fragments de bas-reliefs
ou de peinture, qui un dieu, qui un roi, qui un
scarabée. Pour détacher une sculpture de
quelques pouces carrés, ils entaillent la pierre sur
une surface de plusieurs pieds alentour : ce vandalisme
attriste et irrite. Ce n'est pas que les savants ne donnent
l'exemple. Champollion a enlevé deux statues qui
décoraient l'entrée du tombeau de
Rhamsès. Depuis, M. Lepsius a véritablement
dévasté celui de Séthos. Toutefois, il
faut le dire, ce n'est pas une niaise curiosité, c'est
l'intérêt de la science qui provoque ces
enlèvements. Les objets ainsi dérobés
à l'Egypte, ce sont les musées de l'Europe qui
les recueillent. Enfin, et c'est là l'excuse
sérieuse, ravir ces trésors, c'est les
soustraire à une destruction certaine, c'est les
conserver à la postérité. On ne saurait
donc, sans injustice, comme quelques voyageurs l'ont fait,
comparer l'illustre et courageux Champollion, ni même
le savant Lepsius, à ce lord Elgin, qui a
démoli les frises du Parthénon pour les
emporter dans les brumes de Londres, et que Byron a si
justement flétri. Mais il n'en est pas moins triste
qu'on soit réduit à de pareils moyens pour
sauver ces merveilles et de l'incurie des barbares qui les
possèdent, et de la curiosité stupidement
fanatique des touristes qui les visitent.
Le soir de ce jour où nous étions allés
visiter les tombeaux des rois fut marqué par un des
plus vifs souvenirs que nous ait laissés notre voyage.
Il y avait trois jours que nous étions à
Thèbes, et nous n'avions pas encore vu Karnac : Karnac
où se trouvent les restes les plus étonnants de
la civilisation égyptienne ; Karnac dont tous les
voyageurs parlent comme de la merveille de l'antique Orient.
Notre impatience était extrême, et
excitée plutôt que calmée par ce que nous
avions vu. La journée du 30 avait été
fixée pour cette dernière excursion ; mais nous
anticipâmes sur le programme.
Après le dîner, comme de coutume, nous nous
promenions sur le quai de Louqsor. La pleine lune montait
lentement dans le ciel, inondant de lumière la
campagne déserte et muette. Le village était
plongé dans le silence et le sommeil. On n'entendait,
dans le lointain, que les aboiements des chiens, qui, la
nuit, font la garde autour des maisons pour éloigner
les hyènes et les chacals. La promenade nous avait
conduits hors du village ; insensiblement nous avions pris la
route de Karnac ; nous n'en étions plus qu'à un
quart de lieue. Voir Karnac au clair de lune et par une nuit
aussi splendide, était une tentation trop forte pour
qu'on pût y résister. Nous voilà donc
doublant le pas, seuls, sans guides, et sans autres armes que
nos bâtons, cherchant à l'aventure le chemin des
ruines. Il est difficile de ne pas les trouver, car elles
couvrent la plaine de leurs masses énormes : quant au
danger, il n'y en a aucun pour le voyageur, au milieu de ces
populations paisibles ; et l'hyène, seule bête
féroce qui fréquente les bords du Nil, est trop
lâche pour attaquer l'homme.
Nous avions laissé à gauche le chétif
hameau de Karnac, bâti sur une éminence et
entouré de beaux bouquets de palmiers. En sortant de
l'ombre épaisse de ce petit bois, nous eûmes
tout à coup devant les yeux un spectacle dont il est
difficile de donner idée. Une avenue bordée de
sphinx s'ouvrait devant nous ; à
l'extrémité, s'élevait une porte
triomphale d'une hardiesse et d'une majesté
singulières. Au delà de cette porte, à
droite, à gauche, à perte de vue, un immense
entassement de ruines, un chaos de constructions, de
murailles écroulées, de pylônes, de
temples, de palais à demi renversés ; comme une
ville entière qu'un tremblement de terre aurait
jetée à bas ; et au-dessus de cette plaine
toute hérissée de blocs de granit,
çà et là de longues colonnades
émergeant dans la lumière, et de hauts
obélisques dressant leurs aiguilles noires.
Nous avancions, muets d'étonnement, confondus
d'admiration ; et à mesure que nous avancions, de
nouvelles masses architecturales, de nouvelles portes
triomphales se levaient au loin dans la plaine, marquant, aux
quatre coins de l'horizon, les limites d'une enceinte
disparue. A chaque pas aussi, la montagne de débris
qui était devant nous semblait grandir et monter sur
nos têtes, et, par-dessus un premier étage de
palais, les fenêtres d'un second palais se
découpaient sur le ciel.
La grande porte franchie, en marchant tout droit devant nous,
nous trouvons, ouverte dans la muraille qui se dresse comme
un rempart, une petite porte basse, pareille à une
poterne. Nous entrons ; nous franchissons un couloir obscur,
et, après avoir gravi des monceaux de
décombres, nous pénétrons dans une vaste
enceinte dont la lune n'éclaire qu'à demi les
profondeurs. Nous étions dans la grande salle
hypostyle.
Quand je vivrais mille ans, jamais je n'oublierais
l'impression que m'a laissée ce moment. La parole est
impuissante à décrire de telles choses, et nul
art au monde n'en pourrait reproduire l'effet. Qu'on imagine
une forêt de colonnes, larges et hautes comme des
tours, portant encore sur leurs chapiteaux
évasés quelques-uns des blocs massifs qui
faisaient le plafond ; leurs lignes serrées se
prolongeant de toutes parts sans que l'oeil en
aperçoive la fin ; sur celles qui forment
l'allée centrale, plus haute et plus puissante que les
autres, une seconde ligne de piliers qui portaient une
seconde salle ; çà et là quelques
pierres énormes du plafond à moitié
penchées et s'arc-boutant mutuellement dans leur chute
; tout au bout, en face de nous, une de ces colonnes
gigantesques qui, ébranlée sur sa base et
chancelant comme un homme ivre, s'est appuyée de
l'épaule sur sa voisine, qui a reçu le choc
sans broncher : qu'on se figure toutes ces colonnes couvertes
de sculptures ; qu'on ajoute à l'effet de cette
prodigieuse architecture, dont la grandeur effraie
l'imagination, le prestige de la nuit, le contraste des vives
clartés et des fortes ombres dont la lune frappait
tous les objets, la profondeur des perspectives, la
solennité de l'heure, la majesté de la
solitude, et l'on comprendra à peine quelle
émotion nous causa ce spectacle aussi sublime
qu'inattendu. C'était comme une vision d'un monde
fantastique. Il y a presque de la terreur dans l'admiration
qu'on éprouve en face de telles ruines. On se sent
petit auprès d'elles. Il semble que ce soient des
Titans, non des hommes comme nous, qui aient dressé
ces colonnes sur leur base indestructible, et jeté sur
leurs têtes, en guise de poutres et de tuiles, ces
blocs de quarante pieds de long qu'elles portent depuis trois
mille ans sans fléchir. Nous qui sommes si fiers de
nos arts, de notre industrie, de notre puissance
matérielle, que sommes-nous auprès de ces
bâtisseurs de palais géants ? Que restera-t-il,
dans trois mille ans, de nous, de nos temples et de nos
cités ? Comment les peuples qui ont
élevé de tels monuments ont-ils disparu de
dessus la face de la terre ? Comment leurs empires se
sont-ils écroulés, longtemps avant leurs
sanctuaires et leurs arcs de triomphe ? Assailli de tant de
questions formidables, l'esprit plonge avec effroi dans les
abîmes de l'histoire ; et le souvenir des
révolutions inouïes qu'elles ont vues redouble
encore l'impression que font ces ruines.
Nous errâmes longtemps, perdus dans nos rêveries,
au travers des longues nefs semées de pierres et de
décombres. Le bruit de nos pas troublait seul le
silence éternel des palais déserts et des
temples vides. Il fallut s'arracher enfin à cette
contemplation ; nous reprîmes lentement le chemin de
Louqsor. Un chacal rôdait en glapissant dans les
ténèbres ; au loin, les chiens de Karnac
faisaient toujours retentir l'air de leurs abois. Tout
dormait : seuls, accroupis dans le sable, et nous regardant
passer entre leur double file, les sphinx à tête
de bélier semblaient veiller sur les derniers
débris de la grandeur des Pharaons.