Chapitre 11 - Thèbes (suite) - Louqsor - Karnac
Louqsor en arabe veut dire les Palais. Le village
qui porte ce nom est le plus considérable de tous les
centres d'habitation disséminés dans la plaine
de Thèbes. Construit autour du palais
d'Aménophis, il l'enveloppe, il l'étreint de
toutes parts : ses misérables huttes se sont
adossées aux murailles, elles ont envahi les
enceintes, elles encombrent les cours, obstruent les
colonnades et les sanctuaires. Du côté du
fleuve, cependant, se détachent les grandes lignes
d'un portique soutenu par de belles colonnes à
chapiteau évasé : ce portique sert d'abri aux
âniers et aux chameliers, qui y dorment pendant le
jour.
La façade principale du palais regarde le nord. Elle
était formée par deux pylônes, de deux
cents pieds de développement, de soixante de hauteur,
sur lesquels sont sculptés d'immenses tableaux
représentant des scènes militaires. A droite et
à gauche de la porte qu'ils encadrent étaient
deux colosses de granit qui sont aujourd'hui enterrés
jusqu'au cou dans le sable : c'étaient des
portraits de Rhamsès le Grand. Les figures sont
brisées ; à peine distingue-t-on les oreilles
et la forme de la coiffure.
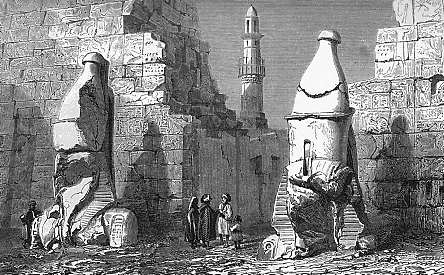 |
C'est au-devant de ces colosses qu'étaient
placés les deux beaux obélisques de granit rose
donnés par Méhémet-Ali à la
France, et dont l'un décore aujourd'hui la place de la
Concorde à Paris. L'autre est encore debout, à
gauche de la porte. Il est d'une admirable couleur, et c'est
ici que l'on comprend combien les monuments des pays
méridionaux perdent à être
transportés sous notre ciel humide. L'obélisque
de Louqsor, vieux de tant de siècles, est aussi jeune,
aussi brillant que le jour où la main de
Sésostris l'a dressé sur sa base. Sa pierre a
les mêmes teintes d'un rose pâle ; et sous les
flots de lumière que lui verse ce ciel de feu, on le
dirait sorti d'hier des flancs de la carrière de
Syène. J'avoue que je n'ai pu me défendre de
quelque pitié quand j'ai revu, depuis, son
frère jumeau, transplanté au milieu des
brouillards de la Seine, revêtu par la pluie d'une
teinte grise qui le fait ressembler à du grès
de Fontainebleau ; pâli, décoloré, et se
désagrégeant déjà sous
l'influence d'un ciel brumeux et inhospitalier.
Les Egyptiens n'isolaient jamais les obélisques. On
les trouve toujours accouplés deux à deux,
au-devant des palais ou des temples. En langue
hiéroglyphique, ce signe voulait dire stabilité
; mais la destination particulière des
obélisques placés à l'entrée des
monuments était d'annoncer, par les inscriptions
gravées sur leurs quatre faces, par qui ces monuments
avaient été construits, dans quel dessein, et
en l'honneur de quelle divinité. Ces longues
inscriptions, ces caractères bizarres, où
l'imagination des hommes a si longtemps poursuivi en
rêve les mystères de la religion et de la
science antique, ne nous ont livré, quand le
génie de Champollion les eut
déchiffrées, que de fastueuses dédicaces
où les Pharaons ont consigné le souvenir de
leur gloire et de leur piété. Mais au point de
vue historique, ces dédicaces, si vides qu'elles
semblent, sont précieuses : elles donnent des dates
irrécusables.
L'obélisque de Louqsor, comme celui de Paris, porte
que le Pharaon Rhamsès II, «fils des dieux et
des déesses, seigneur du monde, soleil gardien de la
vérité, approuvé par Phré, a fait
ces travaux en l'honneur de son père Ammon-Ra, et a
érigé ces deux grands obélisques de
pierre».
C'est à Rhamsès le Grand, en effet, qu'est due
cette partie des monuments de Louqsor que je viens de
décrire et qui regarde le nord. Elle est la plus
remarquable pour la grandeur de l'architecture et la
beauté des bas-reliefs. La partie la plus
méridionale date, comme je l'ai dit,
d'Aménophis : c'est une suite de cours, de salles et
de sanctuaires, qui se prolonge à peu près
parallèlement au fleuve, et dont il est difficile
aujourd'hui de reconstituer l'ensemble par la pensée.
On remarque dans cette partie du palais des colonnes qui
affectent une forme toute particulière : elles ont
à la base de fortes cannelures convexes, sont rondes
au milieu, et se terminent par un bouquet de boutons de
lotus. Larges, trapues, massives, elles semblent
indestructibles.
Après cette rapide inspection de Louqsor, nous avons
repris la route de Karnac. Je n'étais pas, je l'avoue,
sans quelque inquiétude de voir s'évanouir au
soleil de midi ma vision de la veille. Les ruines vulgaires
perdent à être vues au jour ce qu'elles ont
gagné aux illusions de la nuit. Mais cette fois ma
crainte était vaine. Karnac, à quelque heure
qu'on le visite, étonne, émeut toujours autant.
Tout y est si grand, tout y porte une telle empreinte de
puissance et de majesté, que sous la lumière
limpide du soleil comme aux pâles et incertaines
clartés de la lune, il semble aussi en dehors de
toutes les proportions humaines, il excite la même
admiration et le même enthousiasme.
S'ils étaient toujours francs, les voyageurs
avoueraient que, neuf fois sur dix, devant les
prétendues merveilles qu'ils sont allés
visiter, ils ont eu une déception, et que la
réalité leur a paru assez plate auprès
du rêve. A Thèbes, et surtout à Karnac,
j'ai éprouvé l'impression contraire.
L'étonnement va jusqu'à la stupéfaction
: l'imagination est vaincue ; tout ce qu'on avait
rêvé est dépassé par ce qu'on a
devant les yeux ; et plus on regarde, plus on étudie,
plus cette sensation du gigantesque vous envahit et vous
écrase.
Nous avons suivi le même chemin qu'hier soir. L'avenue
de sphinx, dont on ne trouve plus que quelques restes en
arrivant aux ruines, s'étendait autrefois depuis
Karnac jusqu'à Louqsor, c'est-à-dire sur un
espace d'environ une demi-lieue. Plus de six cents sphinx la
bordaient : l'effet de cette décoration, reliant les
deux groupes de palais, devait être des plus
sévères et des plus imposants. Les sphinx sont
de granit ; ils ont une tête de bélier sur un
corps de lion. En style hiéroglyphique, le sphinx
à tête humaine était le symbole de la
puissance ; avec la tête de bélier, la
tête d'Ammon, le grand dieu générateur,
il était le symbole de la puissance divine. Pas un des
sphinx de Karnac n'est resté intact : tous ont
été mutilés ou
décapités.
Les hommes semblent s'être acharnés à
briser ce que le temps seul n'eût pu
détruire.
Il y avait une autre avenue de sphinx qui, partant du Nil et
aboutissant à deux vastes escaliers, donnait, du
côté de l'ouest, accès à la
façade principale du palais. Des colosses qui
formaient cette avenue, il ne reste que des débris
in-formes, enfouis dans le sable.
La grande porte triomphale sous laquelle nous sommes
passés hier est, au contraire, admirablement
conservée. Il semble bien qu'on a fait des efforts
pour desceller les assises de sa base ; mais la masse a
résisté. Cette porte a vingt et un
mètres de hauteur sur douze de large. Malgré
ces dimensions colossales, elle est d'une grande
élégance. Comparativement au reste,
l'époque de sa construction est récente : elle
a été élevée, comme les deux
autres grandes portes du nord et de l'est, par les
Ptolémées. La décadence à cette
époque se montrait déjà dans la
sculpture ; mais l'architecture conservait encore pures les
traditions anciennes.
Les bas-reliefs représentent Ptolémée
Evergète faisant des offrandes aux dieux. Nous
remarquâmes que les têtes de toutes les figures
ont été systématiquement effacées
et piquées au marteau. Déjà nous avons
eu lieu de faire cette observation sur plusieurs monuments de
la rive gauche, surtout à Médinet-Abou. A qui
attribuer ces mutilations ? Peut-être aux premiers
chrétiens, qui poursuivaient dans ces sculptures les
images des faux dieux à peine renversés de
leurs autels. Peut-être aussi aux Arabes, à qui
le Koran inspirait la haine non seulement des idoles, mais de
toute image religieuse, et qui, aujourd'hui encore, croient
en brisant ces figures se préserver du mauvais
oeil.
Au lieu de pénétrer directement dans la grande
salle, nous prenons à gauche pour commencer, par la
façade qui regarde le fleuve, l'examen de cet immense
amas de palais dont il semble assez difficile, au premier
coup d'oeil, de reconnaître le plan
général. Essayons d'en esquisser rapidement les
grandes lignes.
La façade du palais est formée de deux
énormes pylônes, les plus grands qui existent.
Ils ont (car des mesures exactes peuvent seules donner
idée de telles masses) un développement de
trois cent cinquante pieds sur cent quarante de hauteur. Par
la porte qui les sépare, on entre dans une vaste cour
entourée de galeries : au milieu, douze superbes
colonnes formaient une avenue. Toutes sont tombées,
excepté, une, dans un tremblement de terre ; les
monstrueux tambours, couchés l'un sur l'autre,
figurent à terre comme des piles de dames
renversées.
En face de cette allée de colonnes
s'élève un second pylône : c'est celui
qui donnait entrée dans la salle hypostyle. L'un de
ses massifs s'est écroulé dans le même
tremblement de terre ; ses débris ont roulé au
loin ; on dirait d'une montagne foudroyée, et qui a
couvert la plaine de ses ruines. Au seuil de la porte est une
statue colossale, à demi brisée ; c'est l'image
de Rhamsès le Grand, qui acheva ce monument
commencé par son père.
On escalade un amas de pierres qui obstrue la porte :
arrivé sur le haut, on est dans la grande salle, et
l'on a en face de soi la nef principale formée des
plus hautes colonnes. Ici encore il faut des chiffres : ils
en disent plus que toutes les paroles.
La salle renferme cent trente-quatre colonnes, encore debout,
et égales en grosseur à la colonne de la place
Vendôme. Douze grandes forment la nef du milieu :
celles-là ont soixante-dix pieds de haut, et
trente-six de circonférence. Sur leur chapiteau
évasé, qui a soixante-quatre pieds de tour,
cent hommes pourraient s'asseoir. La salle a trois ou quatre
fois la superficie de Notre-Dame de Paris.
M. Wilkinson, le savant égyptologue anglais, n'a rien
exagéré quand il a dit que la salle hypostyle
de Karnac est la ruine la plus vaste et la plus splendide des
temps anciens et modernes. De l'aveu de tous les voyageurs,
il n'y a rien de semblable sur la terre. Balbek même et
Palmyre, dont tant de récits enthousiastes nous ont
été faits depuis un demi-siècle, sans
compter qu'ils sont relativement modernes, puisqu'ils datent
de l'époque romaine, n'approchent pas de cette
grandeur et de cette magnificence. J'ai vu, depuis, les
ruines de Rome : j'avoue que l'Egypte me les avait un peu
gâtées d'avance, et qu'elles m'ont
semblé, le dirai-je ? un peu mesquines au premier
abord. Le Colisée seul m'a rendu quelque chose de
l'impression profonde que Karnac avait produite sur
moi.
Toutes les colonnes sont, de la base jusqu'au faîte,
couvertes de bas-reliefs gigantesques et
d'hiéroglyphes. Les murailles sont pareillement
revêtues de vastes tableaux représentant les
conquêtes de Séthos Ier, qui a construit presque
entièrement la salle. Là, le Pharaon est
représenté, comme son fils Sésostris sur
les murs du Rhamesséum, monté sur un char et
accablant de flèches ses ennemis. Plus loin, les
vaincus font leur soumission. Puis le roi rentre
triomphalement dans ses Etats, et reçoit les hommages
des grands, des prêtres et du peuple.
Cette circonstance singulière, que les prêtres
sont, dans les bas-reliefs, confondus avec tous les
personnages de la cour de Pharaon, ne se remarque pas
seulement ici ; on l'observe sur la plupart des monuments de
Thèbes ; et l'on en a tiré cette conclusion,
qui paraît très légitime, à savoir
que nos idées sur le gouvernement tout
théocratique de l'Egypte, sur la
prépondérance originaire de la caste
sacerdotale, sur la subordination enfin du trône
à l'autel, sont complètement erronées.
C'est l'histoire même, en effet, ce sont les
institutions mêmes de l'Egypte qui sont gravées
sur ces murailles ; et son organisation sociale, politique et
religieuse s'y lit en caractères frappants. Or partout
les Pharaons sont représentés comme recevant
directement et sans intermédiaire le pouvoir royal des
mains de la Divinité. Partout ils font eux-mêmes
les offrandes et les dédicaces aux dieux. Partout les
prêtres, comme les chefs de l'armée, sont
représentés dans l'attitude du respect et de
l'hommage du sujet au souverain. Il semble enfin
résulter de toutes les cérémonies
figurées sur les monuments, que le Pharaon, image et
délégué de la Divinité sur la
terre, réunissait en sa personne le double pouvoir de
roi et de pontife, les doubles fonctions du commandement et
du sacerdoce. Si cette organisation paraît quelquefois
modifiée, c'est par suite de véritables
usurpations consommées par des prêtres
ambitieux. La vingtième dynastie offre un exemple de
ce genre : dans la série de ses rois, on voit,
après Rhamsès XIII, apparaître le
cartouche d'un grand prêtre d'Ammon, qui s'empare du
pouvoir politique et militaire, et dont les descendants
occupent le trône pendant un certain temps.
Parmi les tableaux militaires de Karnac, il en est un qui a
une importance historique particulière. Il
représente un Pharaon traînant plusieurs chefs
ennemis aux pieds des trois grandes divinités
thébaines. Sur la poitrine de l'un de ces chefs,
Champollion a lu ce mot Royaume de Juda, et le
cartouche du roi égyptien lui a donné le nom de
Sésonk. Or le IIIe Livre des Rois raconte que,
dans la cinquième année du règne de
Roboam, c'est-à-dire neuf cent soixante-cinq ans avant
notre ère, un roi d'Egypte nommé Sézac
envahit le royaume de Juda, pilla Jérusalem, et emmena
le roi en captivité. Il est impossible de ne pas
reconnaître dans le Sésac de l'Ecriture le
Sésonk des cartouches de Karnac ; et
l'hésitation est d'autant moins possible que, dans la
figure du roi juif emmené prisonnier par le Pharaon,
le type de sa race esl d'une vérité frappante
et aussi reconnaissable que sur le fameux bas-relief de l'arc
de Titus à Rome.
J'ai dit que le palais de Karnac, commencé par
Séthos Ier, avait été achevé par
son fils Rhamsès le Grand : aussi les exploits de ce
dernier occupent-ils, à la suite de ceux de son
père, une place considérable sur les murailles
de la partie orientale. Un tableau, entre autres, nous montre
le char du roi entouré de tous côtés par
ses ennemis, et le prince s'ouvrant un passage sur le corps
des guerriers qu'ont percé ses flèches. A
côté de ce tableau est gravée une grande
inscription qui contient le récit de l'exploit ainsi
figuré sur la muraille. Ce récit,
complété par d'autres inscriptions et par des
papyrus, a été récemment traduit et
publié par M. de Rougé, à qui les
études égyptologiques doivent tant. C'est le
bulletin, en style poétique, d'une campagne de
Rhamsès en Asie, et le récit
détaillé du fait d'armes par lequel,
engagé seul au milieu des chars de guerre des ennemis,
il parvint par sa valeur personnelle à se tirer de ce
pressant péril. Il y a dans cette sorte
d'épopée une grandeur et une simplicité
dont il est impossible de n'être point frappé.
Les peuples que combat le roi sont des peuples de race
scythique qui avaient envahi toute l'Asie occidentale, la
plaie de Schéto, comme les appelaient les Egyptiens,
et comme ils s'appelaient eux-mêmes, de la même
façon que plus tard Attila s'appelait le fléau
de Dieu. Au début du récit, deux espions de
l'ennemi, arrêtés dans le camp, sont
amenés devant le roi et interrogés. Ils
répondent avec une fierté sauvage.
«Voici la parole des deux pasteurs, la parole qu'ils
disent à Sa Majesté : En multitude est le
Schéto ; il se hâte pour s'opposer au
commandement de Sa Majesté, car il n'a pas peur de ses
soldats... Elle s'est levée la plaie de Schéto,
ô roi, modérateur de l'Egypte, pour une parole
orgueilleuse prononcée par vous aux Babaï. Elle
vient la plaie de Schéto, persistant avec les nations
nombreuses qu'elle a amenées pour en venir aux mains,
de toutes les contrées qui sont du côté
de la terre de Schéto, du pays de Naharaïn et de
celui de Ta-ta, puissante par l'étendue de ses
fantassins et de sa cavalerie à cause de leur
impétuosité, exaltée par les multitudes
nombreuses qui s'étendent comme le sable, qui se
répandent avec la rapidité de la
flèche...»
L'armée égyptienne se met en marche pour
châtier les Schétos. Le combat s'engage.
«Les fantassins et les cavaliers de Sa Majesté
faiblirent devant l'ennemi... Alors Sa Majesté,
à la vie saine et forte, se levant comme le dieu
Mouth, prit la parure des combats ; couvert de ses armes, il
était semblable à Baal dans l'heure de sa
puissance... Le roi, lançant son char, entra dans
l'armée de Schéto. Il était seul ; aucun
autre avec lui... Il se trouva environné par deux
mille cinq cents chars, et sur son passage se
précipitèrent les guerriers les plus rapides de
la plaie de Schéto et des peuples nombreux qui les
accompagnaient... Chacun de leurs chars portait trois hommes
: et le roi n'avait avec lui ni princes, ni
généraux, ni ses capitaines des archers et des
chars».
En un pareil danger, le roi invoque le grand dieu de
Thèbes, Ammon, et lui demande de le secourir.
«Mes archers et mes cavaliers m'ont abandonné !
Pas un d'entre eux n'est là pour combattre avec moi. -
Voici ce que dit Sa Majesté, à la vie saine et
forte : Quel est donc le dessein de mon père Ammon ?
Est-ce un père qui renierait son fils ?
N'ai-je pas célébré en ton honneur des
fêtes éclatantes et nombreuses, et n'ai-je pas
rempli ta maison de mon butin ? On te construit une demeure
pour des myriades d'années... Je t'ai immolé
trente mille boeufs avec des herbes odoriférantes et
les meilleurs parfums... Je t'ai construit des temples avec
des blocs de pierre, et j'ai dressé pour toi des
arbres éternels. J'ai amené dos
obélisques d'Eléphanline... Je t'invoque,
ô mon père ! Je suis au milieu d'une foule de
peuples inconnus, et personne n'est avec moi. Mes archers et
mes cavaliers m'ont abandonné quand je criais vers
eux... Mais je préfère Ammon à des
milliards d'archers, à des myriades de jeunes
héros, fussent-ils tous réunis ensemble. Les
ruses des hommes ne sont rien, Ammon l'emportera sur eux. 0
Soleil ! n'ai-je pas suivi l'ordre de ta bouche, et tes
conseils ne m'ont-ils pas guidé ? Ne t'ai-je pas rendu
gloire jusqu'aux extrémités du monde
?...»
Ici le dieu intervient au milieu de la lutte, comme dans les
combats d'Homère. «Ses paroles ont retenti dans
Hermontis. Phra vient à celui qui l'invoque ; il te
prête sa main ; réjouis-toi. Il vole à
toi, il vole à toi,
Rhamsès-Meïamoun...
- Je suis près de toi, je suis ton père, le
Soleil. Ma main est avec toi, et je vaux mieux pour toi que
des millions d'hommes réunis ensemble. C'est moi qui
suis le seigneur des forces, aimant le courage : j'ai
trouvé ton coeur ferme, et mon coeur s'est
réjoui. Ma volonté s'accomplira... Je serai sur
eux comme Baal dans sa fureur. Les deux mille cinq cents
chars, quand je serai au milieu d'eux, seront brisés
devant tes cavales... Leurs coeurs faibliront dans leurs
flancs, et tous leurs membres s'amolliront. Ils ne sauront
plus lancer les flèches, et ne trouveront plus de
coeur pour tenir la lance. Je vais les faire sauter dans les
eaux, comme s'y jette le crocodile. Ils seront
précipités les uns sur les autres, et se
tueront entre eux».
Raffermi par le secours divin, Rhamsès se
précipite au plus fort des ennemis, renverse tout ce
qui s'oppose à son passage et rejoint son
armée. Il adresse d'amers reproches à ses
généraux et à ses soldats, et
célèbre lui-même sa victoire : «Ils
sont retournés en arrière, en voyant mes
exploits. Leurs myriades ont pris la fuite, et leurs pieds ne
pouvaient plus s'arrêter dans leur course. Les traits
lancés par mes mains dispersaient leurs guerriers
aussitôt qu'ils arrivaient vers moi».
On est frappé, en lisant ces fragments, des rapports
curieux qu'ils offrent avec certaines scènes de
l'Iliade. N'est-ce pas ainsi que les héros
grecs s'adressent à leurs dieux et invoquent leur
secours, en leur rappelant les hécatombes
immolées en leur honneur ? N'est-ce pas ainsi que
Chrysès invoque Apollon : «Ecoute ma
prière, dieu qui portes un arc d'argent, toi qui
protèges Chryse et la divine Cilla... Si jamais
j'ornai ton temple d'agréables festons, si jamais je
brûlai pour toi la graisse des chèvres et des
taureaux, exauce aujourd'hui mes voeux, et que,
frappés de tes flèches, les Grecs paient mes
larmes». N'est-ce pas ainsi qu'au milieu du combat
«le sage Nestor prie en étendant ses mains vers
le ciel étoilé : 0 puissant Jupiter, si jadis
dans la fertile Argos l'un de nous, brûlant sur tes
autels la graisse des taureaux et des brebis, t'implora pour
son retour, daigne t'en ressouvenir, roi de l'Olympe :
éloigne l'heure fatale, et ne permets pas que les
Grecs périssent ainsi sous les coups des Troyens
!»
Ce qui est plus remarquable encore, c'est l'analogie
singulière de cette poésie avec celle des
livres saints. Sauf l'inspiration divine qui donne à
l'Ecriture cette grandeur dont rien n'approche, c'est ici la
même forme littéraire, c'est le même style
et le même mouvement. Les expressions même se
ressemblent, les métaphores sont presque identiques.
On voit clairement ici ce que Moïse a gardé de
son éducation égyptienne, et retenu des
leçons de ses premiers maîtres, les scribes de
la cour des Pharaons.
Cette analogie est plus sensible encore dans le morceau
suivant, où, avec un souffle poétique plus
puissant, on retrouve la coupe du style en versets
symétriques qui est familière à la
Bible. C'est un discours que le dieu suprême de
Thèbes, Ammon, est censé adresser à son
serviteur Toutmès, ce Toutmès III qui porta les
armes égyptiennes dans toute l'Asie occidentale et
étendit sa domination sur les îles de la
Méditerranée; le dieu lui rappelle les faveurs
dont il l'a comblé et les peuples qu'il a soumis
à son empire :
«Tu m'as établi dans ta demeure, je t'apporte et
je te donne la victoire et la puissance sur toutes les
nations. J'ai répandu ta crainte dans toutes les
contrées, et ta terreur s'étend jusqu'aux
limites des supports du ciel. J'ai agrandi l'épouvante
que tu jettes dans leurs flancs ; j'ai fait retentir tes
rugissements parmi tous les barbares ; les princes de toutes
les nations sont pressés dans ta main. J'ai moi
même étendu mon bras ; j'ai lié pour toi
et serré en un faisceau les peuples de Nubie en
myriades et en milliers, les nations du Nord en millions (de
captifs). J'ai précipité tes ennemis sous tes
sandales, et tu as écrasé les chefs au coeur
obstiné. Ainsi que je l'ai ordonné, le monde,
dans sa longueur et dans sa largeur, l'Occident et l'Orient,
te servent de demeure.
Tu as pénétré chez tous les peuples, le
coeur tranquille ; aucun n'a pu résister à tes
ordres ; c'est moi-même qui t'ai conduit quand tu les
approchais. Tu as traversé les eaux de la grande
enceinte et la Mésopotamie dans ta force et ta
puissance. Je t'ai ordonné de faire entendre tes
rugissements jusque dans leurs cavernes, et j'ai privé
leurs narines des souffles de la vie. J'ai fait
pénétrer tes victoires dans leur coeur ; mon
esprit divin qui réside sur ton front les a
bouleversés ; il a ramené captifs (les nomades
?) liés par leurs chevelures ; il a
dévoré dans ses flammes ceux qui
résident (dans les ports ?) ; il a tranché la
tête des Asiatiques sans qu'ils pussent
résister, détruisant jusqu'à la race de
ceux qu'il saisissait. J'ai donné à tes
conquêtes le tour du monde entier. Mon diadème a
répandu sa lumière sur tes sujets, aucun
rebelle ne s'élèvera contre toi sous la zone du
ciel. Ils viennent tous, le dos chargé de leurs
tributs, se courber devant ta majesté, comme je l'ai
ordonné. J'ai énervé (les ennemis
confédérés ?) sous ton règne ;
leurs coeurs sont desséchés et leurs membres
tremblants.
Verset 1. - Je suis venu, je t'ai accordé de frapper
les princes de Tahi (Syrie) ; je les ai jetés sous tes
pieds à travers leurs contrées. Je leur ai fait
voir ta majesté tel qu'un seigneur radieux, projetant
ta lumière sur leurs faces comme mon image.
2. - Je suis venu, je t'ai accordé de frapper les
habitants de l'Asie ; tu as réduit en captivité
les princes des Rotennou (Assyriens). Je leur ai fait voir ta
majesté revêtue de ses ornements ; tu saisissais
tes armes et combattais sur ton char.
3. - Je suis venu, je t'ai accordé de frapper les
peuples de l'Orient ; tu as marché dans les provinces
de la terre sacrée. Je leur ai montré ta
majesté semblable à l'astre qui sème la
chaleur de ses feux et répand sa rosée.
4. - Je suis venu, je t'ai accordé de frapper les
peuples d'Occident ; Kefa et Asi1 sont sous ta terreur. Je
leur ai fait voir ta majesté telle qu'un jeune
taureau, au coeur ferme, aux cornes aiguës, auquel on ne
peut résister.
5. - Je suis venu, je t'ai accordé de frapper les
habitants (des ports ?) ; les contrées de (Maten ?)
tremblent de crainte devant toi. Je leur ai fait voir ta
majesté semblable au (crocodile ?) maître
terrible des eaux, qu'on ne peut approcher.
6. - Je suis venu, je t'ai accordé de frapper les
habitants des îles ; ceux qui résident au milieu
de la mer sont atteints par tes rugissements. Je leur ai
montré ta majesté semblable à un vengeur
qui se dresse sur le dos de sa victime.
7. - Je suis venu, je t'ai accordé de frapper les
Libyens. Les îles des (Tanau ?) sont en ton pouvoir. Je
leur ai montré ta majesté semblable à un
lion furieux, se couchant sur leurs cadavres, à
travers leurs vallées.
8. - Je suis venu, je t'ai accordé de frapper les
extrémités de la mer ; le tour de la grande
zone des eaux est serré dans ta main. Je leur ai
montré ta majesté semblable à
l'épervier qui plane et dont le regard saisit tout ce
qu'il veut...»
Sur un des pylônes qui précèdent la salle
hypostyle, on lit cette courte inscription :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AN VIII
GEOGRAPHIE DES MONUMENTS
Et au-dessous le tableau de la latitude et de la longitude
des principaux temples de l'Egypte. Il y a soixante ans, en
effet, nos soldats et nos savants ont parcouru et
exploré ces contrées célèbres.
Desaix venait de battre une dernière fois Mourad-Bey,
le 16 vendémiaire an VII (7 octobre 1798). La haute
Egypte était soumise. Arrivée devant
Thèbes, au pied de ces monuments dont la grandeur
étonne même après qu'on a vu les
pyramides, l'armée entière, saisie
d'admiration, battit des mains, les saluant de ses
applaudissements.
On sort de la salle de Séthos par un second
pylône, qui ferme la nef principale vers l'est.
Là commence un autre groupe de ruines ; ou
plutôt, quand on a escaladé les monceaux de
pierres entassées qu'on a devant soi, on voit
s'étendre au loin un champ de destruction, un chaos
sans nom, une plaine immense couverte de colonnes
brisées, de portiques, de salles, de temples
renversés les uns sur les autres, de murailles,
déchirées, de pylônes entr'ouverts, de
blocs formidables, les uns suspendus à demi, les
autres précipités dans un indescriptible
désordre.
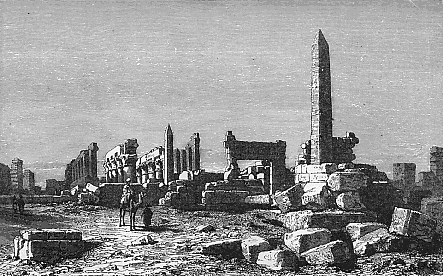 |
A cet endroit, quatre magnifiques obélisques
de granit rose s'élevaient, placés deux
à deux, et prolongeaient à l'oeil les
perspectives majestueuses de la grande nef de la salle
hypostyle. De ces quatre obélisques, deux sont encore
debout, un peu inclinés seulement sous l'effort des
siècles et des tremblements de terre. Les deux autres
gisent sur le sol, brisés en morceaux : l'un d'eux
avait cent pieds de hauteur ; c'est le plus grand qu'on
connaisse. Nous en avons mesuré le pyramidion ; on
appelle ainsi la partie aiguisée en pyramide qui
termine l'obélisque : il a neuf pieds de chaque angle
au sommet.
C'est ici qu'on peut admirer de près et la
beauté de la matière, et le poli qui lui a
été donné, et par-dessus tout la
perfection avec laquelle y sont gravés en creux les
caractères hiéroglyphiques. Ces
caractères sont incisés à une profondeur
d'un demi-pouce, et les incisions sont si nettes, qu'on les
dirait faites à l'emporte-pièce. Quel moyen
inconnu avaient donc les Egyptiens de tailler une pierre
aussi rebelle au ciseau que le granit ? Mais il semble que
ceci n'était pour eux qu'un jeu ; ils faisaient bien
plus : on a des sarcophages, au musée du Louvre,
sculptés en plein basalte. Or le basalte est une
pierre qui rebute nos meilleurs outils, et qui a
bientôt mis hors de service nos aciers les mieux
trempés. Et ce qui confond d'étonnement, c'est
que les Egyptiens ne connaissaient pas le fer : parmi les
innombrables objets découverts dans les tombeaux, on
n'a trouvé que des instruments de cuivre. Avaient-ils
donc pour tremper le cuivre un procédé
aujourd'hui perdu ? Il y a là, en tous cas, un
problème qu'on n'a pu résoudre encore et qui
attend son Champollion.
Les ruines de la partie orientale de Karnac n'ont qu'une
importance secondaire auprès de celles que nous venons
de parcourir, et je n'essaierai pas d'en faire
l'énumération. On y distingue toutefois un
palais de Thouthmosis, de la dix-huitième dynastie,
qui semblerait grand partout ailleurs ; et un petit temple ou
sanctuaire d'Ammon, en granit rose, merveilleusement
sculpté. Ce temple, reconstruit par les Pharaons de la
même dynastie, paraît avoir été
primitivement élevé à une époque
bien antérieure. Sur des colonnes qui s'y voient
encore, on lit, en effet, le nom d'un roi bien plus ancien,
Osortasen, ou Sesourtesen Ier, de la douzième
dynastie. Le même nom a été lu sur
l'obélisque d'Héliopolis. Les monuments de
cette époque reculée ont un
intérêt historique d'autant plus grand qu'ils
sont extrêmement rares, et qu'ils jettent un jour
précieux sur l'histoire de l'ancienne Egypte.
Longtemps on a cru que l'époque héroïque
des Thouthmosis, des Séthos et des Rhamsès,
c'est-à-dire la période des dix-huitième
et dix-neuvième dynasties, qui régnaient quinze
ou seize cents ans avant Jésus-Christ, avait
été la vraie période
d'épanouissement et en même temps
l'apogée de la civilisation égyptienne.
Aujourd'hui des monuments nouvellement découverts,
comme ceux de cet Osortasen Ier qui avait bâti un
temple à Karnac et un autre à
Héliopolis, comme encore les admirables peintures de
Beni-Hassan exécutées sous Osortasen II, nous
apprennent que, sous la douzième dynastie,
c'est-à-dire cinq ou six siècles avant
Thouthmosis et Rhamsès le Grand, la civilisation
était déjà arrivée en Egypte
à un haut degré de développement. Il y a
plus : si les monuments de la dix-neuvième dynastie
l'emportent par la grandeur et la majesté, ceux de la
douzième attestent une perfection plus grande et un
art plus achevé.
Entre ces deux dates lumineuses, entre ces deux
époques florissantes d'une civilisation
déjà si avancée, que s'était-il
passé ? Un fait considérable et qui domine
l'histoire de la vieille Egypte. On sait que, deux mille et
quelques cents ans avant l'ère chrétienne, une
invasion de barbares renversa le trône des Pharaons.
Ces barbares, connus dans l'histoire sous le nom de Pasteurs
ou Hicsos, appartenaient vraisemblablement à ces
tribus nomades, les unes de race scythique, comme les
Schétos, les autres de race sémitique, qui
parcouraient l'Asie centrale et occidentale. Ils
inondèrent la basse et la moyenne Egypte,
refoulèrent jusqu'au delà de Syout les anciens
rois du pays, et s'établirent en conquérants
dans Memphis, portant partout devant eux le pillage et la
dévastation. La domination de ces Pasteurs
paraît avoir duré quatre à cinq cents ans
; elle s'étend de la treizième à la
dix-huitième dynastie, et coupe ainsi en deux l'empire
des Pharaons.
Pendant cette période, une épaisse nuit couvre
la basse Egypte : la civilisation est reléguée
dans la haute Egypte et l'Ethiopie, avec les Pharaons qui
régnent à Thèbes. C'est seulement sous
la dix-septième dynastie que ces Pharaons
thébains commencent à descendre le Nil,
repoussant devant eux les Pasteurs ; et il est vraisemblable
que ce retour des rois indigènes sur le sol
d'où ils avaient été chassés a
été l'origine de la tradition recueillie par
les Grecs et longtemps admise sans preuve, qui faisait
descendre d'Ethiopie la civilisation égyptienne :
hypothèse qui paraît justement le contraire de
la vérité. Quoi qu'il en soit, il est
parfaitement certain que, antérieurement à
l'invasion des Pasteurs, une brillante civilisation
régnait déjà dans la basse Egypte.
Dès la troisième et la quatrième
dynastie se montrent des monuments d'une grandeur
merveilleuse : c'est de ce temps que datent les pyramides de
Ghizeh, et divers temples qui les avoisinent. L'époque
de la douzième dynastie paraît avoir
été, si l'on en juge par les sculptures
retrouvées depuis peu, l'apogée de l'art
égyptien. Les Pasteurs ne laissèrent que des
ruines ; mais à peine furent-ils expulsés, que
l'art reprit un nouvel essor. Moins parfait peut-être,
il revêtit alors ce caractère religieux et prit
ces proportions grandioses qu'on admire dans les monuments de
Thèbes.
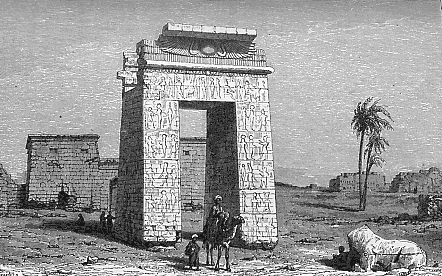 |