Chapitre 12 - Dernière visite aux ruines de
Thèbes - Philae - Les cataractes
Les sources du Nil - Adieu à Karnac - Départ de
Louqsor - Denderah
Aujourd'hui, 31 décembre, nous sommes
repassés sur la rive gauche du Nil. Nous avons voulu
revoir une fois encore le Rhamesséum et
Médinet-Abou. Même après les splendeurs
de Karnac, on admire le caractère grave, le style
noble et pur de ces palais. Médinet-Abou réunit
d'ailleurs à lui seul tous les genres
d'intérêt : comme l'a dit Champollion, c'est un
résumé de toute l'Egypte monumentale, car il
renferme des ruines de presque toutes les époques. Ce
qui m'a frappé le plus aujourd'hui, ce sont les vastes
cours intérieures, entourées de portiques que
soutiennent sur deux côtés des colonnes, et sur
deux autres côtés des piliers à
cariatides : l'effet de ces figures colossales est
singulièrement imposant ; elles inspirent le respect
et une sorte de crainte religieuse.
Nous sommes montés sur les terrasses du palais par des
escaliers intérieurs, dont la pente est tellement
douce, qu'un cheval les gravirait sans peine. Le
désert, du côté de la montagne, a
élevé ses dunes jusqu'au niveau des
plates-formes : par endroits déjà, elles les
dominent. Encore quelques siècles, et ces belles
ruines peut-être auront disparu sous les flots
envahissants du sable.
Au retour, en attendant le canot, nous nous asseyons, en face
de Louqsor, à l'ombre d'un bouquet de palmiers, pour
dessiner le palais d'Aménophis, qui de là
produit un très bel effet, éclairé par
les rayons rouges du soleil couchant. Un village est
auprès, tout enfoui sous le feuillage. Mais à
peine sommes-nous assis que des enfants, nus ou en haillons,
nous entourent et nous assiègent en nous criant leur
éternel bakchich ! bakchich ! Plusieurs femmes
se joignent à eux, nous regardant d'un air doux et
timide, et montrant en riant leurs belles dents blanches
comme l'ivoire. Quelques hommes surviennent, et nous avons
bientôt autour de nous tout un cercle de curieux qui
peu à peu s'approchent, et s'enhardissant touchent nos
vêtements avec un air d'admiration naïve, comme de
véritables sauvages. Tout inoffensive qu'elle
fût, cette curiosité commençait à
devenir importune : nous aurions vidé nos poches sans
faire taire l'avidité des demandeurs de bakchich ; et
de plus nous étions exposés à remporter
plus d'un inconvénient d'un contact si intime et si
prolongé avec des gens d'une propreté suspecte.
Le canot arrivait à temps pour nous délivrer,
et nous repliâmes en hâte nos cartons.
Le soir, nous sommes retournés à Karnac, au
clair de lune, non plus seuls et à pied, mais en
cavalcade nombreuse. A nous cinq s'étaient joints des
Polonais, arrivés de la veille et qui sont
déjà pour nous de vieilles connaissances, car
ils sont venus de France sur le même paquebot qui nous
a amenés. M. M*** était aussi de la partie. A
côté de nous, traînant dans des flots de
poussière leurs grands burnous qui balayaient le
chemin et qui leur donnaient des airs de héros de
théâtre, couraient nos petits âniers,
gamins de douze à quinze ans, vifs, alertes,
intelligents, baragouinant avec un aplomb superbe un langage
composé de toutes les langues du monde
mêlées ensemble. Les ânes galopaient
à l'envi. Rien de plus gai que cette course folle
à travers les campagnes désertes : rien de plus
original sans doute que cette partie d'ânes, à
huit heures du soir, aux monuments des Pharaons.
J'avoue pourtant que j'aimais mieux ma première visite
à la salle hypostyle. Ces grandes choses, ces ruines
mélancoliques, ces débris sublimes du
passé veulent être vus avec une sorte de
recueillement, j'ai presque dit de respect. Rien ne leur sied
que la solitude et le silence. Pour les comprendre, pour les
sentir, pour les admirer comme ils méritent de
l'être, il faut s'abstraire en quelque sorte du monde
présent ; il faut remonter par la pensée le
cours des siècles écoulés, reconstruire
en imagination les palais et les temples, relever les
colonnes et les obélisques, convoquer les
panégyries dans les salles gigantesques, et sous les
pylônes, sous les portes triomphales, à travers
les avenues de sphinx, promener en esprit les longs
cortèges et les processions religieuses, tout cela,
qui m'était apparu le premier soir aux clartés
magiques de la lune, j'avais peine à l'entrevoir
aujourd'hui : les fantômes s'enfuirent au bruit des
rires joyeux et des conversations
légères.
Il était plus de dix heures quand nous revînmes
à Louqsor. La soirée était plus calme et
plus splendide encore que d'ordinaire. Pas un souffle dans
l'air, pas une vapeur à l'horizon. L'atmosphère
avait une limpidité, une douceur incomparables. Nos
plus belles nuits d'été sont moins
tièdes, nos jours d'hiver sont moins brillants que
n'était cette nuit de décembre.
Comme nous approchions du rivage, des sons vagues et comme
une harmonie lointaine frappèrent notre oreille : on
eût dit les accords d'un violon de village, les
derniers accents d'une fête champêtre. Ces sons
étranges semblaient sortir des profondeurs du fleuve.
D'où nous venait, en pareil lieu, à pareille
heure, cette mélodie bien connue ? Quelle
divinité mystérieuse nous jetait à mille
lieues de la France ce souvenir des fêtes de notre pays
? Ceux qui n'ont jamais quitté le sol natal pour
vivre, sous d'autres cieux, de la vie aventureuse des
voyages, ne peuvent se faire idée de l'émotion
que cause parfois un son, un parfum, l'objet le plus
insignifiant en apparence, qui réveille soudainement
le souvenir de la patrie absente.
Arrivés sur notre cange, nous avons enfin le mot de
l'énigme. La divinité du fleuve à qui
nous devons ce concert inattendu nous apparaît sous les
traits peu poétiques du brave Nicolô.
Ménétrier avant de devenir cuisinier, il est
resté fidèle à son instrument, et de
temps en temps il se livre, quand nous sommes absents,
à son goût pour la musique. Modestement
installé sous le pont, il joue le plus
discrètement possible ; mais un nombreux auditoire
l'écoute avec ravissement. Les matelots, rangés
en cercle, ne perdent pas une note de ses airs
mélancoliques : ainsi jadis Orphée charmait
avec son violon les féroces habitants des bois.
Penchés vers le virtuose, attentifs, captivés,
leur admiration se traduit de la façon la plus
naïve et la plus amusante ; elle éclate, comme
celle des sauvages et des enfants, en battements de mains, en
cris, en gesticulations de toute sorte et en bruyants
éclats de rire.
1er janvier.
Ce matin, en nous éveillant, nous n'avons pu nous
défendre de quelque émotion. Notre
pensée s'est reportée vers la France, vers nos
enfants, nos parents, nos amis. Nous manquerons aujourd'hui
à la fête habituelle de famille ; et bien plus
encore manquent à nos baisers ces petites têtes
blondes qui, joyeuses et souriantes, apparaissaient ce
jour-là, dès l'aube, à notre chevet ! Un
singulier hasard veut qu'aujourd'hui même nous nous
trouvions précisément au point extrême de
notre course, à mille lieues de tous ceux qui nous
sont chers !
Pourtant, même à Louqsor, nous recevons une
visite de premier de l'an. Nos Polonais viennent nous offrir
leurs voeux, et nous échangeons de cordiales
poignées de main : des Polonais, il est convenu que ce
sont pour des Français presque des compatriotes.
Ceux-ci d'ailleurs, fort aimables, parlent notre langue aussi
bien que nous. Dans la journée, nous faisons, de notre
côté, visite d'usage et visite d'adieu tout
à la fois à M. M***. Son hôte, le marquis
d'O***, quoique faible encore, peut nous recevoir : c'est un
jeune homme distingué et des plus intéressants.
Sa poitrine paraît gravement atteinte. Nous ne pouvons,
en le quittant, que lui laisser des voeux stériles,
mais bien sincères, de guérison.
Cette journée est la dernière que nous
passerons à Thèbes. Ce soir nous allons tourner
vers le nord la proue de notre barque, et redescendre le
fleuve. Le temps nous manque pour pousser notre navigation
jusqu'à la première cataracte, limite ordinaire
des voyages du Nil. Ce n'est pas sans quelque regret que nous
renonçons à remonter plus haut. Mais, quand on
a vu Thèbes, il faut savoir se résigner
à ne pas voir des ruines qui, à
côté de Karnac, sont modernes et d'un
intérêt très secondaire. Les temples
d'Hermontis et d'Esné, peu importants par leurs
dimensions et leurs restes ; les temples plus
considérables et plus beaux d'Ombos et d'Edfou,
situés les uns et les autres entre Louqsor et Assouan,
appartiennent tous à l'époque des
Ptolémées et des empereurs romains. Qu'est-ce
que cette antiquité auprès de celle des
monuments élevés par les Rhamsès, les
Thouthmosis et les Osortasen ? Il semble qu'on sorte du vieux
monde pour entrer dans le monde moderne.
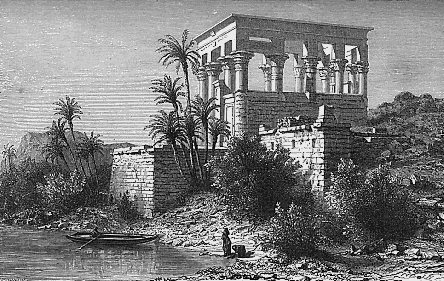 |
Les ruines de Philae, admirablement
conservées d'ailleurs et d'une élégante
architecture, sont de la même époque. On y voit
Tibère, affublé en Pharaon, et sacrifiant au
dieu Ammon. Denderah, que nous visiterons en descendant le
Nil, nous offrira, dans un ensemble plus complet encore et
à un degré de conservation au moins
égal, le même type d'architecture
égyptienne, un peu altéré
déjà, si l'on peut dire, par
l'élégance grecque. Nous nous consolons donc
aisément de ne pas voir le temple de Philae. Aux
voyageurs qui entrent en Egypte par la Nubie, ou qui, venant
du Caire, ont remonté sans s'arrêter
jusque-là et commencent à ce point leurs
visites aux monuments, ce temple inspire une admiration
facile à comprendre : à nous, il ne
présenterait plus désormais le même
intérêt.
Pour trouver un monument qui, auprès de Karnac, ne
pâlisse pas trop, il faudrait aller jusqu'à
Ipsamboul, près de la deuxième cataracte.
Là se trouve un temple du caractère le plus
étrange, le plus imposant, et qui ne ressemble pas aux
temples de la haute Egypte que nous avons vus. Il est
creusé dans les flancs d'une montagne : sa
façade est décorée de quatre colosses
assis, hauts de soixante pieds, et qui sont taillés
dans le roc même. C'est une oeuvre de Rhamsès le
Grand, dont l'image se trouve reproduite à
l'intérieur du temple, dans de magnifiques
bas-reliefs. Mais aller jusqu'à Ipsamboul est un long
voyage, et même du point où nous sommes il
exigerait plus de deux mois.
Ce qui, mieux que les ruines de Philae, mérite qu'on
remonte, quand on le peut, jusqu'à la première
cataracte au moins, c'est le changement curieux, saisissant,
qui se fait, à ce qu'il paraît, aux yeux du
voyageur, dès qu'il a franchi cette limite, dans
l'aspect du pays, dans la nature du sol, dans le type
même de la population. Jusqu'à la cataracte on
était en Egypte, sol de calcaire et de grès :
au delà on est en Nubie, sol granitique. Le Nil se
fraie difficilement un passage au travers de rochers
entassés de basalte et de granit rosé et noir.
Ses îles sont couvertes d'une végétation
magnifique. Le palmier-doum se multiplie et se mêle
partout au dattier. La race change comme le sol : les hommes
sont presque noirs ; les femmes ne se voilent plus le visage.
Elles vont nues, sauf une ceinture en lanières de
cuir, tant qu'elles ne sont pas mariées. Leurs
cheveux, nattés en une multitude de petites tresses,
sont enduits de graisse ou d'huile de ricin.
Quant aux cataractes du Nil, tout le monde sait que ce qu'on
appelle de ce nom ne ressemble en rien à ce que le mot
représente à l'imagination. Ce sont tout
simplement des rapides. Ce qui le prouve, c'est que les
barques, barques de voyageurs et de commerce, les
franchissent tous les jours, tirées à la
cordelle. Il y a loin de là aux pompeuses descriptions
que les anciens nous ont laissées de ces chutes
formidables, se précipitant du haut de rochers
élevés, et assour-dissant du bruit de leurs
eaux ceux qui s'en approchaient. Il est possible que le Nil,
à la longue, ait creusé son lit dans le roc, et
qu'aujourd'hui la différence des niveaux ne soit plus
ce qu'elle était autrefois ; mais on n'en est pas
moins fondé à regarder comme une
exagération et une fable ce que des voyageurs,
même modernes, ont raconté de merveilleux sur
les cataractes du Nil.
D'Assouan à Kartoum, capitale du Sennaar ou Nubie
supérieure, on compte six cataractes aussi
aisément franchissables que la première. Dans
cet espace de plus de deux cents lieues, le Nil ne
reçoit qu'un seul affluent considérable,
l'Atbarah. A Kartoum, il en reçoit un second, le
fleuve Bleu, ainsi appelé de la couleur de ses eaux,
et qui vient de l'Abyssinie. C'est ce fleuve que des
missionnaires portugais prirent, au XVIe siècle, pour
le vrai Nil : ils annoncèrent avec éclat en
avoir découvert les sources. D'Anville reconnut
l'erreur ; et les sources du vrai Nil, du Nil Blanc, sont
encore aujourd'hui ce qu'elles étaient au temps
d'Hérodote, un mystère
géographique.
Depuis une vingtaine d'années, cependant, des
explorations hardies ont été poussées
dans cette direction. Une mission catholique autrichienne
établie en 1846 à Bellenia, dans la tribu des
Berry, a beaucoup contribué, non seulement à
répandre dans ces contrées les lumières
du christianisme, mais aussi à y favoriser les
recherches géographiques. Un des prêtres de
cette mission a pénétré jusqu'à
la montagne de Loupouk, au quatrième degré de
latitude nord. Enfin M. Brun-Rollet, membre de la
Société de géographie, a publié
en 1855 sous ce titre : le Nil blanc et le Soudan,
études sur l'Afrique centrale, le récit du
voyage le plus récent qui ait été fait
dans ces régions. Au delà de Bellenia, capitale
de la grande tribu des Berry ou Bary, il a trouvé de
nouvelles cataractes. Là, le Nil s'élargit sur
de vastes plateaux, et le fond manque souvent aux barques les
plus légères. Sous le troisième
degré de latitude nord, on rencontre une nouvelle
cataracte que le fleuve franchit en écumant.
L'exploration s'est arrêtée à Bobenga,
capitale de la tribu des Kuendas, peuples au teint
olivâtre. De là, on voit se dessiner au sud,
à deux jours de marche environ, les hautes montagnes
de Kombirat : les sauvages de la tribu des Berry affirment
qu'au delà il existe des montagnes plus
élevées encore. C'est là que M.
Brun-Rollet place par conjecture la source du Nil, qui se
trouverait ainsi reportée bien plus loin qu'on ne la
place ordinairement, c'est-à-dire à quatre ou
cinq degrés au delà de l'équateur.
Soit que les vents du nord et de l'est, qui soufflent
régulièrement dans ces contrées au
printemps et au commencement de l'été,
accumulent sur les montagnes de l'Afrique centrale des nuages
qui y crèvent en pluies abondantes ; soit que la fonte
des neiges en précipite des torrents qui vont gonfler
le fleuve ; toujours est-il que, chaque année, vers le
solstice d'été, et comme à jour fixe, se
produit cette crue merveilleuse qui fait lentement
déborder le Nil sur ses rivages, et dont la
régularité bienfaisante ne s'est pas
démentie une seule fois depuis quatre mille ans au
moins que l'histoire la constate. Peu à peu la couleur
des eaux change ; elles prennent une teinte rougeâtre.
Bientôt le fleuve grossit ; il s'élève
pendant trois mois à peu près ; puis s'abaisse
aussi lentement qu'il a monté. La crue, qui varie de
peu de chose chaque année, est en moyenne de dix-huit
à vingt et un pieds.
On l'a dit justement : de toutes les merveilles de l'Egypte,
la plus grande est peut-être le Nil. Tout en est
étonnant, mystérieux : et cette
régularité invariable qui, à jour dit,
fait sortir tous les ans le fleuve de son lit ; et cette
lenteur avec laquelle il se gonfle et s'abaisse, et qui fait
que ses débordements sont un bienfait pour ses rives,
quand ceux de tous les autres fleuves sont des
désastres ; et la richesse de son limon, que la chimie
a analysé, où elle a constaté la
présence d'une matière organisée qui est
sans doute le principe de sa fécondité
extrême, mais dont l'origine n'est pas mieux
expliquée que le reste. On comprend que les anciens
Egyptiens l'aient adoré comme un dieu. Dans les
bas-reliefs il est représenté sous une double
forme : le Nil céleste, vêtu d'une tunique
bleue, qui épanche les eaux d'un vase qu'il tient
à la main ; le Nil terrestre, couronné d'iris
et de glaïeuls, portant des fruits et des fleurs.
Avant de quitter Louqsor, nous avons voulu dire un dernier
adieu à Karnac, et voir une dernière fois le
soleil se coucher sur ses ruines. Nous sommes montés
sur un des gigantesques pylônes qui
s'élèvent du côté du fleuve. De
là, comme du haut d'une colline, nous embrassions du
regard la vaste plaine. L'enceinte immense qui renfermait les
palais se dessinait à nos yeux, marquée par les
trois grandes portos triomphales. A nos pieds
s'étendait ce chaos de débris où l'oeil
se perd, où l'imagination se confond. Les
dernières lueurs du couchant teignaient de rose les
temples de granit. Tout était calme et muet autour de
nous ; le vent était tombé, et les grands bois
de palmiers semblaient à l'horizon immobiles comme les
ruines. Derrière nous, le Nil, tout embrasé des
reflets du ciel, s'enfonçait silencieusement entre les
deux chaînes de montagnes qui le retiennent captif.
Rien de plus triste et de plus grand que ce tableau.
Les ruines d'Egypte (j'en excepte seulement celles du village
de Louqsor, à demi enfouies sous les cabanes des
fellahs) ont au moins, dans leur abandon et leur
dégradation affligeante, un privilège ou un
prestige dont ne jouissent pas les plus belles ruines de Rome
ou d'Athènes : c'est que les bruits importuns des
villes et de notre civilisation moderne ne troublent point
leur silence et ne profanent pas la majesté de leurs
souvenirs ; c'est qu'elles ont le désert pour cadre et
pour horizon, et que le désert ajoute encore, s'il se
peut, à la solennité de leurs aspects.
L'immensité de ces solitudes est seule digne de
l'immensité de ces débris. La tristesse de ces
campagnes, de ces monts arides et dénudés,
s'allie seule avec la tristesse de ces grands vestiges du
passé.
La nuit tombait quand nous revînmes à Louqsor. A
bord de la cange, tout était prêt pour le
départ. Les planches qui recouvraient le pont avaient
été relevées, et entassées de
manière à former des bancs pour les rameurs :
le grand mat était démonté ; la petite
voile seule nous reste ; encore ne servira-t-elle
guère, sans doute, car les vents favorables sont rares
en descendant, et l'on ne marche le plus souvent qu'à
l'aide du courant et de la rame.
Au dîner, Agostino nous ménage la même
surprise et nous offre le même festin qui ont
déjà fêté le jour de Noël.
Mais cette fois, c'est en l'honneur de nous autres
Français que le régal est servi et qu'est bu le
Champagne. Il est neuf heures lorsque nous quittons le quai
de Louqsor, qu'Agostino salue de toute son artillerie.
2 janvier.
Nous espérions être ce matin à la hauteur
de Denderah ; mais le vent a été contraire, et
nous avons marché très lentement. Il est deux
heures lorsque nous arrivons à Keneh, petite ville de
cinq mille habitants, sur la rive droite du fleuve. C'est sur
l'autre rive, en face, que se trouvent, à trois milles
environ dans les terres, les restes de l'ancienne Tentyris,
aujourd'hui Denderah. Nous avons encore le temps de les
visiter avant la nuit. On embarque les ânes qui doivent
nous servir de montures, et nous passons le fleuve avec eux
dans une mauvaise barque de fellahs.
L'heure est charmante et nous promet une promenade
agréable. La plaine où nous cheminons, le long
d'un petit sentier qui serpente parmi les cultures, est
couverte d'une végétation luxuriante. Nous
traversons des champs de fèves et de pois en fleur qui
répandent de suaves senteurs dans l'air. Des fellahs
fauchent leurs trèfles ; et les chameaux,
agenouillés dans l'herbe pour recevoir leur fardeau,
se relèvent chargés de verdure et de fleurs.
Fatigués de la poussière aveuglante et de la
chaleur de Thèbes, nous respirions avec volupté
une atmosphère tout imprégnée de parfums
et de fraîches émanations. Nos ânes
galopaient lestement, non sans faire sur la route de nombreux
larcins aux herbes provocantes qui se penchaient sous leurs
pieds. Leurs petits conducteurs, il est vrai, leur donnaient
l'exemple : je les voyais cueillir çà et
là de jeunes tiges de trèfle ; mais
c'était pour leur propre compte, et ils les broutaient
eux-mêmes à belles dents. Ces pauvres enfants ne
sont guère mieux nourris que leurs ânes, en
effet. J'en ai vu bien souvent qui, tout en courant à
côté de nous, mordaient dans un épi de
maïs complètement cru ou à peine
grillé au feu : c'était tout leur
dîner.
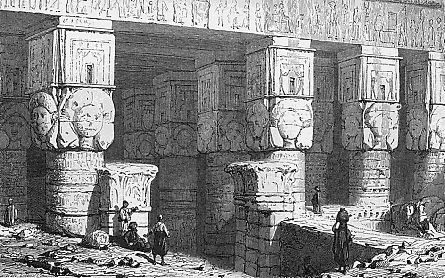 |
Les ruines de Denderah forment un groupe unique,
situé sur une éminence toute composée de
décombres : on distingue alentour quelques huttes
abandonnées. En arrivant par le nord, on passe sous
une porte remarquable par son élégance. A
droite, est un petit temple dédié à
Typhon, le dieu du mal. Plus loin, en face, est le grand
temple. Il a été déblayé depuis
quelques années, et un escalier a été
pratiqué pour descendre à l'intérieur :
le pavé se trouve, en effet, en contre-bas du sol
à plus de quinze pieds. Cette disposition des lieux
nuit un peu à l'effet du monument, dont l'oeil
n'aperçoit, quand on arrive, que la partie
supérieure, puisqu'il est enfoui jusqu'à
moitié de sa hauteur.
On n'en est pas moins frappé, dès l'abord, des
nobles proportions de l'entablement et des colonnes qui
forment le portique. Rien de plus beau que cette
façade ; rien de plus sévère à la
fois et de plus harmonieux. Les chapiteaux des colonnes sont
formés, sur les quatre faces, de quatre têtes
d'Isis colossales ornées de bandelettes pendantes sur
le cou : nulle part ailleurs je n'ai vu cette disposition
originale, et il est difficile d'imaginer quel effet
étrange, mystérieux, imposant, font ces grandes
figures qui de toutes parts semblent fixer sur vous leurs
yeux immobiles. Malheureusement, comme partout, ces belles
têtes ont subi le marteau des iconoclastes.
Ce portique, soutenu par vingt-quatre colonnes, conduit dans
une vaste salle, qui conduit elle-même dans le naos ou
sanctuaire du temple. Tout autour de ce sanctuaire circule un
corridor dans lequel s'ouvrent une multitude de chambres.
Dans l'intérieur des épaisses murailles sont
pratiqués des escaliers qui conduisent aux terrasses
et des couloirs souterrains par où l'on
pénètre dans d'autres chambres, dans d'autres
sanctuaires : c'étaient sans doute des passages
secrets ménagés pour les prêtres.
On a ici un spécimen curieux de l'architecture
égyptienne ; car ce monument, chose étrange,
est complet : pas une pierre n'y manque. Mais si sa parfaite
conservation lui donne un intérêt particulier,
si son architecture est vraiment admirable, les sculptures
qui couvrent ses murs à l'intérieur et à
l'extérieur sont, de l'aveu des connaisseurs, du plus
mauvais style égyptien. Elles sont, en effet, d'une
époque de pleine décadence : les plus anciennes
remontent à Cléopâtre ; d'autres sont du
temps d'Auguste, de Tibère, de Néron ; il y en
a même qui furent exécutées sous les
règnes de Trajan et d'Antonin.
C'est dans une des chambres qui entourent le sanctuaire qu'a
été trouvé, sculpté sur le
plafond dont il faisait la décoration, ce fameux
zodiaque qui est aujourd'hui à Paris et qui a
donné lieu, au commencement du siècle, à
tant de discussions scientifiques et de rêveries
philosophiques et religieuses. On sait que, sur ce zodiaque,
le solstice d'été, qui tombe aujourd'hui dans
le signe du Cancer, se trouvait placé dans le signe du
Lion. Or le rapport des signes célestes avec nos
saisons variant insensiblement avec le cours des
siècles, on était conduit à attribuer
à ce zodiaque une antiquité de cinq à
six mille ans, si on voulait le considérer comme
étant l'image exacte de l'état du ciel à
l'époque de sa construction. Un autre
planisphère, découvert à Esneh, et qui
plaçait le point solsticial dans le signe de la
Vierge, devait par la même raison se reporter à
une époque bien plus reculée encore. Pour cela,
il fallait admettre que ces zodiaques étaient des
oeuvres astronomiques ; il fallait accorder aux prêtres
égyptiens une science bien ancienne, des observations
bien exactes, des connaissances mathématiques bien
profondes. Rien de tout cela n'avait fait hésiter :
toutes ces hypothèses avaient été tenues
pour démontrées ; et l'on se rappelle quelle
fabuleuse antiquité Dupuis et Volney, partant de
là, attribuaient à la civilisation et à
l'espèce humaine.
C'était alors une opinion généralement
admise que les prêtres d'Egypte avaient
été en possession de connaissances très
avancées en philosophie, en religion, en
médecine, en astronomie : la langue prétendue
sacrée des hiéroglyphes en gardait, disait-on,
le dépôt, de tout temps soustrait au vulgaire,
et plus tard dérobé à la
postérité elle-même. Aujourd'hui, j'ai
déjà eu occasion de le dire, on sait que les
hiéroglyphes ne contiennent rien de pareil. Il est
devenu évident, de plus, que la profonde science
attribuée aux prêtres égyptiens se
réduisait à fort peu de chose. Leur philosophie
se bornait à une morale très pure, il est vrai,
et très élevée ; mais leur religion
aboutissait à un vaste panthéisme. En fait de
médecine, ils n'étaient guère
supérieurs à nos astrologues du moyen
âge, et ils avaient, comme ceux-ci, des tableaux qui
soumettaient à l'influence de certains astres les
diverses parties du corps humain. Quant à
l'astronomie, elle ne se constitua vraiment en Egypte
à l'état de science que dans l'école
d'Alexandrie. Ce qui est certain, seulement, c'est que nous
devons aux anciens Egyptiens la division de l'année en
douze mois et en trois cent soixante-cinq jours, qui porte le
nom d'année Julienne.
Pour en revenir aux zodiaques, tous les beaux calculs qu'on
avait fondés sur eux ont croulé d'une
façon assez ridicule. M. Letronne avait
déjà, grâce à une inscription
grecque trouvée à Denderah, jeté des
doutes sérieux sur leur prétendue
antiquité, quand Champollion leur porta le coup de
grâce en prouvant par les inscriptions
hiéroglyphiques que les temples de Denderah et d'Esneh
avaient été bâtis sous les empereurs
romains. Les zodiaques n'étaient donc que des
décorations de fantaisie, exécutées par
quelque artiste ignorant, et n'ayant aucun rapport avec
l'état du ciel à l'époque où ils
avaient été dessinés. Ce fut une seconde
édition de l'histoire de la dent d'or.