Chapitre 13 - Le Nil à la descente - Un santon - Abydos - Syout, son bazar et son cimetière - Antinoë - Les crocodiles - Les hypogées de Beni-Hassan - Le Kamsin
4 janvier.
La physionomie et les habitudes de notre bord ne sont plus
les mêmes qu'en remontant le Nil. Adieu les doux
loisirs de l'équipage, paresseusement étendu
à l'ombre de la grande voile latine que gonflait un
vent favorable. Adieu aussi les chauds rayons de soleil qui
inondaient notre salon, et dont parfois nous étions
obligés de nous défendre ! Nous allons vers le
nord ; et le vent du nord que nous avons en face est souvent
désagréable, en même temps qu'il
contrarie beaucoup notre marche. Quoique le courant du Nil
soit encore fort en cette saison, les barques sont si
lourdes, qu'on ne marche guère que par le temps calme.
Il y a bien la corde et la rame ; mais ce rude travail ne
convient guère à nos Arabes, et toutes les
excitations d'Agostino échouent bien vite contre leur
indolence naturelle.
C'est pitié de les voir soulever, avec une gaucherie
et une mollesse tout orientales, leurs longs avirons qui
plongent à peine dans le fleuve. Pour tromper leur
ennui, ils chantent : c'est l'habitude en Egypte ; le chant
accompagne tous les travaux. On dirait que ces paresseux
enfants du soleil ont besoin, pour supporter le travail, de
lui donner l'apparence d'un plaisir. Tantôt ils
entonnent en choeur un chant monotone ; tantôt l'un
d'eux chante d'une voix nasillarde une sorte de complainte,
dont tous les matelots répètent le refrain.
D'autres fois, chaque couplet se termine par un ah !
prolongé, que pousse tout l'équipage et qui est
de l'effet le plus original. Le marmiton, pendant ce temps,
allume le narguilé, qu'il va présenter
successivement à tous les rameurs : chacun d'eux n'en
aspire que deux ou trois bouffées, et le rend pour
qu'il passe à son voisin. Quand il y a peu d'eau, les
matelots poussent la barque à la perche. Ils ont alors
un mot particulier qu'ils répètent sans cesse
pour s'encourager : Eleïssa ! eleïssa !
modulant les premières syllabes et accentuant
fortement la dernière. Mais cet exercice paraît
leur déplaire encore plus que la rame.
Bientôt on laisse perches et avirons, on se couche le
long du bord, et nous allons comme nous pouvons, à la
dérive, c'est-à-dire très lentement.
Alors nous prenons nos fusils, nous sautons dans le canot, et
nous nous faisons mettre à terre. En chassant sur le
rivage, nous n'avons pas de peine à suivre la barque.
Aujourd'hui nous avons fait un massacre immense de pigeons.
M. P*** a tué un chacal, et mon frère un
magnifique héron.
Près d'une petite ville, nommée, je crois
Farchout, nous avons vu, en chassant au bord du fleuve, un
personnage étrange : c'était un santon, ou
saint musulman. Il était assis ou plutôt
couché à demi, immobile, les jambes
étendues, dans une espèce de fosse peu
profonde, creusée tout près du chemin de
halage. La terre battue et durcie lui servait de lit, sans un
brin de paille, sans une feuille sèche. C'était
là sa demeure. Hiver et été, nuit et
jour, il reste là étendu, sans bouger, sans
abri ni contre le soleil, ni contre le vent, ni contre le
froid et la rosée des nuits. Notez qu'il était
complètement nu, et que son voeu l'astreint à
ne jamais couvrir une partie quelconque de son corps. Il m'a
semblé avoir, si on peut lui donner un âge, de
cinquante à soixante ans. Depuis combien
d'années est-il là ? Je l'ignore, et on n'a pu
me le dire ; mais il doit y avoir longtemps, à en
juger par la couleur de son teint. Sous ce soleil torride,
sous ces variations terribles de température, la peau
de ce malheureux s'est noircie, durcie, racornie ; elle
paraît devenue rugueuse comme de la peau
d'éléphant ou de crocodile. Je n'ai rien vu de
plus affreux et de plus triste. Tout autour de ce pauvre
saint étaient rangés des femmes et des enfants
qui le contemplaient avec une profonde
vénération. C'est la piété des
fellahs de la ville voisine qui lui fournit le peu de
maïs cru dont il se nourrit.
Nous avons dépassé, un peu au-dessus de
Ghirgeh, un point où s'arrêtent quelquefois les
voyageurs : c'est de là qu'on va voir ce qui reste
d'Abydos. Selon Strabon, c'était la seconde ville de
la Thébaïde. La principale ruine est un temple
qu'on croit avoir été celui d'Osiris, et qui
est d'un caractère très sévère.
Mais ce temple est ensablé jusqu'à la hauteur
des soffites : il faut y descendre par les terrasses. Ces
ruines, situées à plusieurs lieues dans les
terres, étaient de trop peu d'intérêt
pour nous écarter autant de notre route.
6 janvier.
Le vent est devenu si violent que nous ne pouvons marcher. On
s'arrête près de la petite ville de Souhag, dont
la mosquée blanche s'élève au milieu de
massifs de verdure. Le soir, après dîner, nous
nous promenons autour de la ville. Des bandes immenses de
grues et de hérons se sont abattues dans les palmiers
et les mimosas, pour y passer la nuit : les arbres sont
à la lettre tout noirs de ces oiseaux. Au retour, les
chiens du village nous poursuivent de leurs hurlements
effroyables ; mais ils sont lâches, et la vue d'un
bâton les tient en respect.
Nous avons dépassé aujourd'hui de nombreux
trains de goulleh ou ballets : ce sont des cruches à
long col, dont on se sert partout en Egypte pour
rafraîchir l'eau. Elles se fabriquent aux environs de
Keneh. On obtient la pâte qui les compose en
mêlant du sel à l'argile : ce sel, en fondant,
ouvre une multitude de pores par où filtre
incessamment le liquide. L'eau qui reste, refroidie par
l'évaporation, arrive à un degré de
fraîcheur extraordinaire. Pour faire descendre ces
cruches jusqu'au Caire, on les lie avec des branchages, de
manière à former d'immenses radeaux, qui ont
quelquefois plus de cent pieds de long et en contiennent
jusqu'à quatre à cinq mille.
Vers huit heures, pendant que nous devisions tranquillement
au salon, nous avons tout à coup entendu un grand
bruit de voix à l'entrée de notre cange. Au
milieu d'un flux de paroles éclataient des cris, des
vociférations : il y avait une rixe parmi nos
matelots. Nous sortons sur le pont ; et nous voyons, en
effet, Agostino et le reïs qui s'efforcent, je ne dis
pas de séparer les combattants, car les Arabes se
battent plus avec la langue qu'avec les poings, mais de
calmer les colères et de rétablir l'ordre.
Leurs efforts cependant étaient vains, et le tumulte
continuait. Alors M. P***, avec le flegme tout britannique
qui ne l'abandonne jamais, rentre au salon, saisit un
bâton déposé sur le divan, et s'avance
sur le groupe des querelleurs ; puis, sans dire un mot, sans
avertir ni crier gare ! le voilà qui se met à
distribuer à droite et à gauche de grands coups
de canne, frappant sur les têtes aussi bien que sur les
épaules. En un instant le calme fut rétabli, le
silence se fit, et chaque matelot, comme un écolier
pris en défaut, retourna à son poste. Je
reconnus, ce jour-là, dans notre compagnon de voyage
le planteur de la Caroline du Sud : il venait d'appliquer
à nos Arabes, on voit avec quel succès, les
moyens de discipline qu'il avait coutume d'employer avec ses
nègres.
7 janvier.
Nous espérions, grâce au calme, arriver demain
matin à Syout. Mais tout à coup une secousse
fait frémir la barque dans toute sa longueur : nous
avons donné sur un banc de sable. Les matelots,
poussant avec les perches, et criant leur éternel
refrain eleïssa ! font de vains efforts pour nous
remettre à flot. Ils ont beau se jeter à l'eau
pour essayer de soulever la barque : tout est inutile. Le
moindre cabestan tirant sur une ancre ou sur une amarre, nous
dégagerait en un instant ; mais le cabestan est une
machine trop savante pour les mariniers du Nil : je ne crois
pas qu'on en puisse trouver un sur toutes les barques qui
parcourent le fleuve. La nuit tombe : il n'y a pas d'espoir
qu'on nous dégage avant le jour. Ce qui ajoute
à la contrariété, c'est que le calme
continue, et que cette nuit nous aurions fait du chemin.
Notre équipage se résigne plus aisément
: c'est pour lui une nuit de repos, et il se met bravement en
devoir d'en profiter.
8 janvier.
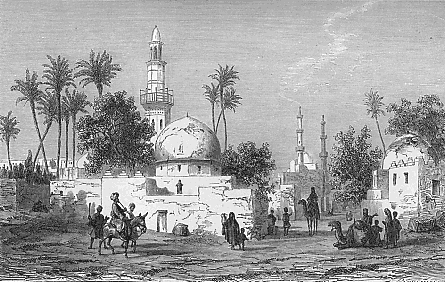 |
Il a fallu que tout le monde, drogman, hommes de service
et même passagers, mît la main à la
manoeuvre pour achever de nous tirer de ce maudit banc de
sable. Nos matelots ont ramé avec plus de coeur pour
regagner le temps perdu. Nous sommes vers le milieu du jour
à Syout.
Nos Américains ont vu dans leur Guide Murray qu'il y a
près de Syout des tombeaux anciens. Ces tombeaux,
complètement dégradés, offrent fort peu
d'intérêt, quand on a visité surtout ceux
de Thèbes et qu'on doit visiter encore ceux de
Béni-Hassan. Mais puisque Murray l'a dit il faut bien
y aller voir. Nous ne voulions pas pour si peu
désobliger nos compagnons de voyage ; et par le fait
ils nous ont, sans le vouloir, donné occasion de faire
une promenade charmante.
La route, comme on sait, est magnifique. Nous montions de
vaillants petits baudets. Ali, notre valet de chambre, qui
est de ce pays, nous sert de guide. Il est en grande tenue :
gilet de soie brodé, ceinture aux vives couleurs,
pantalon blanc bouffant attaché au-dessous du genou,
superbes babouches de maroquin jaune. Ainsi
équipé, il a la meilleure tournure et nous fait
honneur à la tête de la caravane.
Nous laissons la ville à droite ; et bientôt,
parvenus au pied de la montagne, nous quittons nos ânes
pour gravir un sentier rapide. De petites cavités,
creusées dans le roc, frappent nos regards; il y en a
un nombre considérable. Ce sont des tombes, mais qui
sont trop petites pour avoir pu recevoir des momies humaines
: les corps qu'on y déposait étaient ceux des
loups sacrés, adorés autrefois en ce lieu.
Syout, en effet, est l'ancienne Lycopolis, la ville des
Loups.
Les hypogées, ou grands tombeaux, sont placés
plus haut. Celui où nous entrons, le plus vaste et le
mieux conservé, se compose de deux chambres dont
l'étage est très élevé. Sur les
murs et sur le plafond se voient encore des vestiges de
peintures : mais il est impossible, dans l'état
actuel, de distinguer les scènes qui y étaient
représentées ; c'étaient, à ce
qu'il paraît, des tableaux relatifs à l'art
militaire des anciens Egyptiens. Malgré cela, nos
Américains, à grand renfort de besicles et de
torches, s'obstinent à parcourir tous les coins et
recoins du tombeau, tâchant de se persuader qu'ils
voient des choses merveilleuses. Ils ont un peu la manie des
Anglais, qui, en voyage, admirent religieusement tout ce que
leur guide déclare admirable. Nous les laissons
à leurs laborieuses investigations, et nous gravissons
un escarpement de la montagne qui domine tout le pays : de
là nous avons une vue magnifique et pleine de
contrastes saisissants.
La vallée, d'une chaîne à l'autre,
paraît comme une opulente prairie. Devant nous, la
ville, entourée de jardins, semble sortir, avec ses
blancs minarets, d'une corbeille de verdure. Plus
près, sur la gauche, est un immense cimetière :
la cité des morts est presque aussi grande que celle
des vivants. Avec ses murailles basses et dentelées,
avec ses petits dômes d'une blancheur éclatante,
elle s'étend comme un drap funéraire sur le
désert sans limites qui confine la ville de ce
côté. Le domaine de la mort touche celui de la
vie ; l'aridité et le silence enveloppent de toutes
parts le mouvement et la fécondité.
Syout, capitale du Saïd ou haute Egypte, est une ville
d'au moins trente mille habitants, assez importante par son
commerce. Elle est le rendez-vous des caravanes du Darfour.
C'est là que, naguère encore, les marchands
d'esclaves amenaient à travers le désert,
épuisés de fatigue et de privations, les bandes
de jeunes nègres qu'ils conduisaient au Caire.
Aujourd'hui l'esclavage est aboli en Egypte. Je ne
répondrais pas qu'il ne s'y vendît plus
d'esclaves ; mais du moins ce commerce, devenu clandestin, a
singulièrement diminué d'importance.
Le bazar de Syout doit aux relations continuelles de cette
ville avec le Soudan et le Darfour un caractère assez
original. On voit là des Bédouins,
enveloppés de couvertures grises, les pieds
entourés de linges serrés avec des cordes ; des
Nubiens, aux traits réguliers et au visage d'un noir
bronzé ; des Abyssins, coiffés du turban bleu ;
des Coptes, aux traits fins et allongés comme ceux des
Juifs, vêtus de noir et l'écritoire au
côté, car ils sont presque tous scribes. Nous
avons acheté au bazar un certain nombre de fourneaux
de pipe en terre rouge : ces pipes, qui se fabriquent ici,
sont renommées et d'une forme très
gracieuse.
9 janvier.
Nous marchons lentement, contrariés par le vent. Tout
à coup on nous annonce qu'une barque de fellahs qui
remonte et nous dépasse, a vu des crocodiles : ils
dorment au soleil, couchés sur un petit banc de vase
qu'abritent de hauts rochers, dont le Nil baigne le pied.
Quoique nous n'ayons que des fusils de chasse et de petites
balles, nous voulons les saluer au passage. Le canot remonte
sans bruit, en rasant au plus près la montagne. A
trente pas de nous à peu près, au détour
d'un rocher, nous voyons les deux monstres : deux coups de
feu partent presque en même temps. Mais ils ont
déjà plongé dans le fleuve, et c'est
à peine, j'imagine, si notre plomb leur a
chatouillé l'épiderme. Ils avaient bien une
quinzaine de pieds de longueur. On sait que le crocodile ne
peut être frappé qu'au défaut de
l'épaule et sous le ventre. Il faudrait pour une telle
chasse des armes de précision et des balles coniques
à pointe d'acier. C'est un hasard que nous ayons vu
des crocodiles sur ce point du fleuve : rarement ils
descendent au-dessous de Syout. A cette époque froide
de l'année, ils ne sortent de l'eau que pendant les
heures les plus chaudes du jour. Loin d'attaquer l'homme, le
crocodile fuit devant lui, du moins quand il est à
terre. Dans l'eau, il est plus dangereux ; et l'on fait
sagement, l'été, de ne pas se baigner avant
d'avoir fait un grand bruit pour l'éloigner. Les
Arabes, et les Nubiens surtout, ne prennent pas même
cette précaution.
La violence du vent dégénère en une
véritable tempête. Le Nil est agité comme
une mer, et imprime à la cange un mouvement de roulis
qui devient très désagréable. Il faut
s'arrêter : on amarre la barque au pied d'un grand
rocher. Le paysage est triste et sauvage ; tout le long de la
rive droite, de hautes falaises coupées à pic ;
de l'autre côté du fleuve, de grandes plages
unies et quelques îlots de verdure, qui disparaissent
sous le nuage de poussière que le vent amène du
désert. Des barques qui remontent passent près
de nous, filant avec toutes leurs voiles gonflées,
pareilles à des oiseaux effrayés. Nous les
suivons d'un oeil de regret.
Non loin d'ici, sur la rive droite, se voyaient encore, il y
a quelques années, les ruines d'Antinoë, ville de
fondation romaine. En l'an 130 de notre ère,
l'empereur Adrien visitant l'Egypte, son favori Antinous se
noya dans le Nil. Adrien, en guise de monument, lui
bâtit une ville, près du lieu où il avait
péri. De plus, il fit de lui un dieu, et voulut qu'on
l'adorât dans toute la province.
On admirait encore en 1828 de beaux restes de temples, de
théâtres, de colonnades, et un arc de triomphe
élevé par Alexandre Sévère. Mais
un jour Ibrahim-Pacha eut l'idée de construire une
raffinerie dans ces parages. Extraire la pierre de la
montagne et la tailler eût pris du temps et de l'argent
: on jugea plus simple de jeter bas les colonnes, de
démolir l'arc de triomphe, et d'en prendre les
débris pour bâtir l'usine.
12 janvier.
Deux jours de calme nous ont conduits devant
Béni-Hassan.
Les hypogées de Béni-Hassan sont, après
ceux de Thèbes, les plus célèbres de
l'Egypte. Ils sont creusés dans la chaîne
Arabique. Pour gagner la montagne, nous traversons
péniblement une plage aride, couverte d'arbustes
épineux, où le pied s'enfonce tantôt dans
le sable mouvant, tantôt dans des vases à demi
desséchées. Sur la pente crayeuse et blanche,
les rayons réverbérés du soleil
brûlent les yeux ; la chaleur est accablante.
Les tombeaux, ouverts à mi-hauteur de la montagne,
sont tous sur la même ligne. Chacun d'eux est
précédé d'un portique, que soutiennent
des colonnes taillées dans la masse du rocher : cette
disposition est d'un effet très simple et très
grand.
Depuis que Champollion a rendu ces grottes funéraires
si célèbres, elles ont été
singulièrement dégradées par les
voyageurs. Les peintures qu'on y voit n'en sont pas moins du
plus haut intérêt. Elles appartiennent à
l'époque de la douzième dynastie et au
règne d'Osortasen II, c'est-à-dire qu'elles ont
à peu près quatre mille ans
d'antiquité.
A la différence de celles de Thèbes, ces
peintures sont appliquées sur la pierre unie, et non
point superposées à des sculptures en creux ou
en relief. Ce sont quelquefois des sujets religieux, des
offrandes aux dieux ; mais le plus souvent des tableaux de la
vie domestique, représentant les travaux des champs,
la chasse, la pêche, la gymnastique. On voit des canges
somptueuses, garnies de rameurs, remonter le Nil ; dans l'une
est une momie couchée sur son lit
funèbre.
Des inscriptions qui accompagnent ces tableaux disent quel
fut le personnage enseveli dans chaque tombe, quelles
fonctions il remplit, quels honneurs lui furent
conférés. L'une d'elles, relative à un
gouverneur de province, fait de lui cet éloge,
remarquable par l'élévation morale qu'il
dénote : «Aucun orphelin n'a été
maltraité par moi. Aucune veuve n'a été
violentée par moi. Aucun mendiant n'a
été bâtonné par mes ordres. Aucun
pâtre n'a été frappé par moi.
Aucun chef de famille n'a été opprimé
par moi : je n'ai pas enlevé ses gens à leurs
travaux».
Parmi les scènes diverses que contiennent les tombeaux
de Béni-Hassan, il en est une qui a
particulièrement excité l'attention et
provoqué les recherches des savants. Elle
représente un certain nombre d'hommes vêtus d'un
costume étranger, ayant la barbe et les cheveux roux,
les yeux bleus, et un teint clair qui contraste fortement
avec le teint rouge ou brun des Egyptiens. Ces hommes,
appartenant évidemment à une autre nation,
à une autre race, sont conduits devant un haut
fonctionnaire, à qui ils semblent être
présentés par un scribe. Quels sont ces
étrangers ? A quel titre venaient-ils en Egypte ?
Cette question a donné lieu à plus d'une
réponse. Champollion crut que c'étaient des
Grecs ; mais il n'avait pas connaissance alors de
l'inscription qui a révélé la haute
antiquité des grottes de Béni-Hassan. Wilkinson
les prit pour des captifs ; mais cette hypothèse
tombe, quand on voit ces personnages avec des armes et des
lyres, conduisant des ânes chargés de bagages.
D'autres ont cru que c'était Jacob et ses enfants
émigrant en Egypte ; mais l'établissement des
Hébreux dans ce pays est postérieur à la
douzième dynastie. L'opinion la plus probable est
celle de M. Lepsius. Il pense que le fait de
l'émigration de Jacob fut précédé
de bien d'autres faits semblables, et que le tableau de
Béni-Hassan représente l'arrivée
d'émigrants qui demandent à être
reçus sur cette terre de l'Egypte, dont la
fécondité devait être pour tous ses
voisins un objet d'envie. Ces émigrants étaient
sans doute d'origine scythique, comme les Schétos ; ou
bien appartenaient à la race sémitique, comme
ces Hicsos qui, un peu plus tard, envahirent l'empire des
Pharaons ; de sorte que ce serait là en quelque sorte
l'avant-garde de l'invasion des barbares, et comme le
pronostic de la catastrophe prochaine.
Un fait curieux, c'est que ni dans les peintures de
Béni-Hassan, ni dans celles de Syout, qui sont
à peu près du même temps, on n'a vu de
chevaux représentés. Le cheval
évidemment était inconnu à cette
époque en Egypte. Peut-être y fut-il
amené par les Hicsos ou Pasteurs ; car les peintures
de Thèbes le reproduisent dans de nombreux
tableaux.
Quant au chameau, on ne le voit nulle part, et son
introduction est de beaucoup postérieure.
13 janvier.
Le calme continue. La température a même une
mollesse qui semble annoncer un changement dans la direction
du vent. Dieu le veuille, car depuis douze jours nous avons
marché avec une lenteur désespérante.
Nous sommes encore à environ quarante lieues du
Caire.
Nous abordons à un petit village pour acheter quelques
provisions. Un bois épais de mimosas et de dattiers
l'entoure : nous chassons un peu ; mais la chaleur est
énervante. Sous une tente, près du village,
nous apercevons plusieurs femmes. L'une d'elles, plus jeune
que les autres, fume nonchalamment un narguilé. Sa
toilette est bizarre et recherchée : ses cheveux sont
ornés de sequins ; une profusion de colliers retombent
sur sa brune poitrine, que la tunique laisse à demi
découverte. Elle a aussi des bracelets, d'immenses
pendants d'oreilles, et un anneau d'argent passé dans
la narine. Son visage est légèrement
tatoué ; mais sous cet accoutrement singulier elle
n'en est pas moins fort belle. Elle nous regarde assez
effrontément en nous montrant ses dents blanches.
Agostino, à qui nous nous informons, répond en
ricanant. Il paraît que ce sont des almées. Sous
le règne d'Abbas-Pacha, il y a quelques années,
un grand nombre de ces femmes furent enlevées du Caire
par la police, et déportées tout le long du Nil
dans les villes et les villages, jusqu'à Assouan et
même au delà.
Décidément le vent a sauté au sud : il
souffle avec force. On tend la voile, et la barque commence
à filer grand train. Bientôt l'aspect du ciel
change. Au sud, du côté du vent, l'horizon,
toujours si limpide, se trouble et prend une teinte grise. De
minute en minute le vent augmente : il a presque la violence
d'un ouragan. Nous marchons avec une vitesse de trois
à quatre lieues à l'heure.
Malgré la force du vent, l'air est chaud, lourd,
accablant. Evidemment c'est le kamsin qui souffle, le
sirocco des Italiens. Kamsin, en arabe, veut dire
cinquante : au printemps, ce vent du désert
règne en Egypte avec plus ou moins de
continuité pendant une cinquantaine de jours. L'hiver,
il se fait sentir plus rarement. Surtout, il n'a dans cette
saison ni la même violence ni la même ardeur
redoutables. En ce moment, et impatients que nous
étions des lenteurs du retour, il nous paraissait
plutôt un bienfait qu'un inconvénient. Pourtant
nous ne fûmes pas sans en souffrir un peu.
L'atmosphère était devenue comme opaque, le
ciel semblait de plomb ; et, dépouillé de
rayons, le soleil apparaissait comme un disque de
métal rougi au feu.
On avait peine à respirer : l'air aride et
mêlé d'une poussière impalpable fatiguait
la poitrine. De là sans doute cet état
d'abattement, d'énervement invincible qu'on
éprouve pendant tout le temps que souffle le kamsin.
Il y a un proverbe arabe qui dit : «La poussière
du simoun perce la coquille d'un oeuf».
Mais nous glissions sur l'eau avec la rapidité de
l'hirondelle : les rives fuyaient comme un panorama mouvant.
Plus on approche du Caire, plus elles sont plates et
monotones ; en revanche le fleuve s'anime de plus en plus.
Les barques de commerce se montrent plus nombreuses.
Nous en vîmes une, chargée d'une immense meule
de paille hachée, que la violence du vent avait fait
à moitié chavirer et qui s'était
échouée près de la rive. Deux hommes
étaient couchés nonchalamment sur le haut de la
meule, et regardaient leur paille s'en aller au fil de l'eau
: le flot minait incessamment la base du fragile
édifice, qui s'écroulait comme un tas de sable.
On nous dit que ces hommes attendaient du secours qu'on
était allé chercher. Je n'en admirais pas moins
avec quelle tranquille résignation ils contemplaient
ce désastre, qui les ruinait peut être.
Transportez cette scène sur un fleuve d'Europe : quels
cris ! quel désespoir ! mais aussi quelle
activité et quelle énergie contre la mauvaise
fortune ! Toute la différence des deux races est
là.
A dix heures du soir, le vent diminue ; mais nous ne sommes
plus qu'à quelques lieues du Caire. On s'arrête
devant le village de Daschour. C'est de là que demain
nous devons aller visiter les pyramides de Sakkarah et le
Sérapéum.