Chapitre 14 - Memphis - Les pyramides de Sakkarah - Le
puits des oiseaux
Le Serapeum - Les pyramides de Ghizeh - Le sphinx
14 janvier.
Le ciel a repris sa sérénité. L'air est
calme et pur. Le Nil, large et paisible comme un lac, brille
au soleil levant ainsi que de l'argent fondu. Nous descendons
à terre en attendant le déjeuner, et nous nous
promenons dans la forêt de palmiers qui entoure le
village.
Ces palmiers sont d'une incomparable beauté. Nulle
part nous n'en avons vu d'aussi gigantesques ; et l'on dit
que ce sont, en effet, les plus grands de l'Egypte.
Plantés en longues files et à distances
égales, ils forment, à droite et à
gauche de la route qui conduit à Sakkarah, des
quinconces dont les nefs immenses s'enfoncent à perte
de vue. Rien de plus ma-jestueux que ces beaux arbres, droits
comme des flèches, hauts de soixante pieds, et dont le
tronc svelte s'épanouit en un gracieux panache. Si les
voûtes mystérieuses de nos forêts du Nord
ont servi, comme on l'a cru, de type à l'ogive et aux
voûtes à rinceaux de nos cathédrales
gothiques, on ne peut s'empêcher de croire que le
palmier n'ait été le modèle de la
colonne égyptienne, couronnée le plus souvent
de son chapiteau largement évasé.
A dix heures, nous enfourchons nos ânes : ce sont,
cette fois, d'assez pauvres montures qui nous font regretter
celles du Caire et même de Louqsor. Peu de voyageurs,
avant la découverte du Sérapéum,
visitaient Sakkarah, et les moyens de transport ne sont pas
encore ici convenablement organisés.
La route que nous suivons est charmante. Quand on a
traversé la forêt de palmiers, on chemine sur de
hautes digues, qui longent des étangs ou de petits
lacs, remplis chaque année par le Nil. Les bords de
ces eaux sont couverts de canards, de pluviers, de
bécassines, d'une multitude d'oiseaux aquatiques. Nous
en tirons quelques-uns : la plupart sont un gibier
exquis.
Au delà des lacs, on trouve une autre forêt de
palmiers, plus vaste encore que la première. Le sol en
est inégal, montueux, et couvert presque partout
d'efflorescences de salpêtre, qui ressemblent à
une légère couche de neige. A ces indices, on
pourrait reconnaître déjà qu'on foule un
sol qui recèle des ruines. Bientôt se montrent
çà et là des blocs de granit à
moitié enfouis dans le sable, puis des vestiges d'une
enceinte construite en briques crues. On est sur
l'emplacement de l'antique Memphis.
Quelques restes d'un temple ont été
découverts près de là. Mais la ruine la
plus curieuse qui en subsiste est un colosse, exhumé
il y a quelques années, et qui est un des plus beaux
morceau de sculpture égyptienne qu'on connaisse. Il a
trente-cinq pieds de long ; les jambes ont en partie disparu
; mais la face, qui était enterrée, a dû
à cette circonstance de rester intacte. On y a reconnu
le portrait de Sésostris : les traits sont beaux et
fins, l'expression à la fois noble et douce. Une
énorme tranchée a été faite pour
mettre la statue à découvert ; mais elle n'a
pas été relevée ; les eaux se sont
accumulées dans l'excavation, et le pauvre Pharaon
gît tristement, à demi noyé, au fond de
ce fossé bourbeux.
Une plaine fertile sépare la forêt du village de
Sakkarah, qui est placé presque sur la limite des
sables. C'est dans cette vaste plaine, en remontant vers le
nord, que s'étendait la ville de Memphis. Au dire de
Strabon, elle avait cent cinquante stades de
circonférence, et renfermait des palais immenses. Il
n'en reste pas une pierre. Détruite, selon la
tradition, par Cambyse, elle couvrait encore la plaine de ses
ruines immenses à l'époque de la conquête
arabe : ces ruines furent démolies, et servirent
à la construction de Fostat et du Caire.
Auprès de Sakkarah, à l'ouest de la ville,
était la nécropole, qui a laissé plus de
vestiges que la ville elle-même. Au sortir du village,
on s'élève, par une pente assez douce, sur des.
collines de sable et de décombres. Ce terrain aride
semble avoir été fouillé et
bouleversé en tous sens. Des puits ont
été creusés à chaque pas ; le sol
en est criblé, et il faut quelque attention pour n'y
pas trébucher en suivant l'étroit sentier qui
serpente tout au travers. Ces fouilles ont été
faites pour la plupart par les Arabes, qui cherchent dans les
tombes les objets précieux ensevelis avec les
momies.
Parvenus sur la crête de ces collines basses et
onduleuses, nous voyons s'étendre du nord au sud,
parallèlement à la vallée, la ligne des
pyramides dites de Sakkarah. On en compte quinze : elles sont
beaucoup moins élevées que les pyramides de
Ghizeh. Bâties en briques crues, elles ont aussi moins
bien résisté à l'action du temps, et
toutes sont tellement dégradées,
ruinées, éboulées, qu'on les prendrait
volontiers de loin pour de grands tumulus. Il est
évident d'ailleurs, ne fût-ce que par leur
position au long de la nécropole, que, comme les
pyramides de Ghizeh, elles n'étaient autre chose que
des tombeaux.
A peu de distance de là se trouve le Puits des Oiseaux
: c'est une tombe profonde où étaient
déposées les momies des ibis sacrés. Il
est difficile d'y descendre. Notre drogman, qui nous avait
accompagnés, alla nous chercher une de ces momies : il
y en a une telle quantité que, malgré tout ce
qui en est journellement enlevé ou brisé, il
semble quele nombre n'en diminue pas.
Chaque oiseau, soigneusement embaumé et enroulé
d'une toiie fine, était déposé dans un
vase de terre long, pointu par le bas, en forme d'amphore, et
fermé d'un couvercle : ces vases sont placés en
rang, dans le sable, l'un à côté de
l'autre, et entassés par couches. Nous
défîmes la petite momie, la forme de l'oiseau
était parfaitement reconnaissable. Les os, les plumes,
les barbes même des plumes, tout se distinguait
nettement et était merveilleusement conservé.
Seulement, si l'on serrait les doigts, tout se
résolvait en une poussière impalpable et
s'envolait au vent.
C'est non loin de là qu'en 1851 un jeune savant
français, M. Mariette, a fait des découvertes
qui ont rendu son nom célèbre. En pratiquant
des fouilles dans ces terrains consacrés à la
mort et tout peuplés de momies d'hommes et d'animaux,
il a rencontré d'immenses galeries souterraines,
renfermant des sarcophages de granit : c'était le
Sérapéum de Memphis, c'est-à-dire le
tombeau des Apis ou boeufs sacrés, qui étaient
dans cette capitale l'objet d'un culte particulier. Cet
hypogée, l'un des plus étranges monuments de
l'Egypte, était le but principal de notre visite
à la nécropole. Il nous a fallu cheminer encore
assez péniblement, pendant une demi-heure, au milieu
des excavations et des décombres. Le sol est
jonché de morceaux de poteries rouges, de fragments de
terres cuites peintes et vernissées, de débris
de squelettes arrachés de leur sépulture. Un
vent violent nous fouette au visage le sable du
désert. Pas une trace de végétation ne
réjouit l'oeil sur cet immense et morne
cimetière : des aigles et de grands vautours planent
en tournoyant au-dessus de nos têtes.
Un grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants en haillons
sont occupés à déblayer un large trou,
près duquel nous passons. Ce sont des fouilles
nouvelles que fait faire M. Mariette : nous nous informons
s'il est là ; mais il est parti pour le Caire. Ce
travail se fait, comme toujours, à l'aide de
corbeilles en bois de palmier, que ces pauvres gens portent
sur la tête. Le surveillant, armé d'un
bâton, se tenait à l'endroit où venaient
se vider les corbeilles. Je le vis en assener des coups
à deux ou trois des travailleurs, et je crus d'abord
que c'était une correction aux plus paresseux. Mais
bientôt je remarquai que le même coup de
bâton les attendait tous au même moment, et je
compris qu'il était distribue tout simplement à
titre d'encouragement et pour les tenir en haleine.
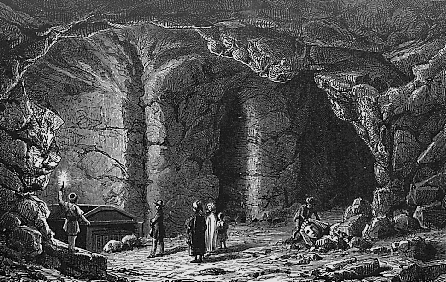 |
On arrive sur le Sérapéum sans le
voir. Il faut descendre comme dans une cave, par une pente
rapide où les pieds enfoncent dans un sable mouvant.
Bientôt, à la lueur des torches, on voit
s'ouvrir devant soi une immense galerie, large à peu
près autant qu'elle est haute. De distance en
distance, à droite et à gauche, sont
creusés dans l'épaisseur du rocher des caveaux,
ou plutôt des espèces de chapelles, plus basses
de quelques pieds que la galerie : dans chacune .de ces
chapelles mortuaires est placé un sarcophage colossal
de granit, à peu près semblable à ceux
qui, dans les tombeaux de Biban-el-Molouk, étaient
destinés à recevoir les corps des Pharaons. Une
inscription hiéroglyphique, gravée sur la
pierre, indique la date et l'âge où est mort le
boeuf sacré.
Les sarcophages sont au nombre de vingt-quatre. Tous ont
été ouverts et violés, comme ceux de
Thèbes. Quelques chapelles sont restées vides,
attendant leur hôte. Près de l'entrée de
la galerie on voit un sarcophage qui n'avait pas encore
été mis en place.
Qu'était-ce donc que ce Sérapis, dont les
images vivantes étaient si somptueusement ensevelies
après leur mort dans ces catacombes ?
Qu'était-ce que ce dieu, qui eut un temple
célèbre à Alexandrie et joua un si grand
rôle dans les derniers temps du paganisme ? Les
découvertes et les travaux de M. Mariette ont fourni
une réponse à ces questions jusque-là
mal résolues.
Sérapis, ou mieux Sorapis, Osorapis, était Apis
mort, identifié avec Osiris ou le soleil
régnant sur l'hémisphère
inférieur. Apis vivant, appelé aussi dans les
inscriptions la seconde vie de Phtha, était
l'incarnation de ce même dieu-soleil éclairant
le monde, et adoré à Memphis comme
divinité suprême.
Dès les premières dynasties, le culte d'Apis
fut le culte propre de Memphis, chaque.nomc ou province
ayant, comme je l'ai déjà dit, son
fétiche particulier. Mais c'est seulement sous
Rhamsès II que ce culte commença à
prendre une importance capitale ; et ce ne fut même que
vers le VIIe siècle avant notre ère, sous le
règne de Psammétichus, qu'il fut entouré
de l'éclat extraordinaire dont nous avons les vestiges
sous les yeux. Alors on creusa ce prodigieux souterrain.
Alors on commença d'ensevelir les Apis dans ces
magnifiques sarcophages. Au-dessus de ces caveaux fut
élevé un temple ou mausolée dont
quelques restes ont été retrouvés.
C'était l'époque où les Grecs
commençaient à pénétrer en Egypte
par leurs factoreries de Naucratis. Soit méprise de
leur part, soit complaisance des prêtres
égyptiens, qui se prêtaient à flatter
leurs idées, le dieu Apis fut bientôt confondu
dans l'esprit des Hellènes avec Dionysos ou Bacchus,
qu'on représentait souvent avec des cornes de boeuf,
et qui parfois, devenu divinité infernale, avait
revêtu quelques-uns des attributs de Pluton. Ainsi, par
un mélange singulier de choses très
dissemblables, les Grecs établis en Egypte en vinrent
à adorer Sérapis comme un de leurs dieux. Plus
tard même, frappés de l'antiquité de la
civilisation et de la religion égyptiennes, ils se
persuadèrent que leur culte national leur était
venu tout entier des bords du Nil. C'est une erreur qui s'est
propagée jusqu'à nos jours ; et Champollion
lui-même a cru que la mythologie grecque était
une dérivation de la religion égyptienne et
avait été transportée dans l'Hellade par
Cécrops. Les colonies égyptiennes en
Grèce sont au moins douteuses ; mais ce qui est
maintenant hors de doute, c'est que la mythologie grecque ne
vient nullement de l'Egypte ; c'est qu'il n'y a aucun rapport
de filiation entre les dieux graves et solennels de Memphis
et de Thèbes, et les divinités gracieuses et
presque humaines de l'Olympe.
Avant qu'on déchiffrât les hiéroglyphes,
les notions que nous avions sur l'ancienne religion
égyptienne se réduisaient à celles que
nous avaient laissées les Grecs ; et la plupart
étaient confuses et erronées. Les Grecs se sont
toujours plu à identifier leurs dieux et leurs
héros avec les divinités de l'Egypte : ces
rapprochements arbitraires, fondés le plus souvent sur
des analogies fortuites et superficielles, datent surtout de
l'époque des Ptolémées et de
l'école d'Alexandrie. Il se fit alors comme un
singulier amalgame des deux religions. Tous les dieux
égyptiens se virent après coup baptisés
des noms grecs et revêtus d'une physionomie grecque :
Ammon était transformé en Jupiter ; Osiris, en
Pluton ou en Bacchus ; la déesse Hathôr, en
Vénus ; Sevek, le dieu crocodile, en Saturne, et ainsi
de suite.
Cette manie qu'ont eue les Grecs les a fait tomber
quelquefois dans d'étranges méprises. En voici
un exemple curieux. Le petit Horus, fils d'Osiris et d'Isis,
qui dans la grande triade thébaine symbolise le monde
naissant, était représenté sous la forme
d'un petit enfant avec un doigt dans la bouche : son nom se
lit, en langue hiéroglyphique, Harpe-Kroti. Les Grecs,
se trompant sur la signification de ce geste emprunté
aux petits enfants, l'ont pris pour le geste du silence, le
doigt sur les lèvres. Du nom égyptien
Harpe-Kroti ils ont fait le nom grec Harpocrate, et du dieu
Horus ils ont fait le dieu du silence.
Hérodote raconte longuement que Cambyse, en arrivant
à Memphis, fut fort choqué de voir les
Egyptiens adorer un boeuf. Il ordonna qu'on amenât le
dieu cornu devant lui ; et, voulant prouver aux prêtres
leur imposture, il frappa d'un coup de poignard l'animal, qui
mourut quelques jours après. Puis, pour donner plus de
poids à son action et à ses paroles, il fit
battre de verges et mettre à mort les prêtres,
et ordonna que la même peine fût appliquée
à tout Egyptien qui célébrerait les
fêtes d'Apis.
Malheureusement cette belle histoire semble, depuis la
découverte du Sérapéum, devoir
être reléguée au nombre des contes. Chose
étrange ! parmi les sarcophages d'Apis trouvés
dans la galerie souterraine, on voit figurer celui du boeuf
sacré que le monarque persan tua peut-être dans
un moment de colère, mais auquel il n'en fît pas
moins rendre les honneurs accoutumés et apporta
lui-même son tribut d'adoration : c'est ce que constate
l'inscription lue sur le granit. Il s'en faut donc de
beaucoup que le conquérant ait été ce
dévastateur impie que les Grecs nous ont peint jetant
à bas les temples, et foulant aux pieds les statues
des dieux. Et quant aux persécutions qu'on lui
attribue, elles semblent tout aussi imaginaires ; car une
autre inscription, qui est aujourd'hui au Vatican, le montre
allant à Saïs adorer la déesse Neïth,
se faisant initier à ses mystères,
rétablissant les prêtres dans tous leurs droits
et rendant au culte son éclat premier. Evidemment
Cambyse, comme plus tard les Ptolémées, fut
obligé, la conquête achevée, de respecter
les institutions et les usages du peuple conquis, et de
rendre lui-même hommage aux objets de son culte. Ses
successeurs firent de même.
13 janvier.
Nous nous sommes réveillés ce matin devant
Ghizeh. Bien qu'un repli du fleuve nous dérobe la vue
du Caire, tout annonce le voisinage de la capitale. Le Nil
est sillonné de barques nombreuses de toutes sortes ;
ses rives sont couvertes de riches maisons de campagne, de
palais de pachas qui ressemblent à des palais de
rois.
Il y a près de deux lieues du fleuve aux pyramides.
Mais Agostino, qui est allé cette nuit au Caire dans
le canot, nous a amené nos vaillants petits ânes
de l'Ezbekieh, et la course se fera plus lestement que celle
d'hier. Le temps est à souhait, calme avec un ciel
légèrement voilé : trop de vent et trop
de soleil seraient gênants pour monter sur la grande
pyramide.
Une forêt de palmiers entoure Ghizeh, comme Daschour :
dès qu'on l'a franchie, on voit en face de soi, sur
des collines blanches et peu élevées, se
dresser les trois pyramides. A cette distance, une lieue
à peu près, elles ne produisent pas l'effet
qu'on en attend. L'absence de tout point de comparaison dans
la perspective trompe l'oeil sur leur masse. Même au
bas des collines qui les portent, on les juge mal. Il faut
être à leur pied, ou à dix lieues.
C'est dans la plaine que nous traversons en ce moment que, le
21 juillet 1798, se livra cette fameuse bataille qui ouvrit
à notre armée les portes du Caire et
détruisit d'un seul coup la puissance des mameluks.
Mourad-Bey avait placé le gros de ses troupes dans un
camp retranché, situé plus bas, près du
petit village d'Embabeh, que nous apercevons d'ici et qui
fait face à Boulaq. Lui-même, avec dix mille
cavaliers, tenait la plaine, entre le fleuve et les
pyramides. Coupés de leur camp par les manoeuvres du
général français, les mameluks
étaient venus s'abattre comme un ouragan de fer sur le
front de nos carrés ; mais leur fougue s'était
brisé contre la froide intrépidité des
soldats d'Italie. Mourad-Bey, tout sanglant, s'enfuyait vers
la haute Egypte ; plusieurs milliers de ses brillants
cavaliers étaient jetés dans le Nil ; son camp
était forcé ; sa flottille n'échappait
au vainqueur que par l'incendie ; et, le soir de ce jour,
Bonaparte, maître du Caire et de l'Egypte,
plaçait son quartier général à
Ghizeh même, où Mourad-Bey avait une superbe
habitation.
Vers le milieu de la plaine, nous fûmes croisés
par un groupe de cavaliers : c'étaient des
Bédouins qui venaient, nous dit-on, payer le tribut au
pacha. Ces hommes nous rappelaient, par le type et le
costume, nos Arabes de l'Algérie : traits
accentués et énergiques, taille haute et
souple, membres secs et nerveux. Au lieu du turban, ils
portaient sur la tête, par-dessus le tarbouche, ce
grand morceau de fine laine blanche, appelé haïk,
autour duquel est roulée la corde de poil de chameau.
Un long fusil battant sur le dos, un sabre et
d'énormes pistolets à la crosse brillante
passés à la ceinture, ils avaient une tournure
martiale, et faisaient caracoler leurs chevaux avec cette
grâce aisée qui n'appartient qu'aux Arabes du
désert.
Il y a de ces Bédouins par centaines de mille en
Egypte ; mais on les voit rarement dans la vallée du
Nil : ce sont des tribus nomades vivant dans le désert
et sur la limite du pays cultivé. Autrefois ils
étaient adonnés au pillage, et leur hardiesse
était telle, qu'ils interceptaient parfois la route du
Caire aux pyramides et y dévalisaient les voyageurs.
Méhémet-Ali les a fait rentrer dans l'ordre,
comme ceux des villages du Nil dont j'ai parlé
ailleurs. Son fils Ismaïl, de cette race albanaise si
brave et si indomptable, fut chargé, avec un corps de
cavaliers toujours prêts, d'aller dans le désert
châtier celles de ces tribus qui se rendaient coupables
de brigandages : de terribles exécutions leur ont fait
perdre leurs habitudes de vol, et aujourd'hui la plaine de
Ghizeh est aussi sûre que la route de Boulaq.
Longtemps avant d'arriver aux pyramides, on est
harcelé par des Arabes qui, du plus loin qu'ils
aperçoivent une bande de touristes, accourent avec de
grands cris, de grands gestes, agitant leurs burnous blancs,
pour offrir leurs services de ciceroni. Il y a
là toute une tribu qui, je pense, ne vit pas d'autre
chose que des pyramides : c'est son bien, et toute son
industrie est de les faire voir. En arrivant au pied des
collines sur lesquelles elles sont assises, nous apercevons
de petits points noirs et blancs qui semblent se mouvoir sur
un des angles de la plus grande pyramide : ce sont des
voyageurs, escortés d'Arabes, qui en font l'ascension.
D'ici, on dirait des fourmis grimpant le long d'un
énorme bloc de grès.
Quand on est sur la plate-forme sablonneuse et en face de ces
étranges monuments, on s'arrête malgré
soi : on se sent comme épouvanté par quelque
chose d'immense, d'éternel et d'immuable. Que dire,
qui n'ait été dit cent fois, de ces
étonnantes constructions que salue depuis tant de
siècles l'admiration des hommes ? L'esprit est
confondu de la puissance qu'elles attestent, de la
civilisation qu'elles supposent, de la grandeur empreinte
dans leur simplicité même. Bossuet a beau
s'écrier avec sa souveraine éloquence :
«Mais quelque effort que fassent les hommes, leur
néant paraît partout : ces pyramides sont des
tombeaux !» J'aime mieux, au pied de ces merveilles de
l'ancien monde, relire la page qu'elles ont inspirée
à Chateaubriand : «J'avoue qu'au premier aspect
des pyramides, je n'ai senti que de l'admiration. Je sais que
la philosophie peut gémir ou sourire en songeant que
1e plus grand monument sorti de la main des hommes est un
tombeau ; mais pourquoi ne voir dans la pyramide de
Chéops qu'un amas de pierres et un squelette ? Ce
n'est point par le sentiment de son néant que l'homme
a élevé un tel sépulcre, c'est par
l'instinct de son immortalité...» - «Tous
ces peuples, dit Diodore, appellent les maisons des vivants
des hôtelleries, par lesquelles on ne fait que
passer ; mais ils donnent le nom de demeures
éternelles aux tombeaux des morts, d'où on
ne sort plus».
La grande pyramide, mesurée à sa base, a sept
cent vingt pieds de côté, d'un angle à
l'autre. Sa hauteur, qui était primitivement de quatre
cent cinquante-un pieds, c'est-à-dire du double de
celle des tours de Notre-Dame de Paris, n'est plus
aujourd'hui que de quatre cent vingt-huit, par suite de la
dégradation du sommet. Les assises ou gradins dont
elle est formée étaient autrefois couverts d'un
revêtement uni qui ne permettait pas d'y monter : on
voit encore au sommet de la seconde pyramide, dite de
Chéfren, une partie de celui qui la recouvrait. Il est
probable que ces revêtements ont été
enlevés, comme les restes de Memphis, pour servir
à des constructions modernes. - La seconde pyramide
n'est pas beaucoup moins haute que la première. - La
troisième, dite de Mycérinus, n'atteint
guère qu'au tiers de la grande.
Sauf un petit nombre de chambres ménagées dans
la maçonnerie, la grande pyramide est
entièrement pleine. On a calculé que la masse
de pierres dont elle se compose, évaluée
à environ soixante-quinze millions de pieds cubes,
pourrait fournir les matériaux d'un mur qui aurait
mille lieues, et ferait le tour de la France. Sa base couvre
un espace égal à cinq hectares et demi.
La pierre paraît avoir été
empruntée au rocher même sur lequel les
pyramides sont fondées. Mais ici, plus peut-être
que devant tout autre monument de l'Egypte, on est
amené à se poser cette question : Comment de
telles masses ont-elles été construites ? Par
quel moyen a-t-on élevé à une telle
hauteur des assises si régulières,
formées de blocs qui pèsent trente milliers ?
Les anciens Egyptiens, quoi qu'on en ait dit, paraissent
n'avoir eu aucunes connaissances en mécanique : on en
aurait trouvé la trace dans leurs peintures, comme on
y a trouvé représentés les
procédés de tous leurs arts et de tous leurs
métiers ; or pas une machine n'y est figurée.
Dans un tableau qui représente le transport d'un
colosse, on voit un nombre considérable d'hommes
attelés à des cordes, et tirant la statue
posée simplement sur des rouleaux. Il est à
croire que toute leur mécanique se bornait là :
des échafaudages, des plans inclinés, et puis
des milliers et des milliers de bras, force qui ne
coûtait rien et qu'on n'économisait
guère. Il faut ajouter seulement qu'ils faisaient du
plan incliné un emploi très habile et
très ingénieux. S'il s'agissait d'un temple ou
d'un palais, à mesure que la construction
s'élevait, ils entassaient des terres de
manière à former un talus en pente douce, qui
s'exhaussait avec l'édifice, et sur lequel on hissait
à force de bras les pierres gigantesques qui
composaient les murailles et les plafonds : l'édifice
achevé, on déblayait. Pour dresser les
obélisques, l'opération était plus
difficile, mais le procédé était le
même. Le monolithe étant amené en place,
et sa partie inférieure étant maintenue
immobile, on faisait décrire à sa pointe un
quart de cercle, en la faisant glisser, toujours à
force de bras, sur un plan incliné qui se
développait en spirale, jusqu'à ce que
l'énorme bloc, arrivé à la
perpendiculaire, vînt s'asseoir de lui-même sur
la base qui devait le recevoir. Il faut admirer
sûrement que de si grandes choses aient
été faites avec des moyens aussi simples. Mais
que de misères, que de souffrances de tels travaux
n'ont-ils pas imposées aux nations asservies ou
captives ! Que de vies humaines ont payé ces grandeurs
!
L'ascension de la grande pyramide se fait par l'angle du
nord-est. Elle est assez pénible : les assises ont un
mètre à peu près de hauteur, ce qui
oblige, on le voit, à faire d'assez fortes
enjambées. Il serait imprudent de monter sans l'aide
des Arabes ; car les gradins ayant peu de largeur et
étant souvent ébréchés, un faux
pas serait mortel et vous précipiterait jusqu'en bas.
Des accidents de ce genre sont arrivés. Aujourd'hui on
ne permet plus aux voyageurs de monter seuls. Un cheik de
village, responsable, est chargé de leur fournir des
guides sûrs, moyennant une rétribution fixe. Ces
hommes, lestes et vigoureux comme des panthères,
montent la pyramide comme nous montons notre escalier ; leurs
pieds nus ne glissent jamais. Deux d'entre eux s'emparent de
vous, un par chaque main, et vous attirent sur l'assise
qu'ils ont gravie, pendant qu'un troisième,
placé derrière, vous soulève par les
reins et vous retient en cas de chute. Avec ces
précautions, l'ascension est sans danger, sinon sans
fatigue. Je ne conseillerai pourtant pas de la tenter
à ceux qui sont sujets aux vertiges ; car, si on monte
sans trop d'émotion, la descente est vraiment
effrayante.
La plate-forme qui termine aujourd'hui la grande pyramide a
trente-neuf mètres de tour. Les Anglais aiment
à y dîner. Nous nous contentâmes d'admirer
le beau panorama dont on y jouit : au nord, en face de nous,
la croupe rougie du Mokattam qui domine le Caire, ses
dômes et ses minarets ; à droite, le Nil,
coupant d'une large bande d'argent la douce verdure des
campagnes et la verdure plus sombre des forêts de
palmiers ; à gauche et derrière nous, le
désert sans bornes, montueux et ondulé. Mais le
trait saillant de ce tableau, c'est la ligne nette,
tranchée, rigoureuse, qui sépare à
l'oeil les terres cultivées du désert qui les
confine : on dirait deux domaines, divisés par une
muraille ; d'un côté une mer de verdure, de
l'autre une mer de sable jaune et nu ; et ces deux
océans rivaux se partagent presque également
tout le cercle de l'horizon.
Quelques-uns de nous ont voulu écrire à leurs
amis un billet daté du haut de la pyramide. Pendant
que nous nous reposons de la rude gymnastique que viennent de
nous faire faire nos guides, d'autres Arabes nous entourent ;
les uns veulent nous vendre des antiquités, les autres
nous offrent de l'eau dans de petites cruches de terre : tous
demandent l'éternel bakchich, et ceux qui nous ont
hissé là, plus obstinément, on le pense
bien, que les autres. Ils prétendent que le cheik
garde toute la rétribution pour lui, et ne leur donne
pour salaire qu'un misérable morceau de pain,
assaisonné de coups de bâton. Ce n'est pas
très invraisemblable ; mais pendant tout le temps
qu'on monte et qu'on descend, il faut s'attendre à
cette opiniâtre et fatigante sollicitation. Il n'y a
qu'un moyen de s'en débarrasser, c'est de vider ses
poches.
Un des pauvres diables qui m'avaient aidé à
monter, trop faible apparemment pour un si rude
métier, y avait gagné un asthme violent : sa
poitrine sifflait comme un soufflet de forge, et ce bruit de
râle que j'avais sans cesse dans l'oreille me fatiguait
horriblement ; je souffrais pour ce malheureux. Il n'en a pas
sans doute pour longtemps ; car, soit besoin, soit
avidité, il ne s'y ménageait
guère.
Ces Arabes sont, la plupart, d'une force et d'une
agilité merveilleuses. Il y en a un qui, pour quelques
piastres, descend en courant la grande pyramide où
nous sommes, court à la seconde, et grimpe jusqu'au
sommet malgré le revêtement qui la couvre en
partie. Cette ascension ne lui a demandé que dix
minutes : nous en avons mis vingt à faire la
nôtre.
L'intérieur de la grande pyramide est peu curieux. Un
corridor étroit et bas, où l'on ne peut marcher
que courbé, conduit à une grande chambre
appelée la chambre du roi, et où se, trouve un
sarcophage en granit. Au-dessus est une chambre plus petite,
qu'on appelle la chambre de la reine ; au-dessus encore,
plusieurs autres chambres moins grandes. La disposition de
toutes les pyramides est à peu près la
même.
On se demande, en présence de ces faits, comment tant
d'absurdes hypothèses ont été
émises sur le caractère et la destination des
pyramides. L'antiquité avait eu beau nous affirmer que
c'étaient des tombeaux ; les faiseurs de
systèmes ont voulu en savoir plus qu'elle. Je ne parle
pas des récits légendaires qui en ont fait les
greniers de Joseph, ou qui y ont placé de
prétendus trésors ; je ne parle que des
explications données pour sérieuses. Les uns y
ont vu des sanctuaires où se faisaient les initiations
et se célébraient les mystères de la
religion égyptienne : ce qui est difficile à
comprendre, les pyramides étant, sauf quelques
caveaux, entièrement compactes. Les autres les ont
prises pour des monuments scientifiques, pour des
observatoires astronomiques ; et il est vrai, chose assez
curieuse, qu'elles sont exactement orientées. Mais on
oubliait que le revêtement poli qui les a recouvertes
jusqu'au temps de Saladin en rendait l'ascension à peu
près impossible ; et quant à leur orientation,
il est probable qu'il y avait là une pensée
religieuse plutôt que scientifique : beaucoup de
monuments funèbres de la même époque sont
orientés. D'autres enfin, et tout récemment,
ont dépensé beaucoup d'esprit pour prouver que
les pyramides avaient été bâties pour
arrêter le sable du désert, qui tend toujours
à envahir la vallée. Il suffît d'avoir vu
les lieux pour reconnaître ce que cette
hypothèse a de futile. Les grandes pyramides,
éloignées de cinq à six cents pas l'une
de l'autre, et celles de Sakkarah, beaucoup plus distantes
entre elles, n'ont point arrêté et ne pouvaient
arrêter le sable du désert. Le sphinx, qui est
situé entre les pyramides et la plaine, a
été ensablé jusqu'au cou ; les temples
qui l'entouraient ont été enfouis. Enfin on a
fait remarquer avec justesse qu'elles auraient plutôt
produit un effet opposé à celui qu'on leur
attribue, la violence des vents étant naturellement
accrue par le rapprochement de deux obstacles, et le sable
tendant à s'accumuler dans les gorges.
Ce qui est la vérité, ce qui n'est pas
sérieusement contestable, c'est que les pyramides
étaient des tombeaux. Tout est venu confirmer à
cet égard la tradition ancienne. On a trouvé
dans la plupart des pyramides des sarcophages et des
ossements. Quoi de plus conforme d'ailleurs à toutes
les données historiques ? Ce genre de monuments
funéraires, de tumulus, soit en maçonnerie,
soit en terre, a été en usage chez presque tous
les peuples, depuis les Scandinaves jusqu'aux sauvages de
l'Ohio, depuis l'Inde jusqu'au Mexique. Le petit nombre
d'inscriptions hiéroglyphiques trouvées dans
l'intérieur de la grande pyramide et auprès de
la seconde ont confirmé encore sur un autre point les
données que nous a fournies l'antiquité. Ces
inscriptions indiquent comme fondateurs des pyramides les
rois Choufou et Chafra : le premier est celui que les anciens
ont appelé Chéops ou Souphis, et qui a
construit la grande pyramide ; le second est celui qu'ils ont
nommé Chéfren. Ces rois appartiennent à
la quatrième dynastie, c'est-à-dire à
une époque de beaucoup antérieure à
l'invasion des Pasteurs : c'est par une erreur
grossière qu'Hérodote en fait des Pharaons
thébains, postérieurs à
Sésostris. C'est aussi une pure légende qui
attribue la construction des pyramides à l'oppression
des Hébreux en Egypte : les pyramides existaient
depuis des siècles déjà, quand Jacob et
sa famille vinrent s'établir au bord du Nil. Les
monuments les plus prodigieux, les plus impérissables
de l'Egypte, sont en même temps les plus anciens. Il
n'y en a pas dans le monde qui remontent plus haut. Nous
sommes ici sur le seuil des temps historiques.
 |
Le sphinx, gardien immobile des pyramides, est
couché à leurs pieds, du côté de
la vallée, regardant le fleuve. Des fouilles
récentes ont dégagé le corps, qui
était tout entier recouvert par les sables. Le corps a
quatre-vingt-dix pieds de long et soixante-quatorze de
hauteur. La tête en a vingt-sept du menton au
sommet.
On sait que cette statue, la plus colossale qu'ait
sculptée la main des hommes, n'est autre chose qu'un
rocher taillé de façon à imiter la forme
humaine. Toute mutilée qu'elle est, cette grande
figure a une expression pleine de majesté. Les Arabes,
dit-on, la nommaient Abou-el-Houl, c'est-à-dire le
Père de la Terreur ; et ce sont eux qui l'ont
défigurée, car elle était encore intacte
au XVIe siècle. Je ne comprends pas que sa vue ait pu
inspirer l'effroi, et la superstition du mauvais oeil peut
seule expliquer la terreur populaire ; car cette tête
est empreinte d'une singulière douceur et respire une
sérénité calme et puissante.
Qu'était-ce que cette statue taillée dans une
montagne ? Le sphinx, que les Grecs empruntèrent plus
tard à l'Egypte et dont ils firent, à cause de
cette origine sans doute, un symbole de science
mystérieuse, un dépositaire de redoutables
énigmes, ne paraît jamais avoir eu ce
caractère pour les anciens Egyptiens. C'était
pour eux tout simplement le portrait d'un roi ou l'image d'un
dieu. On a cru longtemps que le sphinx colossal des pyramides
était le portrait du roi Thoutmosis IV, de la
dix-huitième dynastie, dont le nom se lisait sur une
inscription trouvée à ses pieds. Mais les
fouilles que M. Mariette, l'heureux auteur de la
découverte du Sérapéum, a fait pratiquer
autour des pyramides, ont donné des résultats
qui semblent contraires à cette opinion. Il a
trouvé un colosse d'Osiris, appuyé contre le
flanc droit du sphinx, et tout à côté les
restes d'un temple consacré à Osiris et
à Horus son fils ; et ses recherches sur ces monuments
l'ont conduit à cette conclusion, que le sphinx
n'était qu'un simulacre naturel de ce dernier
dieu.
Le temple exhumé auprès du sphinx par M.
Mariette est un monument unique dans son genre : c'est le
seul temple antérieur à l'invasion des Pasteurs
qui ait été trouvé en Egypte. Il date,
comme les pyramides, de la quatrième dynastie. C'est
une vaste enceinte carrée, renfermant un grand nombre
de chambres et de galeries, construites en blocs
énormes de granit et d'albâtre.
De cette époque, si prodigieusement reculée, on
n'a, à part ce temple et les pyramides de Ghizeh, que
des débris épars, quelques colonnes à
Karnac, un obélisque à Héliopolis : tant
cette invasion de barbares semble avoir complètement
détruit, anéanti, effacé de dessus le
sol les monuments élevés par les Pharaons !
Comment douter, en effet, que dès ce temps-là
l'Egypte ne fût couverte d'édifices aussi
magnifiques que ceux qu'elle a bâtis depuis ? Ceux qui
ont élevé les pyramides pour y loger leur
cercueil, quels palais n'ont-ils pas dû construire pour
y déployer leurs pompes royales, quelles salles pour y
tenir leurs assemblées politiques, quels temples pour
y rendre hommage à leurs dieux !
Et notez que les statues, les sculptures qui nous sont
restées de cette époque attestent, j'ai
déjà eu occasion de le dire en passant, un art
supérieur à tout ce qu'ont produit les
siècles suivants, sans en excepter le siècle de
Rhamsès le Grand. Plusieurs statues de ces premiers
âges ont été retrouvées, depuis
quelques années, aux environs de Ghizeh et de
Sakkarah, admirablement conservées dans le sable qui
les a défendues des outrages des hommes, plus à
craindre que le temps. De précieuses sculptures ont
aussi été découvertes, datant du
même temps, dans des tombeaux situés aux
mêmes lieux : les tombeaux murés et enfouis sont
les seuls monuments qui aient pu échapper aux barbares
et aux soldats de Cambyse. Or, quand on jette les yeux sur
ces sculptures, sur ces statues dont plusieurs sont
maintenant au Louvre, on est émerveillé de la
perfection du style, de la vérité et du naturel
des figures. Ces figures n'ont point la roideur qu'on trouve
dans les oeuvres du second empire, c'est-à-dire de
l'époque postérieure aux Pasteurs : les muscles
sont mieux accusés, les mouvements sont plus vrais, la
vie, en un mot, est mieux saisie et mieux rendue. Sans doute
cet art ne peut être comparé à celui de
la Grèce ; mais s'il manque d'idéal, il se
rapproche de la nature. Les tableaux qui décorent les
tombes ont le même caractère de
simplicité et de vérité à la
fois. Ce ne sont pas, comme aux époques plus
récentes, des allégories religieuses, mais
seulement des scènes de la vie domestique et
agricole.
Quelle civilisation déjà riche, puissante,
perfectionnée, ne supposent pas de tels monuments et
de telles oeuvres ! Les savants discutent encore sur la
question de savoir comment a été peuplée
l'Egypte ; si ses premiers habitants sont venus du Nord ou du
Sud. Ce qui est au moins évident maintenant, quand
même on admettrait qu'elle a reçu sa population
de l'Ethiopie, c'est que sa civilisation a commencé
par la basse Egypte ; c'est que Memphis a
précédé Thèbes, c'est que
longtemps avant le jour où les Thoutmosis et les
Rhamsès élevèrent les temples qu'on
admire à Médinet-Abou et à Karnac,
longtemps même avant le débordement de barbares
qui submergea la basse et la moyenne Egypte, un empire
puissant avait sa capitale dans cette Memphis dont on cherche
aujourd'hui la place ; une civilisation avancée, un
art perfectionné avaient élevé dans son
sein et autour de ses murs des monuments faits pour exciter
l'admiration et l'étonnement de la
postérité. C'est justement, on le voit, le
contre-pied de cette vieille tradition qui fait descendre du
Sud et de la fabuleuse Méroë la civilisation
égyptienne. Les pyramides qui avoisinent
Méroë avaient été données,
dans cette opinion, comme le type et le modèle des
pyramides de Ghizeh : des observations plus exactes ont
démontré qu'elles appartenaient à une
époque relativement moderne, à l'époque
grecque.
Nous sommes rentrés un peu brisés et courbatus
de notre ascension à la pyramide : peu de montagnes,
en effet, sont aussi fatigantes à gravir. Pendant que
la barque franchit le trajet qui sépare Ghizeh de
Boulaq, nous dînons : c'est le dernier dîner que
nous ferons sur le Nil. Ce soir, nous allons dire adieu
à ce beau fleuve; ce soir nous allons quitter cette
cange sur laquelle nous vivons depuis un mois, où la
vie, en somme, nous a été assez douce, et
d'où nous remporterons tant de gracieux ou imposants
souvenirs. Mais, depuis un mois et plus, nous sommes sans
nouvelles de France ; et ce n'est pas sans une vive
impatience que nous attendons nos lettres.
Il était nuit close lorsque la barque s'arrêta
devant le quai de Boulaq. Quelques passants attardés
nous croisèrent encore sur la route qui conduit au
Caire. Mais le silence et la solitude régnaient sur la
place de l'Ezbekieh. Nous étions dans une immense
capitale, et nous nous serions crus volontiers encore sur les
rives muettes de Memphis ou de Louqsor.