Chapitre 15 - Retour au Caire - Une visite au harem du
vice-roi
Les femmes turques - Les esclaves
Notre séjour doit se prolonger plusieurs semaines
au Caire. Bien qu'il nous reste peu de chose à y voir
que nous n'ayons déjà vu, cette perspective ne
nous effraie pas. Il y a dans ce climat, dans cette nature de
l'Orient ; il y a dans l'aspect et le mouvement de cette
grande ville un charme dont on ne se lasse point, et qu'on
goûte même davantage à mesure qu'on le
savoure plus longtemps. Ce charme singulier, tous les
voyageurs l'ont ressenti.
Pour nous, les semaines que nous avons passées au
Caire lors de ce second séjour, nous ont paru courtes.
Des excursions aux environs, où de belles ruines
méritent d'être visitées, des promenades
aux palais qui avoisinent la capitale, ont rempli plusieurs
journées. Mais faire de grandes courses à
travers la ville, errer à l'aventure dans le
dédale de ses rues et de ses bazars ; tantôt se
mêler à ce tourbillon vivant qui roule
incessamment dans ses quartiers marchands ; tantôt
cheminer solitairement dans les rues étroites, pleines
d'ombre et de silence, de ses quartiers arabes ;
c'était là pour nous un plaisir toujours
nouveau, toujours aussi vif ; et chaque jour il nous arrivait
de passer ainsi de longues heures, marchant quasi sans but,
nous enivrant de bruit, de mouvement, de couleur et de
lumière. Au retour de ces flâneries, laissant
nos ânes à l'entrée de l'Ezbekieh, nous
nous délassions en nous promenant sous les belles
avenues de gommiers qui entourent la place, ou dans les
allées sinueuses et tranquilles du jardin qui en
occupe le milieu.
En venant de France, nous avions fait sur le paquebot une
heureuse rencontre : celle de M. de Rosetti, consul de
Toscane au Caire, et de sa fille. La famille de M. de
Rosetti, établie en Egypte depuis plus d'un
siècle, et jouissant d'une grande fortune, occupe ici
une position élevée. Elle avait la faveur de
Méhémet-Ali, et a gardé celle de
Saïd-Pacha. Pendant notre séjour au Caire, nous
n'avons eu garde de négliger cette relation ; et nous
avons reçu de M. de Rosetti et de sa fille le plus
gracieux accueil. Mlle de Rosetti, qui a une tante
attachée à la cour du pacha, offrit à ma
femme et à Mme P*** de leur faire obtenir une audience
de la princesse, femme légitime du vice-roi.
C'était une bonne fortune trop rare pour qu'on n'en
profitât pas avec empressement. Peu de jours
après, en effet, l'audience fut accordée. M.
P*** et moi, qui ne pouvions, hélas ! avoir notre part
de cette haute faveur, convînmes d'aller ce
jour-là, pour nous consoler, faire une seconde visite
aux pyramides.
Cette réception, toutefois, me met à même
de donner ici quelques détails, qui paraîtront
peut-être assez curieux, sur le harem du vice-roi.
Mais, comme je n'ai pas la prétention ni le talent de
parler des choses que je n'ai point vues, il faut bien qu'on
me permette de laisser pour un moment la parole à un
autre. Je transcris ici une lettre écrite le
lendemain, et où se trouve racontée la visite
au harem.
«... Il avait été convenu que Mlle de
Rosetti viendrait, avec sa tante, nous prendre à trois
heures, Mme P*** et moi. A l'heure dite, la voiture de ces
dames était à la porte de notre
hôtel.
 |
Le palais de la princesse étant en
réparation, elle demeure provisoirement chez sa
belle-soeur, fille cadette de Méhémet-Ali, dont
le palais est situé sur l'Ezbekieh, près
de la route de Boulaq. Précédées de
notre saïs, qui rivalisait de vitesse avec les chevaux
fringants de la calèche, nous eûmes
bientôt franchi l'espace qui nous séparait du
palais. Un nombreux personnel de gardes et de domestiques en
remplissait les abords. Nous traversâmes un premier
corps de bâtiments, consacré aux gens de
service. Une sorte de galerie ouverte à l'italienne
nous conduisit à l'appartement des femmes,
situé au milieu des jardins. Là nous
franchîmes la première porte du harem. Le harem
! mot plein de prestige pour une oreille européenne,
et qui évoque à l'esprit tout un monde
poétique et merveilleux ! Pourtant, depuis quelques
années, le voile qui cachait ces retraites
mystérieuses a été bien souvent
soulevé, et les récits d'une
célèbre voyageuse nous les ont fait voir sous
des couleurs propres à dissiper une partie de nos
illusions. Malgré cela, un harem, et surtout un harem
de souverain, éveille singulièrement la
curiosité ; et la nôtre, je l'avoue,
était vive.
Assis ou couchés sur les degrés de marbre, des
esclaves noirs encombraient le seuil du palais. On souleva
devant nous de massives portières qui
retombèrent lourdement comme les portes d'une prison,
et nous entrâmes dans une vaste pièce toute
revêtue de marbre blanc ; c'était le vestibule
de la salle de réception : là erraient des
femmes de toutes couleurs, aux costumes variés, et
dont aucun voile ne dérobait les traits. Enfin une
dernière porte s'ouvrit, et on nous introduisit dans
ce que j'appellerai la salle du trône.
C'était un vaste appartement, très haut
d'étage, et assez semblable pour les proportions aux
grands salons d'apparat de nos châteaux royaux. Une
sorte de trône était placé à
l'extrémité. Cette salle formait un
carré long, dont un des grands côtés
était occupé par d'immenses portes
vitrées donnant sur les jardins.
Quant à l'ameublement, il se ressentait de l'invasion
que l'Occident tend à faire depuis quelque temps en
Orient ; invasion qui malheureusement s'attaque plus à
la forme qu'au fond des choses, et qui détruit le
pittoresque sans améliorer les moeurs. Les meubles,
les draperies, les tentures étaient en riches soieries
venues en droite ligne, non de Brousse ou de la Perse, mais
des fabriques de Lyon. De magnifiques tapis d'Aubusson
recouvraient le plancher ; et au-devant d'un divan qui
régnait tout autour de la salle, des chaises et des
fauteuils étaient disposés pour les visiteurs
européens. Seulement le panneau faisant face au
trône était couvert de gazes
légères, aux vives couleurs, pailletées
d'or, et qui, disposées en draperies flottantes,
avaient un caractère oriental que j'aurais voulu voir
à tout le reste de l'ameublement. La femme du vice-roi
était absente lorsque nous entrâmes. Ce fut sa
belle-soeur, la princesse Zorah, qui nous reçut. Mlle
de Rosetti nous avait mises au courant de l'étiquette.
Nous nous avançâmes en faisant le salut arabe,
qui consiste à porter la main aux lèvres, puis
au front. La princesse s'était levée à
notre approche, et elle vint gracieusement vers nous. Il est
d'usage de lui prendre la main comme pour la baiser ; mais
elle la retire aussitôt. Mlle de Rosetti et sa tante,
qui parlaient arabe, nous servirent d'interprètes. La
princesse s'informa de notre nation, du but de notre voyage ;
puis elle nous fit asseoir, et alla reprendre elle-même
la place qu'elle occupait sur le divan. Nous pûmes
alors l'examiner à notre aise.
Plus petite que grande, plutôt jolie que belle, elle
semble avoir de trente-cinq à quarante ans. Son visage
est rond, ses traits fins et assez réguliers ; son
teint doré manque de transparence. Elle a les cheveux
et les yeux très noirs. L'expression de ses yeux est
spirituelle, mais un peu dure : scrutateurs et
perçants, parfois un peu obliques, ils donnent je ne
sais quoi de sauvage à cette physionomie, qui pourtant
attire le regardât le retient involontairement.
On sentait que le sang de Méhémet-Ali coulait
dans les veines de cette petite personne, dont le cerveau
devait être occupé d'autre chose que des
frivolités du harem. C'était la fille
préférée du vieux pacha ; il l'avait
associée à tous les secrets de sa politique, et
prenait, dit-on, en tout ses conseils. Depuis 1833, elle est
veuve du defterdar Mohammed-Bey, qui a laissé dans ce
pays les souvenirs de la plus effroyable cruauté. Ce
Mohammed était un aventurier albanais que la Porte
avait envoyé en Egypte pour surveiller
Méhémet-Ali, et même, dit-on, pour s'en
défaire au besoin, suivant l'usage turc. Mais le
rusé pacha devina la mission de cet ambassa deur
suspect, et, pour le corrompre, ne trouva rien de mieux que
de se l'attacher en faisant de lui son gendre. Quelque temps
après, il l'envoya dans la haute Nubie pour venger la
mort de son fils Ismaïl, qui, au retour d'une
expédition dans le Soudan, avait été
traîtreusement assassiné à Chendi par
l'ancien cheik de la ville. Le defterdar s'acquitta de cette
mission avec une barbarie sans nom, torturant lui-môme
et faisant torturer devant lui les malheureux, innocents pour
la plupart, qui tombèrent entre ses mains. Chendi fut
dépeuplé, et ne s'est pas relevé depuis
de ces épouvantables exécutions. On nous a
raconté, au Caire, des traits de cruauté de ce
misérable qui dépassent toute créance.
Le maréchal qui ferrait son cheval favori ayant
blessé l'animal, le defterdar le fit ferrer
lui-même pour lui apprendre son métier. Un jour,
une femme se plaignit à lui d'un soldat qui avait bu
son lait et refusait de la payer : il ordonna qu'on
ouvrît le ventre de l'accusé pour s'assurer du
fait, lequel, par bonheur pour la femme, se trouva
vrai.
Quant à la veuve de ce tigre, elle passe pour une
femme d'une rare intelligence, et on lui attribue une grande
influence sur son frère, le pacha actuel. Des bruits
assez sinistres ont aussi couru sur son compte : on a
parlé de certaines histoires qui rappellent Marguerite
de Bourgogne et les légendes de la tour de Nesle. Mais
rien ne nous atteste la vérité de ces faits :
l'affreuse réputation de son mari a bien pu rejaillir
sur elle, et nos compagnes ne nous ont dit d'elle que du
bien.
Revêtue du costume oriental, la princesse portait une
tunique et des pantalons bouffants en moire noire et bleue,
brodée d'or. Une pointe de dentelle noire et or,
retenue par des épingles de diamants, formait sa
coiffure. Mais ce costume était porté avec la
négligence que montrent en cette matière
certaines femmes supérieures, dédaigneuses des
petites coquetteries de leur sexe.
Des femmes de pachas l'entouraient et lui formaient une
petite cour. Aucune de ces femmes, n'était très
jeune, mais elles étaient toutes ornées de cet
embonpoint qui, aux yeux des Orientaux, constitue la parfaite
beauté. Quelques-unes avaient dû être, et
même étaient encore fort belles, mais
plutôt par la régularité des traits que
par l'expression, qui était douce et insignifiante. Un
singulier mélange de richesse et de mauvais goût
régnait dans leurs toilettes, qui manquaient en
général de fraîcheur, pour ne rien dire
de plus.
De nombreuses esclaves allaient et venaient, attentives au
moindre signe de leur maîtresse. Elles portaient toutes
aussi le large pantalon et la tunique ouverte sur la
poitrine, qui n'est couverte que d'une chemise de gaze. Ni un
grand goût, ni une habile ordonnance ne se montraient
dans leurs ajustements. Les unes étaient vêtues
de gaze rose ; d'autres, de lourdes étoffes de soie un
peu fanées ; quelques-unes, d'indienne-perse à
grands ramages ; mais tout cela formait un ensemble qui ne
manquait pas d'éclat. La plupart étaient
nu-tête, ou coiffées du bonnet grec posé
sur le côté. Parmi elles il y en avait de fort
jolies, mais ce n'était pas la majorité, et
nous cherchions vainement ces beautés incomparables
dont l'imagination peuple d'ordinaire les harems. Du reste,
on ne pourrait juger par ce harem de ceux qui appartiennent
aux autres princes de la famille régnante, et dans
lesquels il y a, dit-on, de rares beautés.
Saïd-Pacha passe pour être assez
indifférent à ce sujet. Nous étions
d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, dans la demeure de la
princesse Zorah, et sa belle-soeur n'y avait
vraisemblablement amené que les esclaves
consacrées à son service personnel.
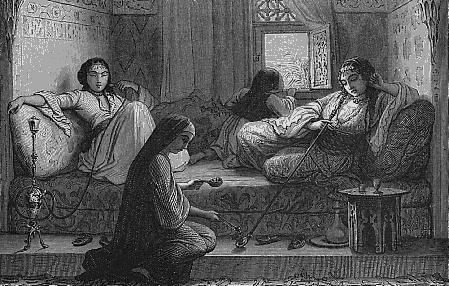 |
Sitôt que nous fûmes assises, des esclaves
nous apportèrent de longues pipes, dont on
posait le fourneau dans de petits plateaux d'argent pour les
isoler du tapis. Les bouts, d'ambre, étaient enrichis
de pierres précieuses et même de diamants : les
pipes sont un des plus grands luxes des pachas. J'avoue que
j'étais fort novice, et par conséquent
très gauche à me servir de la mienne : aussi
s'éteignait-elle à chaque instant ; et
aussitôt les esclaves de m'en apporter une nouvelle,
avec une constance qui ne se lassait pas et dans laquelle je
les soupçonnais de mettre quelque malice. Quant
à la prin-cesse et aux dames de sa cour, elles
fumaient avec toute l'aisance de l'habitude.
Sur ces entrefaites, la femme du vice-roi entra. Nous nous
levâmes aussitôt, et les mêmes salutations
que nous avions adressées à sa belle-soeur
recommencèrent. Elle nous adressa aussi à peu
près les mêmes questions, et je chargeai nos
interprètes de lui faire en arabe, cette langue
poétique par excellence, un compliment bien oriental
sur sa grâce et sa beauté, qui nous
frappèrent d'abord. Elle est, en effet, très
belle, mais d'une beauté qui consiste plutôt
dans l'élégance et la majesté de la
taille et dans le charme de l'expression que dans
l'extrême régularité des traits. Elle a
vingt-sept ans. Son visage long, un peu amaigri,
dénote une constitution délicate ; et une
petite toux assez fréquente indique que sa
santé ne résisterait pas à un climat
moins clément. A en juger par ses yeux bleus, par son
teint rose et un peu pâle, elle doit être
d'origine circassienne : c'est, en effet, une princesse de
Constantinople, et l'on sait que le harem du Grand Seigneur
se recrute parmi les blanches filles du Caucase. Sa bouche
charmante est presque toujours animée par un sourire
plein de bienveillance et de séduction. Ses sourcils,
fins et réguliers, étaient
légèrement peints en noir. Elle portait avec
aisance un magnifique costume : un goût parfait, une
entente toute française du choix et de l'harmonie des
couleurs avait présidé à cet
ajustement.
Ses pantalons étaient en superbe étoffe,
à larges raies, de moire antique brodée d'or,
et de satin violet. Une tunique semblable, ouverte sur le
devant, formait la queue par derrière comme un manteau
de cour. Par-dessus, une sorte de casaque ouverte, à
manches longues et étroites, en velours jaune,
bordée de fourrures, retombait un peu au-dessus des
genoux et était serrée à la taille par
une ceinture de cachemire. Une chemise d'homme à col
rabattu, et une petite cravate de satin noir
complétaient le costume. La coiffure était
charmante : elle se composait d'une espèce de fichu de
dentelle noire et or, dont une pointe, s'avançant sur
le front à la naissance des cheveux, était
fixée par une agrafe de diamants ; tandis que les deux
autres pointes se croisaient derrière la tête,
retenues aussi par des bouquets de diamants.
Après nous avoir fait asseoir, la princesse alla se
placer sur son trône ; mais, habitués à
la pose nonchalante des divans, ses petits pieds,
chaussés d'élégantes babouches, venaient
comme malgré eux se poser sur son siège. Des
esclaves apportèrent le café, sur un plateau
recouvert d'un tapis de velours rouge brodé d'or et de
perles fines. Le café était servi dans de
petites tasses de porcelaine posées, comme d'habitude,
sur ces supports de métal qu'on appelle zerfs
et qui ont la forme de coquetiers : ceux-ci étaient de
vrais bijoux en or ciselé, enrichis de pierreries, et
du travail le plus délicat. Les pierres
précieuses et les diamants sont répandus dans
ces harems princiers avec une profusion qui fait songer aux
trésors de la Lampe merveilleuse.
Après le café, on apporta des sièges
plus simples à l'extrémité du salon, et
les esclaves musiciennes de Son Altesse vinrent y prendre
place : la princesse nous faisait la galanterie d'un concert.
L'orchestre féminin se composait d'instruments tout
à fait primitifs : un tambour de basque, une longue
flûte, un violon datant certainement de l'enfance de
l'art, et une sorte de luth ou de mandoline comme on en voit
dans les peintures du moyen âge. On fit semblant
d'accorder les instruments, et la musique commença.
C'était un concert vocal et instrumental, et
quelques-unes des virtuoses s'accompagnaient en chantant.
Elles entonnèrent une mélodie nationale, sur un
rythme un peu traînant, mais qui ne manquait pas de
caractère. Plusieurs de ces voix étaient fort
belles, mais émises sans art et sans nuance aucune.
Les chanteuses semblaient articuler les paroles avec beaucoup
de netteté ; et l'une d'elles, qui faisait les solos,
accentuait une sorte de récitatif qui se terminait par
une roulade éclatante d'un effet très original.
Quant à l'harmonie des instruments, on pense bien
qu'elle était fort pauvre ; le compositeur ne
s'était pas mis non plus en grands frais d'imagination
; et comme nous ne comprenions pas le sens des paroles, ce
concert, plus curieux qu'agréable, ne tarda pas
à nous paraître un peu monotone.
La princesse s'était bientôt lassée de
poser sur son trône ; elle allait d'un siège
à l'autre, nous adressant la parole, lutinant les
grosses femmes de pachas, riant et causant avec elles, et
mettant sur notre compte, nous dirent nos compagnes, des
plaisanteries à leur adresse et dont nous
étions parfaitement innocentes. Elle faisait tout cela
avec une grâce enjouée, mais toujours digne, et
l'on subissait malgré soi le charme dont sa personne
est entourée. Plus instruite que les femmes turques en
général, il paraît qu'elle n'est pas
étrangère aux occupations et aux jouissances de
l'esprit. Elle recherche la société des dames
européennes. L'aménité de son
caractère lui a concilié les bonnes
grâces du pacha, dont elle est restée la seule
femme légitime, quoiqu'elle ait eu le malheur, immense
pour une femme turque, de ne pas lui donner d'enfants. C'est,
en effet, d'une esclave que Saïd-Pacha a eu un fils. La
princesse s'est montrée d'une bonté touchante
envers la mère de cet enfant ; et elle la traite comme
mérite de l'être, dit-elle, la femme à
qui le pacha a dû un bonheur qu'elle-même n'a pu
lui donner. Nous ne comprenons guère, dans nos moeurs
européennes, ce désintéressement ; et il
faut dire que bien des femmes d'Orient le comprennent et le
pratiquent encore moins.
Comme les princesses et les femmes de leur suite
n'entendaient pas le français, nous pouvions faire nos
réflexions en toute liberté. De leur
côté, les dames du harem parlaient le turc, que
nos compagnes ne comprenaient pas ; si bien que chacun
conversait à l'aise dans sa langue. Accroupie sur son
divan comme une petite chatte, la princesse Zorah, seule
assez silencieuse, fumait sournoisement sa pipe, et
était loin d'avoir l'aimable entrain de sa
belle-soeur.
De temps en temps, on apportait le café et l'on
renouvelait les pipes. Après un assez long entr'acte,
les musiciennes reprirent leurs instruments ; mais cette
fois, voix et orchestre ne servirent plus que
d'accompagnement à un nouveau spectacle. Quatre
danseuses entrèrent dans la salle. Leurs
vêtements, de même forme que ceux des autres
esclaves, étaient en fraîches et brillantes
étoffes de soie, de couleurs claires. L'une d'elles,
la Taglioni du harem, portait à sa ceinture une
énorme agrafe de diamants, que le pacha lui avait
donnée dans un moment d'enthousiasme, et qui eût
fait envie à une princesse d'Europe.
Nous avions beaucoup entendu parler de la danse des
almées. Celle-ci, quoique plus décente, me
dit-on, en était une sorte de diminutif et pouvait
nous en donner une idée.
Voluptueuse plutôt que légère, elle
consistait surtout en des mouvement du corps qui, souple
comme un serpent, se pliait en tous sens, et se renversait en
arrière, non parfois sans une certaine
grâce.
Les danseuses s'accompagnaient avec des castagnettes. L'une
d'elles était remarquablement jolie ; toutes
étaient agréables et gracieuses. Ce spectacle
nous captiva d'abord assez vivement ; mais, comme le concert,
il dura trop longtemps, et manquait d'ailleurs de
variété. Bientôt, mon regard cessant de
se fixer sur les danseuses et errant sur les objets qui
m'environnaient, tous mes souvenirs des Mille et une Nuits me
revinrent en mémoire. Il ne fallait pas un grand
effort d'imagination pour placer toute cette scène
dans le domaine du rêve et me croire transportée
dans un de ces palais enchantés où quelque
puissante sultane m'aurait conviée à une
fête merveilleuse. Gracieusement étendue sur son
divan, tenant avec nonchalance dans ses doigts mignons
l'ambre, enrichi de diamants, de sa longue pipe, la
princesse, sous son magnifique costume, était une
sultane idéale, qui brillait comme une perle fine au
milieu de sa cour. Ces danses, cette musique, ces chants, ces
nombreuses esclaves groupées çà et
là complétaient admirablement le tableau, et il
me semblait parcourir réellement ce monde
féerique où je n'avais jusqu'alors
voyagé que par la pensée.
Mais le songe s'évanouit bientôt, brusquement
dissipé par la réalité qui nous apparut
sous les traits d'une gouvernante anglaise, conduisant le
jeune fils du pacha. Une gouvernante anglaise en plein harem
!... On ne pouvait imaginer de contraste plus bizarre et plus
frappant que cette grande fille d'Albion emprisonnée
dans ses roides ajustements, et ces danseuses au teint
animé, aux tuniques flottantes, et dans le
demi-désordre d'une danse qui venait de finir.
La princesse nous présenta le fils du vice-roi :
c'était un assez gentil enfant de quatre à cinq
ans. Il avait le teint mat et les yeux noirs des Egyptiens.
On l'avait affublé, par-dessus un vêtement
européen, d'une sorte de houppelande taillée
dans un magnifique cachemire de l'Inde. Il se montra bon
prince, et se laissa embrasser comme un simple mortel.
Il y avait déjà plusieurs heures que nous
étions dans le harem ; et quoique Mlle de Rosetti nous
eût prévenues qu'à la cour d'Egypte la
politesse d'une visite se mesure à sa longueur, la
nôtre cependant dut avoir un terme ; et nous
crûmes avoir satisfait aux lois de l'étiquette
aussi bien qu'à notre curiosité.
Nous prîmes donc congé des princesses, en leur
faisant traduire toutes sortes de compliments dans le
goût arabe. Elles furent très gracieuses et nous
invitèrent à revenir les voir. La princesse
Zorah elle-même s'humanisa tout à fait, et nous
adressa les souhaits les plus aimables, espérant que
le climat d'Egypte rendrait la santé à nos
malades, etc. etc.
Dans l'antichambre de marbre, des esclaves nous offrirent des
sirops d'orange dans des vases d'argent, et nous
présentèrent de légers tissus
brodés d'or pour nous essuyer les lèvres. Puis
les lourdes portières se relevèrent devant
nous, pour retomber sur les prisonnières ; les gardes
se rangèrent sous nos pas, et nous eûmes
bientôt regagné notre voiture.
La nouveauté du spectacle que nous avions eu sous les
yeux pendant toute cette longue visite, nous avait à
peine laissé le temps de ressentir l'impression
pénible que cause ordinairement aux femmes de
l'Occident la vue de ces tristes retraites, où leurs
semblables, rabaissées à l'état de
choses, sont si loin de la place qu'occupent les femmes dans
nos sociétés chrétiennes. On jugerait
mal d'ailleurs, d'après un harem princier, des harems
des particuliers ; de même que chez nous les moeurs et
les habitudes de la cour donneraient une fausse idée
de la manière de vivre des simples citoyens. Mises par
leur titre et leur rang en contact continuel avec les
Européens, mêlées même quelquefois
(ce qui est rare cependant) aux affaires du gouvernement, les
princesses ont des occasions fréquentes et des moyens
tout naturels d'occuper et de développer leur esprit.
Tandis que chez nous la vie des cours n'est guère
qu'un brillant esclavage, pour les princesses
mahométanes elle est, au contraire, une sorte de
liberté relative. C'est sur leurs pauvres esclaves que
pèse le plus lourdement cette captivité
dorée ; les princesses sortent souvent en voiture et
échangent des visites ; les esclaves ne mettent jamais
le pied hors du harem. Mlle de Rosetti et Mme B*** me disent
que souvent ces femmes leur jettent un regard d'envie
lorsqu'elles les voient sortir du palais, et s'écrient
avec un accent indéfinissable : «Que vous
êtes heureuses !»
Les femmes des particuliers se visitent aussi entre elles :
elles sortent assez fréquemment, soit pour aller au
cimetière, soit pour aller au bain, qui est pour elles
un lieu de réunion. Mais si ce sont là des
distractions, ce ne sont ni des occupations ni des relations
capables d'élever un peu leur être moral ; et
leur vie n'est guère remplie d'autre chose que des
jalousies, des commérages, des petites passions du
harem. Sauf de rares exceptions, elles sont peu instruites :
la plupart ne savent ni lire ni écrire, et ne semblent
pas même avoir le désir de l'apprendre. Leur
principale occupation consiste en des broderies, qu'elles
exécutent en or ou en argent sur
d'élégants tissus, et dans lesquelles elles
excellent. Les femmes de la classe inférieure filent
ou tissent. Ce n'est pas que les filles ne soient admises,
comme les garçons, aux écoles publiques ; mais
rarement les parents prennent soin de leur faire donner une
instruction, même sommaire : et cette instruction,
quand elles la reçoivent, se borne à lire et
à apprendre quelques versets du koran. La musique et
la danse sont laissées aux esclaves. Ce qu'on enseigne
de préférence aux femmes des classes
élevées, ce sont des poses recherchées
et des manèges de coquetterie, destinés
à captiver le maître : c'est même un art
qui a ses professeurs.
Quant à la beauté des femmes égyptiennes
proprement dites, je n'ai guère pu en juger dans le
harem du vice-roi, les esclaves qui s'y trouvaient
appartenant la plupart à des nations
étrangères. C'est parmi les Coptes que s'est
conservé le plus purement le type de la race
indigène ; mais au Caire toutes les femmes (sauf bien
entendu les Européennes), même juives et
arméniennes, même coptes catholiques, sont
hermétiquement voilées. Sans cela, elles
courraient risque d'être insultées dans la rue.
Par-dessus leur costume, elles s'affublent d'une sorte de
mante de soie, fort ample, appelée habarah, qui
se pose sur la tête comme un capuchon, et retombe par
derrière jusqu'aux pieds ; par devant, un voile blanc
et épais, qui ne laisse que les yeux à
découvert, descend également presque
jusqu'à terre, ne permettant d'apercevoir que le bas
des pantalons. Les femmes mariées portent la mante en
soie noire, et les jeunes filles en calicot blanc ou en soie
blanche. On comprend que sous cet accoutrement la plus jolie
femme ne peut ressembler à autre chose qu'à un
informe paquet. Mais, à l'église, les femmes
coptes ôtent leur voile ; et devant l'autel où
l'on officie suivant leur rite particulier, j'ai vu souvent,
sous les sombres plis du habarah, se dessiner l'ovale
délicat de pâles et charmantes figures,
qu'éclairaient de magnifiques yeux noirs. Ce type m'a
paru très fin ; le teint est d'une blancheur mate, les
traits sont purs et réguliers.
Avec les femmes du harem, celles-là sont les seules
que j'aie vues en Orient. Je dois cependant mentionner les
femmes fellahs des bords du Nil, qui ne cachent pas aussi
sévèrement leur visage. Naturellement la
beauté de ces dernières est d'un
caractère tout autre que celle des femmes coptes : il
y a la même différence qu'entre nos dames du
grand monde et nos robustes paysannes. Je ne sais toutefois
si l'Egyptienne des bords du Nil, avec sa peau dorée,
sa flère tournure et sa beauté un peu sauvage,
ne serait pas préférée des artistes, et
surtout de ceux qui sont amoureux de la couleur».
Aux détails qui précèdent, il ne sera
peut-être pas hors de propos d'ajouter quelques
renseignements sur les moeurs et particulièrement sur
la condition des femmes en Egypte. Cette question de la
condition des femmes est toujours la question fondamentale
d'une société : elle donne la mesure de son
degré de civilisation morale. Et il faut bien dire
qu'apprécié à cette mesure, l'Orient ne
peut être que sévèrement
jugé.
Le koran sans doute a introduit chez les Arabes
d'incontestables réformes ; il a fait cesser parmi eux
bien des pratiques barbares et criminelles ; il n'a pas
créé la polygamie et le divorce, qui existaient
depuis des siècles ; tout au contraire, il les a
restreints et réglementés. Mais, bien que
réglementées, ces deux institutions sont encore
les deux plaies de l'Orient, car elles y ont détruit
la famille.
Le célibat est considéré comme une honte
: un homme qui tarde à se marier souffre dans sa
réputation. Et pourtant, il s'en faut que le mariage
soit entouré en Orient de cette idée de respect
que nous y attachons. Il ressemble plulôt à un
achat et à une vente qu'à un contrat religieux.
On se marie sans se connaître, sans s'être vu de
part ni d'autre. Le père du jeune homme va trouver le
père de la jeune fille, on convient de la dot
qu'apportera l'épouse, et du douaire que le mari lui
assure en cas de répudiation ; puis on se rend devant
le cadi ou devant un scribe quelconque, avec quelques
témoins. Huit jours après, les époux
sont réunis.
Pas plus de formalités pour le divorce que pour le
mariage. Le consentement mutuel suffit ; et l'on comprend
assez que le consentement de la femme ne peut guère
manquer devant les mauvais traitements. Le mari acquitte le
douaire, et l'on se sépare comme on s'était
réuni.
Il y a même des cas particuliers, prévus,
dit-on, par la loi, et qui dispensent du consentement mutuel.
Si la femme est atteinte de certains défauts ou de
certaines infirmités, si par exemple elle a le malheur
de ronfler en dormant, c'est un cas absolu de
répudiation, et, comme on dit chez nous en
matière de vente, un vice rédhibitoire.
Il résulte de tout cela que les divorces se
multiplient avec une facilité déplorable. Les
riches en font un usage moins fréquent ; d'abord pour
n'avoir pas à payer un douaire souvent
considérable ; ensuite parce qu'il leur est permis
d'avoir jusqu'à quatre femmes, sans préjudice
du harem, qui peut recevoir un nombre illimité
d'esclaves. Mais les pauvres, ne pouvant entretenir
d'esclaves, changent de femme aussi souvent qu'il leur en
prend fantaisie. Il est rare de trouver au Caire un homme qui
n'ait pas divorcé au moins une fois ; et l'on en voit,
assûre-t-on, qui ont contracté jusqu'à
trente ou quarante mariages. Quelques hommes changent de
femme presque tous les mois. On peut, dit M. Lane1, trouver
dans les rues du Caire une jeune veuve ou une femme
divorcée de la classe inférieure, qui consent
à se marier avec l'homme qui la rencontre moyennant un
douaire équivalent à douze francs cinquante
centimes ; quand il la renvoie, il n'est obligé
à lui payer que le double de cette somme, pour
subvenir à son entretien pendant les trois mois de
veuvage que la loi lui impose après la
répudiation. Il est juste de dire toutefois que si de
telles choses sont permises par la loi, elles sont
réprouvées par l'opinion des personnes
honnêtes. Un homme peut divorcer deux fois avec la
même femme, et la reprendre deux fois sans la moindre
formalité. Mais s'il la répudie une
troisième fois, elle ne peut être
légalement reprise par lui que si, dans l'intervalle,
elle a contracté un autre mariage rompu lui-même
par le divorce.
En général, les femmes sont traitées
avec douceur par leurs maris et maîtres, au moins dans
les classes aisées. Malheureusement il n'en est pas
toujours ainsi dans les classes inférieures : les
Coptes surtout passent pour exercer souvent de mauvais
traitements envers leurs femmes et leurs esclaves.
A part la réclusion absolue qui leur est
imposée, la condition des esclaves est sous plusieurs
rapports préférable à celle des femmes
légitimes. Leur plus grand avantage, c'est qu'elles
n'ont point à craindre ce divorce toujours suspendu
sur la tête de l'épouse, et qui est la terreur
continuelle de sa vie. Frappée de répudiation,
une femme entourée de luxe et habituée au
bien-être d'un riche harem, se voit du jour au
lendemain plongée dans l'abandon et presque le
dénûment. Il est très rare, au contraire,
que le maître vende ses esclaves : il faut des
circonstances tout exceptionnelles pour qu'il puisse le faire
sans encourir le blâme public. Quelquefois elles sont
épousées par leur maître, surtout
lorsqu'elles lui ont donné un enfant ; ou bien il leur
fait faire ailleurs un bon mariage. On sait du reste combien
est généralement doux l'esclavage en Orient ;
c'est une sorte de domesticité qui fuit entrer
l'esclave dans la famille et l'y établit presque sur
le pied de l'égalité.
Les femmes non légitimes étaient autrefois
toutes esclaves : la loi défendait seulement qu'elles
fussent prises parmi les idolâtres. C'étaient,
en général, sauf quelques femmes blanches, des
Abyssiniennes, à la peau fortement bronzée, et
renommées pour leur beauté. Il n'y a plus au
Caire, depuis une quinzaine d'années, de marché
public d'esclaves : l'esclavage même a
été aboli par le pacha actuel. Mais, par le
fait, il n'y en a pas moins en Egypte beaucoup d'esclaves
sous le nom de serviteurs. On peut même affirmer que
ces esclaves considéreraient leur libération
comme le dernier des châtiments, car elle les
réduirait à la plus extrême
misère.