Chapitre 2 - Alexandrie, la colonne de
Pompée,
les aiguilles de Cléopâtre, le canal
Mahmoudieh
Une plage nue et désolée, qui
s'élève à peine au-dessus du niveau de
la mer, s'étend à l'ouest d'Alexandrie : c'est
le désert Libyque, qui pousse jusqu'aux portes de la
ville sa morne stérilité. Sur les dunes
ondulées on voit s'aligner une file de moulins
à vent, rangés en bataille au bord de la mer ;
plus à gauche, au-dessus de grandes constructions
basses et uniformes, se dresse, comme une ligne noire dans le
ciel, la colonne de Pompée, qui sert de point de
reconnaissance aux navigateurs ; enfin la ville, avec les
mâts des vaisseaux qui remplissent son port, avec ses
minarets, ses forts, ses arsenaux, et le palais du vice-roi
sur la presqu'île de l'Est, semble sortir des flots,
basse, plate et grise comme la côte aride où
elle s'étend.
Nous arrivons dans ce pays du soleil sous une triste
impression. Le ciel est chargé de gros nuages, que
charrie un vent d'ouest violent ; la pluie tombe par averses.
On nous dit qu'en cette saison, et particulièrement
cette année, il pleut souvent à
Alexandrie. C'est jouer de malheur. Espérons
qu'au Caire nous trouverons le soleil.
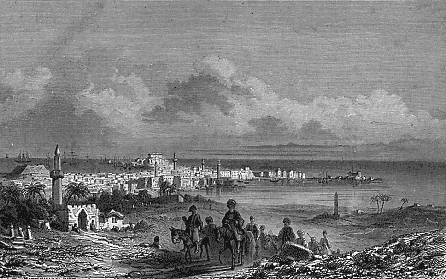 |
Le port est rempli de bâtiments de commerce,
à voile et à vapeur, anglais la plupart. A
l'entrée, une frégate anglaise est à
l'ancre. Dans le port militaire qui est à gauche,
devant le palais du pacha, plusieurs grands bâtiments
de guerre appartenant à la marine égyptienne
sont en réparation. Ce sont quelques-uns des vaisseaux
de cent et de cent vingt canons que des ingénieurs
français ont construits pour Méhémet-Ali
: déjà à demi-ruinées, ces
énormes machines de guerre pourrissent aujourd'hui sur
les cales où on fait semblant de les réparer ;
symboles éloquents de la décadence de cette
monarchie, qu'a élevée le génie d'un
homme et qui ne paraît pas destinée à lui
survivre longtemps.
A peine avons-nous jeté l'ancre, que le pont est
envahi par une nuée d'Arabes, criant, gesticulant,
s'offrant aux voyageurs, se disputant leurs personnes et
leurs bagages. Ce n'est pas chose aisée de se tirer
d'affaire au milieu de cette cohue et de ces
vociférations, vraie Babel où se mêlent
toutes les langues de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. On
parle de la turbulence des facchini de Naples et de
Livourne : ils sont calmes et discrets auprès des
bateliers et portefaix arabes. Enfin nous parvenons à
nous faire déposer, nous et nos malles, dans une
barque que deux vigoureux rameurs ont bientôt
poussée au quai.
Là nous attend la douane. Au-devant d'une sorte de
magasin ou de hangar, sur le bord de la rue encombrée
de ballots, de charrettes, d'ânes, de chameaux, de
chiens et de mendiants, on dépose nos bagages ; la
pluie tombe : nous piétinons dans une boue liquide et
blanchâtre. Les cris, l'agitation, la confusion
redoublent. Il faut se faire à cela en Orient :
beaucoup de bruit pour peu de besogne ; c'est ce que nous
rencontrerons partout. Soyons justes cependant pour les
douaniers de Son Altesse : ils entendent raison. Nous
fîmes mine d'ouvrir nos malles, et moyennant quelques
piastres on nous laissa passer. Qui donc disait les Turcs
étrangers à toute civilisation ?
On entre dans la ville par de grandes et larges rues. Ce
quartier est neuf. Sauf quelques petites boutiques turques,
les maisons ont presque l'apparence européenne. Une
boue horrible forme çà et là des mares
profondes, où pataugent les bêtes de somme et
leurs conducteurs à demi nus. Les rues d'Alexandrie ne
sont pas pavées, et leur sol crayeux se
détrempe aisément. Tout dans ce pays est fait
au point de vue du soleil ; la pluie n'entre jamais dans les
calculs de personne : tant pis s'il pleut !
Notre hôtel est situé sur la place des consuls.
Cette place est un vaste carré long, d'un aspect assez
maussade. Pas un arbre n'en égaie la froide
régularité : au milieu, on a planté une
façon d'obélisque tout neuf, haut de quelques
mètres, et qui, dans ce pays des obélisques
géants, a l'air tout honteux de la triste figure qu'il
fait là. L'été, cette place doit
être un désert torride : en ce temps-ci, c'est
un marais, bordé de quelques trottoirs et
traversé par quelques sentiers.
Tout alentour sont de grands bâtiments, couverts en
terrasses, d'une assez laide architecture, avec force
ornements de mauvais goût, et peints en rose ou en
jaune, à la mode italienne. Tout cela date de
Méhémet-Ali. Des magasins européens
occupent presque partout les rez-de-chaussée. Nous
sommes dans le quartier franc, et là domine tout
à fait l'habit européen.
La population d'Alexandrie est, au surplus, européenne
pour un tiers au moins. Quoiqu'elle appartienne
géographiquement à l'Egypte, Alexandrie est une
ville qui n'est, à vrai dire, ni égyptienne, ni
turque, ni arabe: c'est une ville franque,
c'est-à-dire quelque chose comme un grand
caravansérail où se rencontrent les marchands
de toutes les nations. On y parle toutes les langues, on y
voit tous les costumes, on y trouve toutes les races de
l'Orient et de l'Occident : Persans, Indiens,
Arméniens, Grecs et Juifs, Nubiens et Bédouins
du désert, marchands de Tunis et d'Alger, d'Alep et de
Damas, du Soudan et du Darfour, c'est un assemblage de tous
les types et de toutes les couleurs de la ûgure
humaine. Et c'est cette variété même, ce
mélange, ce pêle-mêle qui forme
véritablement le caractère d'Alexandrie, si
c'est un caractère de n'en avoir point.
A peine installé à mon hôtel, impatient
de sortir enfin de l'Europe, où il me semble que je
suis toujours quand je regarde de ma fenêtre cette
grande place des Consuls et ses maisons alignées comme
des casernes, je vais courir la ville : j'ai hâte de
découvrir dans ses quartiers retirés quelque
chose de cette physionomie orientale que je cherche et n'ai
pas encore rencontrée. A la porte de l'hôtel je
suis assailli par une bande d'âniers qui m'offrent
leurs services. Il y a des fiacres et des voitures de toute
sorte à Alexandrie, et qui stationnent sur la place
même : nouvelle ressemblance avec nos villes
d'Occident. Mais les ânes sont la monture la plus
habituelle et la plus commode pour parcourir les rues de la
ville. Européens et Egyptiens, riches et pauvres, tout
le monde s'en sert. Pour nous, Français, qui avons
pour ce modeste animal un dédain très
aristocratique et très injuste, une promenade à
âne a toujours quelque chose de ridicule. Un voyage
d'Egypte corrige bien vite de ces sottes préventions.
Je déclare, quant à moi, que j'en suis revenu
plein d'estime pour les ânes d'Orient. Il est vrai que
je les crois d'une race supérieure à celle de
notre pays.
Ce premier jour, toutefois, il faut que je le confesse, soit
préjugé, soit besoin d'user un peu de mes
jambes après une traversée d'une semaine, j'ai
préféré m'enfoncer à pied dans
les rues d'Alexandrie. Elles sont presque toutes modernes. Le
quartier arabe a cependant sa physionomie à part. De
petites boutiques à la mode turque,
élevées de deux pieds environ au-dessus du sol,
bordent les rues ; le marchand est assis sur le bord, les
jambes croisées : dans ces boutiques et au-devant sont
des monceaux de fruits et de légumes,
pastèques, dates, bananes, grenades. Dans la rue une
population d'aspect assez misérable : les hommes
à demi vêtus d'une sorte de blouse en cotonnade,
les femmes enveloppées de la tête aux pieds dans
une longue robe bleue, la plupart voilées et ne
laissant apercevoir que les yeux ; les enfants
complètement nus et courant dans la boue parmi les
chiens et les ânes ; au milieu de tout cela, de grands
chameaux s'avançant d'un pas grave et promenant sur la
foule leur regard doux et mélancolique. J'avais
déjà là un coin de l'Orient, une
échappée sur un monde tout nouveau.
Notre première visite, le lendemain, fut pour la
colonne de Pompée. On sort de la ville par de grandes
rues presque désertes ; de chaque côté
sont de vastes jardins plantés de palmiers ; au-dessus
des murs flottent les larges feuilles des bananiers, et des
nopals gigantesques dressent leurs tiges bizarres et
contournées. Quand on a franchi les fortifications par
la porte du sud, à un quart de lieue environ de la
ville, au bord d'une longue avenue d'acacias, on voit
s'élever sur un monticule ce singulier monument. C'est
un monolithe de granit rose, aujourd'hui bruni par le temps,
ou plutôt par les brumes de la mer et les pluies d'un
climat humide.
La colonne a trente-deux mètres de hauteur, y compris
le chapiteau, et trois de diamètre. Elle repose sur un
piédestal à demi sapé et qui menace
ruine. On croit qu'elle était autrefois
surmontée d'une statue colossale. Des Anglais, dit-on,
se sont fait hisser sur la plate-forme du large chapiteau,
à l'aide de cordes qu'un cerf-volant y avait
accrochées, et ils ont eu la gloire d'y
déjeuner.
On sait que c'est très improprement que la tradition a
donné le nom de Pompée à ce monument,
où Pompée n'est pour rien. Bien qu'il soit grec
par le style, il remonte jusqu'aux Pharaons, dont
quelques-uns employèrent des artistes grecs. Une
inscription lue sur le piédestal apprend que cette
colonne, distraite de sa première destination qu'on
ignore, fut érigée à cette place, en
l'honneur de l'empereur Dioclétien, par Pomponius ou
Pompéianus, gouverneur de l'Egypte.
 |
C'est près de là, devant cette porte, que
Kléber, marchant à l'assaut de la ville,
le 2 juillet 1798, fut frappé au front d'une balle qui
le renversa. Au pied de la colonne furent ensevelis ceux de
nos soldats qui avaient succombé dans l'attaque.
La place où s'élève maintenant la
colonne de Pompée était autrefois comprise dans
l'enceinte d'Alexandrie. L'éminence qui la porte
était vraisemblablement l'acropole. On croit que le
fameux temple de Sérapis était situé non
loin de là ; tout alentour se développait la
vieille Alexandrie. Un déplacement insensible et
très singulier a, dans le cours des siècles,
porté la ville nouvelle à une assez grande
distance au nord-est : celle-ci est bâtie, en effet,
sur la chaussée qui unissait jadis le continent
à l'île de Pharos, chaussée peu à
peu élargie par l'accumulation des ruines et les
atterrissements de la mer. Aujourd'hui, à la place que
couvrait la vieille ville, il n'y a que des monceaux de
débris et de sables arides ; près de là
est un cimetière arabe, triste et nu, avec ses tombes
blanches, couronnées de petites colonnes
tronquées.
Pour aller de la colonne de Pompée aux Aiguilles de
Cléopâtre, on suit les bords du canal
Mahmoudieh. C'est une charmante promenade, où, dans la
belle saison, les habitants d'Alexandrie viennent, le soir,
goûter le frais, soit à cheval, soit en voiture.
Elle est bordée de maisons, de villas, quelques-unes
riches et élégantes, plusieurs d'un goût
douteux, toutes d'un aspect gai et pittoresque, et
entourées de beaux jardins. Au moment où nous
parcourions cette promenade, le sol en était
délayé parles pluies ; mais les jardins
étaient brillants de verdure, les rosiers couverts de
fleurs, et les murs disparaissaient sous la parure odorante
des géraniums et des clématites.
Les deux obélisques qui portent le nom d'Aiguilles de
Cléopâtre sont à l'est de la ville, au
bord de la mer. L'un d'eux est couché à terre
en trois morceaux. L'autre est debout, à peu
près intact ; seulement sa base est enfouie dans le
sable. On croit qu'ils étaient autrefois à
Héliopolis, d'où Cléopâtre les fit
transporter à Alexandrie pour décorer
l'entrée du Caesaréum, ou temple de
César.
L'obélisque qui est debout appartient à
l'Angleterre, à qui Méhémet-Ali en a
fait cadeau. Mais les hiéroglyphes en sont si
détériorés, que les Anglais ne l'ont pas
jugé digne d'être emporté. Comme la
colonne, il se noircit et se dégrade à l'air
humide et salin de la mer.
On ne saurait, si peu érudit qu'on soit, parcourir
Alexandrie sans que les prodigieuses vicissitudes de son
histoire se représentent presque involontairement
à l'esprit. Il est peu de villes dans le monde qui
aient éprouvé de plus étranges retours
de fortune, et d'une plus haute prospérité
soient tombées à un plus extrême
degré d'abaissement. Elle a été
mêlée aux plus grands événements,
aux plus éclatantes révolutions politiques et
religieuses des temps anciens et modernes. Un mot suffit
à en donner idée : les trois hommes qui ont
imprimé sur la face du monde la trace la plus
profonde, Alexandre, César et Napoléon, ont
écrit leurs noms dans ses annales.
Le conquérant macédonien la fonda pour
remplacer Tyr, la reine des mers, qu'il venait de
détruire : comme les véritables grands hommes,
Alexandre avait la puissance qui crée non moins que la
puissance qui détruit. La situation de la ville
nouvelle était admirablement choisie. Placée
aux bouches du Nil, aux confins de l'Asie et de l'Afrique,
touchant à l'Europe par la Méditerranée,
à l'Inde par la mer Rouge, elle était le point
central du vieux monde, et naturellement appelée
à devenir le lien de ses relations commerciales, le
rendez-vous commun et le champ de bataille de toutes les
idées, de toutes les sciences et de toutes les
religions : merveilleuse divination du génie, qui
faisait dire à Napoléon que le vainqueur
d'Arbelles fut plus grand par cette seule création que
par toutes ses victoires.
Sous les Ptolémées, Alexandrie parvint à
un degré de richesse et de splendeur qui en faisait la
première ville du monde après Home. Un canal la
reliait par le lac Maréotis au Nil, et lui apportait
les eaux douces du fleuve. Sur l'île de Pharos, en face
d'elle, s'élevait cette tour de marbre,
surmontée d'un fanal, qui passait pour une des
merveilles du monde, et qui a légué son nom
à tous les autres phares. Ses palais, son
musée, vaste collège de savants ; sa
bibliothèque, où se voyaient réunis tous
les trésors de l'antiquité, couvraient un
espace immense, bien plus étendu que celui qu'occupe
la ville actuelle. Elle comptait cinq à six cent mille
habitants. Héritière du génie de la
Grèce, elle était alors la capitale
intellectuelle du monde : c'est là que
brillèrent Euclide, le grand géomètre ;
Théocrite, le poète de l'idylle ;
Manéthon, l'historien, et plus tard Aristarque,
Lucien, Athénée, Philon.
De la domination romaine date le commencement de sa
décadence. A plusieurs reprises, des insurrections
attirent sur elle la colère de ses maîtres.
César, assiégé dans le quartier royal,
allume en se défendant l'incendie qui dévore la
fameuse bibliothèque des Lagides ; Caracalla et
Dioclétien éteignent dans le sang son esprit
d'agitation et de révolte. Mais longtemps encore
Alexandrie tient une grande place dans l'histoire. La vieille
civilisation égyptienne, s'y rencontrant avec la
civilisation grecque, fait encore d'elle un des foyers les
plus actifs de l'esprit humain et le dernier boulevard du
paganisme. Les dieux de la Grèce et de Rome y ont des
autels à côté des dieux de Thèbes
et de Memphis. La philosophie y fleurit comme en son
arrière-saison ; et l'école d'Alexandrie, fille
dégénérée mais ingénieuse
de Platon, essaie, dans un puissant et stérile effort,
de fondre ensemble la science grecque et la tradition
orientale.
«Alexandrie, dit un écrivain
célèbre qui a peint en traits éloquents
cette époque de décadence et de
rénovation, Alexandrie, ville de commerce, de science
et de plaisirs, fréquentée par tous les
navigateurs de l'Europe et de l'Asie, avec ses monuments, sa
vaste bibliothèque, ses écoles, semblait
l'Athènes de l'Orient ; plus riche, plus
peuplée, plus féconde en vaines disputes que la
véritable Athènes, mais n'ayant pas cette
sagesse d'imagination et ce goût vrai dans les arts.
Alexandrie était plutôt la Babel de
l'érudition profane. Là se formait cette
philosophie orientale, suspendue entre une
métaphysique, tout idéale et une
théurgie délirante ; remontant par quelques
traditions antiques à la pureté du culte
primordial, à l'unité de l'essence divine ;
s'égarant par un nouveau polythéisme dans ces
régions peuplées de génies subalternes
que la magie mettait en commerce avec les mortels»
(Villemain, Tableau de l'éloquence
chrétienne au IVe siècle).
Mais déjà le christianisme a ouvert, en face du
musée, ses écoles où brillent
Clément d'Alexandrie et Origène. Saint
Athanase, saint Cyrille déploient leur
éloquence et leur dialectique contre les
hérésies qui se multiplient de toutes parts.
Des émeutes ensanglantent les rues : la belle et
savante Hypatie est mise en pièces par une populace
furieuse, et dans le pillage des temples païens
s'accomplit la destruction de la seconde
bibliothèque.
La conquête arabe porta sans doute à Alexandrie
un coup funeste. Mais déjà, on vient de le
voir, ses bibliothèques avaient été deux
fois détruites, quand Omar fit (selon une tradition
qui a été révoquée en doute)
jeter au feu la troisième, dont l'importance au moins
devait être réduite à peu de chose. Peu
d'années auparavant, les Perses l'avaient aussi prise
et ravagée.
Négligée pour le Caire, Alexandrie ne dut de
garder un reste de vie qu'à sa merveilleuse situation.
Mais bientôt, avec les Turcs, la barbarie l'envahit
définitivement ; et la découverte du cap de
Bonne-Espérance, en détournant d'elle le
courant du commerce, la frappa d'une complète
décadence. Depuis cette époque jusqu'à
nos jours, Alexandrie ne s'était pas relevée de
sa chute ; sous l'anarchie des mameluks, sa ruine et sa
dépopulation avaient même fait des
progrès tels, qu'à la fin du siècle
dernier elle ne comptait plus que six mille habitants.
C'est à Méhémet-Ali qu'elle a dû
sa résurrection. Le canal, creusé par les
Ptolémées pour la mettre en communication avec
le Nil, s'était peu à peu obstrué,
à ce point qu'à l'époque de
l'expédition française il n'était plus
navigable que pendant un mois de l'année ; les
produits de l'intérieur, pour arriver jusqu'à
Alexandrie, port principal de l'Egypte, n'avaient que la voie
coûteuse et lente des transports à dos de
chameau. Bonaparte conçut la pensée de
réparer le canal : il fit même faire à ce
sujet des études préparatoires et des devis.
Mais le temps lui manqua pour ce projet, que le pacha eut la
gloire d'exécuter.
Le canal a vingt lieues d'étendue. Moins de trois
années suffirent pour le creuser. Mais, si cette
restauration de l'oeuvre des Ptolémées a
été un bienfait pour le pays, ce bienfait a
été obtenu, il faut le dire, au prix d'une
dépense odieuse de la vie humaine. Plus de trois cent
mille fellahs furent employés aux travaux. C'est au
moyen de la presse (procédé ingénieux
emprunté par le pacha à la marine anglaise)
qu'on rassemblait ces malheureux, hommes, femmes, enfants et
vieillards. Amenés sous le bâton aux bords du
canal, on ne s'occupait d'eux que pour l'accomplissement de
la corvée. D'outils ou de machines, on ne leur en
fournissait presque d'aucune sorte : sauf quelques pioches
pour fouiller la terre, c'est avec les mains seules et de
mauvais paniers en feuilles de palmier que les Egyptiens
aujourd'hui encore, comme du temps d'Hérodote, font
les travaux de terrassement et de curage. Nulle
précaution n'avait été prise, nul
approvisionnement fait. Non seulement les vivres, mais l'eau
manqua souvent à ces multitudes attelées, comme
un vil bétail, à un labeur écrasant sous
un ciel de feu. La fatigue, les privations, les mauvais
traitements, joints aux influences ordinaires des grands
mouvements de terre, engendrèrent des maladies
épidémiques. Trente mille de ces malheureux,
quelques-uns disent davantage, restèrent ensevelis
sous le chemin de halage qui borde le canal.
Il est vrai que le pacha allouait aux ouvriers un minime
salaire. Seulement, au lieu de le donner en argent ou en
nature, on en fît déduction sur les
contributions qu'ils avaient à payer. Et comme un
arriéré énorme d'impôts pesait
toujours sur les villages, à raison de la
solidarité de tous les imposables, entre eux,
l'opération était tout bénéfice
pour le pacha et ne rapportait pas un para aux pauvres
travailleurs. Voilà comme se font en Orient, quand
elles se font, même les meilleures choses.
Quoi qu'il en soit, grâce à cette oeuvre
vraiment grande, Alexandrie, déjà
relevée en partie par les Français, qui avaient
creusé son port, rétabli ses fortifications,
redressé ses rues, a vu renaître peu à
peu sa prospérité passée. Aujourd'hui sa
population approche de cent mille habitants. Son commerce,
qui a plus que doublé depuis quinze ans,
c'est-à-dire depuis l'abolition du monopole
organisé par Méhémet-Ali, prend tous les
jours plus d'extension et d'activité. Si, comme il y a
lieu de l'espérer, cette magnifique entreprise du
percement de l'isthme de Suez aboutit, Alexandrie sans doute
pourra perdre quelque chose du mouvement commercial qui se
fait aujourd'hui par son intermédiaire ; mais cet
événement sera loin d'avoir pour elle les
conséquences qu'eut, il y a trois siècles, la
découverte de la route du Cap. C'est cette
dernière route qui verra se détourner vers Suez
le courant des marchandises lourdes et encombrantes. Les
voyageurs et les marchandises légères viendront
toujours prendre à Alexandrie la voie plus rapide du
chemin de fer. Et enfin, grâce au canal, grâce
à son port, Alexandrie sera toujours la clef du Nil,
le marché et l'entrepôt des richesses de
l'Egypte. C'est le commerce de l'Egypte seule qui a fait
depuis trente ans sa prospérité : et ce
commerce suffît pour assurer ses progrès dans
l'avenir.