Chapitre 4 - Le Caire - La place de l'Ezbekieh - Les rues - Les bazars
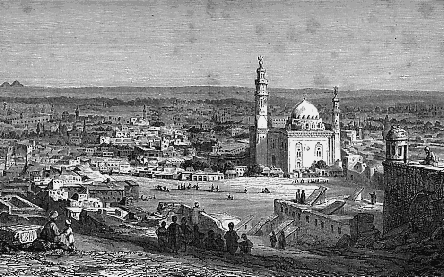 |
De toutes les villes de l'Orient, la plus belle est le
Caire, au dire unanime des voyageurs. Constantinople a
son incomparable panorama du Bosphore ; Smyrne a ses bazars ;
Damas, ses maisons élégantes et somptueuses ;
mais ni Damas, ni Smyrne, ni Constantinople n'ont la
physionomie originale, l'aspect vivant et animé du
Caire. «C'est la seule ville, dit M. de Chateaubriand,
qui m'ait donné l'idée d'une ville orientale,
telle qu'on se la représente ordinairement. Et il y a
longtemps que le Caire jouit de cette réputation. Les
contes arabes des Mille et une Nuits en parlent sur le
ton de l'enthousiasme poétique : Qui n'a pas vu le
Caire n'a rien vu ; son sol est d'or, son ciel est un prodige
; ses femmes sont comme les vierges aux yeux noirs qui
habitent le paradis. Et comment en serait-il autrement,
puisque le Caire est la capitale du monde ?»
(Itinérair de Paris à
Jérusalem)
Je n'ai pas pu vérifier si les femmes du Caire
ressemblent toujours aux houris ; car, sauf les femmes du bas
peuple, toutes sont sévèrement voilées ;
mais je crois qu'aujourd'hui, comme du temps de
Haroun-al-Raschid, le Caire est encore, bien que
singulièrement déchu, une des villes du monde
les plus curieuses et les plus faites pout
émerveiller.
On entre dans le Caire par la place de l'Ezbekieh.
Entourée de palais, d'hôtels, de maisons de
riche apparence, cette place a la figure d'un immense
quadrilatère, plus large d'un bout que de l'autre. Une
double rangée de gommiers magnifiques forme tout
alentour de larges avenues, sur lesquelles ils versent une
ombre épaisse. Le long de ces avenues sont
installés des cafés, simples baraques faites de
planches ou de treillis ; au-devant on a placé de
petites tables et des chaises : usage et mobilier tout
européens, importés ici depuis peu
d'années. C'est là que les négociants et
les banquiers européens se réunissent tous les
soirs pour causer des affaires et des nouvelles du jour, en
fumant et en prenant le café ou les sorbets.
Quelques-uns de ces cafés sont exclusivement
fréquentés par les Turcs, les Arméniens
ou les Juifs, et sur les bancs placés à la
porte on voit à toute heure les joueurs
d'échecs obstinément penchés sur leurs
damiers.
Autrefois le centre de la place, plus bas de quelques pieds,
formait comme un vaste bassin que remplissaient les eaux du
Nil à l'époque de sa crue, et où se
célébrait avec de grandes réjouissances
la fête de l'Inondation. Ce sont les Français
qui, lors de la conquête, ont desséché
cette sorte de lac ou de marais, l'ont exhaussé et
planté d'arbres. Aujourd'hui c'est un beau jardin,
percé de deux grandes allées qui se coupent en
croix et d'allées sinueuses qui circulent à
travers d'épais massifs de mimosas, de lauriers, de
tamaris. J'y ai remarqué aussi quelques arbres
d'Europe qui à cette époque (10
décembre) portaient encore toutes leurs
feuilles.
Il faut bien convenir que la place de l'Ezbekieh, toute belle
qu'elle est, rappelle encore beaucoup l'Europe, et par les
constructions qui l'entourent, et par le nombre assez
considérable d'étrangers qui s'y donnent
continuellement rendez-vous. Pour voir le vrai Caire, montons
à âne et enfonçons-nous dans les rues de
la ville.
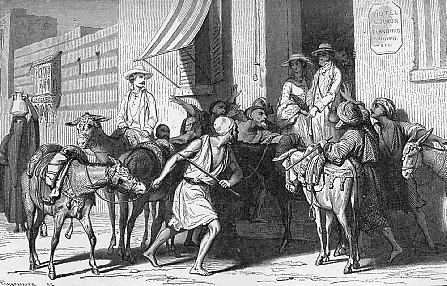 |
Devant chaque hôtel stationnent des bandes
d'ânes tout harnachés, avec leurs grosses
selles de maroquin rouge et leurs housses rouges
bordées de galons d'or. Quelques-uns sont très
coquets, peignés, rasés, tondus comme des
chevaux pur sang, à l'exception des jambes, où
le poil est conservé et artistement
découpé de façon à leur dessiner
comme des bas à jour. Ici, bien plus encore
qu'à Alexandrie, l'âne est le moyen de
locomotion universel. Grâce aux selles anglaises, les
dames européennes elles-mêmes peuvent se
conformer à l'usage. C'est plus qu'un usage au
surplus, c'est presque une nécessité. Il y a
quelques voitures particulières au Caire, mais fort
peu, et encore moins de voitures de louage. La raison en est
bonne : c'est que, à l'exception de deux ou trois
grandes rues qui traversent la ville dans sa largeur, toutes
les rues du Caire sont tellement étroites, tortueuses
et encombrées, qu'une voiture n'y saurait passer. Un
âne passe partout, au contraire, partout où peut
passer un homme. Sur son âne, on pénètre
dans les ruelles les plus étroites, on traverse les
encombrements les plus inextricables, on entre même et
l'on se promène dans les bazars, où l'on peut
faire ses emplettes sans descendre.
Seulement, quand vous irez choisir votre monture, je vous
conseille de vous armer de votre canne et d'en user
énergiquement pour protéger votre
liberté. Autrement vous êtes en un instant
entouré par une troupe d'âniers à demi
nus qui, avec toutes sortes de cris et de gesticulations,
vous offrent leurs services, vous saisissent qui par un bras,
qui par une jambe, qui par la basque de l'habit, et, vous
enlevant de terre, malgré vos menaces et vos
réclamations, se mettent en devoir de vous hisser sur
leurs bêtes. J'ai failli pour ma part être, le
premier jour, victime de ces empressements
exagérés, et sans la canne dont je m'escrimai
de mon mieux, je courais risque d'être tiré de
la sorte, non à quatre chevaux, mais à quatre
ânes et autant d'âniers. C'est d'ailleurs un
assez triste spectacle, et, quand on y
réfléchit, un signe profond de
dégradation morale, que la résignation,
l'indifférence, pour mieux dire, avec laquelle cette
race reçoit les coups. Elle y est si habituée,
que c'est pour elle, ce semble, chose toute naturelle et de
droit ; elle plie les épaules et baisse la tête,
sans jamais faire entendre ni une réclamation ni une
plainte.
Un autre signe de l'abaissement de ce peuple, c'est la
mendicité universellement pratiquée. Il y a un
mot que l'étranger entend sans cesse retentir ici
autour de lui, et dont il a bien vite les oreilles
fatiguées ; c'est le mot de bakchich. Le
bakchich, c'est la buona mano des Italiens,
c'est le pourboire des Français. Partout,
à toute heure, vous êtes harcelé,
poursuivi par ce cri qui s'élève incessamment
de la bouche des hommes, des femmes, des enfants. Mais je
reviens à nos ânes de l'Ezbekieh. Une fois en
selle, vous êtes sauvé. L'animal part à
fond de train, excité par son conducteur, qui suit en
criant et le piquant d'un bâton pointu. Ces ânes,
généralement petits, bruns, portant les
oreilles droites, ont une allure bien autrement rapide et
fringante que leurs frères d'Europe ; et cette allure,
toute rapide qu'elle est, est extrêmement douce et
agréable. Ils galopent aussi fort bien ; mais leur
pied n'est sûr que dans une marche
modérée : si on les force, ils buttent parfois,
et alors cavalier et monture roulent dans la
poussière. Laissés à leur allure
naturelle, ils sont infatigables : leur vigueur et leur
sobriété rivalisent avec celles du chameau ;
une poignée de fèves les nourrit, et l'on en a
vu qui restaient trois jours sans boire.
A l'extrémité nord de la place, quand on a
passé devant l'hôtel du consulat de France, on
tourne tout à coup à gauche, puis à
droite, et l'on se trouve en face de la grande rue du
quartier Franc, qu'on appelle le Mousky.
Déjà, bien que la voie publique soit encore
large, l'encombrement est extrême, la foule est
énorme, et le spectacle que vous avez sous les yeux
est des plus curieux et des plus amusants. A tous les coins
des carrefours, au-devant des maisons, sont établies
des marchandes de pastèques, d'oranges, de bananes, de
cannes à sucre ; des marchands ambulants vous offrent
des confitures, des éventails, des chasse-mouches :
tout cela crie à tue-tête. Le milieu de la rue
est obstrué par des charrettes basses, à quatre
roues, attelées de deux boeufs, et dont l'essieu de
bois gémit d'une façon lamentable ; par des
bandes d'ânes chargés de terre ou de paille ;
par de longues files de chameaux portant de grandes outres
pleines d'eau, ou des moellons mal attachés sur leurs
flancs avec des cordes et qui menacent la tôte des
passants. Parmi tout cela, une population de toutes les
couleurs, affublée de tous les costumes, y compris les
gens qui n'en ont point ou peu s'en faut : des femmes de
fellahs, grandes et sveltes, enveloppées, comme des
fantômes, de leur longue souquenille bleue ouverte sur
la poitrine, et portant sur la tête d'énormes
fardeaux ; des femmes turques ou coptes, juchées sur
leur âne qu'un serviteur conduit par la bride,
hermétiquement voilées jusqu'aux yeux, et
enveloppées de grandes capes de soie noire qui les
font ressembler à d'immenses chauves-souris ; de gros
Turcs, en pantoufles, majestueusement assis sur leur
âne richement harnaché, fumant une longue pipe,
graves et solennels comme des sénateurs romains ; des
officiers égyptiens passant à cheval, dans leur
ample et pittoresque costume, la tête couverte de la
cuffieh jaune, avec un arsenal de pistolets à la
ceinture, précédés de leur saïs qui
fait ranger la foule.
La première impression, au milieu de tout ce monde
bariolé, criant, courant, gesticulant, est celle d'un
étonnement mêlé de quelque
anxiété. On n'a pas assez de ses yeux pour
voir, de ses oreilles pour entendre. Assourdi par les
clameurs des marchands et des âniers, ahuri de ce
mouvement prodigieux dont rien ne peut donner l'idée
dans nos villes d'Occident, distrait par mille objets
à la fois, partant de costumes et de physionomies
étranges, le voyageur a peine à garder assez de
sang-froid pour diriger sa monture, pour ne pas renverser les
aveugles, heurter les femmes, écraser les enfants, et
pour se garer des ânes qui passent au galop ou
préserver sa tête des grandes poutres
chargées en travers sur le dos des chameaux. Tout cela
passe et tourne devant vous comme un kaléidoscope ;
où plutôt vous vous croiriez emporté dans
une course au clocher, ou dans la ronde infernale d'un bal
masqué. Au premier moment, c'est à donner le
vertige.
Mais on s'y habitue bien vite ; et, passé cette
espèce d'étourdissement dont on ne peut se
défendre d'abord, rien de plus gai, de plus
animé, de plus divertissant que ce spectacle des rues
du Caire. Et pourtant nous ne sommes ici que dans le quartier
Franc, dans le Mousky, c'est-à-dire dans une grande
rue nouvellement rebâtie, large et bien alignée,
bordée de magasins européens tels qu'on en voit
à Alexandrie et à Malte, garnis de toutes les
denrées, de tous les produits de l'industrie
européenne : modes de Paris, épiceries de
Marseille, vins de Bordeaux, coutellerie de Sheffield.
Ce qui contribue, à part la population qui la remplit
et où sont noyés de rares Européens,
à donner à la rue du Mousky un aspect
très oriental, c'est qu'elle est en partie couverte de
grandes nattes ou de treillages en feuilles de palmier.
Plusieurs rues du Caire, celles du moins qui sont un peu
larges, ont ainsi une sorte de tenture destinée
à protéger les passants et les marchands contre
l'ardeur du soleil et à y entretenir un peu de
fraîcheur.
 |
Aucune des rues du Caire n'est pavée. On les
arrose même en hiver, pour empêcher la
poussière. C'est un agrément de marcher partout
sur un sol doux, uni, et qui ne retentit pas, comme dans nos
villes, sous les roues des charrettes et les pieds des
chevaux ; mais c'est aussi un inconvénient et presque
un danger, en ce que, sur cette terre spongieuse et sourde
comme un tapis, nul bruit n'annonce l'approche d'un cheval ou
d'une voiture. Il y a, en effet, quelques voitures, dans les
grandes rues, ce qui au premier abord peut paraître
presque impossible. On prétend que le
général Bonaparte a été le
premier qui se soit fait conduire dans les rues du Caire en
calèche à quatre chevaux ; et l'on a dit
spirituellement que, s'il a fait de plus grandes choses, il
n'en a guère fait de plus difficiles. Aujourd'hui ce
tour de force a perdu de son merveilleux, au moins dans le
Mousky moderne et agrandi. Cependant la foule est telle et
les obstacles si nombreux, que toute voiture est
obligée de se faire précéder par un
coureur qui crie aux passants de se garer, et qui même,
de la longue baguette dont il est armé, va frappant
à droite et à gauche les baudets trop lents
à se ranger.
Il ne pleut guère au Caire, et surtout la pluie, qui
tombe quelquefois l'hiver, y dure peu : c'est fort heureux,
car avec ces rues sans pavé on ne pourrait s'en tirer.
Une ondée d'une demi-heure les transforme en marais :
impossible de marcher dans cette argile grasse et tenace.
C'est alors un spectacle lamentable : les ânes
glissent, les chameaux s'abattent ; les pauvres Turcs perdent
leurs babouches dans la boue. Il n'y a que les Arabes,
toujours nu-pieds, qui s'en tirent.
Au bout du Mousky est le quartier Juif. La rue est encore
large, droite, de construction moderne ; seulement les
boutiques arabes remplacent les magasins européens.
Mais parvenu à l'extrémité de cette
grande rue récemment bâtie, soit que vous
tourniez à droite ou à gauche, vous entrez dans
la vieille ville : rues étroites et tortueuses ;
petites maisons, noires d'aspect, serrées les unes
contre les autres dans un désordre pittoresque ;
au-devant, de petites boutiques, larges de quelques pieds,
encombrées de marchandises qui pendent aux parois, aux
piliers, et envahissent souvent la moitié du passage.
Ici la foule est plus pressée, la circulation plus
difficile, le tapage et les cris aussi assourdissants.
Plus on avance, plus les rues sont étroites,
anguleuses et sombres. Nous voici dans un passage couvert,
large d'un à deux mètres à peine, garni
de petites boutiques toutes remplies de fioles et de flacons
de toutes formes ; un parfum pénétrant s'en
exhale : c'est le bazar des marchands d'essences et d'eau de
rose, un des produits célèbres de l'Egypte.
Plus loin, c'est le bazar des étoffes, où
s'entassent les soies de Brousse, les mousselines de Damas,
les burnous de l'Algérie, les châles de la Perse
et de l'Inde. Il faut avouer que ces bazars répondent
peu, par leur aspect général, à
l'idée brillante qu'on s'en fait. Ceux d'Alger, de
Tunis, de Damas sont plus riches, dit-on, que ceux du
Caire.
Des fontaines publiques décorent presque tous les
carrefours de la ville. Ces fontaines sont des monuments
charmants, aussi remarquables par l'élégance de
l'architecture que par la richesse et la grâce des
détails. Généralement, elles sont de
forme semi-circulaire, la plupart construites en marbre
blanc. La façade est ornée de colonnes, dont
les intervalles sont revêtus de grillages dorés
: des sculptures délicates, dans le goût arabe,
décorent la frise, sur laquelle sont peints ou
gravés des versets du Koran. Ces fontaines sont
presque toutes des fondations pieuses. Le défunt, dans
les inscriptions qu'on y lit, sollicite les prières du
passant en échange de l'eau qu'il lui offre : usage
simple et touchant qu'expliquent assez les
nécessités d'un climat torride. L'eau, en
Orient, est le premier des besoins et la première des
richesses : c'est le bienfait par excellence, car c'est la
vie même ; là où elle coule, coulent avec
elle l'abondance et la joie ; là où elle
manque, règnent la détresse et la mort. On
comprend que des familles riches aient attaché leur
nom à ces monuments populaires. Près des bazars
est une fontaine magnifîque que
Méhémet-Ali a fait ériger ainsi en
mémoire de sa soeur. Il y a toujours foule autour de
ces fontaines. Les femmes y viennent remplir leurs amphores
rouges au long col, qu'elles portent sur la tête. Les
passants s'y désaltèrent ; les chameaux et les
ânes s'y abreuvent. Presque toujours à la
fontaine est jointe une école publique et
gratuite.
Les monuments qui, avec les fontaines, contribuent le plus,
à embellir le Caire, sont les mosquées. Le
nombre en est considérable : on en compte, je crois,
plus de trois cents. Souvent j'en ai vu deux, trois et quatre
dans une même rue, et à quelques pas de
distance. Leurs minarets ont des formes très
variées, toujours hardies et légères :
les frises sont ornées de dentelures et de sculptures.
Mais ce qui frappe d'abord le regard et donne à ces
édifices un aspect original, c'est que leurs hautes
murailles sont peintes de larges bandes horizontales, d'un
rouge pâle, disposées à des distances
égales : décoration qui s'harmonise
merveilleusement et avec cette architecture arabe, gracieuse
et fleurie, et avec le ton général de la
pierre, qui a pris partout les teintes chaudes et
dorées de ce beau ciel.
C'est bien ici le pays de la couleur et de la lumière
! La couleur, elle s'étale partout, riche et splendide
; la lumière, elle ruisselle et éblouit. C'est
une fête perpétuelle pour les yeux. Tout leur
est spectacle et enchantement. A côté d'un
chef-d'oeuvre d'architecture, un rien les étonne et
les charme ; une porte de mosquée en ruine, une
échoppe de marchand, un coin de rue tortueux avec ses
fenêtres sculptées et ses balcons treillages :
voilà, tout un tableau, et un tableau charmant si un
rayon de soleil vient en animer les détails. Que de
fois, en parcourant les rues du Caire, nous nous sommes
arrêtés tout à coup pour admirer
quelqu'un de ces effets magiques de couleur, de ces jeux
merveilleux de l'ombre et de la lumière I Je me
souviens entre autres d'un carrefour situé, je crois,
à l'extrémité du bazar des
étoffes. Une vieille mosquée s'élevait
d'un côté, avec ses murs rayés de blanc
et de rose ; de l'autre, de grandes maisons aux
fenêtres étroites et grillées. Des frises
de la mosquée aux terrasses des maisons étaient
tendues des toiles, des nattes, des tapis, destinés
à tempérer l'ardeur du jour. Mais, à
travers ces tentures à demi pendantes, glissaient
jusqu'à terre quelques rayons de soleil qui, projetant
sur les masses d'ombre comme des îles de
lumière, faisaient briller par places la foule
bariolée et mouvante, et étinceler aux
étalages des marchands les soies chatoyantes et les
étoffes brochées d'or et d'argent. Cadre et
personnages, caractère et costumes, contraste
vigoureux des clartés et des ombres, nous avions
là sous les yeux une de ces scènes
qu'affectionne et qu'a reproduites vivantes sur la toile le
pinceau de Decamps.
Sauf le Mousky et deux ou trois grandes rues marchandes,
impossible à l'étranger de se reconnaître
et de s'orienter dans les rues du Caire : c'est un labyrinthe
inextricable ; c'est un dédale et un lacis sans fin de
rues, de ruelles, de passages obscurs, où les
âniers seuls peuvent retrouver leurs chemin. Beaucoup
de ces ruelles sont tout juste assez larges pour deux hommes
de front, et l'on a peine à passer sans encombre si
l'on se croise avec un âne chargé ou un chameau.
Nous autres gens du Nord, nous cherchons, nous appelons le
soleil : ici on le fuit ; c'est l'ennemi. Les maisons se
serrent les unes contre les autres. pour l'empêcher de
passer. Souvent elles ont, comme nos vieilles maisons du
moyen âge, plusieurs étages qui s'avancent en
saillie l'un sur l'autre. Mais ce qui ajoute le plus à
l'obscurité des rues, tout en les décorant
d'une façon charmante, ce sont les
moucharabieh, ou balcons, dont presque toutes les
fenêtres sont garnies.
Ces balcons, tout en bois, fermés exactement sur les
trois faces par des grillages serrés ou des panneaux
élégamment sculptés et
découpés à jour, avec toutes sortes de
fantaisies et d'arabesques, sont disposés de
façon à ce qu'on puisse voir de
l'intérieur sans être vu. Plusieurs ont comme de
petits avant-corps au moyen desquels l'observateur, en
avançant la tête, peut plonger le regard
perpendiculairement au-dessous de lui. Ces cages
délicieuses ne laissent jamais entrevoir les charmants
oiseaux qu'elles tiennent captifs. A peine, de temps à
autre, voit-on une main furtive entr'ouvrir
discrètement le châssis, ou deux yeux de gazelle
briller à travers le treillage. Pour le voyageur, dont
ils attirent involontairement le regard et dont l'imagination
les peuple de gracieuses figures, ces balcons
ouvragés, sont l'ornement des rues du Caire ; mais,
hélas ! ce ne sont, en effet, que des fenêtres
de prison ; ce ne sont que les grilles des harems, cette
plaie de l'Orient. Derrière, vous trouveriez la
servitude, la dégradation, tous les vices du
maître et tous ceux de l'esclave. Ainsi en est-il
partout en ce pays : au dehors l'éclat et la
poésie, au dedans la misère et la
corruption.
Dans les rues étroites, les moucharabieh se rejoignent
presque d'un côté de la rue à l'autre ;
et lorsque les maisons ont plusieurs étages qui
surplombent l'un sur l'autre, les balcons supérieurs
s'entrecroisent littéralement, et, fermant presque la
rue par en haut, n'y laissent pas pénétrer le
soleil, à peine le jour. Dans la saison chaude, ces
ruelles doivent être très fraîches ; en
revanche, comme l'air n'y circule guère, elles doivent
être assez malsaines. Pour se défendre du
soleil, on s'expose à la peste.
Du reste, il faut rendre justice à la police de la
voirie égyptienne : je n'ai pas vu beaucoup de villes
en Europe qui puissent, pour la propreté des rues,
être comparées au Caire. Tout le monde sait
qu'à Constantinople ce sont les chiens seuls qui sont
chargés de nettoyer les rues ; et il en est ainsi, je
crois, à peu près dans tout l'Orient. Ici, tous
les matins, les rues sont balayées et les immondices
enlevées. Cette propreté merveilleuse
était, je l'avoue, un de mes étonnements. Comme
tout ce qui se voit de bon en Egypte, cette police date de
l'occupation française ; mais c'est au gouvernement de
Méhémet-Ali qu'elle a dû d'être
organisée et de durer.
Despote impitoyable, Méhémet-Ali était
du moins un grand administrateur. Il avait fait de
l'administration en Egypte un mécanisme de fer,
écrasant les individus, exploitant la terre comme les
hommes, mais marchant avec régularité. Il n'a
pas eu de successeurs ; mais l'impulsion donnée par
lui s'est continuée ; la machine qu'il avait
construite fonctionne encore, bien qu'au centre la force
organisatrice et la pensée supérieure soient
désormais absentes.