Chapitre 5 - Le Caire (suite) - La citadelle - Les mosquées
Nous sommes allés aujourd'hui visiter la citadelle.
Elle est, je l'ai déjà dit, bâtie sur la
croupe du Mokattam, qui s'élève au nord de la
ville et la domine. Comme nous sommes logés dans la
partie méridionale, près de la place de
l'Ezbekieh, il nous faut, pour nous y rendre, traverser le
Caire dans toute sa largeur. Après avoir franchi le
Mousky, le quartier des Juifs et celui des Bazars, nous
entrons dans les quartiers des artisans. Un bruit
assourdissant de marteaux annonce de loin la rue des
chaudronniers : à la suite sont les bourreliers, puis
les corroyeurs, puis les marchands de pipes, et ainsi de
suite. Au Caire, chaque commerce, chaque industrie a son
quartier et sa rue, comme dans nos villes du moyen âge.
Une ressemblance de plus avec nos villes d'autrefois, c'est
que chaque quartier avait ses portes qui se fermaient
à la nuit : les portes subsistent encore en beaucoup
d'endroits ; mais elles sont déjetées,
vermoulues, et depuis longtemps elles ont cessé de
tourner sur leurs gonds.
On monte à la citadelle par une rampe en spirale,
assez douce pour que les voitures puissent la gravir :
à droite et à gauche s'élèvent de
vieilles mosquées en ruine, avec leurs minarets
ébréchés par le temps et comme
calcinés par le soleil. C'est à
Méhémet-Ali qu'est due cette route nouvelle,
large, commode, plantée d'arbres. Il n'y avait
autrefois, pour arriver à la citadelle, qu'un chemin
étroit, escarpé, taillé dans le roc, qui
allait, plus à l'est, déboucher sur la place de
Roumelieh par une porte en demi-ogive, flanquée de
deux tourelles.
 |
C'est dans ce vieux chemin, à droite en montant,
que se passa, en 1811, le drame terrible qui consolida
dans le sang la domination du pacha. Arrivé au pouvoir
à force d'habileté et d'audace, de
persévérance et de souplesse ; confirmé
par la Porte dans le gouvernement de l'Egypte, qu'on lui
laissait par cette raison principalement qu'on n'eût
pas pu le lui ôter, Méhémet-Ali n'avait
plus d'adversaires que les mameluks, milice turbulente et
redoutable qui, pendant cinq siècles, avait
dominé la province et lui avait donné des
maîtres. Bien que décimée et
singulièrement affaiblie par la conquête
française, elle tenait en échec le nouveau
gouvernement, et faisait peser sur le pays le poids d'une
féodalité brutale et d'une anarchie
dévorante. Longtemps ce fut entre le pacha et les
mameluks une suite de combats, de vengeances, de
représailles : chassés du Caire, mais toujours
menaçants, ils s'étaient retirés dans la
haute Egypte et de là entretenaient dans tout le pays
une agitation continuelle. Enfin, à la veille de sa
grande expédition contre les Wahabites, ne pouvant
laisser derrière lui des ennemis aussi dangereux,
Méhémet-Ali demanda à la ruse ce que la
force ouverte n'avait pu lui donner.
Avec des paroles de réconciliation, avec des promesses
et des présents, il attira au Caire ses adversaires.
Des fêtes somptueuses devaient avoir lieu pour le
départ de l'expédition d'Arabie. Le 1er mars
1811, tous les mameluks sont invités à la
citadelle : c'était là que résidait le
pacha. Ils s'y rendent avec douze à quinze cents
cavaliers de leur suite, revêtus de leurs plus riches
costumes et de leurs plus belles armes.
Méhémet-Ali les reçoit sous une tente
magnifique, et leur offre les sorbets et le café avec
une cordialité faite pour dissiper tous les
soupçons. La fête terminée, les mameluks
se retirent aux sons d'une musique militaire ; mais, parvenus
au bas de ce chemin étroit et abrupt dont j'ai
parlé, ils trouvent fermée la porte massive qui
donne sur la place de Roumelieh. Des Arnautes, troupes
dévouées au pacha, les enveloppent par
derrière : ils se voient cernés, traqués
dans une gorge profonde, bordée de hautes murailles.
Au même instant, un feu terrible éclate de tous
côtés : de toutes les meurtrières pleut
sur eux une grêle de balles. La résistance
était impossible ; ils n'avaient pas même de
cartouches.
Quelques-uns, avec la rage du désespoir, poussant
leurs chevaux au travers de la mousqueterie, reviennent sur
leurs pas et tentent, le sabre à la main, de se faire
jour. Ceux qui tombent aux mains des Arnautes sont conduits
devant le pacha et décapités. Un seul
échappa : il se nommait Amyn-Bey. Parvenu dans la
grande cour du palais, poursuivi par la fusillade
jusqu'à la plate-forme du mur d'enceinte, et n'ayant
qu'à choisir entre deux genres de mort, il
lança son cheval de la terrasse haute de plus de vingt
mètres. Le vaillant animal fut tué sur le coup
; l'homme, quoique meurtri, se releva, et, grâce
à quelques Arabes qui eurent pitié de lui, put
quelques jours après se réfugier en
Syrie.
Certes, si la politique explique un pareil acte, rien ne peut
l'absoudre ; pour avoir eu un précédent dans le
massacre des Strélitz par Pierre le Grand, pour avoir
servi de modèle au massacre des janissaires par le
sultan Mahmoud, il n'en est pas moins odieux. Ce qu'on peut
dire de mieux pour l'excuser, c'est qu'à l'anarchie
stupide entretenue par cinquante tyrans il fit
succéder un despotisme unique et intelligent qui
devait être un bienfait pour l'Egypte. Quoi qu'il en
soit, de ce jour le pouvoir de Méhémet-Ali fut
affermi ; et le pacha put travailler sans obstacle à
la réalisation de ses projets d'agrandissement et de
réforme.
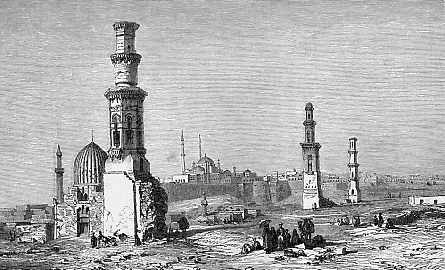 |
La citadelle du Caire est une véritable
ville. Ses trois enceintes, qui ont un développement
de plus de trois kilomètres, renferment, en effet,
plusieurs palais avec leurs jardins, douze mosquées,
des casernes, des arsenaux, des tribunaux, des places
d'armes, sans compter des ministères et des archives.
Nous laissons nos ânes dans la première cour, et
nous nous acheminons à pied vers la grande
mosquée. C'est Méhémet-Ali qui l'a
construite : commencée vers 1820, elle n'a
été achevée que peu d'années
avant sa mort.
Un vieux Turc, qui fume assis sur ses talons, vient nous
mettre aux pieds des chaussons de grosse toile blanche, qui
s'attachent avec des ficelles par-dessus nos souliers. Cette
cérémonie accomplie, on nous introduit dans une
vaste cour carrée qui précède la
mosquée. Cette cour est magnifique ; la richesse de la
matière éblouit vraiment le regard : le
pavé, la fontaine qui est au milieu, tout ornée
de riches sculptures, la galerie soutenue de colonnes, qui
forme les trois côtés de la cour opposés
à la mosquée, tout est en marbre blanc ; et
sous ce ciel d'une inaltérable
sérénité on ne voit jamais, comme dans
nos climats humides, comme en Italie même, le marbre se
noircir ou se couvrir de mousses vertes ; il garde
éternellement sa blancheur immaculée et
l'éclat que lui a donné la main de
l'ouvrier.
L'intérieur de la mosquée est plus riche
encore. Le revêtement des murailles et les colonnes qui
portent la voûte sont en albâtre oriental, cette
belle pierre d'un jaune pâle, aux larges ondes
transparentes et laiteuses. Les frises sont peintes de
couleurs vives ; et autour de la coupole centrale pendent, au
bout de longues chaînes ornées de touffes de
soie, une innombrable quantité de lampes. Dans l'angle
à droite en entrant s'élève,
derrière une grille dorée, le tombeau de
Méhémet-Ali. Tout cela est splendide, et le
premier aspect est merveilleux. Mais si la matière est
admirable, l'art est médiocre. Ce n'est plus là
cette architecture arabe, si légère et si
hardie, si élégante dans ses caprices, dont
nous avons déjà pu en passant contempler les
monuments dans les rues du Caire ; et l'on est tenté
de répéter au pacha le mot du sculpteur grec :
«Ne pouvant la faire belle, tu l'as faite riche».
Mais est-il besoin d'aller jusqu'en Egypte pour trouver des
exemples d'une semblable décadence, et voir dans l'art
religieux la richesse remplacer le beau ?
A côté de la grande mosquée se trouve le
palais du vice-roi. C'est un édifice moderne et de
pauvre apparence. L'intérieur répond au dehors
: luxe et mauvais goût, mélange de barbarie et
de civilisation ; des antichambres délabrées,
des corridors sales et enfumés, où pendent
d'ignobles quinquets, conduisent à des salles
dorées et entourées de riches divans. A
côté de meubles de Boule ou de palissandre
sculpté, on voit une mauvaise table de noyer, boiteuse
et couverte d'une toile cirée. Près du
trône est le fauteuil de repos du vice-roi, un fauteuil
gigantesque, où trois hommes tiendraient à
l'aise. L'obésité, on le sait, est
l'infirmité des Turcs : on dirait d'un mal
endémique, et qui les atteint tout jeunes. Bien que
Méhémet-Ali fût Grec d'origine1, sa race
semble déjà s'être abâtardie sous
l'influence énervante du climat et subir cette loi
d'appesantissement précoce. Son petit-fils,
Abbas-Pacha, était un véritable Turc, au
physique et au moral ; son fils Mohammed-Saïd, le pacha
actuel, affligé avant l'âge d'un embonpoint
monstrueux, ne paraît pas être d'une autre
nature. C'est un fait général et souvent
observé, sans qu'on en rende bien compte, que les
races étrangères, les races européennes
surtout, s'altèrent et dépérissent en
Egypte. Les enfants européens y meurent presque tous
avant la dixième année. Dans les familles
mêmes qui résistent à cette influence
pernicieuse, le type primitif dégénère
promptement ; et dès la seconde ou la troisième
génération, il a dépouillé
à peu près toutes ses qualités
premières. Les Ptolémées en ont
laissé dans l'histoire un curieux exemple : la race de
l'héroïque Lagus vient finir en cet être
difforme qui fut flétri du sobriquet de Physcon,
c'est-à-dire le Ventru ou l'Enflé. La dynastie
des mameluks n'a échappé à cette
dégénérescence que parce qu'elle se
renouvelait incessamment, comme chacun sait, au moyen de
l'esclavage.
Il y avait, naguère encore, près du palais du
vice-roi, des ruines du plus haut intérêt :
c'étaient les restes d'un palais de Saladin, que la
tradition appelait de son nom (Yousouf) le Divan de Joseph.
Ce monument, qui datait de la meilleure époque de
l'art arabe, n'avait pas, dit-on, pour la pureté du
style, son pareil dans toute l'Egypte. Les derniers restes en
ont disparu : on a brisé ses colonnes de granit pour
bâtir quelque caserne.
C'est Saladin qui a construit la citadelle. C'est lui aussi
qui, pour la fournir d'eau, a fait creuser dans la montagne
sur laquelle elle est assise cette citerne prodigieuse qu'on
appelle le Puits de Joseph. Ce puits a une profondeur de cent
mètres ; on peut descendre presque jusqu'au fond au
moyen d'une rampe en spirale creusée dans
l'épaisseur du rocher, et si douce qu'un âne
peut la monter. L'eau est élevée par une
roue à chapelet que font tourner des boeufs ou
des chevaux. C'est vraiment là une oeuvre colossale et
digne d'un grand homme. Nous descendîmes jusqu'à
mi-chemin à peu près. Je remarquai que plus de
la moitié des pots de la chaîne étaient
brisés. La machine n'en continue pas moins à
marcher, bien que donnant à peine la moitié de
l'eau qu'elle peut donner. Qu'importe ? Elle doit tourner ;
elle tourne. Quand les pots seront tous cassés, on
songera peut-être à les remplacer.
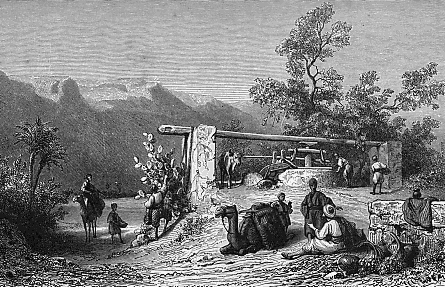 |
En sortant de la citadelle, nous nous avançons
jusqu'au bord de la terrasse qui domine le Caire : on appelle
cet endroit le Saut du Mameluk, en souvenir de
l'audacieuse évasion d'Amyn-Bey. De là on a une
vue admirable. A nos pieds s'étend la ville immense,
avec ses toits gris en terrasses, avec ses dômes et ses
minarets innombrables ; à gauche, on aperçoit
le vieux Caire et les arcades élevées de
l'aqueduc du sultan Touloun, qui apportait l'eau du Nil
à la citadelle ; à droite, les tombeaux des
califes, vaste champ de ruine et de désolation ; en
face, Boulaq et ses entrepôts ; puis, étincelant
sous le soleil et enveloppant de ses flots dorés des
îles verdoyantes, le Nil qui traverse majestueusement
ces plaines fécondes, toutes couvertes de jaunes
moissons, de palais, de villas, de jardins. Au loin, une
ligne jaune tranche sur les champs de verdure : c'est le
désert, au-dessus duquel se dressent, posées
à la limite même où il s'arrête,
les grandes pyramides de Ghizeh, et, en remontant le fleuve
jusqu'aux bornes de l'horizon, les quatorze pyramides plus
petites de Sakkarah. Il y a peu de spectacles au monde qui
soient plus variés et plus saisissants : il n'y en a
pas peut-être qui réunissent ainsi les
splendeurs du ciel, les richesses de la nature, la
poésie des souvenirs, la grandeur des monuments et la
solennité du désert.
Nous sommes sortis de la citadelle par la porte qui s'ouvre
au sud sur la place de Roumelieh. Cette place est une des
plus grandes et des plus animées du Caire. Près
de là se trouve la mosquée du sultan Hassan,
que nous devions visiter.
Il y a seulement trente ans, l'entrée des
mosquées n'était pas ouverte sans quelque
difficulté aux Européens : il fallait
être accompagné d'un janissaire du consulat ;
souvent même il était prudent de revêtir
le costume oriental. Quant aux femmes, elles n'y
étaient jamais admises. A cette époque, il
n'était pas rare même que l'habit
européen fût insulté dans les rues. Le
savant Belzoni, en 181S, fut frappé d'un coup de sabre
à la jambe par un Turc qui trouvait qu'il ne se
rangeait pas assez vite. La longue domination de
Méhémet-Ali a singulièrement
modifié sous ce rapport l'état des choses, et
introduit la tolérance dans les moeurs
égyptiennes. Soit indifférence religieuse, soit
calcul politique, il voulut que les diverses religions et les
divers cultes fussent respectés dans ses Etats.
Intéressé à attirer et à retenir
les Européens près de lui, son premier soin
devait être de leur assurer une sécurité
entière. Aujourd'hui, grâce aux relations de
plus en plus fréquentes de l'Europe avec l'Egypte, et
au nombre croissant des voyageurs qui visitent ce pays, les
habitants du Caire voient sans étonnement les giaours
parcourir leurs rues et même entrer dans leurs
mosquées, conduits par un simple drogman. La seule
condition imposée est qu'on quitte ses chaussures, ou
qu'on mette des babouches par-dessus.
 |
La mosquée du sultan Hassan est de la plus
belle époque (1386), et, bien qu'à demi
ruinée, mérite une attention
particulière. Ses minarets sont les plus
élevés et les plus élégants du
Caire : sa coupole est d'une grande hardiesse. Comme
d'habitude, les murs, à l'extérieur, sont
peints de bandes alternativement rouges et blanches ; une
large corniche les surmonte. La mosquée s'ouvre, sur
une rue latérale, par un portail en ogive
décoré de pendentifs ou grecques : ce portail
est un admirable morceau d'architecture, orné avec
goût, noble et gracieux à la fois. On traverse
un beau péristyle, et par un passage obscur où
se tiennent les gardiens on entre dans une vaste cour
carrée, pavée en marbre, entourée de
trois côtés de chapelles et de bâtiments
où logent les ulémas ; les murailles qui en
forment l'enceinte sont couronnées de trèfles
sculptés ; au milieu de la cour, une fontaine avec une
colonnade octogone, et recouverte d'une jolie coupole, verse
l'eau des ablutions. Au fond est le sanctuaire,
élevé seulement d'un degré au-dessus de
la cour, et dont le pavé est entièrement
revêtu de nattes. Les murs portent des inscriptions
à demi effacées, des incrustations de marbre,
de nacre ou d'émail.
Derrière le sanctuaire est une grande salle, dite
salle du tombeau, carrée, surmontée d'un
dôme, et qui n'offre plus que le spectacle de la ruine
et de l'abandon le plus affligeants. A peine peut-on
distinguer encore sur les murs les caractères
gigantesques qui y retraçaient les versets du koran ;
la coupole effondrée laisse passer le jour en plus
d'un endroit, et sert d'asile aux corbeaux et aux
chauves-souris. Dans les angles, des pendentifs en bois
merveilleusement sculptés, vermoulus et disjoints,
s'affaissent et menacent ruine : demain peut-être ils
tomberont en poussière sur la tête des croyants,
qui ne mettraient pas un clou pour les soutenir.
Au milieu de cette salle délabrée
s'élève, entouré de sa balustrade en
fer, le tombeau du sultan Hassan, aussi poudreux et aussi
dégradé que tout ce qui l'entoure. Le cercueil
est tourné vers la Mekke. Aux pieds du sultan est
placé un livre à fermoirs d'argent : c'est un
koran que Hassan copia tout entier de sa main.
En dépit de l'état de dégradation
où les Turcs ont laissé tomber ces magnifiques
monuments, on ne peut se lasser d'en admirer
l'élégance hardie, la fantaisie pleine de
grâce, la richesse pleine de bon goût. On imagine
aisément quel devait en être l'éclat,
quand s'ajoutaient à l'effet de cette architecture
tant de détails aujourd'hui ternis ou disparus :
vitraux coloriés, boiseries découpées
à jour, plafonds peints et dorés, lambris de
marbres précieux, pavés de marqueterie, lampes
innombrables se balançant du haut des coupoles. De
tout cela, il ne reste guère que les débris :
les monuments des Arabes, vieux de cinq à six cents
ans, semblent à peine plus épargnés par
le temps que les temples des Pharaons.
Après la mosquée du sultan Hassan, les plus
intéressantes du Caire sont celle du sultan Touloun et
celle d'El-Azhar, ou mosquée des fleurs. Toutes deux
comptent parmi les modèles de l'architecture arabe. Je
n'en donnerai pas la description, tous ces monuments
étant à peu près, et sauf quelques
détails, construits sur le même plan. Au reste,
la mosquée de Touloun est aujourd'hui
défigurée : Ibrahim-Pacha en a fait un
hôpital militaire. On a démoli la fontaine,
construit des murs entre les colonnes, dans les galeries. Il
y avait en Egypte, au Caire même, dix palais
inhabités, abandonnés, qui eussent pu servir au
même emploi : on a mieux aimé déshonorer
un admirable monument.
El-Azhar est à la fois une mosquée et une
université où se donnent divers enseignements
scientifiques et religieux, et une sorte de
caravansérail où trouvent asile les
pèlerins de toute nation qui font le voyage de la
Mekke. On raconte que ce fut là que logea Soleyman
el-Halegy, l'assassin de Kléber, en arrivant de Syrie.
Il y enflamma son fanatisme aux prédications des
docteurs de la loi ; fanatisme qui n'était point, au
surplus, celui d'une âme basse ni d'une nature
vulgaire. Il eût été capable
d'héroïsme comme il fut capable de crime, l'homme
qui, pendant qu'on lui brûlait le poignet, impassible
et fier, n'ouvrit la bouche que pour se plaindre qu'un
charbon ardent fût tombé sur son bras,
«cela, disait-il, n'étant pas dans la
sentence». Une mosquée, dans les idées
des musulmans, n'est point un temple où Dieu habite et
fait sentir sa présence : c'est tout simplement une
maison de prière, un lieu de recueillement et de
contemplation où les hommes se réunissent pour
adorer le Dieu unique et éternel. Leur religion, en
effet, n'a d'autre dogme que celui de l'unité de Dieu
; point de culte proprement dit, ni de symboles : à
l'origine même elle n'avait pas de prêtres, ou du
moins tout fidèle pouvait en remplir les fonctions.
Une pensée élevée et pieuse fit
bientôt placer auprès de ces monuments
destinés à la prière des
établissements utiles, des collèges, des
bibliothèques, des asiles pour les pauvres, les
infirmes et les pèlerins. Sous ce rapport El-Azhar fut
de tout temps un des plus riches et des plus importants
établissements de l'islamisme. Ses écoles
réunissaient autrefois jusqu'à vingt mille
élèves de tous pays. Aujourd'hui encore les
cours de son université sont suivis par tous ceux qui
se destinent aux professions civiles et religieuses.
L'instruction y est gratuite. Dans les dépendances, se
trouve un hospice appelé la Chapelle des aveugles :
trois cents aveugles de tout âge y sont entretenus aux
frais de la mosquée. Cette mosquée était
autrefois propriétaire de grands biens : elle en a
été, comme toutes les autres, violemment
dépouillée par ce fameux décret de
confiscation qui fit passer entre les mains de
Méhémet-Ali le sol tout entier de l'Egypte. Le
pacha, en s'emparant des immeubles qui appartenaient aux
établissements religieux et charitables,
s'était bien engagé à leur servir des
revenus suffisants pour leur entretien ; mais cet engagement
ne paraît pas avoir été tenu toujours
bien fidèlement, et l'importance de ces grandes
fondations a par suite considérablement
diminué.