Chapitre 6 - Le Vieux-Caire - Rhodah - La mosquée
d'Amrou
Les derviches hurleurs
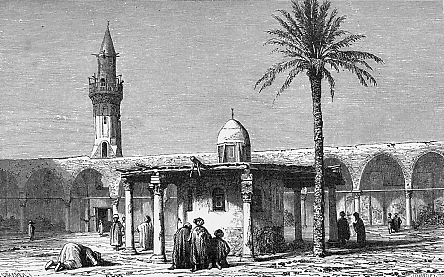 |
Le Vieux-Caire mérite une visite à part. Il
est situé sur le bord du Nil, à une demi-lieue
environ de la capitale actuelle. Sa fondation remonte aux
temps de la conquête arabe (641). Amrou, maître
de l'Egypte, qui avait perdu depuis longtemps
déjà sa vieille capitale Memphis, voulut lui en
donner une nouvelle. Il la bâtit sur le lieu où
il avait campé, et la nomma Fostat,
c'est-à-dire la Tente. Une légende
gracieuse raconte que, pendant qu'il assiégeait une
forteresse romaine appelée Babylone d'Egypte et
située en ce lieu même, une colombe fit son nid
sur la tente du terrible conquérant, et que celui-ci
défendit qu'on levât sa tente, pour ne point
déranger l'innocente couvée : de là le
nom de la ville nouvelle. Le Caire actuel fut fondé,
trois siècles plus tard, par le premier calife
fatimite. Moëz : son nom, Cahira, veut dire la
Victorieuse.
On va au Vieux-Caire par une belle avenue, plantée de
grands arbres, bordée de jardins et de champs de
cannes à sucre. Plusieurs de ces champs ont pour
clôture des haies de gigantesques cactus : il y en a
qui s'élèvent jusqu'à quinze ou vingt
pieds.
La route est soigneusement entretenue et arrosée. Le
système d'arrosement employé partout aux
environs de la ville est très simple et très
primitif. Au bord de la route est ménagé un
petit canal, où passe un courant d'eau continuel,
alimenté par des roues à chapelet qui puisent
ou dans le Nil ou dans les grands canaux communiquant avec le
Nil. Ces eaux servent à arroser pendant
l'été les arbres. Pour arroser la route, des
hommes qui portent une outre de peau de bouc suspendue
derrière le dos vont remplir celte outre au canal :
ils se promènent ensuite sur la route, tenant
serré avec la main l'orifice de l'outre, et l'ouvrant
et le fermant alternativement de façon à lancer
devant eux un jet d'eau demi-circulaire. Les rues du Caire
sont arrosées de la même manière, avec
l'eau que fournissent ses abondantes fontaines.
Bien que situé sur le bord du fleuve, le Vieux-Caire
est une ville à peu près morte : toute la vie,
tout le commerce se sont concentrés à Boulaq,
qui est le vrai port du Caire et qui n'est situé
qu'à une distance moitié moindre de cette
capitale. Ce qu'on vient voir ici, ce n'est pas la ville,
c'est une ruine, la vieille mosquée d'Amrou. Elle est
complètement abandonnée. C'est le plus ancien
monument religieux que le mahométisme ait
élevé en Egypte : comme le Vieux-Caire
lui-même, elle date, le nom de son fondateur le dit, de
la conquête. Elle se compose d'une vaste cour
découverte ; au milieu est une fontaine ; tout autour,
une sorte de cloître ; au fond, une partie couverte
formée par sept rangs de colonnes. Le nombre de ces
colonnes est de trois cent soixante-dix ; elles sont toutes
en marbre ou en granit, et ont été
enlevées pour la plupart à des monuments
gréco-romains. Des chapiteaux de formes très
variées, et surtout quelques-uns représentant
des feuillages sculptés avec une perfection rare, sont
dignes d'attention. Cette forêt de colonnes est
d'ailleurs d'un très bel effet.
On visite encore, au Vieux-Caire, une petite et pauvre
église, dédiée à saint Sergius,
et desservie par des Coptes. Elle a de vieilles peintures
grecques. Sous l'autel est une crypte ; c'était, selon
la tradition, une grotte où la sainte Famille trouva
asile pendant son séjour en Egypte.
En face du Vieux-Caire est l'île de Rhodah. Ce nom veut
dire jardin, et l'île, en effet, est un jardin
charmant, rempli d'arbres de l'Inde et des tropiques. A la
pointe, un palais a été bâti : de ses
terrasses on a une vue magnifique sur le fleuve et la ville
lointaine. Près de là on voit le
nilomètre : c'est une colonne graduée qui sert,
comme on sait, à mesurer la hauteur de l'inondation ;
elle est placée au milieu d'une large citerne
carrée, où Ton descend par un petit escalier.
Ce nilomètre ne date que des Arabes, et du IXe
siècle ; mais les anciens Egyptiens en avaient
élevé bien des siècles auparavant.
L'île de Rhodah fut de tout temps célèbre
comme un lieu de plaisir. Il en est parlé en ce sens
dans les Mille et une Nuits. Une légende
populaire en fait le théâtre des amours
d'Antoine et de Cléopàtre. Une tradition
religieuse veut aussi que ce soit à la pointe de
l'île que se soit arrêté le berceau qui
portait Moïse, quand la fille du Pharaon le recueillit
sur les eaux.
Nous ne rentrons pas dans le Caire par le même chemin :
un sentier poudreux qui passe au travers d'une plaine
couverte de monceaux de ruines et de débris, où
errent des chiens affamés et sur lesquels planent de
grands vautours, nous ramène dans les faubourgs
situés au pied de la citadelle. De là, pour
regagner l'Ezbekieh, nous avons à traverser toute la
vieille ville, tout le massif des quartiers arabes. Sauf
quelques rues marchandes et assez animées, tout dans
cette partie du Caire est silence et solitude. C'est
là un des caractères et des contrastes
singuliers de cette ville : au sortir de la foule, du tapage,
de l'encombrement de certaines rues, vous tombez tout d'un
coup dans des rues désertes, muettes et qu'on dirait
inhabitées. Toutes ces maisons hermétiquement
closes, avec leurs fenêtres grillées, avec leurs
portes basses et massives comme des portes de prison,
auraient même quelque chose de sinistre, n'était
ce soleil éblouissant qui, malgré les toiles,
les nattes, les balcons entrecroisés, jette une teinte
chaude et gaie sur les murailles grises.
Nous eûmes cette fois la sensation inverse :
après avoir cheminé longtemps à travers
un labyrinthe de ruelles obscures et silencieuses, nous
débouchâmes brusquement dans les grandes rues
qui avoisinent les bazars et le Mousky, et nous
tombâmes comme d'un saut au milieu de ce tourbillon
humain qui les parcourt sans cesse : c'est un chan-gement de
décoration à vue, et la surprise est toujours
extrême. J'avoue du reste que, la dixième fois
comme la première, j'ai toujours été
étonné, ahuri de cette agitation et de ce bruit
qui remplissent les grandes rues du Caire, et auxquels rien
ne ressemble dans nos villes d'Occident les plus populeuses.
Nous avons le mouvement des affaires, quelquefois raffluence
des promeneurs, quelquefois la foule des fêtes
populaires : mais notre activité est morose et
silencieuse ; nos joies mêmes sont sans gaieté
et sans expansion. Chez les Arabes, rien ne se fait qu'avec
des cris, avec des chants : travail ou plaisir, c'est
toujours une profusion de gestes, une abondance et une
volubilité de paroles inexprimables.
Mais si vous voulez, à côté de cette
turbulence de la rue, admirer la gravité orientale et
la majesté turque, regardez dans ces petites
boutiques, semblables à des cellules carrées,
et qui sont, côte à côte, rangées
sur chaque face de la rue. A l'un des angles est assis le
marchand, les jambes croisées, sur une natte ou un
tapis. Immobile, les yeux à demi clos, il fume
silencieusement sa pipe au long tuyau de cerisier, ou
dévide son chapelet à gros grains. Si,
d'aventure, vous vous adressez à lui pour acheter
quelque objet de son commerce, gravement, lentement, et d'un
air ennuyé, il se lèvera sans dire un mot, et
se mettra, toujours sans se presser, en devoir de chercher ce
que vous demandez. Jamais une de ces paroles engageantes, de
ces offres de services, encore moins de ces vanteries que
prodigue le marchand européen. Lui, vous avez l'air de
le déranger ; il vous reçoit comme un importun
qui trouble sa méditation ou sa prière ; en
vous vendant, il a l'air de vous rendre service. On entend
bien du reste que je ne parle pas ici des marchands juifs,
syriens ou grecs, qui ont de tout autres allures et sont
très actifs et très déliés. Au
surplus, tout grave, tout silencieux qu'il est, le marchand
turc n'en est pas moins disposé à tromper
l'Européen et à surfaire sa marchandise : avec
lui comme avec les autres, il est bon d'être sur ses
gardes. Si vous voulez avoir de meilleures conditions, allez
le trouver le matin, de bonne heure : pour commencer sa
journée sous de favorables auspices, il ne vous fera,
si vous êtes son premier acheteur, payer la marchandise
que ce qu'elle vaut.
Comme nous passions dans le Mousky, nous entendons tout
à coup, au milieu du bruit général, un
cri plus perçant et plus singulier que les autres. On
eût dit du gloussement d'une poule appelant ses
poussins, ou du glouglou d'un dindon effrayé, mais
dans un ton suraigu. Ce cri était poussé par
des femmes marchant à côté et en avant
d'une voiture où se trouvaient d'autres femmes
richement vêtues. On nous dit que c'était un
mariage, et que ce cortège conduisait la
fiancée chez son époux. Ce gloussement
étrange, appelé en arabe zagarit, et qui
se produit en agitant vive-ment la langue dans la bouche
entr'ouverte, est un signe de réjouissance qui se fait
entendre dans toutes les fêtes de famille, comme le
mariage, la circoncision, et dans les fêtes
religieuses. Je crois même qu'aux funérailles il
est pareillement en usage, mais alors avec un accent propre
à exprimer la douleur.
Au retour de nos courses dans la ville et aux environs, nous
nous asseyons d'ordinaire sous les beaux ombrages de la place
de l'Ezbekieh ; et, en attendant l'heure du dîner, nous
prenons le café devant ces baraques dont j'ai
parlé et qui bordent la promenade. Les cafés
d'Orient ne ressemblent guère aux nôtres. Ce ne
sont, je parle surtout de ceux qu'on voit dans
l'intérieur de la ville, que de petites boutiques,
sombres, étroites, enfumées, au fond desquelles
est installé le cafetier avec ses fourneaux.
Généralement le bas peuple seul les
fréquente. On s'assied, au-devant, sur des bancs de
bois ou de pierre ; et là vous pouvez voir, graves et
silencieux, des Turcs qui fument pendant de longues heures,
savourant de temps en temps une tasse de café. C'est
le spectacle de l'indolence, et, si l'on veut, de l'apathie
orientale : mais j'aime mieux cela que le désordre et
les rixes, les chants grossiers et la débauche brutale
dont nos cafés et nos cabarets populaires sont trop
souvent le théâtre. Ici, du moins, la
dignité humaine ne subit pas cette affligeante
dégradation de l'ivresse que causent les liqueurs
fermentées.
C'est, à mon avis, un breuvage délicieux, que
le café tel que le boivent les Orientaux ; et je le
déclare pour ma part bien supérieur au
nôtre. Ils le font tout simplement en infusion et
à vase ouvert. Fait de la sorte, c'est une liqueur
légère, blonde, transparente, doucement
parfumée, à la fois agréable et salubre,
très tonique et admirablement convenable aux climats
chauds : vous pouvez en prendre vingt tasses par jour sans
inconvénient. En Europe, nous avons fait de notre
café un breuvage noir, acre, irritant, qui
exaspère l'estomac et enflamme le cerveau, quand nous
ne le gâtons pas en y mêlant des flots de
lait.
Le lendemain de notre course au Vieux-Caire se trouvait
être un vendredi. C'est le jour où chaque
semaine, les derviches hurleurs, qui ont un couvent sur la
route même du Vieux-Caire, se livrent à leurs
exercices religieux en présence des fidèles et
des curieux admis à ce spectacle édifiant. A
défaut de derviches tourneurs, - il n'y en a point au
Caire, - nous voulûmes du moins voir, ou plutôt
entendre ceux-ci.
Un peu avant deux heures, qui est l'heure dite, nous
étions rendus au couvent, dont l'apparence est fort
modeste. On nous introduisit dans une cour plantée de
grands arbres, et autour de laquelle sont disposés de
larges bancs en pierre, revêtus de nattes et formant
divan. La réunion était déjà
nombreuse. Outre plusieurs Européens, il y avait vingt
à trente Turcs et Arabes, assis sur les divans, fumant
la pipe ou le narguilé, quelques-uns récitant
leur chapelet, d'autres, qui semblaient des soldats,
occupés pacifiquement à tricoter.
On nous donna des chaises, et, quelques instants
après, on nous offrit le café. Le service
était fait par des domestiques du couvent, derviches
eux-mêmes, ou du moins convers, comme j'eus lieu de le
voir plus tard. Ces serviteurs avaient bien les plus
étranges figures qui se puissent imaginer, l'un d'eux
surtout : de grands cheveux couleur de filasse, qui lui
tombaient en mèches effiloquées sur les
épaules et jusqu'au milieu du dos ; sur la tête,
une sorte de bonnet persan, haut et pointu, garni tout
alentour d'un bourrelet de fourrure ; une figure longue,
imberbe, hébétée ; le regard terne,
l'oeil éteint, la bouche entr'ouverte : une vraie
physionomie de crétin ou d'idiot. Ce personnage long,
maigre, fluet, était vêtu d'une espèce de
sarrau en indienne rayée de rouge et de jaune, qui
descendait jusqu'aux talons et que serrait une ceinture
à la taille : il s'en allait d'un pas d'automate,
traînant ses babouches sur les dalles de la cour, et
offrant d'un air solennel le café ou la pipe aux
assistants.
Après une demi-heure d'attente, nous fûmes
introduits dans une vaste salle en hémicycle,
voûtée, les murailles complètement nues ;
on nous fit asseoir au fond, dans la partie circulaire. En
face de nous, dans la muraille formant le diamètre de
l'hémicycle, s'ouvrait la niche de la kébla,
orientée, comme dans toutes les mosquées, du
côté de la Mekke. Le chef des derviches
était assis, les jambes croisées, sur un tapis
au-devant de la niche : c'était un homme jeune encore,
d'une belle et grave figure, barbe noire, turban blanc, robe
noire. Devant lui, en demi-cercle, et accroupis de même
sur des nattes, étaient rangés les derviches et
tous ceux qui devaient prendre part à la
cérémonie. Je remarquai alors parmi ceux-ci
plusieurs des personnages que j'avais vus dans la cour,
attendant comme nous que la salle fût ouverte :
c'étaient apparemment ou des membres libres de
l'association, ou des fidèles qui venaient, par
zôle pieux, se joindre aux exercices des derviches. Les
serviteurs qui nous avaient offert le café prirent
place aussi dans le demi-cercle. Deux ou trois vieux
musulmans, à barbe grise, et qui paraissaient
être des dignitaires de l'ordre, arrivèrent
successivement, et prirent les places d'honneur, qui
étaient les premières à la gauche du
chef. En levant les yeux, j'aperçus des fenêtres
grillées, pratiquées dans la muraille qui nous
faisait face, et à travers les grillages il me sembla
voir des visages curieux qui devaient appartenir à des
femmes.
Au moment où nous étions entrés, les
prières étaient commencées. Sous la
direction du chef, qui marquait le rythme par des
balancements de la tête et du corps, chaque assistant
récitait avec lui une sorte de rosaire. Cela continua
quelque temps, jusqu'à ce que tout le monde fût
arrivé. Puis le chef se leva ; tous les assistants se
levèrent aussi, et commencèrent par se
débarrasser de leurs manteaux, châles ou
burnous, et par mettre bas leurs bonnets et leurs turbans.
Une musique aigre et stridente, une musique turque, pour tout
dire se fit entendre. Les musiciens étaient à
droite du chef : l'orchestre se composait d'un fifre ou
espèce de flûte de bambou, et de divers tambours
ou tam-tam. Us exécutaient un air monotone, dont la
cadence toujours la même rappelait l'air sur lequel les
bateleurs de nos foires faisaient jadis danser les
ours.
Alors, et comme sous l'impulsion musicale, tous les
assistants, rangés debout, côte à
côte, commencèrent d'un mou-vement lent
l'exercice pieux qui est l'objet de la
cérémonie. Chaque fidèle, immobile
à sa place, les bras pendants, jette le corps en avant
de façon à abaisser la tôte jusqu'au
niveau des genoux, puis se relève en rejetant les
épaules et la tête en arrière ; c'est au
moment où il se redresse ainsi en se renversant
violemment, que chacun d'eux fait entendre un cri rauque, une
sorte de gémissement âpre et sourd qui semble
sortir du fond des entrailles. Cette espèce de
hurlement a quelque chose de sauvage et d'effrayant : on
dirait un rugissement de bête fauve plutôt qu'un
accent de la voix humaine.
J'ai dit qu'il n'y avait pas au Caire de derviches tourneurs.
Nous en vîmes cependant deux qui, à ce moment,
s'introduisirent dans le demi-cercle, et coiffés de
longs bonnets pointus, le corps droit, la tête fixe,
les bras tendus horizontalement, commencèrent à
pivoter sur eux-mêmes avec la régularité
d'une mécanique. Mais à coup sûr
ceux-là n'étaient pas du même ordre que
les célèbres derviches de Constantinople, qui
tournent, dit-on, jusqu'à perdre haleine et à
tomber étourdis. Durant une heure environ, ils
continuèrent de tourner avec la même
régularité, mais aussi avec la même
lenteur et la même solennité monotone.
Nos derviches hurleurs, au contraire, n'y épargnaient
pas leur peine. Le mouvement de tangage, réglé
par l'orchestre, va peu à peu
s'accélérant. Le chef, resté à sa
place, marque la mesure en frappant dans ses mains, et en
imprimant de temps on temps à son corps les
mêmes oscillations. A mesure que le mouvement
s'accélère, les hurlements deviennent aussi
plus pressés, plus âpres, plus profonds.
Bientôt toutes les poitrines sont haletantes, tous les
fronts sont ruisselants de sueur ; les genoux des malheureux
patients fléchissent sous ces efforts violents et
répétés ; leurs longs cheveux battent la
terre, ou se collent sur leur visage humide. Une fatigue
atroce semble ployer tous les corps.
Mais la musique infernale redouble de bruit et
précipite la cadence. Le chef et les grands
dignitaires placés à sa gauche quittent alors
leur place, et à tour de rôle s'avançant
dans le demi-cercle, marquant la mesure avec les mains et
avec le corps, allant de l'un à l'autre, les excitent
et les encouragent. Une sorte d'ivresse
frénétique semble s'être emparée
d'eux, et l'exaltation nerveuse les soutient seule dans
l'épuisement visible des forces physiques. Enfin,
à un signe du chef, la musique cesse ; le mouvement
furieux de balancement s'arrête : le supplice est
fini.
La plupart des acteurs de cette atroce
cérémonie tombent anéantis sur leur
natte. Mais il arrive que quelques-uns, doués d'une
organisation plus sensible ou arrivés à un plus
haut degré d'irritation nerveuse, ne peuvent plus,
même après le signal, s'arrêter, et, comme
un pendule trop fortement lancé, continuent
malgré eux à suivre cet affreux balancement,
entrecoupé de hoquets convulsifs. C'est comme une
trépidation spasmodique et involontaire qui les secoue
d'avant en arrière et d'arrière en avant, et
qui se prolonge parfois assez longtemps. Leurs
confrères sont obligés de les saisir à
bras le corps pour arrêter ce mouvement automatique.
J'en ai vu un qui se serait brisé la tête contre
les murs si deux hommes, en y employant toute leur force,
n'étaient parvenus à le maîtriser.
Ce spectacle est horrible, et j'avoue qu'à ce dernier
acte de la cérémonie le coeur me manqua tout
à fait. Une jeune Anglaise, qui était venue
avec nous, faillit se trouver mal. Nous sortîmes en
hâte, et ce ne fut pas sans quoique volupté que
je retrouvai à la porte l'air pur et la splendeur du
ciel : j'étais comme un homme qui s'éveille
après un cauchemar.