Chapitre 7 - Départ pour la Haute Egypte - La
cange - Journal du Nil - Les femmes du Nil
La montagne des oiseaux - Le couvent des Coptes - Les
chadoufs - La plaine de Syout - Girgheh
Le jour de Noël - Arrivée à
Louqsor
Nous ne sommes que depuis peu de jours au Caire ; et,
malgré l'intérêt que nous offre cette
ville, nous avons songé déjà à
partir pour la haute Egypte. La saison s'avance, en effet ;
les eaux du Nil sont déjà basses, et à
mesure qu'elles baisseront davantage la navigation va devenir
plus difficile et plus lente. Il vaut donc mieux ne pas
tarder : au retour nous pourrons à loisir prolonger
notre séjour. Et puis, nous sommes impatients de
commencer cette seconde partie de notre voyage. Nous n'avons
vu encore que l'Egypte moderne, que l'Egypte arabe, qui date
d'hier : il nous reste à visiter l'Egypte antique,
l'Egypte des Ptolémées, surtout celle des
Pharaons ; à parcourir cette vallée du Nil qui
fut un des premiers berceaux de la civilisation, et le long
de laquelle sont semées les ruines de tant de
cités ; à saluer au fond de leurs solitudes les
ruines de Memphis et de Thèbes aux cent portes.
On nous parle des bateaux à vapeur qui, une ou deux
fois par an, vont jusqu'à Assouan et y transportent
des voyageurs : il y a aussi des remorqueurs, qui font un
service plus régulier, et par lesquels on peut faire
remonter sa barque, sauf à redescendre avec le
courant. Rien de tout cela ne nous tente ; et, pour ma part,
je ne conseillerai à personne de faire ainsi le voyage
du Nil. Il y a dans cette manière de voyager à
la vapeur je ne sais quoi qui désenchante
l'imagination et sied mal surtout au vieil Orient, au
désert, aux ruines. Quelle chose déplaisante,
je m'imagine, de se voir traîné sur ce beau
fleuve, comme un chargement de blé ou de coton, par
une machine qui vomit incessamment dans le ciel les flots
d'une fumée noire, et trouble de son rauque
gémissement le silence de ces rives !
Il n'y a qu'un moyen raisonnable de voyager sur le Nil :
c'est la cange traditionnelle, la barque pontée, aux
deux grandes voiles latines, avec son équipage arabe.
De la sorte, on va moins vite, mais on voit mieux : on marche
au caprice du vent, mais on a tous les hasards et tous les
charmes de l'imprévu ; on est chez soi, on jouit sans
trouble du climat, du ciel et du fleuve. La cange, c'est le
voiturin du Nil : même originalité, même
lenteur, même liberté d'allures ; et si vous
avez eu, en Italie, le bon esprit de préférer
le classique vetturino au chemin de fer ou à la
diligence, n'hésitez pas en Egypte à
fréter une barque pour aller aux cataractes.
Quelques voyageurs traitent directement avec le patron d'une
barque, et avisent ensuite à la munir de toutes les
provisions nécessaires au voyage. C'est un grand ennui
et un grand embarras. Le plus simple, et le mieux sans
contredit, est de faire marché avec un drogman qui,
pour un prix convenu, se charge de vous conduire et de vous
nourrir. Le seul point important est de trouver un homme
sûr et honnête. Sous ce rapport la fortune nous
servit bien : nous n'avons eu qu'à nous louer du
drogman avec lequel nous traitâmes pour le voyage de la
haute Egypte. C'était un homme plein d'intelligence et
d'activité, très expérimenté et
très énergique, poli, empressé,
attentif, enfin honnête, quoique Maltais. Son nom
était Agostino Gianni.
Nous sommes allés, il y a quelques jours, à
Boulaq, choisir notre cange : il y en avait une cinquantaine
amarrées au quai, qui attendaient les voyageurs, plus
rares cette année que d'habitude. Notre choix fait,
les conditions du marché ont été
rédigées en double écrit. Nous sommes
cinq voyageurs : à nous trois, ma femme, mon
frère et moi, se sont adjoints deux jeunes
Américains, M. P*** et sa femme, dont nous avons fait
connaissance à bord du Gange. Agostino doit nous
fournir, outre l'équipage, un valet de chambre et un
cuisinier européen ; il se charge de tous les
approvisionnements, et veillera à embarquer tout le
matériel nécessaire. Ces préparatifs ont
demandé plusieurs jours.
14 décembre.
Aujourd'hui nous avons fait une dernière visite
à la cange. Tout est prêt, ou peu s'en faut :
notre équipage est au complet ; les provisions de
bouche sont embarquées ; nous avons des fusils et des
livres, pour remplir les loisirs de la navigation.
Au grand mât flotte le pavillon tricolore ; à
l'arrière, le drapeau étoile de l'Union. Toute
barque, en effet, a ses couleurs sur le Nil : chaque voyageur
arbore sa nationalité. On se signale de loin ; on
interroge curieusement le pavillon de chaque barque qui passe
; et l'on se salue, au passage, de quelques coups de
feu.
Le vent est propice ; il souffle du nord avec une
régularité qui promet de se prolonger pendant
plusieurs jours. Le départ est définitivement
fixé à demain soir, 15 décembre.
En revenant à notre hôtel, nous parcourons les
rues de Boulaq. Ce n'est, à vrai dire, qu'un faubourg
du Caire, triste, noir, mal bâti, mais très
vivant. Il ne s'y trouve rien de remarquable qu'une
très ancienne mosquée, et un vaste palais
bâti par Ismaïl-Pacha, et aujourd'hui
abandonné comme la moitié des palais de ce
pays-ci.
Dans la rue principale de Boulaq, une douzaine de fellahs,
sous la direction d'un homme armé d'un bâton,
nettoyaient un carrefour obstrué d'immondices et
couvert d'une boue noire et infecte. J'ai vu là
appliqué le système de travaux publics dont
j'ai parlé plus haut : ces malheureux enlevaient les
ordures et la boue avec les mains, en emplissaient un panier,
et, portant ce panier sur la tête, allaient en courant
le vider dans le fleuve. Ces hommes étaient de
corvée. Chaque village fournit douze hommes, qui sont
conduits et surveillés par un chef. Le gouvernement,
bien entendu, ne les nourrit ni ne les paie. A mi-route de
Boulaq au Caire, nous avons vu, en revenant, plusieurs
centaines d'hommes employés ainsi aux terrassements
d'une petite ligne de chemin de fer.
15 décembre.
Vers trois heures, nous quittons l'hôtel, pour aller
dîner sur la cange. Montés sur nos
indispensables baudets, nous parcourons gaiement la route du
Caire à Boulaq. Notre drogman nous
précède, escortant un cheval qui porte les
bagages. Equipage et serviteurs, nous trouvons tout le monde
à son poste, et nous prenons possession de la maison
flottante que nous devons habiter pendant un mois.
Les canges sont en général assez
commodément installées, quelquefois même
richement meublées. La nôtre est convenable,
quoique modeste. C'est une barque longue de seize à
vingt mètres, large de cinq. A l'avant est
placée la cuisine. Sous le pont, les matelots et les
domestiques s'entassent pêle-mêle, quand le froid
ne leur permet pas de dormir à la belle étoile.
L'arrière se compose d'un habitacle, formant une
dunette élevée sur laquelle se tiennent le
timonier et le reïs ou patron ; on entre d'abord dans
une pièce assez grande où règne de
chaque côté un divan, et qui nous servira
à la fois de salon et de salle à manger, et le
soir se transformera en chambre à coucher pour deux
d'entre nous. Une cabine et une petite chambre, tout au fond,
sont destinées à nos compagnons.
L'équipage se compose, outre le reïs et le
timonier, de dix matelots et du marmiton chargé de
leur faire la cuisine. Nous avons de plus, avec le drogman,
deux valets de chambre et un cuisinier. Ajoutez à ce
personnel deux chats, un mouton, une chèvre avec son
chevreau, pour nous fournir du lait quand le lait de vache
manquera, et dans une cage placée à
l'arrière des poules et des dindons qui ne manquent
jamais de saluer l'aurore de la façon la plus
bruyante.
Au moment où nous nous mettons à table pour
dîner, la barque s'ébranle, et nous quittons
Boulaq. Ce premier repas est fort gai. Nous pouvons
déjà apprécier les talents de notre
maître d'hôtel, qui ne laissent pas d'être
assez recommandables. Peut-être aussi l'eau excellente
du Nil et son air vif qui excite l'appétit
contribuent-ils à nous rendre indulgents. L'eau du
Nil, on le sait, a une grande réputation, et elle la
mérite : filtrée dans de grandes amphores de
terre poreuse, elle est légère, agréable
et très salubre. On dit qu'on en expédie
à Constantinople pour le harem du Grand Seigneur ;
mais il paraît qu'une raison particulière l'y
fait rechercher : on lui attribue la vertu de rendre les
femmes fécondes.
 |
Après le repas nous montons sur la dunette. La nuit
est presque venue. A l'avant, nous avons une immense voile
triangulaire qui semble plus haute que la barque n'est longue
; à l'arrière, une autre voile, de même
forme, mais plus petite, et qui s'incline du
côté opposé à la grande. Le vent
est frais, et nous filons bon train. Déjà nous
sommes à la hauteur des pyramides ; mais
l'obscurité ne permet pas de les apercevoir. C'est au
retour seulement de la haute Egypte que nous les visiterons,
en même temps que Sakkarah et le
Sérapéum, qui forment avec elles tout un
ensemble de monuments qu'il ne faut pas séparer. Cette
première soirée de navigation m'a laissé
un vif souvenir. La vue du large fleuve sur lequel nous
glissions d'un mouvement insensible était imposante. A
notre droite, de grands bois de palmiers projetaient leurs
ombres noires sur l'eau calme et profonde : le croissant, qui
montait dans un ciel resplendissant d'étoiles,
blanchissait légèrement leurs cimes, et faisait
briller la partie du fleuve restée dans la
lumière comme une étoffe de soie moirée
d'argent. Au-dessus des bois sombres se découpaient
sur l'azur les flèches élancées des
minarets de Gbizeh. Involontairement je me rappelai le
tableau célèbre de Marilhat, le chef-d'oeuvre
du jeune maître, un Crépuscule au bord du
Nil : c'était la scène, c'était
l'heure, c'était presque tous les détails du
paysage ; et cette poésie rêveuse, cette
tristesse pleine de grandeur et de calme que le peintre
m'avait fait entrevoir, je la sentais cette fois avec toute
la puissance d'impression qu'exerce la nature dans ces
scènes solennelles de la nuit et du
désert.
Les nuits sont fraîches sur le Nil ; la rosée,
même en hiver, est abondante, et il est prudent de ne
pas s'y exposer. Les ophthalmies, si fréquentes dans
ce pays, paraissent en grande partie devoir être
attribuées à cette cause. On rentre donc de
bonne heure au salon : on lit, on fait le whist ; à
dix heures chacun se retire, et les divans sont
transformés en couchettes. Ces couchettes sont un peu
étroites ; les matelas sont un peu durs : il faut
s'accoutumer à cela en Egypte. On n'y rembourre les
lits qu'avec du coton, sans doute pour éviter les
insectes, qui n'en pullulent pas moins. Nous nous apercevons
bientôt que nos lits n'en sont pas exempts. Il y a
aussi de gros cancrelats qui, la nuit, se promènent
sans façon dans nos chambres. Tout cela, c'est le
fruit d'Egypte, comme dit Agostino. Mais qu'y faire ?
16 décembre.
A notre lever, une brume épaisse nous entoure et nous
cache les rives du fleuve. Dans la basse Egypte, il y a
souvent, en hiver, des brouillards le matin. Bientôt le
soleil dissipe ces blanches vapeurs, qui, en se
déchirant, flottent sur les eaux comme des lambeaux de
gaze légère. Le vent nous pousse rapidement
vers le sud. Les matelots, qui n'ont rien à faire
quand la voile est tendue, sont nonchalamment couchés
sur le pont. Ils fument, chacun à leur tour, un
grossier narguilé, formé d'une noix de coco
emmanchée d'un morceau de bambou, et que le marmiton
est chargé d'allumer et de leur présenter
à tour de rôle. Ce marmiton est un enfant d'une
douzaine d'années, qui a des traits d'une
régularité et d'une finesse remarquables.
Par-dessus sa robe de coton bleu, il porte un large lambeau
d'étoffe rayée qu'il laisse traîner comme
un manteau d'empereur. Du reste, il remplit toutes ses
fonctions avec un sérieux et une dignité
comiques. Accroupi sur l'avant de la dunette, le reïs
surveille l'équipage et dirige les manoeuvres. C'est
un brave Egyptien, au visage ouvert. Nous n'avons eu
qu'à nous louer de sa vigilance et de son
expérience : l'une et l'autre qualité sont
nécessaires sur le Nil, dont la navigation, sans
être dangereuse, a ses difficultés et ses
hasards. Fervent musulman, il ne manque jamais de faire les
ablutions prescrites par le koran ; et tous les soirs, au
coucher du soleil, nous le voyons se prosterner
dévotement le visage contre terre, comme le doit tout
pieux serviteur du Prophète en quelque lieu qu'il se
trouve.
Nos valets de chambre, Hassan et son fils Ali, sont
originaires de la haute Egypte. Ali, garçon d'une
quinzaine d'années, a même, à un
degré frappant, le caractère égyptien
tel que nous l'ont conservé les anciennes statues et
les bas-reliefs du temps des Pharaons. C'est une remarque que
nous ferons souvent dans ce pays : les moeurs, les usages, le
type humain lui-même semblent avoir à peine
changé depuis plusieurs mille ans. Du reste, nos
valets de chambre, à eux deux, n'en valent pas un
médiocre : c'est la paresse, l'insouciance et la
gaucherie même. Hassan s'est cassé un bras,
étant jeune, pour échapper au service
militaire. Il fait faire ce voyage à son fils pour
achever son éducation : le jeune garçon est
fiancé et doit se marier au retour. Nicolô,
notre cuisinier, est à lui seul plus actif que tout le
reste de l'équipage. Grec de naissance, en sa
qualité d'Européen il ne fraie pas avec les
matelots, qui se vengent de ses allures aristocratiques en
lui jouant de temps en temps quelque mauvais tour. Il a une
physionomie étrange et porte de formidables
moustaches, qui lui donnent un air de don Quichotte. Mais
sous ce masque un peu farouche, c'est un excellent homme,
très empressé à nous complaire, et assez
bon cuisinier, ce qui même sur le Nil n'est pas
à dédaigner.
Il a été convenu que, pour profiter du vent
tant qu'il sera favorable, nous ne nous arrêterons en
remontant qu'autant qu'il sera nécessaire pour
renouveler les provisions. C'est seulement en redescendant le
fleuve que nous visiterons les ruines et les tombeaux qui se
trouvent sur divers points, le long de ses rives.
Aujourd'hui on ne descendra pas à terre. Nous nous
associons sans trop de peine au far niente des
matelots. Assis à l'ombre de la voile, nous regardons
fuir le rivage, et nous laissons aller nos pensées au
gré de l'imagination ou de la causerie. Bien des
journées se sont passées ainsi, doucement
rêveuses, à voir couler les flots paisibles du
Nil, à contempler ses paysages si pleins de charmes
dans leur monotone mais majestueuse grandeur, et, je puis le
dire, aucune de ces journées ne nous a paru
longue.
Après les heures de rêverie, il y a les heures
d'étude. Nos Américains, qui ne parlent pas le
français avec une grande facilité,
éprouvent le besoin de s'isoler de temps à
autre, ce qui laisse à chacun une liberté dont
tout le monde se trouve bien. Malgré la
différence des moeurs qui, d'Américains
à Français et surtout d'Américaines
à Françaises, fait toujours obstacle à
une grande intimité, je crois que nous n'en ferons pas
moins très bon ménage. M. P*** est un homme
charmant : doux, poli, d'un caractère facile et
souvent enjoué, il n'a rien de son compatriote, le
Yankee de l'Amérique du Nord. C'est un planteur de la
Caroline, qui a reçu une éducation
distinguée et employé ses loisirs à
cultiver son esprit.
17 décembre.
Vers le soir, nous abordons à un petit village
où Agostino achète des provisions. Après
deux jours de navigation, c'est un plaisir de descendre
à terre. Un bois de palmiers et de mimosas entoure le
village. Nous y chassons des pigeons et des tourterelles qui
s'y trouvent en grand nombre. Je tue aussi quelques jolis
oiseaux, d'un vert d'émeraude, de la grosseur d'une
perruche, et dont je ne sais pas le nom. Les pauvres
bêtes, qui ne sont jamais chassées, se laissent
approcher sans défiance : j'espérais les faire
empailler par Agostino, qui en sa qualité de drogman
sait à peu près tous les métiers ; mais
il n'a pas les ingrédients nécessaires.
J'ai dit ailleurs qu'on a, en Egypte, pleine licence de tirer
les pigeons qui volent par milliers autour des villages. Bien
que logés par les habitants, ce sont, à vrai
dire, des oiseaux sauvages. Attirés par nos coups de
fusil, les hommes du village s'approchent peu à peu de
nous. Aucun d'eux n'a une apparence hostile. L'expression de
leur visage est généralement douce ; plusieurs
sont remarquables par la vigueur du corps et la beauté
sévère des traits. Les enfants ramassent les
pigeons abattus, et nous les rapportent pour avoir un
bakchich. Les hommes nous demandent de la poudre ; c'est le
cadeau qui leur fait le plus de plaisir, car presque tous ont
un fusil.
Les femmes aussi nous entourent : elles examinent
curieusement la toilette de nos compagnes de voyage, les
bijoux, les voiles, les chapeaux de paille. L'effet des
crinolines paraît surtout les intriguer beaucoup.
Leur toilette, à elles, est des moins
compliquées : c'est une sorte de sarrau, ou
plutôt une longue blouse de coton bleu ouverte sur la
poitrine, qui est le plus souvent à découvert.
Quelquefois elles portent des bracelets ou des colliers de
verroteries ; souvent un anneau d'argent passé dans la
narine droite. Quelques-unes de ces femmes se voilaient
à demi le visage ; mais la plupart, moins
sévères que dans les villes, laissaient la
figure complètement découverte. L'une d'elles,
grande fille de quinze à seize ans, pouvait passer
pour le type de la beauté des femmes fellahs : de
grands yeux noirs et brillants, le nez droit et bien fait, la
bouche forte mais d'une forme gracieuse, et laissant voir des
dents qui brillaient comme des perles sur son teint d'un brun
doré ; le bas du visage seulement un peu lourd, et, ce
qui est une coquetterie chez elles, le front et le menton
légèrement tatoués de bleu. Sa
physionomie, vive et ouverte, exprimait l'intelligence et la
douceur.
On rencontre beaucoup de femmes aussi jolies que cette jeune
villageoise ; mais leur beauté, tout à fait
épanouie de douze à quatorze ans,
décline promptement après cet âge ; la
plupart sont mères avant de l'avoir atteint. A vingt
ans, elles sont fanées ; elles sont vieilles à
vingt-cinq.
Les enfants sont affreux jusqu'à six ou sept ans. Ils
vont entièrement nus jusqu'à cet âge, ont
le ventre ballonné, la peau blême, la mine
chétive et repoussante. Un préjugé
bizarre et déplorable empêche qu'on ne les lave
: c'est par crainte du mauvais oeil ; moins sales et moins
laids, ces enfants attireraient les regards des passants, et
parmi ces regards il pourrait s'en trouver de funestes.
Victime de cette absurde coutume, ils ont ordinairement les
yeux chassieux et couverts d'une quantité de mouches
qu'on ne songe pas seulement à chasser. On comprend
que cette malpropreté favorise singulièrement
les ravages de l'ophthalmie.
18 décembre.
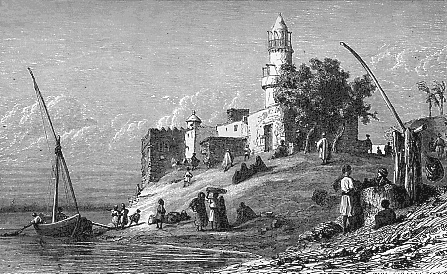 |
Nous passons, sans nous arrêter, devant
Beni-Souef, petite ville située sur la rive
gauche du fleuve : de loin, avec les massifs de verdure que
surmontent ses minarets, elle offre un coup d'oeil gracieux
et pittoresque.
Le vent faiblit un peu, surtout vers le soir ; et les
matelots sont obligés de tirer la barque à la
cordelle, lorsque les bords du fleuve le permettent. Nous
descendons alors à terre, et nous les suivons,
tantôt en chassant, tantôt en nous promenant
lentement le long des champs de dourah qui sont nouvellement
moissonnés. Les paysans sont occupés en ce
moment à battre la récolte : ce travail se fait
en plein champ. Le bruit cadencé du fléau nous
reporte en imagination à l'été de notre
pays. La pureté du ciel, l'ardeur du soleil ajoutent
à l'illusion. Mais pour le reste, rien ne nous
rappelle la fraîche vallée de la Loire.
Les paysages du Nil, un peu monotones au premier aspect, sont
cependant empreints d'un charme auquel on n'échappe
pas. Ils ont, dans la grandeur des horizons, dans
l'austère beauté des lignes, quelque chose qui
saisit et émeut, comme la campagne de Rome. Souvent
c'est la même désolation et la même
mélancolie ; c'est le même contraste de la
solitude présente avec le mouvement et la vie
d'autrefois. Ce grand fleuve dont la source est encore un
mystère et qui ne ressemble en rien aux fleuves de
notre Europe, ce ciel d'une inaltérable pureté,
cette nature sévère, tout concourt à la
majesté du tableau. Chaque détail ajoute
à l'effet de l'ensemble. Les misérables
habitants des villages, à peine couverts de haillons,
portent ces haillons avec tant de noblesse naturelle, que de
loin, montés sur leurs chameaux ou conduisant leurs
buffles, ils ont l'air de vieux patriarches. Les femmes, qui
viennent au bord du fleuve puiser l'eau dans des cruches de
forme antique qu'elles posent gracieusement sur
l'épaule, ont dans leurs longs voiles, avec leur
démarche fière et grave, quelque chose de
biblique.
Le Nil, comme contenu par des digues gigantesques, coule
entre deux chaînes de montagnes qui s'étendent
parallèlement du sud au nord. Ces montagnes de roches
calcaires, nues, brûlées,
dépouillées de toute espèce de
végétation, sont cependant harmonieuses de
forme et de couleur. Les dattiers et les mimosas sont
à peu près les seuls arbres qui croissent dans
la vallée. Partout où Ton voit de loin
s'élever leurs massifs d'un vert sombre, on est
sûr que quelque petit village se cache et se blottit en
quelque sorte sous leur ombrage. Le palmier est un bel arbre,
d'un port élégant et majestueux ; mais, quoique
la variété de ses attitudes et de ses groupes
le rende moins uniforme à l'oeil qu'on ne le suppose
ordinairement, sa beauté cependant a quelque chose
d'un peu triste et qui s'harmonise à merveille avec le
désert dont il est le seul ornement.
C'est surtout le soir, au coucher du soleil, que ces paysages
du Nil nous apparaissaient dans toute leur splendeur. Nous
dînions de bonne heure pour ne rien perdre de ces
magnifiques spectacles que, pendant un mois, nous ne nous
sommes jamais lassés d'admirer. Lorsque le soleil
avait disparu derrière l'horizon, le ciel s'embrasait
tout à coup et prenait des teintes d'or vif qui
illuminaient tout le paysage et se reflétaient sur les
grandes nappes d'eau du Nil : peu à peu cette teinte
devenait plus ardente, plus empourprée, puis, passant
par tous les tons de l'orangé, finissait par se perdre
dans des nuances d'or pâle. Bientôt
d'innombrables étoiles s'allumaient au ciel, et une
nuit brillante, une nuit des tropiques semblait continuer le
crépuscule. Les matelots psalmodiaient leur chant
monotone ; l'eau murmurait autour de la barque, qui filait
silencieuse, pareille à un grand oiseau de nuit ; et
nous restions plongés dans une muette contemplation
jusqu'à l'heure où la fraîcheur du soir
nous avertissait de nous arracher à ce dangereux
plaisir.
Quand ils ne tirent pas la barque à la halée,
ce qui est rare, nos matelots, inoccupés, chantent
assis en rond au pied du grand mât et s'accompagnent en
frappant des mains. Leur chant traînant et d'un rhythme
monotone, comme celui des peuples primitifs, n'a pourtant
rien de désagréable : il y a dans ces
mélodies enfantines je ne sais quel charme secret en
rapport avec le calme qui nous entoure.
Quelquefois ils écoutent des histoires que raconte
l'un d'eux. Il y en a un surtout qui a le privilège de
les amuser : c'est un singulier personnage, bavard, bruyant,
turbulent, nous l'avons surnommé le loustic, et
c'est là vraiment la fonction dont il s'acquitte le
mieux. Il parle avec une volubilité inouïe, et
conte des histoires qui n'en finissent pas, mais qui
provoquent toujours, dans son auditoire attentif et
charmé, des exclamations bruyantes et des
éclats de rire prolongés.
Ni le reïs ni le timonier ne prennent part à ces
joies vulgaires : leur grandeur et surtout leur devoir les
attachent sur la dunette. Notre timonier est un beau jeune
homme de vingt à vingt-cinq ans. Drapé dans son
burnous, il a souvent, en s'accoudant à la barre de
son gouvernail, une fierté d'attitude qu'admirerait un
statuaire. C'est un Nubien, parfaitement noir. Son turban
blanc et son burnous de même couleur font encore
ressortir l'ébène de sa peau. Mais tout noir
qu'il est, son visage est d'un type très pur et d'une
expression intelligente et douce. Les Nubiens, en effet, ne
ressemblent aux nègres que par la couleur : leurs
lèvres sont épaisses, mais bien
dessinées ; le nez est long et droit, le front n'est
pas déprimé, et surtout (caractère
essentiel) les cheveux ne sont pas laineux.
Quant au marmiton, il bourre la pipe unique de
l'équipage, et regarde gravement bouillir la marmite.
Ses fonctions ne sont pas lourdes, et n'exigent pas une
science culinaire bien profonde. Elles se bornent à
faire tremper dans de l'eau quelques morceaux de biscuit
noir, et à faire cuire des lentilles et des oignons :
le tout mêlé ensemble forme une espèce de
pâte assez semblable à celle dont on nourrit
chez nous les dindons. Assis sur leurs talons autour d'une
large écuelle de bois, les matelots prennent avec les
mains chacun leur part de ce festin. Je dois dire à la
décharge des convives qu'ils se lavaient presque
toujours les mains dans le fleuve, avant et après le
repas.
Lorsque nous avons fait bonne chasse, nous leur abandonnons
une certaine quantité de pigeons : c'est alors grand
régal à bord. Ils rapportent aussi de leurs
excursions dans les villages des cannes à sucre, dont
ils sont très friands et qu'ils mâchent cour en
exprimer le jus.
Nous commençons à voir sur les rives du fleuve,
et sur ses îles de sable, des quantités
innombrables d'oies et de canards sauvages, de pluviers, de
pélicans et de hérons. Mais nous ne pouvons
tuer qu'un petit nombre de ces oiseaux : ils sont difficiles
à approcher, et il faudrait des armes à longue
portée que nous n'avons pas.
En revanche, il nous vient tous les jours sur la cange des
visiteurs charmants : ce sont de jolies bergeronnettes qui se
posent sur les bords de la barque, courent en voletant sur le
pont, et s'enhardissent jusqu'à venir dans notre
cabine et presque sous nos pieds becqueter les miettes de
pain que nous leur jetons.
19 décembre.
La vallée du Nil se rétrécit tellement
que bientôt le fleuve baigne le pied même de la
chaîne Arabique. La montagne abrupte qui le borne de ce
côté s'appelle en arabe Djebel el-Theyr
(montagne des Oiseaux). Rongés par le flot qui les
noircit à leur base, ces rochers ressemblent à
d'énormes scories, et sont percés
d'innombrables cavités où se nichent les
oiseaux qui leur ont donné leur nom, et dont la fiente
les a marqués par endroits de larges taches blanches.
Au sommet de la montagne, on remarque de grossières
constructions ; c'est un couvent de Coptes. Plusieurs
religieux se promènent au-devant. A peine ont-ils
signalé notre barque sous pavillon européen,
que nous les voyons quitter précipitamment leurs
vêtements, et, complètement nus, accourir au
bord de la falaise qui s'élève à pic sur
le fleuve. Agiles comme des singes, ils se laissent glisser
le long du rocher, descendent par des cavités, et se
jettent à la nage. Bientôt ils entourent notre
barque en nous criant : Bakchich, cristiani. On
s'empresse de leur donner ce bakchich pour les
éloigner au plus vite, la présence des dames ne
permettant pas de les recevoir à bord. Ces malheureux,
qui ne vivent que des aumônes qu'ils recueillent ainsi
près des Européens en spéculant sur leur
titre de chrétiens, font peu d'honneur à leurs
coreligionnaires. Hassan, qui se pique d'être un
fervent musulman, nous dit en les regardant avec un
dédain superbe : Son cristiani. Hélas !
les pauvres gens, comme beaucoup de Coptes schismatiques des
bords du Nil, n'ont guère de chrétien et de
religieux que le nom.
Du côté de la chaîne Libyque, la
vallée est très étendue, et offre
l'aspect d'une riche campagne couverte de verdure : ce sont
des champs de blé, de fèves, de trèfle,
de lin, de cannes à sucre. Sous un climat aussi sec,
qui n'est rafraîchi que par les rosées de la
nuit, on comprend qu'un arrosement artificiel peut seul
développer cette opulente végétation.
Mais le système des irrigations est ici primitif comme
tout le reste : il n'a pas changé depuis
Sésostris. C'est le travail de l'homme qui fait
presque tout.
La grande difficulté, la seule, est d'élever
l'eau du fleuve au niveau de sa rive. Comme la pente,
grâce à une heureuse disposition qui est due
sans doute aux alluvions annuelles, s'en va de chaque
côté en s'abaissant à mesure qu'on
s'éloigne du fleuve, rien n'est plus simple, une fois
l'eau élevée sur la rive, que de la diriger de
là jusqu'aux extrémités de la
vallée à l'aide de rigoles. Mais la rive est
très haute ; à l'époque de
l'année où nous sommes, les eaux sont
généralement à quatre ou cinq
mètres au-dessous du niveau des terres ; et
bientôt elles seront plus bas encore. Les cultivateurs
riches font établir au bord du fleuve des roues
à chapelet, appelées sakiehs, que font
tourner des ânes ou des boeufs.
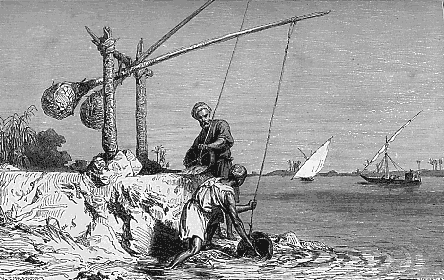 |
Mais les pauvres fellahs, qui n'ont que leurs bras, font
manoeuvrer des chadoufs : c'est tout simplement un
panier de cuir attaché à
l'extrémité d'une bascule ; un contre-poids
fixé à l'autre bout enlève le panier
quand il a plongé dans le fleuve. L'eau est
déversée dans une rigole, ou bien, si la berge
est trop haute, dans un réservoir où une autre
chadouf vient la prendre. Il y a quelquefois deux, trois et
quatre de ces bascules étagées l'une au-dessus
de l'autre. En général, un homme suffit
à chacune : on a calculé qu'une chadouf pouvait
puiser à peu près cinquante litres d'eau par
minute. Cette machine est assurément l'a b c de la
mécanique ; et les peintures retrouvées sur les
tombeaux égyptiens prouvent que, depuis plus de trois
mille ans, elle est en usage aux bords du Nil. On n'a pas
songé à la perfectionner : malgré les
conquêtes, malgré les révolutions,
l'homme ici ne change pas plus que la terre. Dans les petites
choses comme dans les grandes, l'Orient est immobile ; il
faut que le progrès lui vienne du dehors.
Les sakieks ne tournent guère que la nuit, pour
épargner aux animaux qui les font mouvoir la grande
chaleur du jour : souvent nous entendons retentir au loin
dans les ténèbres le cri plaintif de leurs
rouages, qui ne sont jamais graissés. Mais les hommes
se ménagent moins qu'ils ne ménagent leurs
boeufs. Tant que dure le jour, on les voit, d'un mouvement
régulier, mécanique, infatigable, abaisser tour
à tour et relever le seau de cuir de leurs chadoufs ;
rude labeur sous ce soleil implacable : même en cette
saison, nous avons, à l'ombre une température
de vingt-cinq à trente degrés
centigrades.
Cette race des fellahs, on le voit, ne manque ni de vigueur
physique ni d'énergie morale. C'est même un
miracle que l'oppression séculaire sous laquelle elle
gémit n'ait pas brisé en elle tout ressort et
effacé toute vertu. Le fellah n'a jamais
été ni pu être propriétaire de la
terre qu'il cultivait. Bien plus, sous
Méhémet-Ali, il n'avait pas le droit,
l'impôt payé, de vendre à d'autres qu'au
pacha, et à un autre prix qu'au prix fixé par
le pacha, l'excédant de ses récoltes. Quant
à la perception de l'impôt et aux
corvées, ç'a toujours été en
Egypte le plus effroyable système de concussion qui
puisse dévorer un peuple. A la tête de chaque
province était un moudyr ou gouverneur, dont la
première préoccupation était de se
maintenir le plus longtemps possible dans la faveur du
vice-roi ; et la seconde, de s'enrichir le plus vite
possible, dans la crainte d'être remplacé par un
plus puissant. De là d'impitoyables exactions.
L'impôt était établi, non par tête,
mais par village, et tous les habitants du village
étaient solidairement responsables de son
acquittement. Les plus riches payaient pour les pauvres, pour
les paresseux, pour les absents, pour les fugitifs ; les
terres cultivées, pour les terres en friche. La
confiscation, la prison, la bastonnade étaient les
moyens ordinaires de perception. Si un village était
insolvable, le fardeau de ses impositions retombait sur les
villages voisins : c'était un axiome du gouvernement,
que l'Etat ne peut perdre. Mas on imagine bien que tout cet
argent n'entrait pas dans les coffres de l'Etat : la
meilleure partie en restait aux mains des fonctionnaires
intermédiaires. Pour compléter ce
système d'exactions, de violence et de dilapidation,
ajoutez la tyrannie locale du cheik el-beled ou chef
de village, répartiteur de l'impôt, de la
corvée, du recrutement militaire, despote au petit
pied qui mettait naturellement son pouvoir sans
contrôle et sans limite au service de ses vengeances ou
de sa cupidité personnelle, et vous aurez une faible
idée de l'état où était,
naguère encore, réduite cette
société.
Saïd-Pacha, le vice-roi actuel, a introduit, en montant
sur le trône, quelques réformes dans
l'administration des provinces : ainsi le pouvoir du cheik a
été restreint ; l'impôt est devenu
personnel, et il se paie par l'intermédiaire d'un
receveur spécial. On voudrait croire que ces
réformes existeront ailleurs que sur le papier ; mais
on sait trop qu'en Orient, si les apparences changent, les
hommes et les moeurs ne changent guère ; et sous la
main du receveur comme saus celle du chef de village, il y a
lieu de craindre que le pauvre fellah ne soit toujours
rançonné et bâtonné.
Un bienfait réel, toutefois, ç'a
été la remise faite par le pacha de
l'arriéré des impôts qui, depuis
longtemps, pesait d'un poids écrasant sur les
villages, et servait de prétexte à loute sorte
de malversations. Mais, de toutes les réformes
accomplies, la plus efficace, la plus féconde sans
doute pour l'avenir, a été l'abolition du
monopole qu'avait établi Méhé-met-Ali.
En renonçant au monopole, le gouvernement a admis par
là même le paiement des impôts en argent :
d'un autre côté, le fellah, libre de vendre ses
denrées à qui il veut et au prix qu'il veut,
peut réaliser maintenant un certain
bénéfice sur l'exploitation de la terre qu'il
cultive ; il peut dès lors s'élever à un
certain bien-être, et même de degré en
degré arriver jusqu'à être
propriétaire. Plusieurs, dit-on, le sont
déjà. Si la propriété parvenait
à se constituer en Egypte, ce serait sans doute une
immense amélioration dans le misérable
état de cette société. Où la
propriété n'existe pas, il n'y a de place et de
garantie ni pour l'indépendance ni pour la
dignité individuelle.
C'est en naviguant sur le Nil qu'on peut bien juger de la
nature du sol de la vallée. La berge, comme je l'ai
dit, est le plus souvent coupée à pic ; si bien
qu'on a, jusqu'à une assez grande profondeur, comme la
tranche de toutes les couches géologiques qui l'ont
constituée. Imaginez une sorte d'argile brune ou
noirâtre, compacte, mais grasse et comme onctueuse au
toucher : pas une pierre, pas un caillou, pas une veine de
sable ou de gravier. Sous l'action de la chaleur, cette terre
se fend profondément : on a quelquefois peine à
marcher dans les champs à travers ses larges
crevasses. Au bord du fleuve dont le courant la
délaie, elle s'écroule par blocs qui affectent
une forme cubique, et qui, grâce à leur couleur,
imitent à s'y méprendre des blocs de pierre
noire.
20 décembre.
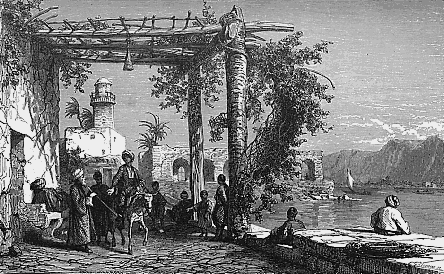 |
Le vent est toujours favorable. Nous passons devant
Minieh, ville assez importante, située à
quelque distance du Nil. De vastes champs de cannes à
sucre l'entourent. Nous apercevons de loin les
cheminées de plusieurs raffineries appartenant
à des pachas.
Vers le soir, le vent devient si violent, que nous sommes
obligés de nous arrêter. Nous avons à
franchir, en effet, un bras du Nil qui passe au pied d'une
montagne abrupte et escarpée. Le courant est rapide ;
et les matelots arabes sont si maladroits, qu'avec un vent si
fort il ne serait pas prudent de s'aventurer dans ce passage
pendant la nuit. L'équipage ne demande pas mieux, au
surplus : les barques du Nil ne marchent pas la nuit
d'ordinaire ; et l'activité qu'Agostino a fait
déployer à nos hommes depuis cinq jours
commence à leur peser.
21 décembre.
Nous croisons une cange sous pavillon prussien. Elle nous
rend coup pour coup le salut que nous lui faisons. Sur le
Nil, tout Européen est un compatriote pour un
Européen, et personne ne s'affranchit de ces
règles de politesse traditionnelle. Je me trompe : les
Anglais, qui portent partout leur morgue, ne saluent,
même sur le Nil, que les gens qui leur sont
présentés. Nous en fîmes nous-mêmes
l'expérience plus tard. Un jour que nous redescendions
le fleuve, au retour de la haute Egypte, une cange qui
portait le pavillon britannique passa près de nous.
Comme elle remontait, c'était elle qui devait le salut
: silence absolu. Notre compagnon de voyage, M. P***, qui en
sa qualité d'Américain était un peu
Anglais de coeur, voulut pousser la politesse au delà
de ce qui était dû : il salua de deux coups de
feu, et je dois dire qu'il en fut pour ses frais de poudre et
de politesse.
Cette journée a été plus chaude que les
autres. Nous sentons que nous approchons de la haute Egypte.
Depuis que nous avons quitté le Caire, à peine
quelques légers nuages blancs, aussitôt
dissipés, se sont-ils montrés sur l'azur
inaltérable du ciel. Les aspects du Nil, toujours
magnifiques, sont plus variés : tantôt il court
profond et rapide, resserré entre de hautes rives
ombragées de grands bois de palmiers ; tantôt il
s'élargit en nappes étincelantes qui entourent
mollement des îlots de verdure.
22 décembre.
Dans la nuit, nous sommes arrivés à la hauteur
de Syout. C'est la capitale de la haute Egypte : elle est
située à une demi-lieue environ dans les
terres. Le petit village où nous abordons lui sert de
port. Comme il faut renouveler la provision de pain
épuisée, Agostino nous annonce que nous ne
repartirons que dans l'après-midi : une bonne nouvelle
pour nous, qui commençons à avoir besoin
d'exercice. Le fusil sur l'épaule, nous nous
acheminons vers la ville. La route, élevée en
chaussée au milieu d'une vallée couverte des
plus riches cultures, est plantée de beaux arbres, de
gommiers, de mimosas en fleur, qui répandent dans
l'air leurs senteurs pénétrantes. La
matinée était magnifique. Un léger
brouillard enveloppait encore la base de la chaîne
Libyque, au pied de laquelle est bâtie la ville.
Dorée par le soleil levant, la montagne élevait
ses cimes roses au-dessus de cette brume transparente, tandis
que, plus à droite, les minarets blancs de Syout
s'élançaient du milieu d'épais massifs
de feuillage. Des groupes pittoresques de fellahs qui se
rendaient à la ville animaient la route. Des centaines
de tourterelles roucoulaient dans les arbres ; des troupeaux
de buffles paissaient dans les hautes herbes des prairies, et
au milieu d'eux erraient familièrement des ibis
blancs, qui recherchent leur société et se
perchent souvent sur leur dos. Tout cela était plein
de caractère, de calme et de fraîcheur.
Nous pénétrâmes dans la ville par une
porte fortifiée, flanquée de deux tours
massives, et nous nous trouvâmes alors sur une petite
place au fond de laquelle est une mosquée. D'immenses
sycomores y versaient une ombre profonde. Il y avait
là, assis, sur leurs talons, le long des murs, de
vieux Turcs qui fumaient ; plus loin, des derviches,
prosternés du côté de l'orient, faisaient
dévotement leurs prières. Quelques furtifs
rayons de soleil, glissant à travers
l'épaisseur du feuillage, jetaient sur cette
scène tranquille comme un réseau mouvant
d'obscurité et de lumière. Nous avons parcouru
quelques rues de la ville : l'aspect en est pauvre, mais
assez original. Le temps nous manque pour aller jusqu'au
bazar, qu'on dit assez curieux; au retour, sans doute nous y
ferons une visite.
Nous repartons vers deux heures. Agostino nous a fait faire
du pain. Mais quel pain ! il me rappelle les galettes de
blé noir que mangent nos paysans bretons. A Syout on
ne peut avoir mieux. Nous en prenons bravement notre parti,
et nous y substituons, comme on fait en Orient, du riz cuit
à l'eau.
24 décembre.
Depuis Syout, le vent du nord est devenu plus régulier
encore : c'est ce qui arrive à mesure qu'on s'avance
dans la haute Egypte. Nous nous apercevons aussi, surtout
quand nous descendons à terre, que la
température s'est sensiblement élevée.
Pourtant nous n'avons encore pas vu de crocodiles, quoiqu'ils
commencent, dit-on, à se montrer dans ces parages.
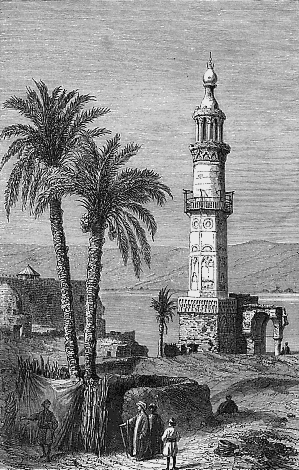 |
On touche à Girgheh, pour acheter un mouton
et des poules. Cette petite ville, assez importante par son
commerce, est située sur le bord même du Nil,
qui la ronge et chaque année en emporte un lambeau.
Près de l'endroit où notre barque est
amarrée, une mosquée a coulé dans le
fleuve ; sa coupole éventrée surplombe
au-dessus de la rive. Plus d'une maison a pris la même
route, et bien d'autres la suivront. Rien de plus
étrange et rien de plus triste que cette ville,
dévorée en quelque sorte par le fleuve qui la
mine incessamment. Ce qui est plus triste encore, c'est que
personne ne fait rien pour arrêter ou seulement pour
retarder le désastre : population et gouvernement
assistent impassibles à cette destruction. Pas une
pierre n'est jetée pour consolider les terres ; pas un
effort n'est tenté pour détourner le courant.
Du reste, ce spectacle n'est pas rare le long du Nil. Les
plantations de palmiers font seules obstacle aux
envahissements dont les villages sont quelquefois
menacés, quand le courant du fleuve se déplace.
Les racines chevelues de ces arbres forment une espèce
de lacis inextricable qui résiste à l'action
des eaux ; et quand, sapés profondément, ils se
sont écroulés, on voit leurs troncs immenses
qui, renversés sur la berge, protègent encore
contre le flot la terre qu'ils n'ombragent plus. Si quelque
part vous apercevez un bout de quai, de chaussée, de
digue qui resserre le fleuve, vous pouvez gager qu'il y a
là, auprès, quelque habitation de pacha : on ne
fera rien pour empêcher une ville de périr ; on
jettera des millions pour protéger le palais d'un
prince.
Nous avons chassé autour de la ville ; mais
bientôt la chaleur nous a forcés de rentrer. En
attendant l'équipage, qui s'est attardé au
café, nous regardons de notre cange la soène
animée de la rive. Des enfants, nus comme des
sauvages, jouent au bord de l'eau et se roulent dans la
poussière. Les buffles, les chameaux viennent
s'abreuver au fleuve ; et les filles du village, grandes et
sveltes, y viennent emplir leurs amphores. Un vieux Turc,
à la barbe grise, coiffé d'un turban vert et
vôtu avec une certaine recherche, vient s'asseoir sur
notre cange et converser avec le reïs : il fume une pipe
magnifique, peinte de couleurs brillantes, et dont le long
tuyau est orné de fils d'argent et de soie. C'est un
marabout, un saint du voisinage, en grande
vénération dans le pays.
A la tombée de la nuit, nous nous arrêtons
devant un petit village : nous allons coucher là. Deux
hommes fournis par le cheik de ce village doivent passer la
nuit à bord : ils répondent de nous et de notre
barque. C'est une mesure de police à laquelle on n'est
pas libre de se soustraire ; et je serais presque
tenté d'y voir une sorte d'impôt levé sur
les voyageurs, car une rétribution est due aux deux
gardiens que fournit le village.
On jouit maintenant sur le Nil d'une complète
sécurité. Nos revolvers et ceux qu'Agostino a
toujours à côté de lui quand il dort sur
le pont, roulé dans son manteau, ont été
jusqu'à présent, et seront probablement pendant
tout le voyage un luxe inutile. Il faut dire qu'il n'en a pas
toujours été ainsi. Dans les parages où
nous sommes, il y avait autrefois des tribus de
Bédouins qui, de temps en temps, ne se faisaient pas
scrupule, comme leurs frères du désert, de
dévaliser les voyageurs. Mais
Méhémet-Ali les a corrigés de ces
habitudes. Il y a trente à quarante ans, une cange qui
attendait, non loin d'ici, des Anglais venant de Koceïr,
fut attaquée pendant la nuit par les hommes d'un
village voisin : l'équipage fut massacré, la
barque pillée. Le pacha fit brûler le village,
et pendre au bord du fleuve tous les hommes qui s'y
trouvaient. Cette justice un peu turque, mais
énergique, a produit effet ; et onques depuis on n'a
ouï parler d'un autre attentat de ce genre. C'est,
dit-on, à la suite de ce fait, que les cheiks de
village furent astreints de fournir des hommes de garde aux
canges amarrées dans leur voisinage : le village tout
entier est alors responsable des dommages qu'elles pourraient
souffrir.
25 décembre.
Le ciel, légèrement voilé de vapeurs
blanches, annonce un jour de calme et de chaleur. Vers dix
heures du matin, en effet, le vent cesse complètement,
les voiles retombent le long des mâts. On amarre la
barque au bord d'une grève. Nous descendons, et nous
essayons de poursuivre des oiseaux d'eau. La chaleur est si
forte, qu'il nous faut mettre habit bas. Las bientôt
d'une poursuite inutile, nous revenons sans avoir rien
tué qu'un pluvier et un ibis. Cet ibis, dont j'ai
déjà parlé et qu'on voit en
quantité dans toute l'Egypte, n'est pas l'ibis
sacré des anciens : celui-ci, qu'on ne trouve plus que
dans le Soudan, avait le cou nu, le plumage doré, les
ailes noires. L'oiseau qu'on appelle maintenant de ce nom est
une espèce de héron blanc, le héron
garde-boeuf, ainsi nommé parce qu'il suit toujours les
bestiaux dans les prairies et souvent se perche sur leur
tête ou leurs épaules. Il est d'une
familiarité extrême, et se promène
presque entre les jambes des cultivateurs qui travaillent aux
champs.
Les matelots se sont couchés sur le sable et dorment
au soleil. Nous nous asseyons sur la grève, à
l'ombre de la grande voile, qui est restée tendue sur
sa vergue. L'un de nous dessine une petite barque turque,
arrêtée près de la nôtre, et dont
les matelots raccommodent leurs voiles. En face de nous, de
l'autre côté du Nil, les montagnes de la
chaîne Libyque, coupées carrément
à leur sommet, ressemblent à de colossales
fortifications ; elles ont cette teinte dorée dont le
soleil revêt ici tout ce qui ne se couvre pas de
végétation. Sur leurs pentes, dans les larges
anfractuosités de la roche, brillent des masses
blanches qui font aux yeux une singulière illusion ;
à cette distance, on croirait voir des neiges
entassées. Ce sont des sables accumulés par le
vent, et dont la blancheur sous ce ciel étincelant
imite les neiges éternelles des Alpes. Plus d'une fois
déjà nous avons été
frappés de cette singularité.
Pendant que nos yeux charmés errent sur ces montagnes
d'une si chaude couleur, sur la plaine verdoyante qui
s'étend à leurs pieds, sur ce beau fleuve qui
coule large et paisible comme un lac et où se
réfléchit l'azur pâle d'un ciel sans
nuage, notre pensée se reporte involontairement vers
la France. C'est aujourd'hui le jour de Noël : c'est le
temps des brouillards glacés, le temps des neiges et
des frimas. Il nous semble d'ici entrevoir le pays natal
à travers un épais rideau de brume, sous un
manteau de givre et de glace. N'étaient les
chères affections qu'on a laissées
là-bas et qui arrachent toujours un soupir, quelle
joie, quelle volupté de respirer à pareil jour
cette tiède atmosphère, de s'épanouir
aux rayons bienfaisants de ce soleil, d'admirer ce calme
paysage qui semble baigné d'une lumière plus
douce que celle de nos climats ! Je le sais, rien ne tient
lieu de la patrie ; mais qu'est-ce qui tient lieu du soleil ?
Le soleil, n'est-ce pas la vie, pour l'homme comme pour la
nature ? n'est-ce pas la santé, la joie, la
poésie ? Heureuses les hirondelles, qui tous les ans
peuvent voler vers lui, et revenir tous les ans au nid qui a
abrité leurs amours !
La journée tout entière se passe dans un calme
plat. Notre impatience est grande pourtant d'arriver à
Thèbes, dont nous ne sommes plus
éloignés que de quelques lieues : demain sans
doute nous toucherons au but.
Mais tandis que chacun se laisse aller aux douceurs du loisir
forcé que nous fait le calme, une activité
inaccoutumée règne à l'avant de notre
cange. Depuis hier il nous semble qu'Agostino et le cuisinier
machinent quelque complot ténébreux. Les
moustaches de Nicolo sont plus allongées et plus
menaçantes encore que de coutume. Nous avons
bientôt le mot de l'énigme. L'heure du
dîner est venue, et nous nous asseyons, non sans
surprise, devant un véritable festin :
pâtisserie, dinde rôtie, entremets
raffinés, rien n'y manque. Nos maîtres
d'hôtel ont combiné leurs talents pour nous
festoyer en l'honneur de la Noël. Au second service,
Agostino apporte triomphalement un gigantesque pouding.
Ce mets national est surtout à l'intention de nos
compagnons de voyage : chez les Américains, comme en
Angleterre et en Allemagne, on sait que la Noël est la
fête populaire et de famille, comme chez nous le
premier jour de l'an. Nous nous associons à cette
attention délicate de notre drogman, et nous vidons
à la santé de nos compagnons quelques
bouteilles de vin de Champagne prudemment apportées du
Caire.
26 décembre.
Quoique le vent soit très faible, nous marchons un peu
à la voile, un peu à la halée. Nos
matelots, qui voient le terme de leurs fatigues, s'attellent
à la corde avec plus de courage. Nous coucherons ce
soir à Louqsor.
Les bords du fleuve sont magnifiques ; les palmiers et les
mimosas, plus nombreux, et plus grands. Tout à coup,
vers le soir, on nous montre sur la rive qui est à
notre gauche, au-dessus des dômes sombres d'un bois de
palmiers, deux masses énormes d'architecture qui
s'élèvent, comme deux collines blanches, sur
l'horizon : ce sont les pylônes du palais de Karnac.
Voilà Thèbes ! Le soleil se couche, en face de
nous, dans des flots d'or, et jette comme une auréole
sur le front de ces ruines imposantes.
Vers dix heures du soir, la barque s'arrête. Nous
sommes à Louqsor. De petites lumières brillent
tout le long du fleuve : ce sont des canges de touristes
amarrées au quai. La nuit est belle et douce ;
impatients de contempler ces rivages célèbres,
nous descendons à terre, ou plutôt nous
gravissons la berge élevée qui borde le Nil de
ce côté. Le village est à quelques
centaines de pas de nous. Un splendide clair de lune jette
ses lueurs fantastiques sur les colonnes d'un temple à
demi écroulé ; un obélisque gigantesque
raie de sa ligne noire la voûte étoilée
du ciel.
De petits âniers, à peine vêtus, veulent
nous mener tout de suite aux ruines, et nous fourrent presque
leurs bêtes entre les jambes, tout en épuisant
pour nous séduire leur vocabulaire étranger.
«Bon baudet, Monsieur ! - Karnac, Signor ! - Beautiful,
splendid, Milady !» Ces derniers mots surtout sont
prononcés avec un accent anglais d'une pureté
à toucher le plus roide gentleman. Nous restons sourds
cependant à cette éloquence polyglotte, et nous
nous débarrassons à coups de canne des
ânes et des âniers.