Chapitre 8 - Thèbes - Gournah - Le
Rhamesseum
Les livres égyptiens - Le colosse de Memnon
Le 27 au matin nous étions debout de bonne heure,
éveillés par une curiosité qui
n'était pas sans émotion. La matinée
était calme, l'air doux et limpide, le ciel de cette
pureté incomparable qui est le privilège de la
haute Egypte. Ici plus de brouillards, même sur le
fleuve ; point de nuages qui voilent l'éclat du soleil
: quant à la pluie, c'est un phénomène
à peu près inconnu. Lorsqu'il tombe, par
aventure, quelques gouttes d'eau de ce ciel toujours serein,
les enfants sortent aux portes, comme chez nous pour admirer
une éclipse ou une aurore boréale.
J'ai dit que la rive est très haute du
côté de Louqsor ; si bien que du pont de la
cange nous ne voyons rien que le fleuve. Mais à peine
montés sur le quai, nous avons devant les yeux un
spectacle saisissant. En face, le soleil se lève
derrière un majestueux portique formé d'une
double rangée de colonnes ; à
l'extrémité de cette colonnade se dresse un
obélisque ; tout alentour sont entassées les
huttes basses d'un village, surmonté de ses
pigeonniers blancs criblés de trous : c'est Louqsor et
son palais. Vers le nord, en descendant le fleuve,
derrière d'épais massifs d'arbres,
s'étendent les ruines de Karnac, que nous avons
saluées hier en passant.
En nous retournant, nous embrassons d'un regard toute la rive
gauche du Nil, et nous pouvons d'ici, à vol d'oiseau,
prendre une idée générale de ces ruines
immenses semées sur un vaste espace.
La vallée a ici, d'une chaîne de montagnes
à l'autre, quatre à cinq lieues de largeur. La
ville de Thèbes était assise sur les deux rives
: on suppose que la communication se faisait d'une rive
à l'autre par un pont de bateaux, car l'on n'a
retrouvé aucun vestige de pont en pierres. La
véritable ville, la ville d'Ammon occupait la rive
droite, la rive orientale où nous sommes : la ville de
la rive gauche confinait à la nécropole,
laquelle était placée, comme toutes les
nécropoles, à l'occident : l'occident est la
région des morts.
Sur cette rive gauche, qui forme une large plaine toute
revêtue en ce moment de moissons verdoyantes, trois
groupes de monuments se montrent à de grands
intervalles. A droite et tout au nord, on distingue le petit
temple de Gournah : il fait face à Karnac ; plus haut,
en remontant le fleuve, un vaste monument que Champollion a
appelé, du nom de son constructeur Rhamsès, le
Rhamesséum ; tout à côté,
au milieu de la plaine, les deux colosses, dont l'un est
celui de Memnon, et qui ressemblent à d'énormes
tours ; puis enfin, en remontant encore vers le sud, un grand
amas de ruines qui porte le nom d'un village voisin,
Médinet-Abou. Derrière ces trois groupes de
constructions, et parallèlement au fleuve,
s'étend la chaîne Libyque : ses flancs, jaunes
et décharnés, sont creusés de grottes
funéraires ; ce sont les tombeaux des particuliers.
Enfin, dans une vallée étroite qui s'enfonce au
delà de Gournah dans le massif des montagnes, se
trouvent les tombeaux des rois, vastes catacombes
excavées dans le rocher.
Voilà ce qui reste de l'antique Thèbes, la
cité sainte, la rivale opulente de Memphis et de
Babylone : quelques monceaux de débris épars
dans une plaine qu'elle couvrait jadis de ses palais et de
ses temples.
Centum jacet obruta portis.
Déjà, il y a dix-huit siècles,
Juvénal cherchait dans le sable les vestiges de ses
cent portes dont parle Homère. Aujourd'hui, son nom
même, ce nom qui a rempli le monde, ne vit plus que
dans l'histoire. Jamais sans doute il n'a frappé
l'oreille des misérables fellahs qui habitent parmi
ses ruines ; et dans la langue des hommes qui foulent sa
poussière sacrée, la cité des Pharaons
n'a plus, hélas ! d'autre nom que le nom barbare des
villages de boue qui se sont élevés à
l'ombre de ses murailles à demi renversées par
les siècles.
Nous devons rester six jours à Louqsor. Ce n'est pas
trop pour voir et revoir, même en simples curieux, ces
incomparables monuments. Il est convenu que nous
commençons par la rive gauche. Agostino a
déjà traité avec un chef d'âniers,
qui nous fournira des montures et nous servira de guide. Nous
aurions voulu que lui-même pût nous accompagner ;
mais il est retenu par la nécessité de
renouveler les provisions de toute sorte, et aussi, je le
crois, par le désir de veiller sur la barque et de
protéger son bien et le nôtre.
A neuf heures, le canot nous conduit sur la rive gauche.
Mais, les eaux étant très basses, on ne peut
approcher du bord : les matelots nous prennent sur leurs
robustes épaules et nous portent à terre.
Là nous attendait, comme une proie, une bande
d'âniers qui se disputent d'avance l'honneur et le
profit de nos préférences. Heureusement nos
montures sont choisies, et Giuseppe (c'est le guide avec
lequel Agostino a traité) nous délivre de toute
importunité. On ajuste sur le dos de deux baudets les
selles anglaises que nous avons pris la précaution
d'apporter du Caire pour les dames. Mon frère caracole
sur un assez beau cheval arabe. M. P*** et moi
préférons nos pacifiques ânes. Tout le
monde est en selle ; nous partons. Giuseppe trotte devant sur
son baudet, fier comme un pacha ; nos âniers suivent,
toujours courant.
Après avoir traversé le lit sablonneux et
desséché d'un bras du Nil, nous entrons dans
une plaine coupée de canaux de dérivation et
sillonnée de rigoles qui portent au loin dans les
cultures l'eau fécondante du fleuve. Les champs
voisins de la rive sont dépouillés de leurs
récoltes. Plus loin sont des champs immenses de
froment semé il y a quelques semaines, et qui couvre
déjà la terre d'une riche verdure. Nous
chevauchons à la file, tantôt dans des sentiers
qui traversent les jeunes blés, tantôt sur des
digues étroites qui longent les canaux d'irrigation.
Nous passons à gué plusieurs de ces canaux.
Toute cette plaine, parfaitement cultivée, est de
l'aspect le plus riant. Quelle terre ! Quel climat ! Il me
semble voir, dans cet étroit espace, toutes les
saisons réunies : sur nos têtes, un ciel
d'été ; au bord du fleuve, les champs
moissonnés de l'automne ; dans la plaine, le vert
tapis des blés du printemps. L'hiver seul est
absent.
Tous les hommes qui, autour de nous, travaillent à la
terre sont complètement nus, sauf un pagne
étroit à la ceinture ; et c'est un spectacle,
je vous assure, fort singulier que celui d'un grand gaillard,
a la peau couleur de bronze, qui dans cet équipage
sommaire conduit gravement sa charrue, attelée de deux
boeufs étiques. Cette charrue, primitive comme le
costume de celui qui la mène, se compose tout
simplement d'un hoyau renversé, qui écorche la
terre à quelques centimètres de profondeur. Les
peintures qui se voient encore sur les monuments attestent
qu'elle était il y a trois mille ans ce qu'elle est
aujourd'hui.
Après une heure de marche environ, nous entrons sous
un bois de palmiers où se cache à demi un petit
village : c'est Gournah. Là finit la vallée ;
le sol se relève ; c'est la limite des eaux dans
l'inondation, et par là même c'est le
commencement du désert. Quelques tombeaux de santons
semblent placés là comme sur la
frontière de la vie et de la mort. Au delà
s'ouvre une gorge d'un aspect désolé,
encombrée de roches calcinées : c'est la
vallée des Tombeaux des rois. Sur la gauche, au pied
de la montagne, nous apercevons à travers les palmiers
le palais de Gournah. Ce palais a eu pourfondateur un Pharaon
que Champollion appelle Ménephtha, et que les travaux
récents désignent sous le nom de Séthos
Ier, chef de la dix-neuvième dynastie. Son fils,
Rhamsès II ou Rhamsès-Meïamoun, dit le
Grand, le Sésostris des Grecs, l'acheva et le
décora. C'est un des moindres monuments de
Thèbes pour l'étendue : ce n'est pas le moins
remarquable pour l'élégance, les proportions et
la beauté des sculptures. Dix colonnes
composées de faisceaux de tiges de lotus, dont les
boutons tronqués forment le chapiteau, supportent un
portique haut de dix mètres, long de cinquante. Cette
façade est d'un bel effet, simple et
sévère : on dirait presque un temple grec. Une
inscription, gravée sur l'architrave en beaux
caractères hiéroglyphiques, faisait
connaître par quel prince le palais a été
achevé.
Du portique on passe dans une salle dont les plafonds sont
formés d'énormes blocs de pierre, reposant sur
deux rangs de colonnes. Des sculptures couvrent les murailles
et les colonnes de cette salle : elles représentent le
Pharaon faisant hommage aux dieux et recevant d'eux la
puissance royale. Celles d'une salle voisine, achevée
par Rhamsès, accusent déjà dans le style
une certaine décadence.
Cet édifice était à la fois un palais et
un temple : ou plutôt c'était un palais
dédié par la piété des rois
à la grande divinité de Thèbes et de
toute l'Egypte, Ammon-Ra, qui n'était autre que le
soleil. Les dernières découvertes de la science
ont mis, en effet, hors de doute ce point important que le
soleil, considéré comme le principe de vie,
comme le grand générateur, était le dieu
suprême de l'Egypte, et en réalité le
seul qui reçût un culte dans toutes ces
provinces. Ce dieu, les Egyptiens le personnifiaient, comme
les Aryas ou Aryens, en plusieurs divinités, selon les
divers attributs qu'ils lui prêtaient. Ainsi, à
son lever, il était adoré sous le nom de Ra;
à son coucher, sous celui de Tmou ; comme
créateur, sous celui de Cheper. Sous le nom de Horus
enfant, il symbolisait le monde naissant.
Ammon-Ra, le père ou le principe mâle, Mouth, la
mère ou le principe femelle, et Kons, le fils,
formaient la grande triade thébaine,
vénérée aussi, comme Amrnon, dans toute
l'Egypte.
Au-dessous de ce culte général qui s'adressait
à la grande force vivifiante de la nature, il y avait,
dans chaque province, dans chaque ville, un culte particulier
et local. Ici on adorait le crocodile ou le loup ; là,
l'épervier ou le boeuf ; ailleurs, le chat ou l'ibis :
c'étaient là de grossiers fétiches
inventés par la superstition populaire. Mais il semble
que partout l'influence de ce culte supérieur,
répandu par un corps sacerdotal puissant, se soit fait
sentir pour épurer plus ou moins ce fétichisme,
en le rattachant à la religion d'Ammon ou du soleil,
et à ses croyances sur la vie et la mort et sur la
transmigration des âmes.
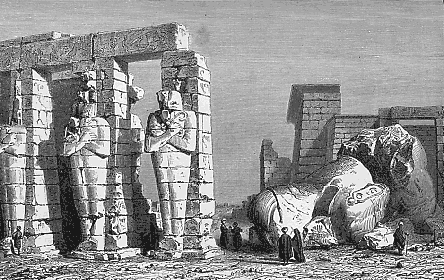 |
Un quart d'heure de marche à peu près nous
conduit, en allant vers le sud, à un groupe de ruines
bien autrement imposantes que celles de Gournah. Elles furent
longtemps connues sous le nom de Memnonium. Les
savants de l'expédition d'Egypte crurent y retrouver
ce fameux tombeau d'Osymandias, dont Diodore de Sicile a fait
une si merveilleuse description, qui contenait une immense
bibliothèque, avec cette inscription : Officine de
l'âme, et ce cercle astronomique en or de trois cent
soixante-cinq coudées de circonférence et d'une
coudée d'épaisseur. Mais aujourd'hui le tombeau
d'Osymandias et son cercle d'or semblent
relégués au rang des fables que la
crédulité des Grecs a recueillies de la bouche
des prêtres égyptiens. Ce qui est certain, c'est
que nulle part le nom de ce roi ne se rencontre sur cet
édifice, et que partout Charopollion y a lu celui de
Rhamsès le Grand, d'où il s'est cru, à
bon droit, autorisé à l'appeler le
Rhamesséum.
C'est en effet Rhamsès, dont le souvenir est partout
dans ces ruines de Thèbes, qui a élevé
ce monument magnifique, moitié temple, moitié
palais, comme celui de Gournah, et sur les murs duquel il est
partout représenté rendant hommage à
Dieu ou recevant les adorations de sa race. Deux
pylônes gigantesques précèdent la suite
des salles et des cours dont se compose le palais. L'un d'eux
s'est à demi écroulé dans la plaine,
comme une colline soulevée de sa base. Toutefois on
peut encore monter par un escalier intérieur
jusqu'à son sommet, et là on commence
déjà à se faire une idée de cette
architecture prodigieuse qui entassait des montagnes de
pierre pour en encadrer la porte d'un palais.
Derrière ces pylônes, l'oeil distingue à
gauche du temple un monceau de blocs de granit rose : ce sont
les débris de la fameuse statue monolithe de
Sésostris. Ce colosse, représentant le roi
assis sur son trône, avait vingt-six mètres de
haut au-dessus du piédestal. On a calculé qu'il
devait peser deux millions de kilogrammes. Le pied, qui est
intact, a plus de deux mètres de longueur. C'est
assurément la plus prodigieuse statue qui ait
été faite d'un mortel. La matière en est
admirable, et le poli qu'elle a reçu de l'ouvrier,
malgré sa dureté, ne l'est pas moins. Comment
cette statue a-t-elle été renversée et
fendue en trois morceaux ? C'est une question qu'on ne peut
s'empêcher de se faire en contemplant ces monstrueux
débris. Aucune cause naturelle, aucun accident
fortuit, pas même un tremblement de terre, ne peut
expliquer la chute d'une masse si formidable. La main des
hommes a dû s'y employer. Mais comment ont-ils
brisé et précipité le Pharaon de granit
? C'est ce qu'on ne peut dire.
Le Rhamesséum est peut-être le plus pur
spécimen qui nous soit resté de l'architecture
égyptienne. Sa première enceinte était
fermée, sur les deux faces principales, par deux
portiques que soutenaient des cariatides gigantesques. Il est
impossible de rien voir de plus imposant que cette double
façade ornée de ces grandes figures en pied,
taillées dans la pierre même du monument, et
empreintes de noblesse et de douceur. J'ai été
frappé ici pour la première fois de ce
caractère des statues égyptiennes.
Malgré leurs dimensions colossales et la roideur de
leurs attitudes, elles n'ont rien dans l'expression de dur ni
de menaçant : tout au contraire. Si l'on n'y trouve
pas l'élégance, la pureté de lignes et
la beauté harmonieuse des statues grecques, elles n'en
ont pas moins une beauté à elles : un
demi-sourire est sur leurs lèvres ; l'intelligence et
la majesté rayonnent sur leur front ; leurs traits
expriment la sérénité, et je ne sais
quelle grâce naïve et austère. C'est le
repos dans la force ; c'est la bonté dans la puissance
suprême. Partout ce même caractère se
montre sur leurs figures de rois ou de dieux.
Le plus beau morceau de ces admirables ruines est la salle
hypostyle, ornée encore de trente colonnes d'une
élégance qui serait assurément de nature
à surprendre ceux qui se figurent que l'architecture
égyptienne est toujours lourde et massive. C'est dans
cette salle que se célébraient, en
présence du roi, les panégyries,
c'est-à-dire les assemblées politiques ou
religieuses. Sur les parois et sur les colonnes sont
sculptés d'innombrables bas-reliefs peints, car la
peinture semble avoir toujours été aux yeux des
Egyptiens le complément obligé de la sculpture
et de l'architecture. Ces bas-reliefs racontent les exploits
de Rhamsès le Grand. On voit le roi,
représenté deux fois plus grand que ses
ennemis, debout sur son char, l'arc tendu à la main,
dans une attitude pleine de force et de majesté. Un
lion court à ses côtés ; ses chevaux
bondissent et hennissent. Il y a dans ces tableaux, avec un
défaut frappant de proportion et de perspective, des
qualités réelles de vie et de mouvement.
Parmi les appartements particuliers, Champollion a reconnu
l'entrée d'une bibliothèque ou salle des
livres. Sur les jambages de la porte sont sculptées
deux divinités, qui sont : à gauche, le dieu
des sciences et des arts, l'inventeur des lettres, Thoth
à tête d'ibis ; et à droite, la
déesse Safré, compagne de Thoth, portant le
titre remarquable de Dame des lettres et
Présidente de la bibliothèque. Ces
divinités sont suivies de deux assesseurs, dont l'un,
qui porte un grand oeil sur la tête, personnifie le
sens de la vue, dont l'autre, qui porte une grande oreille,
représente le sens de l'ouïe, et qui
écrivent tout ce qu'ils voient et entendent.
Les Egyptiens avaient donc des livres, et, les fables
même relatives au tombeau d'Osymandias l'attestent, ils
avaient aussi des bibliothèques. Qu'on songe seulement
que nous sommes ici en présence d'une antiquité
de quinze à seize cents ans avant l'ère
chrétienne ! Du reste on n'est pas sur ce point
réduit à des conjectures tirées des
monuments. Quelques-uns de ces livres, sous la forme de
rouleaux de papyrus, sont parvenus jusqu'à nous. Les
musées de l'Europe en possèdent un assez grand
nombre ; et, bien qu'ils soient plus difficiles encore
à déchiffrer que les inscriptions
hiéroglyphiques, étant écrits en
caractères hiératiques ou abréviatifs,
on commence à les lire. Les uns sont des livres
religieux, des rituels funéraires, des recueils de
prières, etc. ; les autres sont des poèmes
historiques destinés à célébrer
les exploits et les victoires des Pharaons. C'est toute une
littérature qui semble sortir de la nuit du
passé, et qui ne peut manquer d'apporter à
l'histoire de précieuses révélations.
Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple mais qui est du plus
haut intérêt, des papyrus lus pour la
première fois en Angleterre, il y a peu
d'années, par un ministre protestant, le
révérend Heath, et contemporains du
Pentateuque, relatent des faits qui se rapportent visiblement
à Moïse et à la sortie des Hébreux
de l'Egypte. Un passage de ces textes fait une allusion
évidente à la mort du Pharaon et de son
armée noyés dans la mer Rouge : c'est une
lettre écrite par le bibliothécaire en chef du
palais à un scribe royal.
«Le chef des gardiens des livres de la chambre blanche
du palais, Amenemani, au scribe Pentéhor :
Quand cet écrit te sera parvenu, et que tu l'auras lu
de point en point, livre ton coeur à l'agitation la
plus vive, semblable à la feuille devant l'ouragan, en
apprenant le désastre accompli, déplorable et
fait pour toucher ton coeur, par les calamités de la
submersion dans l'abîme. Malheureuse fut la
pensée du souverain et fatale pour lui, de prendre les
esclaves en commisération au jour du fléau !
L'esclave, le serviteur, est devenu le chef d'un peuple qu'il
tient en sa puissance. L'obstacle à sa
rébellion est détruit par derrière,
comme en avant l'obstacle à ses déportements...
Le puissant triomphait dans son coeur en voyant
s'arrêter l'esclave. Son oeil les touchait, son visage
était sur leur visage ; sa fierté était
au comble. Tout à coup le malheur, la dure
nécessité s'emparent de lui.
Oh ! répète l'assoupissement dans les eaux qui
fait du glorieux un objet de pitié ; dépeins la
jeunesse moissonnée dans sa fleur, la mort des chefs,
la destruction du maître des peuples, du roi de
l'Orient et du couchant ! Quelle nouvelle peut-on comparer
à celle que je t'envoie ?»
D'autres textes contiennent des allusions plus ou moins
directes au caractère de Moïse, à
certaines circonstances de sa vie, et au pouvoir que son
éloquence lui avait donné sur son peuple.
«Par la lumière de la face d'Horus ! cet homme
est un magicien, car toutes ses volontés sont
irrésistibles. Qu'il est habile à
enchaîner le misérable peuple de Sem ! qu'il est
habile à lui tracer sa loi ! Il met le puissant parmi
les répudiés, l'opprimé parmi les
puissants. C'est l'enfant qui n'a dû son existence
qu'à ceux qui l'ont sauvé dès le sein de
sa mère. Il s'élance pourtant pour faire des
hommes ses instruments.
Peins le scribe sauveur d'un peuple tombé en esclavage
et faisant les transports pour toute espèce de
constructions... Représente-le avec l'énergie
de la constance dans la direction du gouvernail ;
réussissant à fasciner ; ne faisant pas
dégénérer l'action de son
autorité en oppression ; agissant sur les masses. Il
se manifeste au peuple de la race de sa mère, et se
sépare de son supérieur. C'est l'enfant qui
enlève le joug de la réprobation,
l'opprimé qui devient puissant, le maître dans
l'art de séduire.
Sa marche est pleine de ruse. Combien de
dextérité brille dans sa conduite ! Puisse la
puissance de la flamme dévorer ce scribe ! Qu'à
son crime réponde le châtiment, élevant
la colère de chacun contre l'enfant
rebelle».
Je m'arrête : ces citations m'entraîneraient trop
loin. Elles suffiront du moins pour montrer quel puissant
intérêt s'attache à ces textes, et quels
rapprochements inattendus et décisifs ils
présentent avec nos Livres saints. Je ne suis pas
d'ailleurs si loin de Thèbes qu'on pourrait le croire
: tout à l'heure, en sortant de la bibliothèque
de Rhamsès II, nous allons nous trouver face à
face avec le Pharaon même dont le scribe Amenemani
vient de raconter l'assoupissement dans les eaux.
Non loin du Rhamesséum, et quand on a traversé
un petit bois de mimosas aux fleurs jaunes et odorantes, on
rencontre un vaste terrain tout couvert de cultures, et
où sont semés, à demi enfouis dans le
limon du Nil, à demi cachés parles hautes liges
de fèves ou de maïs, d'innombrables débris
de colonnes et de statues. On y a reconnu les fragments de
dix-huit colosses de granit rose ou noir, dont plusieurs
avaient jusqu'à six mètres cinquante
centimètres de hauteur. Ces ruines sont celles d'un
groupe de monuments, aujourd'hui disparus, qu'on a
appelé Aménophium, du nom de leur
fondateur Aménophis III, de la dix-neuvième
dynastie, fils et successeur de Rhamsès le Grand.
C'est sous le règne de ce prince que paraît
avoir eu lieu la sortie d'Egypte par les Hébreux.
Aménophis avait bâti deux palais, l'un à
Louqsor. l'autre ici. Il y a encore à Louqsor des
restes considérables du premier ; du second, il ne
subsiste plus rien que des vestiges informes.
 |
Je me trompe : il en reste deux monuments uniques, et de
l'aspect le plus étrange. A quelques centaines de pas
de là, au milieu des champs de blé,
s'élèvent ces deux colosses dont l'un est
devenu si célèbre sous le nom de statue de
Memnon. Rien de plus extraordinaire et, il faut le dire,
de plus imposant que ces deux figures dressant au-dessus de
l'horizon leur front mutilé et, du haut de leur
trône de pierre, semblant comme les génies de la
vieille Egypte, régner encore sur cette vallée
où fut une cité populeuse, et qui n'est plus
qu'un vaste sépulcre. Comme on n'a vu nulle part rien
de pareil, l'esprit est étonné et comme
dérouté ; il semble qu'on soit en
présence de quelque chose de surhumain ; et volontiers
on prendrait ces monstrueuses sculptures pour les images d'un
peuple de géants qui aurait
précédé sur la terre les hommes
d'aujourd'hui et bâti les monuments qui nous
entourent.
Qu'était-ce que ces statues ? Que faut-il croire
surtout de cette fameuse statue de Memnon qui rerrdait aux
premiers rayons du soleil des sons harmonieux ? Il n'est
peut-être pas de point d'histoire sur lequel il se soit
élevé plus de discussions et de
systèmes. Ce qu'on a écrit de volumes
là-dessus, entassé en pyramide, formerait une
masse aussi haute que la statue. Les hiéroglyphes lus
par Champollion sur les socles des deux colosses, ont mis
hors de doute qu'ils étaient tous deux le portrait en
pied du même roi : ce roi est l'Aménophis dont
nous venons de parler, et qui, pour décorer la
façade de son palais de la rive gauche, avait
élevé à l'entrée ces deux images
de sa royale majesté. Le Pharaon est
représenté assis, les mains étendues sur
les genoux, dans l'attitude du repos.
Les statues, formées chacune d'un seul bloc de
grès, reposent sur des piédestaux de cinq
à six mètres de hauteur, qui sont un peu
enfouis maintenant dans la vase du Nil. Quelques chiffres
donneront une idée de leurs dimensions : leur hauteur
au-dessus du piédestal est de seize mètres ;
les jambes ont six mètres de la plante des pieds
au-dessus du genou ; le pied a deux mètres de long et
un mètre d'épaisseur.
Les deux statues sont tristement mutilées. Celle qui
est le plus au sud a toute la partie antérieure de la
tête brisée : on ne distingue plus que les
oreilles et une partie de la coiffure.
Le colosse du nord, celui de Memnon, est plus
défiguré encore. Un tremblement de terre le
fendit par le milieu, vers l'époque de Néron :
toute la partie supérieure du corps, depuis la
ceinture, s'écroula. Septime-Sévère
ordonna qu'il fût réparé. Mais la
restauration se fit grossièrement et par des mains
bien peu dignes de toucher à ces merveilles du
génie égyptien. Les maçons de
Septime-Sévère ont tout simplement, à
grands coups de moellons, bâti sur ce qui restait de la
statue une construction qui imite à peu près la
forme d'une tête humaine.
Ce qu'on peut admirer encore, dans ces étranges
monuments, ce sont les bas-reliefs et les hiéroglyphes
sculptés sur les piédestaux avec une grande
perfection de ciseau, et dont Champollion disait que
c'étaient des camées d'un pied de haut ; ce
sont aussi les figures accessoires, sculptées dans le
bloc, à droite et à gauche des jambes du
Pharaon.
Il y a des touristes pleins de foi qui ont encore le courage
de se lever avant le jour pour aller, aux pieds de Memnon,
guetter l'instant où les premiers rayons du soleil
viennent le frapper, dans l'espoir d'entendre ce fils
harmonieux de l'Aurore saluer sa mère de ces sons
mystérieux que l'antiquité a entendus avec
admiration. Mais, hélas ! depuis longtemps, depuis des
siècles, la statue est muette. Un des Arabes qui nous
accompagnent grimpe jusque sur les genoux du colosse, et en
frappant avec un caillou lui fait rendre un son qui a quelque
chose de vibrant et de métallique. C'est tout ce qui
reste de voix à la mélodieuse statue.
Il est impossible de douter cependant qu'à une
certaine époque se soit réellement produit ce
singulier phénomène, attesté par de
nombreux auteurs et par quantité d'inscriptions qui se
lisent sur la statue même. On a compté
jusqu'à soixante-douze témoins auriculaires, au
nombre desquels sont l'empereur Adrien et
l'impératrice Sabine, qui déclarent dans ces
inscriptions avoir ouï eux-mêmes la merveille.
L'étude de ces inscriptions et des textes anciens a
fourni à un illustre savant français, M.
Letronne, la solution du problème. Il est
arrivé à cette curieuse conclusion, que le son
produit par la statue n'a commencé à se faire
entendre que sous le règne de Néron,
c'est-à-dire après que le tremblement de terre
eut fendu le monolithe ; et qu'il n'a plus été
entendu après que Septime-Sévère eut
fait réparer la statue : double fait qui s'accorde
parfaitement avec les données de la physique. En
effet, la vibration sonore, due vraisemblablement à la
brusque transition du froid de la nuit à la chaleur du
jour (transition très rapide et très
marquée dans ces climats), et devenue possible par la
fracture de la pierre, a cessé de l'être quand
une lourde maçonnerie a été
superposée à la statue brisée. De ce
phénomène naturel, l'imagination des Grecs
avait fait cette fable de Memnon, fils de l'Aurore, qui
saluait sa mère au lever du jour, et des oracles que
rendait sa statue vocale. Ce nom de Memnon lui-même,
nom d'un héros homérique, n'avait
été si singulièrement appliqué
à la statue du Pharaon Aménophis que par suite
d'une de ces méprises que les Grecs commirent souvent,
dans la préoccupation qui leur faisait retrouver
partout leur mythologie et leurs légendes
poétiques : à Thèbes, le quartier
où se trouvait le colosse s'appelait le
Memnonium ou les Memnonia (de Mennou, en
égyptien grand monument) ; ils en conclurent
que la statue était celle de Memnon, fils de l'Aurore
et roi des Ethiopiens.
Parmi les inscriptions grecques et latines, en prose et en
vers, qui couvrent une des jambes de la statue, quelques-unes
sont touchantes ou curieuses ; la plupart insignifiantes ou
ridicules. En voici quelques-unes :
«Titus Julius Lupus, préfet d'Egypte. J'ai
entendu Memnon à la première heure. Bon
présage !...»
«Funisulanus Charisius, stratège d'Hermontis
(sous le règne d'Adrien), natif de Latopolis,
accompagné de son épouse Fulvia. Il t'a
entendu, ô Memnon, rendre un son au moment où ta
mère éperdue honore ton corps des gouttes de sa
rosée».
Des vers grecs, pédantesques et
prétentieusement adulateurs, composés par une
femme poète de la cour d'Adrien, nommée
Babilla, apprennent à la postérité que
le colosse a daigné par trois fois saluer l'empereur,
roi du monde, et sa femme, l'impératrice Sabine.
Une inscription latine porte ceci : «Julius Tenax, de
la douzième légion, la Fulminante ; Valerius
Priscus, de la vingt-deuxième légion, et
Quintius Viator, décurion, ont entendu Memnon la
onzième année du règne de
Néron». Au-dessous, on lit en caractères
moins profonds : «Jean-Pierre Chouilloux, soldat de la
vingt et unième demi-brigade, a passé ici le 2
ventôse an VII».