Chapitre 9 - Thèbes (suite) - Medinet-Abou
Les fellahs et l'agriculture - Une soirée à
Louqsor
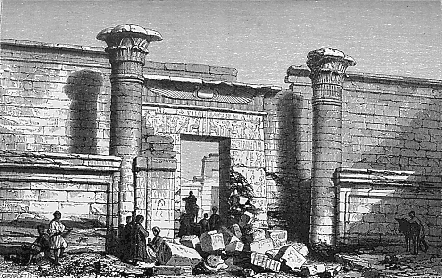 |
Pour en finir avec les monuments de la rive gauche, il
nous restait à voir un groupe considérable de
ruines, situé vers le sud : c'est
Médinet-Abou. Depuis longtemps
déjà, en cheminant dans la plaine, nous voyions
se détacher sur l'horizon les masses
sévères des propylées qui, du
côté du Nil, précèdent la suite
des temples et des palais. En arrière, un immense
entassement de hautes murailles couvrait toute une
éminence, au pied de la chaîne Libyque. Nous
n'avions encore rien vu d'aussi grand.
L'ensemble des ruines de Médinet-Abou se divise en
deux groupes principaux, qui datent l'un de Thouthmosis III,
de la dix-huitième dynastie, l'autre de
Rhamsès-Meïamoun. Mais par-dessus ces deux
groupes, et tout alentour, se sont ajoutés ou
superposés des monuments de moindre importance,
appartenant à toutes les époques
intermédiaires ou postérieures, et offrant en
quelque sorte, sur un seul point, comme un tableau complot et
un résumé de l'histoire politique et religieuse
et des vicissitudes sans nombre de l'Egypte.
Ainsi, au-devant d'un petit temple de Thouthmosis, qui
remonte à seize ou dix-sept cents ans avant notre
ère, est une cour extérieure construite par
Antonin, qui est représenté adorant la grande
trinité thébaine. Plus loin, on rencontre un
pylône élevé par les
Ptolémées ; au delà, une deuxième
cour où se lit le nom d'un roi éthiopien ;
puis, dans une des cours du palais de Rhamsès, se
voient gisantes des colonnes corinthiennes, débris
d'une église chrétienne qui avait
été adossée aux portiques du Pharaon et
qui a moins duré qu'eux. Les ruines d'un village
chrétien, qu'on croit du IVe siècle, se
montrent non loin de là. Une mosquée, qui avait
remplacé l'église, a disparu à son tour,
laissant sur les murs quelques versets du koran. Enfin, sur
les terrasses mêmes du palais, et sur ses
épaisses murailles, se sont perchées les huttes
d'un village arabe, aujourd'hui abandonné :
misérables ruines de boue qui souillent ces ruines de
grès et de granit, et qui ressemblent à des
végétations impures poussées sur
l'antique monument. Que de souvenirs accumulés sur cet
étroit espace ! que de générations de
rois et de peuples, de conquérants et de nations
conquises ! Les Ethiopiens, les Perses, les Grecs, les
Romains, les Arabes, ont passé sur cette terre comme
des flots, et chaque flot en passant y a déposé
son alluvion, témoin immortel de sa gloire d'un jour !
Les religions mêmes y ont laissé tour à
tour leur empreinte : aux pieux solitaires qui ont
illustré ces déserts de la Thébaïde
ont succédé les disciples de Mahomet ; mais si
l'humble chapelle élevée par les compagnons de
saint Jérôme et de saint Antoine s'est
écroulée, leur souvenir est encore pour nous
vivant sur ces rivages et semble encore peupler ces mornes
solitudes.
Franchissons les deux premières enceintes. Nous sommes
en présence d'un des monuments les plus curieux de la
vieille Egypte, unique peut-être dans son genre. Les
vastes constructions dont est semée la plaine de
Thèbes, celles qu'on admire sur tant d'autres points
de la vallée du Nil, sont toujours ou des temples ou
des palais destinés aux cérémonies, aux
assemblées, aux actes solennels enfin de la religion
ou de la vie publique des Egyptiens. Nulle part il ne reste
rien de leurs habitations privées. Ici c'est
précisément une habitation privée, ce
que nous appellerions une résidence royale ; c'est un
petit palais approprié à la vie domestique et
de famille. On l'appelle le Pavillon. Il a
été construit par Rhamsès.
L'architecture n'est pas sans élégance ; les
appartements sont petits, comme ceux qu'on voit à
Pompéi. Les ouvertures étroites, les plafonds
et les murs formés de blocs massifs, tout était
évidemment calculé pour défendre
l'intérieur contre les ardeurs tropicales du soleil.
Au dedans sont représentées, sur les parois des
murailles, des scènes de famille : on voit le Pharaon
servi à table par de jeunes filles ; il joue aux
échecs avec sa femme, et s'amuse avec ses
enfants.
Un grand pylône dont les bas-reliefs rappellent les
campagnes du roi Rhamsès donne accès dans une
première cour entourée d'une galerie que
soutiennent des cariatides, et dont le sol est jonché
de colonnes. On dépasse un second pylône, et
l'on entre dans une seconde cour, plus vaste, et qui est une
des merveilles de cette terre si féconde en
merveilles. Tout alentour règne un magnifique
péristyle soutenu par des colonnes. Les belles
proportions de ces colonnes à la fois puissantes et
légères et dont le chapiteau gracieux
s'évase en fleur de lotus, la hardiesse de la galerie
dont les plafonds massifs sont formés de blocs
énormes, donnent à ce monument admirablement
conservé un caractère saisissant de grandeur et
de majesté. Rien de plus imposant et de plus
harmonieux comme ensemble. Si vous pénétrez
sous la galerie, la richesse des détails et le luxe de
la décoration intérieure ajoutent à
l'étonnement. Comme d'habitude, les colonnes sont, du
haut en bas, couvertes de figures hiéroglyphiques ; la
paroi de la muraille qui fait face à la colonnade est
pareillement, dans toute sa largeur et sa hauteur,
revêtue de tableaux sculptés et peints.
Presque partout les couleurs appliquées sur les
sculptures, soit en creux, soit en relief, subsistent encore
avec leur éclat et leur vivacité
première. En beaucoup d'endroits, on les dirait
posées d'hier, tant elles sont fraîches et
brillantes. Le plafond, qui représente un firmament
semé d'étoiles, est particulièrement
d'une conservation merveilleuse. Jamais peuple n'a
appliqué sur une aussi grande échelle l'art de
l'architecture peinte ; et il faut convenir que, même
dans l'état de dégradation actuel, l'effet en
est vraiment grandiose. Toutes ces colonnes, toutes ces
murailles semblent comme animées et vivantes ; ces
longues galeries semblent remplies d'un peuple de rois, de
prêtres, de guerriers, et l'on croit voir se lever, de
dessous les dalles usées par les siècles,
toutes les pompes guerrières et religieuses des
Pharaons.
Ces peintures murales offrent une suite de scènes
où l'on voit le roi tantôt perçant ses
ennemis de flèches, tantôt assis sur son char
dans l'éclat du triomphe. Devant lui sont
entassées des mains coupées sur les vaincus ;
des soldats les comptent, tandis qu'un scribe, à
côté, en enregistre le nombre. Ici c'est une
ville prise d'assaut ; plus loin, un combat naval. Ailleurs
le Pharaon est encensé comme une divinité par
sa cour, par les prêtres et par les chefs de son
armée.
Dans un de ces tableaux, le roi est représenté
tenant d'une main par les cheveux un groupe de captifs, et de
l'autre levant une massue. On a voulu induire de ces
représentations, qui se retrouvent sur beaucoup de
monuments, que chez les anciens Egyptiens les sacrifices
humains étaient en usage. C'est une erreur. Ce groupe
hiéroglyphique n'exprimait autre chose que la
soumission absolue au vainqueur, le droit de vie et de mort
sur les vaincus. On voit la même scène sur
plusieurs temples de la haute Egypte, notamment celui
d'Edfou, qui ont été construits sous les
Ptolémées, époque où, sans nul
doute, les sacrifices humains étaient chose inconnue
sur les bords du Nil. Hérodote atteste que de son
temps ils ne l'étaient pas moins.
Les murailles extérieures de Médinet-Abou sont,
comme les murs intérieurs, couvertes de bas-reliefs
racontant les conquêtes de
Rhamsès-Meïamoun. Sur la paroi du sud est un
tableau très curieux ; c'est un calendrier
sacré, contenant l'indication des fêtes de
chaque mois. L'imagination recule effrayée à la
pensée de ce que représentent de travail ces
sculptures murales, qui revêtent des surfaces de
plusieurs kilomètres de développement, sur une
hauteur souvent considérable. Il semble que ces
oeuvres prodigieuses aient été un jeu pour les
Egyptiens. Cette profusion de sculptures et de peintures se
retrouve en effet partout. Il y en a des exemples incroyables
: ainsi on a calculé que le mur de circonvallation
d'un seul temple est décoré de cinquante mille
pieds carrés de sculptures religieuses et symboliques.
J'ignore combien il y en a à Médinet-Abou ;
mais l'étendue en est immense, et la perfection en est
partout la même.
Beaucoup de ces bas-reliefs sont enfouis sous des
décombres accumulés à une grande
hauteur. Champollion avait signalé sur un des
pylônes une grande inscription qui semblait contenir
des indications historiques importantes sur les
conquêtes de Rhamsès III. Il n'avait pu en lire
que la première colonne ; le reste était
enterré. Des fouilles pratiquées par un jeune
savant, M. Greene, ont mis récemment à
découvert le texte entier ; et notre illustre
compatriote, M. Emmanuel de Rougé, de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en a
donné une traduction qui a confirmé les
prévisions de Champollion.
Cette inscription est un long discours d'apparat que le
Pharaon adresse à ses sujets. Parmi beaucoup de
formules emphatiques, il y a cependant dans ce morceau une
certaine grandeur et un certain éclat poétique
qui, sauf l'inspiration religieuse, rappellent parfois la
Bible. Au début, on célèbre la vaillance
du monarque ; il est comparé «à un
coursier aux pieds valeureux qui s'élance comme les
astres dans la sphère du ciel». Plus loin, il
prend lui-même la parole. Après avoir
rapporté à son père, le dieu Ammon, tout
l'honneur de ses victoires, il énumère les
peuples qu'il a vaincus. «Je les ai pressés,
dit-il, de mon glaive victorieux. J'ai effacé ces
peuples et leurs pays, comme s'ils n'eussent jamais
existé...» Suit la description d'un combat
naval. «La flotte égyptienne paraissait sur les
eaux comme un mur puissant... Sur le rivage, les fantassins,
l'élite de l'armée d'Egypte, étaient
comme le jeune lion rugissant sur les montagnes... Quant
à moi, ajoute le Pharaon, j'étais vaillant
comme le dieu Mouth ; je restais à leur tête ;
ils ont vu les exploits de mes braves. J'ai agi comme le
héros qui connaît sa force, qui sort son bras et
défend ses hommes au jour du massacre. Ceux qui se
sont approchés de mes frontières ne
moissonneront plus dans ce monde ; le temps de leur âme
est compté pour l'éternité».
Nous avions peine à nous arracher du milieu de ces
ruines admirables. Des semaines, des mois entiers ne seraient
pas de trop pour les étudier, pour les parcourir
seulement avec quelque soin. Mais nous ne sommes pas des
érudits : ce que nous cherchons dans ces
débris, c'est l'empreinte du génie de la
vieille Egypte, c'est la physionomie de ses monuments, c'est
le caractère de son architecture ; et nulle part
peut-être ce caractère ne se montre plus
varié. Tout est réuni ici, la grandeur et
l'élégance, la majesté de l'ensemble et
la richesse des détails. Nous verrons à Karnac
des choses plus gigantesques, nous ne verrons rien de plus
achevé et de plus harmonieux.
Quelques fellahs à demi nus erraient au milieu des
décombres, conduisant de petits ânes
chargés de terre. On s'est aperçu que la
poussière des ruines contient une grande
quantité de salpêtre : le salpêtre vient
partout à la surface en efflorescence; et comme cette
poussière, mêlée à la terre
végétale, a une vertu très fertilisante,
les fellahs viennent la recueillir dans des paniers pour la
répandre dans leurs champs. La mine est riche, et ils
creuseront longtemps avant d'avoir enlevé les
montagnes de débris entassés dans les cours du
palais et autour de son enceinte. Dieu veuille que ce
travail, inspiré par le lucre, tourne au profit de la
science ! Quant au gouvernement, ce qu'il y a de mieux
à souhaiter, c'est qu'il continue de ne rien faire.
Chaque fois qu'il s'est occupé des ruines qui couvrent
ce pays, ç'a été pour hâter leur
destruction. Un Anglais avait indiqué à
Méhémet-Ali un moyen facile et
économique de se procurer le salpêtre dont il
avait besoin pour fabriquer de la poudre : ce moyen
consistait à l'extraire des pierres de vieux
monuments. Plus d'un palais de Thèbes auquel on a
appliqué cette ingénieuse recette a disparu
sous le marteau de ces barbares modernes. Mais le plus
barbare, ici, ce n'était pas le Turc.
Plusieurs des fellahs qui travaillent dans ces ruines
s'approchent de nous pour nous offrir des curiosités.
L'un d'eux nous montre un scorpion vivant, d'une taille
monstrueuse. L'été, ces animaux pullulent parmi
les débris, et leur piqûre est redoutable : on a
vu des hommes en mourir en quelques heures.
Je remarque que presque tous ces hommes ont le pouce ou
l'index de la main droite coupé. Déjà
plusieurs fois, au Caire et sur le Nil, cette
singularité m'a frappé. Notre guide m'explique
que c'est pour échapper au service militaire que ces
hommes se sont ainsi mutilés. Cette pratique n'est pas
nouvelle dans l'histoire du monde : et il semble que les
Romains eux-mêmes, ce peuple soldat, ne l'ignoraient
pas ; le mot de poltron dont nous nous servons n'a
pas, dit-on, une autre étymologie que pollex
truncatus, pouce coupé. Ce qui étonne ici,
ce n'est pas de voir des pouces coupés, c'est d'en
voir en si grand nombre : sur dix hommes, il y en a bien huit
qui ont la main mutilée ou un oeil de moins. Cela date
de Méhémet-Ali.
Méhémet-Ali, qui a tout fait pour l'Egypte, qui
l'a arrachée à l'anarchie, qui lui a
donné l'ordre intérieur et l'a
élevée presque à la hauteur d'une
puissance politique, n'avait opéré ce prodige
qu'en tendant outre mesure les ressorts du gouvernement sous
sa volonté implacable. Pour remplir son trésor
il avait mis la main sur les domaines particuliers,
s'était constitué l'unique propriétaire
du sol, et avait fait de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce son monopole exclusif. Pour assurer son
indépendance politique, il avait voulu avoir une
marine redoutable; il avait voulu surtout tenir sur pied une
armée respectable, et avait élevé
jusqu'à cent soixante mille hommes l'effectif de ses
troupes régulières : chiffre exorbitant, eu
égard à la population de ce pays, qui ne
dépasse guère trois millions. Non seulement il
était obligé, pour entretenir cette
armée, de lever tous les ans un nombre
considérable de recrues, mais il gardait
indéfiniment les hommes sous le drapeau. La guerre,
les maladies, les mauvais traitements, la nostalgie surtout,
faisaient d'effrayants ravages parmi ces pauvres conscrits,
enrôlés à coups de bâton, et
conduits enchaînés deux à deux jusqu'aux
dépôts, pour être de là
transportés en Arabie ou en Syrie : si bien qu'il
était presque sans exemple qu'un homme, une fois
enrégimenté, eût jamais revu ses
foyers.
On imagine aisément quelle répugnance, quelle
horreur, pour mieux dire, inspirait à cette
malheureuse population la pensée seule du service
militaire. Le fellah, doux et docile, n'est point soldat par
nature ; on l'arrache avec peine à ses champs et
à son fleuve natal. Les levées en masse qui se
faisaient dans les villages semaient au loin la terreur : les
hommes s'enfuyaient dans le désert, se cachaient dans
des souterrains ; mais les mauvais traitements exercés
sur les femmes et les enfants, la confiscation de leur vache
ou de leur âne, seule richesse de la famille, en
avaient bien vite raison.
De là ces mutilations dont nous voyons les traces. Les
choses en étaient venues à ce point que les
pères et les mères, par une cruelle
prévoyance, mutilaient leurs enfants au berceau ;
tantôt leur retranchant une ou deux phalanges d'un
doigt, tantôt leur crevant un oeil.
Aujourd'hui ces horreurs n'ont plus lieu. Le traité de
1841 a imposé à Méhémet-Ali une
réduction considérable de son armée. Son
successeur, Abbas-Pacha, l'a réduite encore,
préférant s'entourer de mercenaires albanais
qui lui formaient une garde dévouée, capable de
tous les crimes et docile à tous les caprices de son
despotisme digne de Néron ou de Caligula. Sous le
pacha actuel, l'armée ne se compose plus que de douze
à quinze mille hommes ; et la durée du service
n'est guère de plus de deux ans.
Il semble au reste que Saïd-Pacha n'ait une armée
que pour ajouter à l'éclat des fêtes
qu'il aime passionnément, ou pour lui servir d'escorte
dans les voyages continuels qu'il fait d'une de ses
résidences à l'autre. Contrairement aux
habitudes orientales et particulièrement à
celles de sa race, il est, en effet, presque toujours en
voyage. Ce besoin de mouvement est poussé chez lui
jusqu'à la manie : or, chaque fois qu'il se
déplace, il faut que toute son armée le suive.
Un jour qu'il était au Barrage, près du Caire,
il lui plut tout à coup de partir pour Bar-el-Beda, ce
palais qu'un caprice insensé d'Abbas a
élevé en plein désert sur la route de
Suez. Il fallut que l'armée l'accompagnât. Mais,
comme aucune mesure n'avait été prise ni aucun
ordre donné à cet effet, les soldats
bivaquèrent sans eau et sans abri dans une affreuse
solitude. La fatigue et le soleil en tuèrent en grand
nombre.
Cet esprit capricieux et follement fantasque, qui semble
attester l'incurable décadence de la famille de
Méhémet-Ali, s'était montré chez
Saïd-Pacha dès les premiers jours de son
règne. C'était en 1857. L'Europe apprit tout
à coup que le vice-roi conduisait une
expédition dans la haute Egypte et la Nubie. Quel en
était le but ? Nul ne le savait. Ce qu'il y a de plus
curieux, c'est qu'aujourd'hui encore on n'en sait pas
davantage. L'opinion la plus vraisemblable (et c'était
dès lors celle de toutes les personnes qui
connaissaient le mieux le pacha), c'est que
l'expédition n'avait effectivement aucun but
sérieux. L'événement le démontra
bien. A peine arrivé à Kartoum, la nouvelle et
florissante capitale du Sennaar, Saïd-Paeha revint
brusquement au Caire, laissant son armée
derrière lui ; et, pour se dispenser de la ramener, on
la licencia sur place ; de sorte que ces malheureux soldats,
abandonnés à eux-mêmes,
dénués de toutes ressources pour regagner leurs
foyers, périrent la plupart de misère le long
des chemins.
Pour revenir au bord du Nil, en quittant Médinet-Abou,
nous traversons de nouveau la riche plaine que nous avons
parcourue le matin. Çà et là se montrent
quelques palmiers-doums. Déjà nous en avions
aperçu quelques-uns sur les rives du Nil, depuis
Ghirgheh. C'est un arbre qu'on ne trouve ni dans la basse ni
dans la moyenne Egypte. Son aspect est bizarre, et son port
ne ressemble en rien à celui du palmier ordinaire ou
dattier. Son tronc lisse se divise en deux branches
principales, qui se subdivisent à leur tour, et dont
les rameaux ont aussi leurs bifurcations : ses feuilles sont
étalées en forme d'éventails.
J'ai pu observer, en cheminant à travers les cultures,
le système d'irrigation employé par les
fellahs. Quand la terre, que le soleil avait durcie, a
été légèrement remuée par
le soc de la charrue, on divise la surface du champ en
compartiments carrés, de trois à quatre
mètres de côté, formés par de
petits sillons hauts de quelques centimètres. L'eau,
élevée au moyen des chadoufs et conduite au
bord du champ par des rigoles, est introduite, après
que la semence a été jetée, dans un de
ces carrés où une ouverture a été
ménagée. Quand ce carré est suffisamment
arrosé, on le ferme, et l'eau est introduite dans un
autre ; et ainsi de suite. Quelquefois, après cette
opération, ils jettent sur la tsrre humide cette
poussière salpêtrée qu'ils vont chercher
dans les ruines. Voilà toute l'agriculture
égyptienne : elle se résume en deux mots, semer
et arroser ; car le labourage ne compte guère. Donnez
de l'eau à cette terre ; Dieu et le soleil feront le
reste. J'ai vu là des froments, semés il y a un
mois, qui ont déjà un demi-pied de haut, et
qu'on coupera en mars ou avril. J'ai compté le nombre
de tiges sorties, en touffe serrée, d'un même
grain de blé : il y en avait vingt-deux. Cette terre
rend, en moyenne, de quatre-vingts à cent pour
un.
De temps en temps se détachent, du milieu des
travailleurs disséminés dans la plaine, des
hommes nus et bronzés qui, du plus loin qu'ils
aperçoivent notre caravane, accourent au-devant de
nous pour nous offrir de prétendues antiquités.
Antico ! antico ! crient-ils tous à la fois. Ce
sont des amulettes, des scarabées, des colliers, des
statuettes en terre émaillée. Il faut se
défier de ces marchands officieux. Depuis que les
touristes abondent en Egypte et se montrent, surtout les
Anglais et les Américains, avides de ces
antiquités, non seulement les fellahs les recherchent
avec soin, mais la fraude en a fait une véritable
industrie. Il y a, dans un des villages de Thèbes, un
Arabe dont l'unique métier est de fabriquer des
antiquités. On m'a même assuré qu'il en
venait d'Angleterre.
Il était près de cinq heures quand le canot,
qui nous attendait au rivage, nous ramena à bord de la
cange. Le soleil s'abaissait à l'horizon ; le vent
était tombé : à une journée qui
avait été chaude succédait une
soirée délicieuse. Nous voulûmes
dîner sur le pont, pour jouir mieux et de cette
charmante température et du beau spectacle que nous
avions sous les yeux. Le couchant était comme
inondé d'une poussière d'or ; le Nil, large ici
comme un bras de mer, semblait aussi rouler de l'or liquide.
Les pylônes de Médinet-Abou et l'amas de ses
palais étaient déjà noyés dans
l'ombre que projetait la chaîne Libyque ; tandis que le
front mutilé des deux colosses assis à leurs
pieds brillait encore empourpré d'un dernier
rayon.
Le dîner s'est prolongé plus que d'habitude. La
douceur du ciel, la grandeur mélancolique du paysage,
l'impression des choses que nous avons vues, tout invite
à la rêverie. Le jour tombé, nous
descendons à terre, et nous nous promenons au bord du
fleuve. La lune qui est dans son plein se lève
derrière Karnac, et ses rayons obliques glissent
jusqu'à nous à travers les sombres colonnades
du temple d'Aménophis. Dans ce ciel d'une
sérénité et d'une transparence
admirables, les étoiles brillent d'un éclat
inconnu à nos climats. On lirait dans un livre
à la clarté de la lune ; et je crois en
vérité que le soleil de Londres pourrait
souvent être jaloux d'elle.
Depuis que nous sommes à Louqsor, nous ne ressentons
plus ce froid assez vif que nous avons éprouvé
la nuit, pendant tout le voyage. A dix heures du soir, nous
nous promenons en vêtements d'été avec un
vrai sentiment de bien-être. Cet air tiède et en
quelque sorte balsamique semble dilater les poumons et
rafraîchir les poitrines irritées. C'est un fait
constaté par la science que dans la haute Egypte, et
surtout au delà d'Assouan, la phthisie est une maladie
inconnue.
Huit ou dix canges sont amarrées au rivage en avant de
la nôtre. Nos yeux ont cherché, dès le
matin, le pavillon français. Nous ne voyions partout
flotter aux mâts que les couleurs anglaises,
américaines, prussiennes et russes. Enfin, tout
à l'extrémité du quai, une flamme
tricolore s'est montrée à nous. Le drogman nous
apprend qu'un domestique français est
déjà venu s'informer de nous : c'est le valet
de chambre d'un pauvre jeune homme, le marquis d'O***, qui
est gravement malade. Nous allons, mon frère et moi,
pour le visiter ; mais il ne peut nous recevoir. Parti du
Caire il y a plusieurs semaines, sans précautions
suffisantes contre le froid des nuits, il est arrivé
ici très souffrant. Heureusement un Français
établi à Louqsor, et qui habite la Maison de
France,, lui a offert une hospitalité dont il avait
grand besoin.
Ce qu'on appelle la Maison de France est un grand
bâtiment carré, situé à
l'extrémité du village, et dont
Méhémet-Ali avait fait cadeau aux officiers de
l'expédition française qui vint chercher ici
l'obélisque qu'on voit aujourd'hui à Parisi
L'expédition finie, la maison que les
ingénieurs français avaient reconstruite et
restaurée est restée la propriété
de la France : un petit pavillon tricolore flotte au-dessus.
Depuis quelques années, un Français qui
s'occupe dans le pays du commerce des blés, M. M***, a
été autorisé par le consul
général de France à l'habiter. Il y
offre une gracieuse hospitalité à ceux de ses
compatriotes que la maladie ou les accidents du voyage lui
amènent quelquefois réduits à une
fâcheuse situation. L'année
précédente, il avait eu pour hôte pendant
deux mois Mlle Rachel, qui, comme le marquis d'O***,
était arrivée ici très fatiguée
d'une longue navigation et ayant beaucoup souffert du
froid.
L'expérience m'autorise à le dire, et c'est
l'avis de tous ceux qui connaissent ce climat, le voyage de
Thèbes est un magnifique voyage, un des plus beaux qui
se puissent faire, - pour ceux qui se portent bien ou ne sont
guère malades. Pour ceux qui ont la poitrine gravement
atteinte, il est, dans les conditions actuelles et avec les
moyens ordinaires de transport, une imprudence, une folie.
Ceux-là doivent rester au Caire.
Nous allâmes faire visite à M. M***, qui nous
reçut fort poliment. Une jeune femme qui partage sa
solitude parut surtout heureuse de voir des voyageurs et des
Français. Reléguée dans ce désert
depuis cinq à six ans, elle aspire à retourner
au Caire ou à Alexandrie, à défaut de la
France. Ce climat, que nous trouvons si beau, elle le trouve,
elle, froid l'hiver par comparaison, dévorant
l'été. Ce paysage, que nous trouvons splendide,
lui paraît bien monotone, ces ruines bien
mélancoliques, ces montagnes bien
désolées. Il n'est pas jusqu'à cette
éternelle verdure des palmiers qui ne lui soit devenue
odieuse : et cette poussière, et cette aridité,
et cette sérénité implacable d'un ciel
d'airain, tout cela lui pèse. L'hiver encore, c'est
peu ; on s'ennuie, mais on vit : l'été, on ne
vit pas, et l'été dure huit mois. Pendant ces
huit mois, on passe les nuits sur les terrasses, pour
demander à la rosée du ciel une fraîcheur
qu'on trouve à grand'peine. On passe le jour
étendu sur des divans, dans de vastes appartements
où, en fermant toutes les ouvertures avec des nattes
qu'on arrose sans cesse, on parvient à faire descendre
le thermomètre à quarante degrés. Au
mois de juin, l'eau du Nil est à vingt-trois
degrés. Un piano, que la pauvre exilée avait
apporté pour charmer sa solitude, éclata en
morceaux dans le premier été, et toutes les
cordes se rompirent. Il faut qu'on songe que nous ne sommes
ici qu'à quarante lieues d'Assouan, et qu'Assouan
passe pour être, à raison de diverses
circonstances climatologiques, le lieu le plus chaud de la
terre, bien qu'il ne soit pas tout à fait sous le
tropique.