Γαμος.
I. GRECE
Nous envisagerons d'abord le mariage au point de vue juridique, en laissant de côté tout ce qui a trait aux moeurs, aux coutumes et aux cérémonies du mariage, du moment qu'elles ne rentrent pas dans le droit matrimonial proprement dit. A cet égard, d'ailleurs, ici comme dans bien d'autres matières du droit, les sources sont assez pauvres ailleurs qu'à Athènes. La loi de Gortyne elle-même qui, en dehors de l'Attique, est la source la plus riche, et qui renferme nombre de dispositions intéressantes concernant le droit de famille, ne traite, dans l'état où elle nous est parvenue, que de quelques points spéciaux du mariage, notamment de la dissolution du mariage par le divorce et des effets de cette dissolution en ce qui concerne, soit les biens des époux, soit la condition des enfants nés après le divorce. Les règles posées par la loi de Gortyne à ce sujet ont, du reste, été précédemment exposées [voir Divortium, Dos, Gortyniorum leges].
Dans la Grèce antique, le mariage est loin d'avoir le caractère élevé qu'il présente dans les législations modernes. Son objet principal n'est point l'union de deux êtres qui se connaissent et qui s'associent pour le bonheur comme pour les peines de la vie ; c'est avant tout, en unissant deux personnes dans un même culte domestique, d'en faire naître une troisième qui soit apte à continuer ce culte. C'est ce dont témoigne à Athènes la formule sacramentelle qui, au dire de Clément d'Alexandrie, était prononcée lors de la célébration du mariage. C'est ce qu'attestent également pour Sparte de nombreux témoignages. Aussi peut-on considérer comme très exacte la définition que donne l'auteur précité du mariage grec en général et du mariage athénien spécialement : l'union de l'homme et de la femme formée pour la procréation d'enfants légitimes. Aussi, en raison du rôle qui lui est assigné, à savoir de devenir mère et de donner de nouveaux citoyens à la cité, la femme athénienne, du moins à l'époque classique, n'occupe-t-elle au foyer domestique qu'un rang tout à fait secondaire [Gynecaeum]. Par contre, l'épouse est seule à ce foyer et n'a pas à craindre d'y voir une rivale. Non seulement, en effet, comme on l'a précédemment expliqué, l'unité du mariage est admise dans le droit athénien [Bigamia], mais encore l'épouse légitime n'a point à tolérer dans la famille la présence si insultante d'une autre femme, d'une concubine, donnant également le jour à des enfants légitimes [Concubinatus].
- Formation du mariage
A l'origine, chez les divers peuples aryens, un homme se procurait une femme en l'enlevant ou en l'achetant. Le mariage par rapt, qui est incontestablement la forme la plus ancienne, a, en raison même de son antiquité, peu marqué son empreinte dans l'histoire du droit grec. Ainsi dans Homère, à l'exception de l'enlèvement d'Hélène qui fait mouvoir toute la grande épopée, on ne rencontre aucune allusion au rapt, considéré comme mode de formation du mariage. Dans la législation de Sparte, le mariage par enlèvement a laissé des traces notables. Le fiancé devait, en effet, aussitôt qu'il avait obtenu l'adhésion des parents dont sa fiancée dépendait, s'emparer de celle-ci par une sorte de rapt.
Le mariage par achat, qui a remplacé le mariage par enlèvement, était, au témoignage d'Aristote, pratiqué par les anciens Grecs, le mari achetant, soit la femme elle-même directement, soit la puissance sur elle de celui qui l'exerçait. Cette forme de mariage était, dans l'opinion générale, encore pratiquée dans le droit homérique. On peut, en effet, considérer les présents donnés lors du contrat au père de la jeune fille, et nommés εδνα, comme le prix réel ou fictif de l'achat de la fiancée. Il est incontestable que chez tous les peuples d'origine aryenne, chez les Hindous comme chez les Germains primitifs, le mariage par achat s'est perpétué assez longtemps. Les Hellènes, lorsqu'ils se fixèrent en Grèce, pratiquaient vraisemblablement cette forme de mariage ; or il serait étrange qu'elle eût déjà disparu à l'époque homérique.
La conclusion du mariage passe, dans le droit homérique, par trois phases distinctes. La première consiste dans la convention préalable entre le fiancé et le père de la jeune fille. On y précise les conditions de la cession de la puissance sur celle-ci, et on y fixe le montant des εδνα offerts par le fiancé, et des μειλια donnés par le père de la jeune fille, où l'on peut voir l'origine de la dot. Tout se borne à un échange de promesses correspondant au contrat de fiançailles. Puis celles-ci sont suivies de la tradition de la fiancée, qui donne le caractère de réalité à un contrat jusqu'alors resté purement consensuel. Cette tradition s'accomplit vraisemblablement suivant certaines formes symboliques, comme la mise de la main de la fiancée dans celle du fiancé en présence de témoins. A partir de ce moment la femme est dite kouridiê alochos, épouse légitime. Enfin la formation du mariage se termine par des fêtes qui accompagnent la conduite en pompe de la fiancée à la maison de son époux : c'est le γαμος dans le sens propre du mot. Les règles du droit homérique sur la conclusion du mariage ont dû se maintenir en Grèce pendant un certain temps. Mais on n'en trouve plus de traces dans le droit attique, tel du moins qu'il apparaît à l'époque classique. A cette époque, le mariage se forme à Athènes de deux manières, suivant la situation de la fiancée : soit par εγγυησις, soit par επιδικασια. L'engyésis, qui est le mode ordinaire de formation du mariage, consiste dans un contrat entre le kyrios de la femme et le mari. L'épidicasie, qui n'a lieu que dans certains cas exceptionnels, consiste dans la revendication en justice de la femme par celui qui y est autorisé par la loi. Que le mariage soit, du reste, contracté par engyésis ou par épidicasie, le contrat ou la revendication sont suivis, d'une part, de certaines fêtes ou solennités constituant le γαμος et, d'autre part, de la yap.rla(a dont nous aurons à déterminer la véritable signification.
- Formation du mariage par engyésis
L'εγγυησις est le contrat par lequel la personne ayant autorité sur la femme, le kyrios, donne celle-ci en mariage à son mari. Trois personnes interviennent donc dans cet acte : le kyrios, dont la participation est désignée par le verbe εγγυαν, le futur, εγγυωμενος, et la femme, nommée εγγυητη. L'engyésis est toujours présentée comme la condition indispensable de la validité et de l'existence du mariage. Sans elle, les enfants qui naissent d'un citoyen et d'une citoyenne d'Athènes ne peuvent revendiquer les droits que confère la légitimité, notamment les droits d'anchistie et de succession. De même, un enfant ne peut être inscrit sur le registre de la phratrie que si celui qui le présente prête le serment qu'il est né d'une mère εγγυητη.
Quel est précisément le rôle de l'engyésis dans la formation du mariage ? On attribue généralement à l'engyésis le caractère d'un simple contrat de fiançailles : ce serait le contrat en vertu duquel le kyrios de la femme s'engagerait à la donner en mariage au fiancé qui, de son côté, promettrait, de la prendre à titre d'épouse. Le γαμος suivrait alors l'engyésis, comme en droit romain les nuptiae viennent après les sponsalia, et le mariage ne serait parfait qu'après le γαμος. Dans une autre opinion, qui nous paraît plus exacte, l'engyésis suffit à elle seule pour fonder le mariage, et elle consiste dans la remise solennelle, ordinairement devant témoins, de la fiancée au mari. Ce caractère de l'engyésis résulte notamment de la formule de la loi citée par l'auteur du second plaidoyer contre Stéphanos, où l'on voit que l'effet direct et immédiat de l'εγγυησις, c'est de conférer à la femme la qualité d'épouse, damarta einai. La synonymie des mots εγγυαν et εκδουναι, synonymie qui est attestée non seulement par plusieurs lois, mais encore par les plaidoyers des orateurs, montre, d'autre part, que l'engyésis constituait autre chose qu'une simple promesse. Si, du reste, l'engyésis n'avait constitué qu'une phase préparatoire dans la conclusion du mariage, celui-ci ne serait devenu parfait que par un acte ultérieur, et certainement ces orateurs, qui traitent à chaque instant dans leurs plaidoyers du mariage et de ses effets, nous auraient parlé de cet acte décisif pour la formation du lien matrimonial. Il y a bien, il est vrai, postérieurement à l'engyésis, la noce, γαμος. Mais les formalités du γαμος, qui ne sont point obligatoires pour la validité du mariage et la légitimité des enfants, aboutissaient seulement à la consommation du mariage, qui n'en était pas moins formé dès l'engyésis.
Celle-ci n'a point d'ailleurs seulement pour objet la dation de la fiancée à son mari ; elle est ordinairement accompagnée des formalités relatives à la dot. Il n'y a guère, en effet, de mariage sans dot et, au temps des orateurs, si la dot n'est pas essentielle à la validité du mariage, elle est presque indispensable pour sa preuve, et ce n'est guère que par l'apport d'une dot que le mariage légal se distingue du concubinat. Cette relation étroite entre l'engyésis et la dot est attestée notamment par une inscription de Mykonos.
L'engyésis pouvait, soit en raison de la volonté des parties, soit par la force mème des choses, précéder d'un temps plus ou moins long le γαμος, la consommation du mariage. Lorsqu'au surplus l'engyésis n'est point accompagnée de la consommation du mariage, il ne semble pas que le mari ait eu le droit de contraindre le kyrios à lui livrer la femme.
Le mariage par voie d'engyésis parait remonter, dans le droit attique, à une époque fort reculée. L'engyésis, dont l'existence est attestée dans les lois de Solon, a-t-elle été substituée par ce législateur à une autre coutume, ou bien Solon s'est-il borné à la réglementer, comme il l'a fait pour plusieurs autres institutions relatives, soit aux femmes en général, soit au mariage ? La dernière hypothèse paraît la plus vraisemblable. L'ancienneté du mariage par voie d'engyésis paraît d'autant plus probable que cette institution n'est point spéciale à Athènes, et qu'elle paraît commune à toute la Grèce. Son existence est attestée à Mykonos, à Kéos à Sparte et en Messénie, et il y a tout lieu de croire qu'elle était également pratiquée dans les autres cités grecques.
L'engyésis du droit attique est un contrat qui se passe exclusivement entre le kyrios et le futur mari. La future épouse n'y est sans doute pas étrangère, car son assentiment, s'il n'est pas exigé par la loi, semble requis par les moeurs, mais juridiquement la femme ne joue aucun rôle dans le contrat ; elle en est seulement l'objet. A Sparte également, le citoyen qui recherche une fille en mariage doit d'abord s'assurer le consentement du père ou du parent qui a autorité sur elle. En cas de contestation sur le point de savoir à qui, parmi plusieurs prétendants, la femme doit échoir, les rois tranchent la difficulté.
L'intervention du kyrios dans le contrat d'engyésis a pour unique fondement la puissance tutélaire attachée à ce titre ; l'idée de protection y est tout à fait étrangère. Le kyrios, ayant du reste le droit absolu de disposer de sa pupille, est libre de la marier ou de ne pas lui donner d'épouxt. Il a, d'autre part, toute liberté pour choisir le mari de sa pupille. Celle-ci pourrait toutefois, si on lui présentait un fiancé indigne, intenter contre son kyrios l'eisaggelia kakôseôs, action ouverte d'une manière générale à tous les incapables contre leurs représentants, lorsque ceux-ci commettent à leur égard un acte blâmable. Enfin le kyrios est maître de procéder à l'engyésis, même si sa pupille est encore impubère ; mais la consommation du mariage ne peut, naturellement, avoir lieu qu'après que la fille a atteint rage de la puberté. Les moeurs viennent toutefois adoucir la rigueur du droit du kyrios et la femme peut, dans certains cas exceptionnels, être consultée sur le choix de son mari.
C'est le futur mari qui, dans l'engyésis, stipule lui-même du kyrios la tradition de la pupille. Mais il faut, naturellement, pour figurer dans ce contrat, que le fiancé soit majeur, c'est-à-dire qu'il ait été inscrit sur le lêxioarchikon grammateion. A cette époque cesse la puissance paternelle ou la tutelle et le citoyen majeur a pleine capacité pour procéder seul à son mariage comme à tous les autres actes de la vie civile. Le père du futur époux n'a donc point à donner son consentement an mariage, mais tout au plus un conseil. Quant au futur mari, dont le consentement est absolument libre, en principe, il paraît cependant que, dans un cas exceptionnel, il pourrait être contraint, indirectement, au mariage, à savoir : en cas de viol d'une vierge, où le coupable, au témoignage d'Hermogène, aurait eu àchoisir entre la mort et le mariage sans dot avec la femme lésée, si celle-ci ou ceux qui avaient autorité sur elle y consentaient. Mais ce cas paraît fort contestable.
L'engyésis devait comporter certaines formes solennelles, destinées à constater d'une façon absolument certaine l'échange des consentements. C'est à cette solennité de forme que fait vraisemblablement allusion la loi de Solon citée dans le second plaidoyer contre Stéphanos, où il était dit ên an egguêsê epi dikaiois damarta einai. Le plus ancien témoignage concernant ces formes légales paraît fourni par Hérodote dans le récit qu'il fait du mariage d'Agariste, fille de Clisthène, tyran de Sicyone, et où, bien que la scène se passe à Sicyone, l'engyésis paraît bien conclue conformément au droit attique. On y voit d'abord que le contrat se passe en présence de témoins : c'est ce qu'attestent aussi les plaidoyers des orateurs. Les témoins amenés par chacune des deux parties, et pris parmi les parents ou amis, sont en général assez nombreux, eu égard à l'importance du contrat. Les témoins appelés à constater l'engyésis servent en même temps à attester la constitution de dot qui accompagne habituellement cet acte. Mais leur présence est plutôt considérée comme une sûreté que comme une formalité essentielle pour la validité de l'engyésis. Dès lors, leur absence exposait seulement les intéressés à des difficultés de preuve.
Il ne semble pas, d'autre part, que la volonté des parties ait dû se manifester par des formules solennelles. Le kyrios doit toutefois, naturellement, désigner d'une manière précise la femme qu'il promet au futur mari, en indiquant notamment à quel titre elle se trouve sous sa puissance. Le kyrios déclare également la filiation naturelle ou légitime de sa pupille. Au surplus, l'engyésis étant un contrat qui se passe exclusivement entre le kyrios et le futur mari, la présence de la fiancée n'y est point nécessaire et ne s'y comprend pas, puisque la femme n'a point de consentement à y exprimer Si le mariage existe légalement, à notre avis du moins, dès l'engyésis, la cohabitation des époux n'en est pas moins le but final et hautement avoué du mariage, car celui-ci n'est contracté que pour donner naissance à des enfants. C'est cette consommation du mariage qui constitue à proprement parler le γαμος, par opposition à l''εγγυησις. Le γαμος, dans son sens propre, c'est la copula carnalis, ainsi que cela résulte de nombreux témoignages, notamment de ceux de Clément d'Alexandrie et de Pollux. Quant aux cérémonies religieuses ou autres en lesquelles consistait le γαμος, elles seront exposées plus loin.
Les cérémonies de la noce étaient ordinairement suivies d'une autre formalité, sur la signification de laquelle existent des doutes sérieux, et qui est désignée dans les plaidoyers des orateurs par ces termes : eispherein gamêlian uper tês gunaikos tois phratorsin, expression qui était même devenue proverbiale. C'est le mari qui, à l'occasion de son mariage, procède à cet acte, dont l'objet est tantôt un sacrifice, tantôt un présent offert aux phratores, ou peut-être même les deux à la fois. La γαμηλια ne paraît pas, du reste, avoir été spéciale au droit attique, car une inscription de Delphes parle d'offrandes dites γαμελα, qui correspondent évidemment à la γαμηλια athénienne.
Dans l'opinion générale, la prestation de la γαμηλια correspondrait à une formalité d'ordre public, analogue à l'introduction des enfants légitimes ou adoptifs dans la phratrie paternelle, le mari présentant sa femme à la phratrie à laquelle il appartient et faisant inscrire son union sur le registre de la phratrie. Un sacrifice était alors accompli et un banquet était offert aux phratores, et peut-être aussi une somme proportionnée à la fortune du mari était-elle versée dans la caisse de la phratrie ou servait-elle à couvrir les frais du banquet. Par cette introduction dans la phratrie de son mari, la nouvelle épouse était associée aux sacra de celui-ci et, en même temps, devenait étrangère à ceux de sa famille d'origine.
Cette opinion nous semble accorder une importance excessive à la prestation de la gamélia. Celle-ci consiste, à notre avis, uniquement dans une redevance que le nouvel époux paye, sans y être du reste obligé, à sa phratrie, à l'occasion de son mariage ; mais le payement de la gamélia ne suppose nullement l'introduction de la femme dans la phratrie du mari, et il sert seulement à procurer, le cas échéant, une preuve plus facile du mariage. Rien, en effet, dans les plaidoyers des orateurs, les seuls textes sérieux en la matière, ne laisse supposer que la prestation de la gamélia corresponde à l'introduction des enfants dans la phratrie : la différence même de terminologie employée pour l'épouse et les enfants montre que les formalités usitées avaient dans l'un ou l'autre cas un caractère bien différent. De nombreux textes nous parlent de l'admission des enfants dans la phratrie et des effets qu'elle entraîne. Jamais, au contraire, il n'est question d'une introduction de ce genre pour la nouvelle épouse, et il serait singulier, si elle avait eu lieu, qu'on n'y eût fait allusion que par l'expression équivoque eispherein gamêlian. La femme, selon nous, demeure donc, malgré le mariage, dans sa phratrie d'origine.
La prestation de la γαμηλια, qui est, du reste, toute volontaire de la part du nouvel époux, constitue une sorte de devoir imposé par la coutume, et probablement aussi par la religion, eu égard au caractère religieux de la phratrie. La sanction de ce devoir consistait dans le blâme de l'opinion publique et dans l'exclusion des bénéfices accordés aux membres de la phratrie. Le défaut de prestation de la gamélia pouvait aussi, dans certains cas, entraîner un inconvénient assez sensible. Cette prestation avait, en effet, à plusieurs égards, le même caractère que le sacrifice offert aux dieux de la phratrie lors de la présentation d'un enfant, c'est-à-dire qu'elle constituait une manière de publicité de l'acte juridique, mariage ou reconnaissance de paternité, en le portant officiellement à la connaissance d'un assez grand nombre de personnes. La prestation de la gamélia présupposant l'existence d'un mariage, le témoignage des phratores pouvait être très précieux lorsque l'existence du mariage était contestée. Aussi les orateurs, dans les procès de ce genre, attachent-ils une grande importance au témoignage des phratores. La preuve de la prestation de la gamélia peut donc fournir indirectement une preuve de la formation du mariage.
Le mariage n'étant inscrit d'ailleurs ni sur le registre de la phratrie (du moins dans notre opinion), ni, à plus forte raison, sur le registre du dème, il n'en existait aucune preuve écrite et, en cas de contestation sur son existence, on était obligé de recourir à la preuve testimoniale ou à d'autres preuves indirectes. La preuve testimoniale pouvait être fournie soit par ceux qui avaient été invoqués lors de l'engyésis, soit par ceux qui avaient assisté aux cérémonies de la noce, soit enfin par les phratores à qui le nouvel époux avait offert la gamélia. La possession d'état et la conduite de la femme, soit dans la famille, soit au dehors, pouvaient également être prises en considération. Parmi les preuves indirectes, on peut citer aussi celle qui résulte de l'existence d'une dot, car la constitution de dot est un signe caractéristique du mariage. La constitution de dot était même souvent constatée, comme sur un registre de Mykonos, par un écrit où se trouvait mentionnée également l'engyésis. - Formation du mariage par épidicasie
L'επιδικασια, mode exceptionnel de formation du mariage, consiste dans une procédure suivie devant le magistrat ou devant un tribunal et dont le but est de revendiquer à titre d'épouse la femme qui se trouve dans certaines situations spéciales. Elle aboutit à l'homologation par l'archonte ou par les héliastes de la requête, ληξις, présentée par le revendiquant et qui, manifestant de sa part l'intention de prendre pour épouse la femme επιδικος, suffit, à notre avis, pour la formation du mariage en cas d'épidicasie. Il y a lieu à épidicasie dans différentes hypothèses ; mais, dans tous les cas, la procédure est la même et on en a indiqué le mécanisme en traitant des épiclères.
Le premier cas d'épidicasie est celui de la fille épiclère. Un second cas a lieu lorsqu'un père de famille, n'ayant qu'une ou plusieurs filles, se crée par testament un fils adoptif, lequel est alors soumis par la loi à l'obligation d'épouser la fille du testateur ou celle de ses filles désignée par lui. Il y a lieu, en pareil cas, à une épidicasie de cette fille par l'adopté, et cette revendication s'applique en même temps, comme dans le cas d'épiclérat, à la fille et à la succession, car les deux sont inséparables. Nous rencontrons un troisième cas d'épidicasie lorsqu'un citoyen sans enfants mâles adopte une femme, laquelle se trouve alors dans une situation semblable à celle de l'épiclère et peut être l'objet d'une revendication soumise aux mêmes règles que s'il s'agissait d'une fille épiclère. Il y a lieu enfin à épidicasie dans le cas de legatum mulieris, c'est-à-dire lorsque le kyrios d'une femme, au lieu de la donner en mariage de son vivant, dispose de sa main par acte de dernière volonté en faveur d'un autre citoyen.
- Formation du mariage par engyésis
- Conditions de validité du mariage
Dans le droit attique, la théorie des conditions de validité du mariage se trouve singulièrement simplifiée. Ainsi d'abord, en ce qui concerne le consentement des époux, il n'y a pas à se préoccuper du consentement de la femme, puisque celle-ci ne joue, comme nous l'avons vu, qu'un rôle passif, soit dans l'engyésis, soit dans l'épidicasie. Quant au consentement des personnes qui ont le droit de puissance, il ne peut en être question que pour le kyrios de la femme. Quant au futur époux, nous avons établi qu'il n'est soumis à aucune condition analogue.
En ce qui concerne l'âge des époux, le mariage ne peut être contracté que par ceux qui ont atteint l'âge de la puberté. Cette règle n'est vraie toutefois d'une façon absolue que pour le futur mari qui stipule personnellement au contrat et qui ne peut y figurer que lorsqu'il a la capacité requise pour contracter, c'est-à-dire après qu'il a accompli sa dix-huitième année et qu'il est inscrit sur le lêxioarchikon grammateion. Quant à la femme, elle peut, bien qu'elle soit encore impubère, former l'objet du contrat d'engyésis, ou si elle est épicière, être revendiquée comme épouse par l'anchisteus. Mais la consommation du mariage ne peut avoir lieu qu'après que la femme a atteint la majorité requise pour le mariage. La loi ne paraît point, du reste, avoir fixé d'âge à cet égard. S'il semble résulter d'un plaidoyer de Démosthène que cet âge doive être fixé à quinze ans, d'autres témoignages attestent qu'une fille pouvait être mariée avant cet âge, à treize et même à douze ans.
Quant aux empêchements pouvant, résulter de la parenté, i1 en a été question précédemment en exposant les cas où il y a inceste dans le droit grec [Incestum].
En dehors de la parenté, on a prétendu que, du moins pendant un certain temps, le droit attique avait admis certains empêchements au mariage provenant de la tutelle et destinés à protéger les mineurs contre l'avidité de leurs tuteurs. Mais l'existence de semblables prohibitions ne paraît nullement établie.
C'est aussi une question controversée que celle de savoir si l'extranéité de l'une des parties constitue un empêchement à l'existence d'un mariage légitime produisant tous les effets de l'union contractée entre deux citoyens. Dans une théorie qui est, généralement admise, il ne peut exister de mariage légitime qu'entre citoyen et citoyenne, à moins que, par une faveur spéciale, le droit de contracter un mariage valable, c'est-à-dire l'épigamie (epigamia), n'ait été accordé à un étranger, soit individuellement, ce qui était le cas habituel, soit à des communautés entières. Cette théorie a pour fondement principal les lois citées dans le discours de Démosthène contre Nééra, qui punissent de peines assez sévères le mariage contracté dans certaines conditions entre citoyens et étrangers et qui, dit-on, supposent qu'en principe le mariage n'est permis qu'entre personnes jouissant toutes deux du droit de cité. Elle s'appuie, en outre, sur un certain nombre de cas où il y aurait eu concession de l'épigamie, soit à des citoyens isolés, soit à des cités, et d'où il résulte, a contrario, dit-on, que, sans cette concession, les étrangers ne peuvent contracter de mariage valable avec les Athéniens. Le droit attique aurait même, suivant certains auteurs, fortifié par une sanction pénale, par une action dite exagôgês dikê, la prohibition du mariage entre Athéniens et étrangers. Les partisans de cette théorie ne sont point, du reste, d'accord sur le point de savoir à quelle époque l'épigamie serait devenue une condition légale du mariage. Suivant les uns, la prohibition du mariage entre Athéniens et étrangers aurait existé même avant le décret rendu par Périclès en 451 qui refusait désormais le droit de cité ceux qui n'étaient point nés de père et mère citoyens. Suivant d'autres, elle serait seulement postérieure à ce décret.
La théorie de l'épigamie est toutefois, malgré la faveur dont elle jouit, fortement contestable. Visiblement inspirée de la théorie romaine du connubium, elle ne présente cependant, comme l'a démontré Hruza, aucun intérêt sérieusement appréciable dans le droit attique. Elle paraît, en outre, contredite par des documents très sérieux. Il est certain d'abord qu'avant le décret de Périclès, le droit attique a reconnu la validité des mariages mixtes, et l'on peut citer plusieurs cas de mariages contractés entre personnes de nationalité différente et dont la validité ne parait avoir soulevé aucune objection. Plusieurs Athéniens illustres, bien qu'issus d'une mère étrangère, furent considérés comme légitimes et comme citoyens : tels notamment Clisthène, le grand réformateur, Thémistocle et Cimon. Le décret rendu sur la proposition de Périclès, en 451, dut sans doute avoir une grande influence sur les mariages mixtes, mais on a fort exagéré cette influence. Le décret de Périclès, à notre avis, n'a porté aucune atteinte à la validité des mariages mixtes. Sans doute, les enfants nés de ces unions ne pouvaient plus, comme auparavant, prétendre à la jouissance du droit de cité ; ils devinrent νοθοι au point de vue politique. Mais ils n'en demeurèrent pas moins légitimes et conservèrent, en principe, la jouissance de tous leurs droits civils, n'étant point ainsi νοθοιl au point de vue du droit de famille. On peut citer, en effet, un assez grand nombre de cas de mariages mixtes ayant donné naissance à des enfants dont la légitimité est incontestable.
Les arguments sur lesquels on fonde la théorie de l'épigamie sont, d'autre part, très discutables. Ainsi, d'abord les lois citées par Démosthène dans son discours contre Nééra ne prononcent en aucune manière la nullité du mariage par cela seul qu'il aurait été contracté entre Athénien et étrangère. D'autre part, elles requièrent pour leur application une fraude spéciale du côté de la partie pérégrine Quant à la prétendue action pénale nommée exagôgês dikê, rien ne prouve son existence dans le droit attique ! En ce qui concerne enfin les documents où l'on a voulu trouver des cas de concession d'épigamie, nous observerons d'abord que les cas allégués se réfèrent tous à une concession collective et qu'on n'en cite aucun ayant trait à un individu déterminé. Or si, comme on le prétend, l'épigamie avait pu être, comme le connubium à Rome, concédée soit isolément, soit collectivement, il serait étrange que les inscriptions ne nous eussent révélé aucun cas de concession individuelle. Nous en possédons, en effet, un grand nombre concernant la concession d'une faveur analogue à des métèques, à savoir de l'isotélie, et il serait singulier qu'il ne nous en fût parvenu aucune relative à la concession de l'épigamie. Quant aux divers cas de concession collective d'épigamie que l'on prétend trouver dans les discours des orateurs, ils ne sont nullement décisifs. Il paraît donc plus exact d'admettre que les mariages mixtes n'ont jamais été prohibés par la loi athénienne.
Il n'existe d'autre part, à Athènes, aucune prohibition au mariage provenant de la différence de classes des époux, et un citoyen de la première classe peut valablement épouser une femme d'une classe inférieure. - Effets du mariage
- A l'égard des époux
Les effets que produit le mariage à l'égard des époux sont relatifs soit à leurs personnes, soit à leurs biens. Nous ne nous occuperons pas ici des rapports pécuniaires des époux qui ont été précédemment exposés [Dos]. En ce qui concerne leurs rapports personnels, on admet généralement que le mariage a pour effet d'investir le mari de la tutelle de la femme et que tous les pouvoirs qui appartenaient au kyrios sont désormais exercés par le mari. Certains textes montrent, en effet, le mari exerçant les fonctions de kyrios de sa femme et cela non seulement à Athènes, mais aussi à Ténos.
Dans une autre théorie, qui nous semble plus exacte, on admet que si le mari peut avoir souvent et a même ordinairement la qualité de kyrios de sa femme, il n'exerce point cependant la tutelle en vertu du mariage même, mais en vertu d'un titre spécial, antérieur ou postérieur au mariage. Si donc le mari n'a point un titre spécial pour exercer cette tutelle, la qualité et les pouvoirs du kyrios appartiennent à celui qui était investi de cette fonction avant le mariage, et la femme est ainsi soumise parallèlement à deux puissances distinctes. Cette seconde théorie, qui est parfaitement conciliable avec les textes, permet seule d'expliquer comment le mari, devenu kyrios de sa femme, cesse de l'être quand le mariage est dissous. En effet, le pouvoir du kyrios, qui s'exerce indépendamment de toute relation maritale, devrait logiquement survivre au mariage, et cependant l'on admet généralement que si le mariage se dissout par le divorce, la femme retombe sous la puissance du kyrios qui exerçait la tutelle antérieurement au mariage.
Si l'on admet, que le mari n'est pas de plein droit le kyrios de sa femme, il faut dire que le kyrios conserve les pouvoirs qu'il avait antérieurement sur la femme, sauf ceux dont il a fait délégation expresse ou tacite au mari. Ainsi le kyrios conserve le droit de disposer de la personne de sa pupille et, par suite, il possède le droit de dissoudre le mariage par sa seule volonté et de reprendre sa pupille [Divortium]. Mais tant qu'il n'use pas de ce droit, la femme est, par la nature même du mariage, tenue de résider avec son mari. D'autre part, le kyrios conserve en principe les pouvoirs qu'il avait sur les biens de la femme, et c'est lui, en règle, et non le mari qui doit intervenir pour assister la femme dans un acte de disposition ou pour la représenter en justice. Mais relativement aux biens constitués en dot, en admettant d'ailleurs, ce qui est contesté, que le mari n'en devienne pas propriétaire, il a, en vertu du contrat de mariage passé avec le kyrios, l'administration et la jouissance de ces biens [Dos].
Abstraction faite de la puissance du kyrios, le mariage produit d'autres effets en ce qui concerne les rapports personnels des époux. Ainsi, d'abord les époux ont le même rang dans la société, et, à l'époque où la noblesse existait comme caste spéciale et possédait certains privilèges, la femme mariée à un mari noble devenait noble elle-même. La femme prend, d'autre part, le domicile légal du mari, du moins dans le cas où celui-ci est son kyrios. Dans le cas contraire, elle conserve son domicile chez son kyrios, du moins si l'on admet la théorie d'après laquelle le mari n'est pas de plein droit le kyrios de sa femme.
On a prétendu qu'à Athènes la femme devient, par le fait du mariage, étrangère au culte de sa famille d'origine et qu'elle adopte nécessairement celui de son mari. Mais cette manière de voir repose sur une fausse interprétation de la formalité relative à la gamélia. Si l'on admet, comme nous l'avons fait, que la prestation de la gamélia est une formalité qui n'a trait qu'à la preuve du mariage, il faut dire qu'elle n'a nullement pour effet d'associer la femme au culte de son mari et que celle-ci continue, malgré le mariage, à participer au culte de son kyrios. C'est seulement dans le cas où le mari est tuteur de sa femme qu'il y a entre les époux communauté complète juris divini.
Si, indépendamment de la qualité de kyrios, qui peut conférer au mari des pouvoirs considérables sur sa femme, les deux époux sont, en général, sur un pied d'égalité, le mari a cependant en droit la direction générale de la famille, ce qui comprend la femme aussi bien que les enfants. Il exerce vis-à-vis de sa femme ce qu'Aristote nomme une archê gamikê, c'est-à-dire qu'il est le chef de l'association conjugale dans tous les points qui ne dépendent point de la puissance tutélaire.
Le mari est tenu non seulement de recevoir sa femme au domicile conjugal, mais encore de subvenir à son entretien suivant son rang et sa fortune. Si le mari néglige de remplir cette obligation, la femme peut s'en prévaloir comme d'une juste cause de divorce, apoleipsis [Divortium].
Lorsque la femme mariée est une épiclère, son mari est tenu envers elle à certaines obligations spéciales précédemment exposées. Quant au devoir de fidélité, on a précédemment exposé dans quelle mesure il existait entre les époux et quelle en était la sanction [Adulterium]. - A l'égard des enfants
Le mariage, dans le droit grec, a pour but principal et hautement avoué la procréation d'enfants destinés à perpétuer le culte domestique et à offrir au père de famille, après sa mort, la série des repas funèbres qui doivent assurer le repos et le bonheur à ses mânes ainsi qu'à ceux de ses ancêtres. Le mariage a d'autant plus d'importance à cet égard que le fils qui doit perpétuer la religion domestique doit être issu d'un mariage légitime, car l'enfant naturel ne peut pas remplir le rôle religieux dont nous venons de parler. L'étude des effets du mariage nous amène donc naturellement à l'étude des effets de la filiation, c'est-à-dire du lien qui rattache l'enfant né du mariage à ses auteurs.
La filiation ne peut évidemment produire un effet quelconque que si elle est légalement certaine. Cette certitude existe toujours à l'égard de la mère, parce que l'accouchement est un fait matériel facile à constater dans tous les cas. La paternité est, au contraire, incertaine et ne peut guère s'établir que par présomption. A cet égard le droit grec a, comme le droit romain, admis que l'enfant est présumé avoir pour père le mari. Il faut toutefois, pour l'application de cette présomption, que la femme ait conçu ou ait pu concevoir pendant le mariage. Or, en ce qui concerne les limites extrêmes de la durée légale d'une grossesse, on doit admettre, d'après un passage de Platon, où le philosophe se référait vraisemblablement au droit en vigueur dans sa patrie, que la durée minima de la gestation est de six mois pleins et la durée maxima de dix mois pleins. L'enfant, pour être légitime, doit donc être conçu au plus tard le cent quatre-vingt-unième jour et au plus tôt le trois cent unième jour avant celui de la naissance, et le délai pendant lequel la loi place ainsi la conception est de cent vingt et un jours. Il faut toutefois admettre, bien qu'il n'y ait pas de texte à cet égard, que le mari pouvait décliner la paternité de l'enfant en prouvant que pendant ce délai de cent vingt et un jours il avait été dans l'impossibilité de cohabiter avec sa femme.
Le mari ne paraît pas avoir la faculté de désavouer l'enfant pour cause d'adultère de sa femme, ou du moins le désaveu aurait alors très peu de chance de réussir en présence de ce principe de droit grec, rapporté par Aristote, que « quand il s'agit de reconnaitre des enfants, c'est surtout aux femmes qu'on s'en rapporte pour découvrir la vérité ». Il semble toutefois qu'à Athènes le mari qui a des doutes sur sa paternité ait le moyen de la décliner : ce serait de répudier sa femme puis de prêter, lors de la présentation de l'enfant à la phratrie par les parents de la mère, le serment que l'enfant n'est pas de lui.
A la preuve de la filiation se rattachent deux formalités, à savoir la dekatê et l'introduction de l'enfant dans la phratrie. La première, qui s'accomplissait généralement le dixième jour après la naissance de l'enfant, consistait en un sacrifice solennel, auquel on convoquait les proches parents, qui apportaient du reste au nouveau-né certains petits présents. Cette cérémonie, fête de famille ayant un caractère purement privé dans laquelle on donnait un nom à l'enfant, n'en présentait pas moins un certain intérêt au point de vue juridique, car elle constituait de la part du père de famille une sorte de reconnaissance de sa paternité qui, plus tard, pouvait être prise en considération en cas de contestation sur la légitimité de la filiation. Quant à la seconde formalité, nous renvoyons à ce qui sera dit ultérieurement sur l'institution des phratries.
Les effets de la filiation peuvent se diviser en deux séries : les uns s'appliquent dans les rapports de l'enfant avec ses deux auteurs ou leurs parents ; les autres se limitent à ses rapports avec son père. Parmi les effets de la dernière série, le plus important est la puissance paternelle, dont il sera question dans un article spécial [Patria potestas]. Un autre effet spécial aux rapports de l'enfant avec son père est que celui-ci lui communique sa qualité de citoyen. Il n'en fut ainsi toutefois, à Athènes, que jusqu'aux décrets de Périclès et d'Aristophane, car, après ces décrets, le citoyen athénien qui épousait une étrangère ne conférait plus à ses enfants, quoique légitimes, le droit de cité, réservé désormais aux enfants dont le père et la mère en même temps sont citoyens d'Athènes. Les enfants jouissent aussi quelquefois des faveurs spéciales accordées au père : ainsi la sitêsis en Prutaneiô, ou nourriture au Prytanée aux frais de l'Etat, peut être accordée à un citoyen et à ses enfants. De même les enfants succèdent quelquefois à l'ateleia, ou exemption de certaines charges publiques conférée à leur père. Par contre, l'atimie, avec toutes les conséquences qu'elle comporte, peut se transmettre aux enfants. Il semble même résulter d'un discours attribué à Démosthène que les fils de ceux qui avaient été condamnés à mort se trouvaient frappés de l'incapacité de parler dans l'assemblée du peuple.
Quant aux effets de la première série, les principaux sont les suivants :
1° La filiation légitime engendre la parenté nommée anchisteia, c'est-à-dire la parenté donnant aux personnes qu'elle unit certains droits, et, par contre, établissant entre elles certaines incapacités. L'anchistie, dans le droit grec, existe d'ailleurs, à la différence de l'agnatio du droit romain, non seulement vis-à-vis des parents du père, mais aussi vis-à-vis des parents de la mère. En effet, à défaut de certains parents paternels, dont le nombre est, du reste, assez limité, la succession passe aux parents maternels. La parenté engendrée par la filiation légitime entraîne entre ceux qu'elle unit non seulement des droits de succession, mais aussi d'autres droits qui peuvent se rattacher au droit de succession, comme celui de revendiquer la fille épiclère ou le droit de tutelle. Elle peut enfin créer des incapacités de mariage.
2° Une obligation alimentaire réciproque existe entre les ascendants et les descendants. Cette obligation, pour les ascendants, ne se borne pas à nourrir l'enfant ; ils lui doivent aussi une éducation conforme à leur fortune et à leur situation, ainsi que cela résulte de la disposition de la loi athénienne qui libère les enfants de leur propre obligation alimentaire, lorsque leurs parents ne leur ont pas donné l'éducation dans le sens que nous venons d'indiquer.
Réciproquement, les enfants sont tenus de fournir à leurs ascendants les moyens d'existence dont ils ont besoin : c'est l'obligation qui est connue sous le nom de gêrotrophia, et qui est formellement consacrée par la loi, et cela non seulement dans les rapports des enfants avec leurs père et mère, mais aussi vis-à-vis de tous leurs ascendants de l'un ou l'autre sexe. L'obligation alimentaire pèse, du reste, sur les filles aussi bien que sur les fils, ainsi que le prouve la généralité des termes dont se sert la loi précitée. Cette obligation n'est point limitée dans sa durée et incombe aux descendants à tout âge. Elle n'est pas, au surplus, spéciale au droit attique, et en Argolide, notamment, les parents avaient aussi une action alimentaire contre leurs enfants.
L'obligation alimentaire des enfants leur est imposée, dans l'esprit du droit attique, en reconnaissance de l'éducation que leurs parents leur ont eux-mêmes donnée, et des sacrifices qu'ils ont pu faire dans ce but. En conséquence, le législateur athénien a restreint d'une manière assez rationnelle l'obligation dans des cas où il considère que les parents n'ont pas rempli, de leur côté, les devoirs que la nature leur impose envers leurs enfants. Ceux-ci sont dès lors dispensés de l'obligation d'aliments :
1° quand ils n'ont pas reçu de leurs parents une éducation conforme à leur état ;
2° quand ils ont été prostitués par eux ;
3° quand ils sont nés d'une concubine et qu'ainsi par leur faute leurs parents les ont mis dans une situation sociale inférieure. Mais un enfant ne peut se prévaloir, pour se soustraire au paiement de sa dette, de l'indifférence, de la dureté ou des mauvais traitements qu'il serait en droit de reprocher à ses parents. Il est tenu également, même si ses parents ne lui ont laissé aucuns biens.
Quant à la technê que, d'après Plutarque, les parents doivent faire apprendre à leur enfant, il faut entendre vraisemblablement par là non point un métier quelconque, mais plutôt une instruction suffisante. On peut d'autant moins hésiter à étendre l'obligation des parents à l'instruction proprement dite, qu'on voit une obligation semblable peser sur les tuteurs. La loi devait du reste probablement tenir compte de la condition du père et de ses ressources.
L'obligation alimentaire des enfants envers leurs ascendants a pour objet non seulement les aliments proprement dits, mais, d'une manière générale, tout ce qui est nécessaire à leur entretien, ta epitêdeia, et spécialement le logement. Un texte parle aussi des soins que les enfants doivent donner à leurs parents.
3° L'enfant doit à ses ascendants un certain respect, que l'on petit définir d'une manière négative en disant qu'il doit s'abstenir vis-à-vis de ses parents de toute action constituant ce que les textes nomment kakôsis, expression assez vague, d'ailleurs, et qui comprend le refus d'aliments aussi bien que le manque de respect. En l'absence de toute définition légale, on doit dire que la détermination des cas de kakôsis est abandonnée à l'appréciation du juge. Il y a spécialement manque de respect quand les enfants maltraitent ou insultent leurs parents. Un cas particulier de xxtoatç, qui ne se produit même qu'après la mort des parents, a lieu lorsque les enfants ne procurent pas à leurs ascendants des funérailles en rapport avec la dignité de leurs familles, obligation dont parlent les textes en disant que les enfants est tellement rigoureuse que rien ne peut en dispenser les enfants, pas même le fait d'avoir été prostitués par leurs parents.
La sanction des diverses obligations dont les enfants sont tenus envers leurs parents (obligation alimentaire, respect) consiste d'abord dans une action nommée kkôseôs goneôn graphê, qui entraîne contre le coupable l'application de pénalités rigoureuses. En l'absence de toute poursuite et de toute condamnation, le fils dénaturé peut se trouver exposé à certaines incapacités politiques: ainsi il ne peut être orateur, ni archonte. En effet, dans l'examen préalable, dokimasia, auquel sont soumis les candidats à des fonctions publiques, on recherche notamment s'ils se sont bien conduits envers leurs parents, et la réponse négative à cette question entraîne l'exclusion.
- A l'égard des époux
- Dissolution du mariage
Le mariage se dissout :
1° par la mort de l'un des époux ;
2° par la servitude encourue jure civili ;
3° par le divorce. Les règles spéciales aux causes du divorce et à ses effets ont été précédemment exposées [Divortium].
Lorsque le mariage se dissout par la mort, il ne semble pas qu'il y ait pour la femme, dans le droit attique, une obligation légale de lugere maritum, sanctionnée par une peine quelconque. On ne trouve non plus aucune trace d'un délai de viduité. Une semblable restriction, si elle peut avoir existé dans le droit primitif, aurait été peu en harmonie avec les moeurs nouvelles, et avec la fréquence des seconds mariages, surtout de la part des veuves. Loin d'y apporter des obstacles, la loi athénienne les voyait plutôt d'un oeil favorable. On a cité, il est vrai, une prétendue loi d'Athènes frappant d'atimie la femme qui se serait mariée trois fois. Mais il est difficile d'admettre l'authenticité de cette loi dont on ne retrouve de trace nulle part. A Sparte également, les seconds mariages des veuves, loin d'être vus avec défaveur, étaient encouragés par l'opinion. Au surplus, la veuve est sous la protection spéciale de l'archonte éponyme lorsqu'elle se déclare enceinte au moment de la mort de son mari.
La servitude encourue jure civili par l'un des époux met fin au mariage, car il n'y a point de connubium entre un citoyen et une esclave, ou entre une citoyenne et un esclave. Toutefois cette cause de dissolution du mariage devait être assez peu fréquente, car les cas dans lesquels un citoyen athénien pouvait être privé de sa liberté étaient assez rares. Quant à la captivité, il ne semble point qu'elle soit à Athènes une cause de dissolution du mariage, mais elle peut fournir une juste cause de divorce.
On a voulu assimiler à l'espèce de mort civile résultant de la servitude celle qu'entraîne l'atimie des débiteurs du trésor public. Cette atimie, a-t-on dit, avait pour conséquence, sinon immédiatement, du moins après un assez court délai, la confiscation des biens, et cette confiscation permettait à la femme d'agir en restitution de sa dot. Or cette restitution n'étant point possible pendant le mariage, il en résulte que la confiscation des biens entraîne la dissolution du mariage. On peut cependant expliquer le droit de la femme de réclamer sa dot non comme un effet de la dissolution du mariage, mais comme une conséquence de la diminution de garanties produite par la confiscation. Ce que l'on doit plutôt admettre, c'est que la confiscation encourue par le mari peut fournir à la femme une cause de divorce, lorsqu'elle est prononcée en raison de faits avant un caractère déshonorant et de nature à rendre impossible la vie commune. Quant aux effets de la dissolution du mariage concernant la personne des époux et des enfants, ils ont été précédemment exposés à propos du divorce [Divortium]. De même, les effets de la dissolution du mariage quant aux biens des époux sont indiqués à propos de la dot [Dos].
Article de L. BEAUCHET
CEREMONIES DU MARIAGE
Les principaux témoignages écrits qui nous renseignent sur les cérémonies du mariage en Grèce, sont les textes des lexicographes. Ils font allusion surtout aux usages de l'époque classique. Aussi nous est-il difficile de remonter plus haut et d'étudier avec quelque détail les usages plus anciens, antérieurs au Ve et au IVe siècle. Nous nous bornerons à rappeler qu'au chant XVIII de l'Iliade, le poète homérique décrit une scène de mariage qui nous offre à coup sûr un tableau des moeurs ioniennes. Dans une des deux villes figurées sur le bouclier d'Achille, on célèbre des noces par des repas solennels ; on conduit les épousées à travers la ville, à la clarté des torches, et partout retentissent les chants d'hyménée ; des jeunes gens dansent en choeur, au son des flûtes et des cithares, et des femmes admirent le spectacle, debout devant le vestibule des maisons. Un fragment de Phérécyde de Syros, qui décrit les noces divines de Zeus et de Héra, emprunte sans doute plus d'un trait aux coutumes du VIe siècle, et les peintures du vase François, où le sujet de l'une des zones représente les noces de Thétis et de Pélée, peuvent aussi s'inspirer de certains détails de la vie réelle. Il est probable que, au cours du temps, l'évolution des moeurs a simplifié le cérémonial du mariage, comme elle a restreint le luxe des funérailles. C'est cette période plus récente que visent les textes des lexicographes, et nous en trouvons le commentaire figuré dans les peintures des vases attiques du style le plus développé.
Bien que le mariage, en Grèce, soit d'institution sacrée [Hieros gamos], il ne comporte point, à proprement parler, de cérémonie religieuse d'un caractère officiel. On ne saurait généraliser les cas exceptionnels où, au dire de Plutarque, on voit intervenir les prêtresses de Déméter et d'Athéna. Si les rites religieux et les sacrifices trouvent leur place dans les cérémonies nuptiales, ils relèvent plutôt du culte domestique que du culte officiel, et, à vrai dire, c'est dans la maison du père de l'épousée que se passent les actes solennels qui constituent la célébration du mariage. Lorsque l'accord était fait entre les deux familles, on fixait le jour des noces. Il semble que, le plus souvent, on préférât les mois d'hiver ; dans le calendrier attique, un de ces mois, celui de Gamélion, est désigné par un nom qui signifie le mois nuptial. On choisissait aussi assez volontiers le moment où la lune, étant dans son plein, promettait une soirée claire, un ciel net et pur. Les apprêts du mariage, les fêtes dont il était l'occasion, occupaient en général trois jours, au moins à l'époque pour laquelle les textes nous renseignent. S'il reste encore quelque incertitude sur l'ordre rigoureux des cérémonies, sur la durée du temps qu'on leur consacrait, on peut tout au moins les répartir de la manière suivante : 1° les cérémonies préparatoires ; le mariage (γαμος) ; 3° la fête des επαυλια qui se célébrait le lendemain des noces.
- LES CEREMONIES PREPARATOIRES
Pollux mentionne sous le nom de proaulia, le jour qui précédait le mariage. Cette journée était consacrée aux préparatifs de la fête et à certains rites d'usage. La fiancée faisait en quelque sorte ses adieux à sa vie de jeune fille, et consacrait à Artémis les jouets qui avaient charmé son enfance. Dans une épigramme de l'Anthologie, une fiancée offre à Artémis « ses tambourins, sa balle, son cécryphale, ses poupées et les vêtements de ses poupées ». Il est probable qu'il faut aussi placer dans cette journée la cérémonie des proteleia ; tout au moins le témoigage d'Hésychius est assez précis sur ce point (ta proteleia... pro mias tôn gamôn tês parthenou). Suivant le même auteur, elle comportait un sacrifice et une fête (ê pro tôn gamôn thusia kai eortê). C'était donc un acte religieux, consistant. en un sacrifice offert par le père de la fiancée, et qui consacrait la jeune fille à Artémis et aux Moires.
Certains critiques placent les proteleia le jour même du mariage, et y reconnaissent le sacrifice célébré immédiatement avant le repas de noces. On peut cependant objecter que, dans ce cas, la présence du fiancé eût été de règle, et que le même sacrifice eût réuni les deux jeunes gens. Or, il semble bien résulter d'un passage de Pollux que, si le fiancé accomplissait, lui aussi, la cérémonie des proteleia, c'est isolément. Voici un autre texte qui paraît prouver que le fiancé n'assistait pas nécessairement au sacrifice offert par le père de l'épousée. Dans Iphigénie en Aulide, le messager rapporte les propos qui courent dans le camp des Grecs : « On consacre (protelizousi) la jeune fille à Artémis, reine d'Aulis ; mais qui doit l'épouser ? » Et quand Agamemnon annonce à Clytemnestre le mariage prochain d'Iphigénie, elle lui demande : « As-tu offert à la déesse le sacrifice préliminaire (proteleia) ? » Nous croyons donc que cette présentation de la jeune fille à l'autel, au moment du sacrifice offert par le père, était indépendante du repas de noces et pouvait avoir lieu la veille, comme l'affirme Hésychius, quand, pour donner aux fêtes du mariage plus de solennité, on les répartissait sur plusieurs jours. Il reste possible que, dans certains cas, lorsque les fêtes étaient célébrées plus modestement, le sacrifice des proteleia fût reporté au jour même du mariage.
Cette cérémonie se complétait par l'offrande des aparchai. La jeune fille coupait une boucle de ses cheveux et la consacrait à Artémis. Les usages variaient d'ailleurs suivant les pays. A Mégare, les fiancés faisaient des libations sur le tombeau de la vierge Iphinoé, fille d'Alcathoos, et y déposaient des boucles de leurs cheveux ; à Délos, on accomplissait le même rite, et l'offrande était consacrée à Hécaergé et à Opis. A Haliarte, en Béotie, les fiancés se rendaient à la fontaine Kissoessa, et offraient un sacrifice aux Nymphes.
C'est aussi la veille du mariage, croyons-nous, qu'il faut placer la cérémonie de la loutrophorie. Le bain nuptial était en Grèce un usage général qui, suivant les pays, comportait des pratiques différentes. En Troade, les fiancées se baignaient dansle Scamandre, et prononçaient une sorte de formule rituelle : « Reçois, ô Scamandre, ma virginité ». A Thèbes, on puisait l'eau du bain dans l'Isménos, pour l'apporter aux fiancées. En général, on utilisait pour cet usage l'eau du fleuve qui coulait dans le pays. Un passage souvent cité de Thucydide nous apprend que les Athéniens se servaient, pour le bain nuptial, de l'eau de la fontaine Callirrhoé, et les termes qu'emploie l'historien attique (pro te gamikôn) semblent indiquer que l'offrande du bain, la loutrophorie, précédait la journée consacrée au mariage. Cette cérémonie s'accomplissait avec un certain apparat. Contenue dans une loutropbore, c'est-à-dire dans une amphore de forum spéciale, l'eau du bain était apportée à la fiancée par un jeune garcon choisi parmi les parents les plus proches, au dire d'Harpocration, ou par une jeune fille, suivant Pollux. Si l'on se reporte aux scènes de loutrophorie peintes sur les vases attiques, on s'apercoit que ces deux témoignages se concilient très facilement, et que la cérémonie donnait lieu à la formation d'un cortège où figuraient à la fois le jeune garçon et la jeune fille.

Une loutrophore du Musée national d'Athènes nous met ce cortège sous les yeux. Une femme portant deux torches ouvre la marche et se retourne vers les autres personnages qui s'avancent à pas mesurés. Vient ensuite un jeune garcon, le pais dont parle Harpocration ; couronné de myrte, il joue de la double flûte. Derrière lui, marche une jeune fille, presque une fillette, à en juger par sa taille, portant d'un air recueilli la loutropbore qui contient l'eau du bain, et devant laquelle vole un Eros. La fiancée s'avance à la suite, drapée dans un manteau, la tête inclinée, avec une expression charmante de gràce et de pudeur, et deux femmes, dont l'une tient une torche, complètent le cortège. Comme le fiancé n'y figure pas, il est impossible de confondre cette peinture avec celles qui représentent la rencontre des époux, et il n'y a guère d'hypothèse plus plausible que d'y reconnaitre la scène de la loutrophorie. La présence des torches portées par deux des femmes permet de croire que cet épisode des cérémonies de croire que cet épisode des cérémonies nuptiales avait lieu à la tombée de la nuit, dans la soirée qui précédait la célébration des noces.
- LE JOUR DU MARIAGE (γαμος)
1° Les préparatifs
Il est facile d'imaginer que, ce jour-là, la maison du père de la fiancée était en rumeur. On décorait la porte de guirlandes ; on disposait sur les murs ces couronnes de myrte que les peintres de vases n'ont garde d'oublier dans les représentations de scènes nuptiales. Tous ces préparatifs mettaient le voisinage en émoi et provoquaient la curiosité des passants. Quelques lignes de Lucien nous permettent d'évoquer un véritable tableau de genre : « Elle m'engagea à me pencher du côté de votre ruelle pour voir partout des couronnes, des joueurs de flûte, le mouvement de la fète, les choeurs chantant l'hyménée ». Il est vraisemblable que la matinée était occupée à ces soins. Dans le gynécée, les femmes entouraient la fiancée et procédaient à sa toilette, sous la direction de la nympheutria à qui était confiée la mission de parer la jeune fille (numphostolein), de l'aider de ses conseils et de l'accompagner pendant toute la durée de la cérémonie. L'épousée revêtait des vêtements de fête dont les couleurs variées et les broderies rehaussaient l'élégance : une riche tunique (stolê), le manteau brodé (imation poikilon) dans lequel les peintures de vases la montrent drapée, et le voile qui devait cacher son visage quand elle entrait dans la salle du festin ; elle chaussait les numphides, et l'on posait sur sa tête la couronne nuptiale qui figure souvent dans les peintures céramiques sous la forme d'une couronne de myrte ou d'un diadème radiés. Il est naturel que cette scène gracieuse de la toilette de l'épousée ait souvent inspiré les peintres de vases.
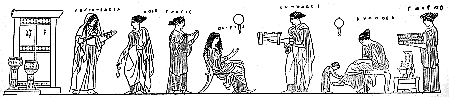
On peut à coup sûr la reconnaître sur une pyxis de pur style attique conservée au British Museum : sous des noms mythologiques, l'artiste a représenté en réalité la fiancée et les femmes qui s'empressent autour d'elle, au milieu des accessoires de toilette et des cadeaux de noce (progameia) parmi lesquels la loutrophore trouve sa place.
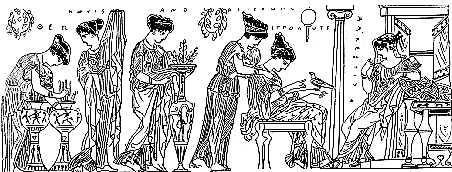
Un sujet analogue, traité dans le même esprit de demi-allégorie mythologique, décore une des faces d'un ovos d'Erétrie, au Musée national d'Athènes. La scène se passe dans le gynécée. Déjà parée, accoudée sur le coussin d'un lit, la fiancée regarde en souriant ses compagnes, prêtes elles aussi pour la cérémonie, et qui occupent les moments d'attente, l'une en jouant avec un oiseau, les autres en disposant des bouquets dans des vases. Une de ces dernières orne d'un bouquet de feuillage de myrte une loutrophore qui sans doute figurera tout à l'heure dans le cortège nuptial. Il serait facile de citer une longue série de vases où l'on retrouve des scènes de même nature ; pyxis, lécanés, amphores à couvercle montées sur un pied, tous ces vases de luxe qui ornaient le gynécée se prêtaient fort bien à ce genre de décoration. Les peintres traitent souvent ces scènes avec une fantaisie qui permet d'y introduire tout un monde d'Eros ailés, voltigeant autour des jeunes fenunes, apportant des coffrets et des bandelettes, et s'acquittant même parfois des fonctions dévolues à la nympheutria en posant la couronne nuptiale sur la tête de la fiancée.
2° Le sacrifice et le repas
La cérémonie du mariage comprend un sacrifice et un repas auquel sont conviés les parents et les amis des fiancés. On a vu plus haut que certains érudits placent à ce moment le sacrifice des proteleia. Nous avons adopté un avis différent. Mais il paraît certain que le repas de noces était précédé d'un sacrifice aux dieux du mariage (theoi gamêlioi) qui sont Zeus Téléios, Héra Téléia, Aphrodite. Peitho et Artémis. D'après Athénée, le banquet avait lieu en quelque sorte sous les auspices des theoi gamêlioi et Suidas rapporte que c'était l'usage à Athènes de sacrifier et de prier pour la fécondité de l'union des deux époux.
Le repas (gamos, thoinê gamikê, gamodaisia) a lieu dans la maison du père de la fiancée. L'ordonnateur (o trapezopoios) a tout disposé pour que la salle présente un bel aspect. Dans un fragment d'une comédie attique, l'Anakalyptoméné d'Evangélos, un personnage donne ses ordres pour un banquet de noces. « Il faut que le repas soit copieux et que rien ne manque ; nous voulons que les noces soient brillantes ». Une des femmes de la maison, qui remplit le rôle de dêmiourgos, celle-là même à qui est échu le soin de surveiller les apprêts du sacrifice, a préparé un des mets que l'usage commande, en pareille circonstance, d'offrir aux convives ; elle a pétri des gâteaux de sésame (plakous gamikos), symbole de fécondité. On a disposé les tables suivant l'ordre prescrit. Dans le passage de l'Anakalyptoméné d'Evangélos auquel nous avons fait allusion, il est fait mention de quatre tables destinées aux femmes ; six autres sont réservées aux hommes. A Athènes, au IVe siècle, la loi intervenait pour limiter le nombre des convives, de même qu'elle interdisait une trop grande affluence de monde aux cérémonies des funérailles, et les gynéconomes étaient chargés de visiter les maisons où se célébrait un mariage, afin de faire respecter cette prescription. Quand les convives prenaient place, la nympheutria introduisait dans la salle du festin la jeune épousée, strictement voilée, et celle-ci s'asseyait parmi les femmes. Lucien nous a laissé la description d'un repas nuptial : les femmes occupent un lit (klintêr) à droite de l'entrée de la salle ; le père de l'épousée et celui de l'époux sont en face des femmes. A vrai dire, le dialogue de Lucien nous offre surtout une amusante scène de parodie. Les convives de marque soulèvent des questions de préséance ; des intrus arrivent sans avoir été invités. A la fin du repas, on apporte les lampes, les coupes circulent, des poètes débitent des épithalames ; les têtes s'échauffent, les discussions tournent à la rixe et l'on finit par emporter l'époux, la tête fendue. Parodie à part, c'est encore le dialogue de Lucien qui nous a conservé le tableau le plus vivant d'un repas de noces. Les libations, les voeux adressés aux nouveaux époux, les épithalames étaient de règle. Au milieu des convives circulait un jeune garçon, dont les parents devaient être encore vivants (pais amphithalês) ; il présentait une corbeille remplie de pains, et disait : « J'ai fui le mal, j'ai trouvé le mieux ».
3° Les Anakalyptéria
A la fin du repas avait lieu la cérémonie du dévoilement de l'épousée (anakaluptêria). C'était le moment où la jeune fille, qui avait assisté voilée au repas, découvrait son visage pour la première fois en présence des hommes. S'il fallait ajouter foi à certains textes, cette cérémonie devrait se placer le troisième jour du mariage. Mais, après M. Caillemer, M. Deubner a démontré que le dévoilement de l'épousée a bien réellement lieu à la fin du banquet, avant la formation du cortège qui doit l'accompagner lorsqu'elle quitte la maison paternelle. Cet acte signifie que le mariage est en quelque sorte officiellement consacré et que la jeune fille est désormais une femme mariée. A ce moment, l'époux lui offre des cadeaux, les anakaluptêria dôra. Il faut sans doute reconnaître ici le souvenir d'une coutume en vertu de laquelle, accueilli dans la maison de l'épousée, il est l'hôte qui doit, par bienséance, apporter des cadeaux. On verra plus loin que cet usage a sa contre-partie et que, le lendemain des noces, les parents et les amis de l'épousée font porter leurs cadeaux dans la maison de l'époux.
4° Le départ de l'épousée
La cérémonie du dévoilement terminée, l'heure était venue où l'épousée devait quitter la maison paternelle. Ici encore, on se conformait à un cérémonial où l'on peut retrouver comme un souvenir très atténué des usages primitifs, au temps où le départ de la fiancée était un véritable enlèvement. Le mot agôgê, qui est quelquefois employé pour signifier la « conduite » de l'épousée à la maison du mari, est significatif. Comme le repas s'était prolongé tard, le départ de l'épousée avait lieu à la tombée de la nuit et la scène se passait à la clarté des torches nuptiales (dades numphikai). A la porte de la maison attendait le char qui devait emmener les époux, accompagnés d'un ami du marié qui remplissait le rôle de parochos ; on l'appelait aussi le paranumphios ou le numpheutês ; ses fonctions consistaient à conduire le couple jusqu'à la maison du mari. Le char (zeugos êmionikon ê boeikon) était attelé de mulets ou quelquefois de boeufs. Ce sont des mulets qui forment l'attelage dans un vase archaïque publié par M. Cecil Smith.

Un fragment d'onos en terre cuite nous conserve une représentation qui répond assez bien à la description du char dans Photius (klinida ê estin omoia diedrô) : c'est une sorte de charrette montée sur deux roues, d'un type fort simple et qui rappelle les véhicules usités dans nos campagnes. Il y avait place pour trois personnes : l'épousée au milieu ; de chaque côté l'époux et le parochos qui conduisait l'attelage. Sur ce fragment d'onos, ou voit un personnage à cheval qui suit le char : c'est un des amis du marié, l'oreôkomos, auquel fait allusion un passage d'Hypéride. Si telle était le plus généralement, d'après les lexicographes, la forme du char, on pouvait aussi faire usage d'un véhicule plus élégant. Dans la peinture qui décore une belle loutrophore du Musée de Berlin, le char a une caisse munie d'une antyx, et sur une coupe du même musée, où il offre la même forme, il est traîné par un attelage de quatre chevaux. Dans certains cas, lorsque l'époux contractait mariage pour la seconde fois, il n'était pas admis qu'il emmenât lui-même l'épousée : ce soin était confié à un de ses amis qui s'acquittait du rôle de numphagôgos, en conduisant seul la jeune femme à la maison de son mari. Enfin il arrivait encore que celle-ci fît le trajet à pied (chamaipous).
Quand est venue l'heure du départ, un cortège (pompê) se forme pour conduire le couple jusqu'au char qui doit l'emmener. En tête marche l'ordonnateur (proêgêtês) qui peut-être accompagne le char pendant tout le trajet, et porte le kérykeion comme insigne de sa fonction de héraut. Le couple vient ensuite, suivi de la nympheutria qui escorte ia mariée ; derrière elle s'avancent les parents de la jeune femme, la mère portant les dades numphikao,les torches nuptiales qui attestent que le mariage a été célébré comme une union légitime ; enfin, c'est le cortège des parents et des amis, des enfants couronnés de myrte (paides propemponpes) qui font escorte à l'épousée, et le défilé des joueurs de flûte et de lyre accompagnant les chants d'hyménée.
Cette scène du départ des époux était un des épisodes les plus caractéristiques, un de ceux qui pouvaient le mieux suggérer aux peintres céramistes de gracieuses compositions. Ils l'ont en effet souvent reproduite sur les loutrophores et les vases de luxe, avec une délicatesse de sentiment qui s'allie à la plus exquise pureté de style.

La voici traitée sur une belle loutrophore du Musée de Berlin. Couronné de myrte, charmant de jeunesse et de grâce, le jeune homme s'approche de l'épousée pour lui prendre la main. Celle ci s'avance pudiquement, la tète légèrement inclinée, tandis que la nympheutria, avec une sorte de coquetterie maternelle, dispose les plis de son voile ; un gros volant lui apporte un collier de perles, allusion évidente aux cadeaux offerts par l'époux au moment du dévoilement. A droite, la mère tient les deux torches nuptiales. La scène est conçue et traitée à peu près de la même manière sur une loutrophore du Musée national d'Athènes. Au centre de la composition, la jeune femme, à demi voilée, se dirige vers l'époux qui fait un geste d'accueil. Entre les deux personnages vole un Eros jouant de la double flûte. On reconnaît aisément, dans les autres figures, la nympheutria et la mère tenant les torches.

La loutrophore de Berlin que nous avons déjà mentionnée à propos du char nuptial nous montre, non plus le cortège d'adieu, mais la scène même du départ. Dans le tableau de gauche, on voit le parochos déjà monté sur le char, tenant d'une main l'aiguillon et de l'autre les rênes rassemblées. Le cortège, figuré par la mère et un des paides propempontes, est arrêté au seuil de la porte, et l'époux, soulevant doucement de terre la jeune épousée tout émue, va lui faire prendre place sur le char. C'est bien une sorte de rite qu'il accomplit ainsi avec une sorte de respect religieux, et cette jolie peinture pourrait servir de commentaire au passage où un poète comique attique fait allusion au départ de l'épousée.
5° La réception dans la maison de l'époux
Dans la peinture de la loutrophore de Berlin, l'artiste a représenté ingénieusement la contre-partie de la scène du départ. Un second tableau représente l'arrivée dans la maison paternelle de l'époux. Sur le seuil, se tiennent les parents de ce dernier, le père, en costume de fête, couronné de myrte, tenant un sceptre, la mère portant les torches nuptiales. C'est que, en effet, la réception du jeune couple était aussi réglée par un cérémonial obligé, et les parents de l'époux lui faisaient accueil lorsqu'il descendait du char. En Béotie, au dire de Plutarque, l'usage commandait de brûler devant la porte une roue du char, pour témoigner que désormais la jeune femme n'avait plus d'autre demeure que celle de son mari. On peut citer d'autres peintures de vases attiques où la répétition d'une scène analogue à celle de la loutrophore de Berlin indique bien que la réception du couple est aussi un des épisodes importants de la cérémonie.

Sur une coupe de Berlin, la mère du marié, tenant les torches, et accompagnée d'un joueur de lyre, se tient sur le seuil de la porte pour recevoir les époux, suivis de la nympheutria.

Sur une pyxis du Louvre, c'est le père du marié qui s'avance à leur rencontre, et, usant de la liberté que permettent de pareils sujets, traités souvent dans un esprit d'allégorie, le peintre a mêlé aux personnages deux divinités, Apollon et Artémis.

Nous citerons encore une amphore d'ancien style attique, conservée à Saint-Pétersbourg, où est représentée l'arrivée du char devant la maison. On aperçoit à droite le portique et la porte de la chambre à l'intérieur de laquelle une servante prépare le lit nuptial.
Quand le couple avait fait son entrée dans la maison, on lui offrait une collation de bien composée de dattes, de gàteaux, de figues sèches et de noix. S'il faut ajouter foi au texte de Plutarque, l'usage voulait qu'avant d'entrer dans la chambre nuptiale l'épousée mangeait un coing, fruit qui passait pour le symbole de la fécondité. Puis le couple se retirait dans la chambre où était dressée la klinê gamikê, et dont l'entrée était gardée par un des amis du marié, le thurôros. Les peintures des vases attiques, si riches en renseignements, ne nous offrent pas de documents figurés comparables à la célèbre peinture des Noces Aldobrandines, de l'époque romaine, où l'artiste a représenté la chambre nuptiale, l'épousée entourée d'un cortège de femmes, et prêtant l'oreille aux paroles de la pronuba. Mais, à l'époque hellénistique, les coroplastes grecs ont parfois emprunté à la même donnée le sujet de leurs compositions. En publiant un joli groupe de Myrina conservé au Musée Britannique, M. S. Reinach l'a interprété dans cet esprit, et dans les jeunes femmes assises sur un lit, il a reconnu l'épousée et une amie mariée « engagées dans un entretien discret ».
Un autre groupe du Louvre, de même provenance montre un couple assis sur un lit; le jeune homme semble écarter doucement le voile de sa compagne, et peut-être le modeleur a-t-il songé à une scène de dévoilement dans la chambre nuptiale. Pourtant ces compositions gardent un caractère un peu indécis et sont loin d'avoir la valeur documentaire des scènes si vivantes traitées par les peintres de vases attiques.
© Agnès Vinas
- LE LENDEMAIN DU MARIAGE
C'était encore un jour de fête, consacré à la cérémonie des epaulia. Le jour des epaulia est celui qui suit la nuit nuptiale où, pour la première fois, l'épousée a habité dans la maison de son mari (epêulistai). On le célébrait par l'envoi de cadeaux qui s'appelaient les epaulia dôra. Offerts par le père et les parents de la jeune femme, ces présents étaient en quelque sorte envoyés par réciprocité au jeune couple pour reconnaître ceux que le fiancé avait apportés la veille au moment du repas de noces. Ils étaient remis avec un certain apparat. Suidas nous a laissé une description du cortège qui se formait à cette occasion, et une énumération des objets qu'il était d'usage d'offrir aux mariés. D'abord venait un jeune garçon, en chlamyde blanche, tenant un flambeau allumé ; puis une jeune fille remplissant la fonction de canéphore ; enfin, d'autres jeunes filles, portant les cadeaux : c'étaient des lécanés, des vêtements, des peignes et autres objets de toilette, des alabastres, des chaussures, des coffrets, des parfums, du nitre, cadeaux utiles, convenant à une maîtresse de maison. Au dire de Suidas, c'est ce jour-là qu'était remise au mari la dot de sa femme.

Le cortège des epaulia a été reconnu très ingénieusement, par M. Deubner parmi les scènes qui décorent une pyxis d'Erétrie du Musée de Berlin. En tête marche un jeune homme portant une torche ; derrière lui s'avance la canéphore, une fillette aux cheveux courts tenant une corbeille qui n'est pas à proprement un kanoun, mais la corbeille à laine si ordinairement représentée dans les scènes de gynécée ; une jeune fille qui la suit tient de chaque main un de ces vases à pied et à couvercle qui sont si souvent décorés de scènes nuptiales ; de la main gauche elle présente une pyxis ; derrière elles vole un Eros, portant une loutrophore. Une joueuse de flûte prend part au cortège.
La réception des cadeaux offerts par le père de l'épousée était le dernier acte des cérémonies du mariage. Désormais la jeune femme commençait sa vie nouvelle dans la maison de son mari, devenue la sienne.
Article de MAX. COLLIGNON.
II. ROME
Le mariage est une des institutions les moins connues du droit romain ; nous ne savons pas exactement quelle a été sa forme primitive, pourquoi et comment se sont établis deux modes de mariage dont les effets sont radicalement différents, le mariage avec manus et le mariage sans manus. Il est probable qu'à l'époque primitive le mariage et la manus se confondaient.
- FORMATION DU MARIAGE (justae nuptiae, matrimonium justum, legitimum)
- Les éléments communs aux deux formes du mariage étaient :
1° Les fiançailles (sponsalia)
Les fiançailles exigeaient les mêmes conditions de validité que le mariage, sauf pour l'âge, où on pouvait descendre jusqu'à sept ans. Elles n'avaient pas à l'origine de caractère juridique ; elles se concluaient par contrat verbal, par une stipulation unilatérale qui promettait la femme au mari ; dans le droit latin, il y avait une double stipulation sanctionnée par l'action de sponsu ; le droit romain autorisait peut-être aussi une action en dommages-intérêts pour inexécution du contrat. Plus tard on se contenta du simple consentement, souvent avec témoins, et les fiançailles purent avoir lieu entre absents, mais elles ne furent plus obligatoires, et elles étaient résolubles par voie de renonciation unilatérale (repudium renuntiare, remittere ; sponsalia dissolvere) ; aussi on y joignait souvent une stipulatio poenae. Cependant elles produisaient quelques effets juridiques ; ainsi les fiancés ne pouvaient porter témoignage l'un contre l'autre, un fils ne pouvait épouser la fiancée de son père ni un père celle de son fils ; un rescrit de Septime Sévère autorisa la poursuite de la fiancée pour adultère. Celui qui se fiancait avec deux personnes à la fois était frappé d'infamie et perdait le droit de postuler pour autrui. Constantin punit même la rupture injustifiée des fiançailles par la perte de tous les présents que le fiancé avait faits, et il autorisa la fiancée ou ses héritiers, en cas de décès du fiancé après le baiser des fiançailles, à conserver la moitié des présents. Le futur remettait en effet habituellement à la future une somme d'argent, arra, ou, à titre de gage, un anneau soit de fer, soit d'or, dans ce dernier cas, souvent orné d'une pierre précieuse, que celle-ci portait au quatrième doigt. La fête des fiançailles comportait des invités, un repas, et la future épouse pouvait y recevoir des présents.
2° Les cérémonies du mariage
Elles étaient très simplifiées pour la veuve qui contractait un second mariage, et ce remariage paraît avoir été assez mal vu par l'opinion publique jusque dans la période la plus récente. Les inscriptions font souvent l'éloge des univiriae. Les cérémonies nuptiales s'appliquaient donc essentiellement aux jeunes filles. Des motifs religieux rendaient impropres à la célébration des noces un certain nombre de jours : le mois de mai marqué par les Lemuria et le sacrifice des Argei, la première quinzaine de juin consacrée au culte de Vesta, les dies parentales du 13 au 21 février, la première quinzaine de mars, les trois jours, 24 août, 5 octobre, 8 novembre où les Enfers étaient réputés ouverts, tous les dies religiosi, les calendes, les nones, les ides, et, en général, au moins à l'époque primitive, les jours de fête.
La veille des noces, la future quittait sa robe de jeune fille, sa toga praetexta, la consacrait avec ses jouets à des dieux, probablement aux Lares de sa famille, et revêtait en se couchant un costume spécial, une tunica recta ou regilla et une résille rouge (reticulum). La robe de noce était blanche ; c'était aussi une tunica recta, par quoi il faut entendre soit une tunique tissée à la mode ancienne avec fils de chaîne verticaux [Tela], soit une tunique sans sinus par-dessus la ceinture de laine qui la serrait à la taille avec un noeud (nodus herculeus). La mariée se couvrait en outre la tête (nubere, obnubere) d'un voile rouge (flammeum) ; elle avait changé sa coiffure, ses cheveux avaient été partagés au moyen de la hasta caelibaris, dard ou aiguille à pointe recourbée, en six tresses ou bandeaux, maintenus par des bandelettes (vittae). Cette coiffure, insigne de chasteté, était celle des matrones et des vestales. Les figures de vestales retrouvées à Rome dans l'atrium Vestae nous permettent de nous en représenter l'arrangement autour de la tête. Les matres familias la portaient dans l'ancien temps relevée en tutulus. Le voile qui les couvre, dans les scènes de mariage que nous voyons sur des monuments d'un temps assez récent, n'en laisse apercevoir que le bas ; mais dans l'une de ces scènes, sur un sarcophage du Musée de Naples, la mariée par exception est sans voile, et la femme qui se tient debout derrière elle est occupée à disposer la chevelure dans l'ordre qui convient à son nouvel état : on y distingue très bien la touffe relevée en masse au-dessus des bandelettes du front.

Elle portait sous le flammeum une couronne de fleurs cueillies par elle-même.
Le premier acte de la fête commençait dès l'aube par une prise d'auspices, par l'intermédiaire des nuptiarum auspices attitrés, qui observaient à l'origine le vol des oiseaux, plus tard simplement les entrailles d'une victime, probablement d'une brebis, offerte en sacrifice. Nous ne savons pas exactement à partir de quelle époque les plébéiens ont pu employer les auspices, qui étaient en principe réservés aux patriciens. Ce fut peut-être après l'établissement du connubium entre les deux classes. Les augures annoncaient le résultat de leurs observations aux nombreux invités. C'est à ce moment que l'on concluait le contrat de mariage, qu'on le faisait signer par des témoins, qui, jusque dans les derniers temps, paraissent avoir été au nombre d'au moins dix, et que les deux fiancés donnaient leur consentement au mariage. Puis une femme qui devait n'avoir été mariée qu'une fois, la pronuba, amenait les deux époux l'un vers l'autre et mettait la main droite de la femme dans la main droite du mari ; c'était la dextrarum junctio.

Elle était suivie d'une prière prononcée par un auspex nuptiarum, et adressée à Jupiter, à Junon, à Vénus, à Diane et à la déesse Fides. Ensuite les mariés accomplissaient eux-mêmes le sacrifice d'un boeuf ou d'un porc, soit dans la maison, soit même devant un temple public, comme paraissent le prouver plusieurs textes et des monuments figurés qui indiquent soit un temple, soit un cortège de sacrifice. Après le sacrifice et les voeux de bonheur formulés par les témoins au moyen de l'acclamation feliciter, avait lieu le repas de noces (cena), régulièrement dans la maison du père de la femme. A l'époque primitive, il se terminait à la nuit.
Alors commençait le second acte de la cérémonie, la conduite à la maison de l'époux (domum deductio). Après avoir fait semblant d'arracher l'épouse aux bras de sa mère, le cortège des parents et des invités l'accompagnait à la maison du mari avec des joueurs de flûte et des porteurs de torches, en chantant des vers fescennins, dont les principaux caractères étaient la bouffonnerie et l'obscénité, et en poussant le cri talasse, épithète d'une ancienne divinité oubliée, peut-être du dieu Consus dont la fête avait coïncidé avec le rapt des Sabines. Ces réjouissances étaient en général très indécentes et devaient être condamnées plus tard énergiquement par les pères de l'Eglise chrétienne. Les petits garçons demandaient à l'époux de leur jeter des noix, soit parce que ces fruits étaient le symbole de la fécondité, soit parce que l'époux en avait fini avec les jeux de l'enfance, L'épouse était accompagnée par trois garçons patrimi et matrimi (c'est-à-dire ayant encore leurs père et mère) ; deux d'entre eux la conduisaient, le troisième portait en l'honneur de Cérès un flambeau formé par une branche d'aubépine (alba spina), dont les invités s'emparaient ensuite comme d'un talisman. Derrière l'épouse on portait une quenouille et un fuseau.
Le troisième acte était la réception de l'épouse dans la maison du mari. Elle frottait de graisse ou d'huile et enveloppait de bandes de laine les montants de la porte. Elle prononçait la formule : Ubi tu Gaius, ego Gaia, détournée de son sens primitif, par laquelle elle répondait à l'interrogation de son mari et donnait son nom ; puis, pour entrer dans la maison, elle était soulevée au-dessus du seuil. Cet acte était-il le symbole du rapt ou avait-il pour but d'éviter une chute, et, partant, un mauvais présage ? Les textes donnent les deux explications. Le mari recevait son épouse en lui présentant l'eau et le feu, symboles de la vie et du culte communs dans l'atrium, brillamment éclairé, où la pronuba avait préparé en face de la porte le lectus genialis Il y avait alors quelques rites accessoires mal connus : la prière aux dieux de la maison ; la cérémonie obscène où on plaçait la jeune femme sur une représentation de Mutunus Tutunus pour lui assurer dans l'avenir la fécondité ; l'offrande par la femme de trois as, l'un à son mari, l'autre au foyer des Lares, le troisième à l'autel du carrefour voisin. Le lendemain elle offrait à ses parents un repas, les repotia, et aux dieux de sa nouvelle maison son premier sacrifice. Juvénal fait allusion à un don, au lendemain des noces, fait par le mari.
A tous ces actes du mariage se rapportaient de nombreuses divinités, pures abstractions, souvent de sens obscène, que nous ne connaissons guère que par les pères de l'Eglise chrétienne : Afferenda pour la dot, Domiducus, Domitius, Iterduca, Manturna pour la conduite à la maison de l'époux, Unxia, Ginxia, Virginiensis dea, Subigus, Prema, Pertunda, Perfica pour la réception dans la maison du mari et la nuit de noces. - Les éléments propres au mariage avec manus étaient la confarreatio, la coemptio, l'usus. Nous renvoyons à l'article Manus, en ajoutant ici le résumé de ce que l'on sait des cérémonies du mariage. Un monument découvert il y a quelques années à Chiusi et conservé dans le musée de cette ville jette sur ce point quelques lumières nouvelles ; il répond en même temps à une question souvent posée au sujet de la communauté d'usages qui peut avoir existé entre les peuples de l'Italie primitive. Les scènes sculptées sur ce tombeau étrusque, qui ne peut être postérieur au Ve siècle av. JC., nous montrent, au moins en Etrurie, l'existence de rites sur lesquels nous n'étions renseignés que pour les Romains.

Sur une de ses faces on voit, sous un drap frangé, soutenu à ses extrémités par deux personnes, dont une au moins est une femme, trois figures dont les têtes sont cachées par ce voile. Autant qu'on en peut juger par ce que l'on aperçoit de leurs corps, celle du milieu est une femme vue de face, enveloppée d'un manteau ; les deux autres, des hommes qui la saisissent par son vêtement. Il semble bien que l'on ait ici l'image de la mainmise (manu captio), avec un simulacre de violence, du rapt en un mot, que l'on rencontre chez d'autres peuples à l'origine du mariage, dont l'enlèvement des Sabines conservait la tradition légendaire chez les Romains et que Denys d'Halicarnasse présente comme l'ancienne coutume ; la trace ne s'en est jamais perdue. M. Gamurrini, qui a fait connaître la découverte de ce monument, en citant des textes connus, rappelle aussi la formule dont se servait le pontifex maximus quand il désignait une vestale nouvelle, en la saisissant par la main : ita te, Amata, capio, et y reconnaît celle dont on se servait en s'adressant aux femmes mariées quand elles étaient manu captae. Le voile étendu à la fois sur les deux époux, dont l'usage ancien est établi par un texte, parait être le symbole du connubium, par lequel ils étaient nuptus et nupta ; deux autres personnages sont figurés sur le bas-relief, tenant des feuillages : l'un d'eux serait, selon M. Gamurrini, un prêtre qui a pris les auspices. On voit à la suite un joueur de flûte.

Dans la sculpture qui décore un autre côté du même monument, il est difficile de ne pas reconnaître la cérémonie de la coemptio. Le personnage du milieu est un homme, et une femme lui fait face ; tous deux tiennent dans leur main levée un objet indistinct, peut-être une pièce de monnaie. En même temps le mari en dépose une autre dans un sac que lui tend la femme : ce qui s'accorde avec le commentaire où Servius déclare que les deux époux s'achetaient par une vente simulée. Dans la troisième figure on peut voir soit un pronubus ou une pronuba, soit le libripens, assistant nécessaire à la mancipatio.
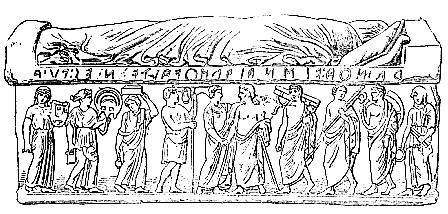
Sur un sarcophage étrusque d'un temps plus récent, un mariage est représenté : au milieu les deux époux se donnent la main. Chacun d'eux est suivi de serviteurs qui portent, derrière le mari, le siège, le lituus, le cor, qui sont sans doute des insignes de son rang ; derrière la femme, un parasol, une cassette, un éventail, une lyre : ils sont encore représentés sur le couvercle se tenant embrassés.
La cérémonie de la confarreatio était une cérémonie religieuse, précédée de la prise des auspices, célébrée par le grand pontife et le flamine de Jupiter, le flamen Dialis, en présence de dix témoins. Quel était le rôle de ces dix témoins ? Représentaient-ils les dix gentes de la curie ou les dix curies de la tribu du mari ? Etaient-ils, eux et le grand pontife, de simples témoins instrumentaires, ou avaient-ils à sauvegarder un intérêt politique, à constater par exemple l'existence du connubium entre les époux ? Nous ne le savons pas exactement. Mais il est probable qu'à l'origine la confarréation, comme l'adrogation et le testament, intéressait toute la communauté et se célébrait dans la curie. Plus tard elle a dû se passer, comme les autres mariages, dans la maison de la future. Au premier acte, après la conclusion du contrat, la future prononçait la formule dont nous n'avons que le texte grec, et qu'on traduit par les mots quando (ou ubi) tu Gaius, ego Gaia. Elle signifiait probablement à l'origine que la fiancée adoptait le nom gentilice de son fiancé. Plus tard, lorsque Gaius et Gaia furent de simples prénoms, elle cessa d'être comprise et on en donna des explications invraisemblables. Après la dextrarum junctio, on offrait à Jupiter une oblation composée de fruits et d'un gâteau d'épeautre (panis farreus, libum farreum), probablement par l'intermédiaire du flamine de Jupiter, qui prononçait la formule de la prière, où étaient sans doute invoquées outre les divinités nuptiales, telles que Junon, des divinités champêtres, Tellus, Picumnus et Pilumnus. Pendant l'offrande, les époux se tenaient sur deux sièges jumeaux, recouverts de la toison d'une brebis qui avait été sacrifiée, puis ils faisaient le tour de l'autel, par la droite, précédés par un enfant (camillus) qui portait dans un vase appelé cumerum ou camillum certains objets (nubentis utensilia) que nous ne connaissons pas exactement. Y avait-il un autre sacrifice ? C'est peu probable. Nous ignorons quelles étaient les paroles solennelles (certa et solennia verba) dont parle Gaius. Le mariage par confarréation se dissolvait par la cérémonie analogue de la diffarreatio.
On voit donc que, en dehors de la confarréation, le mariage n'exige ni solennités de forme, ni intervention de l'autorité publique. Il n'y a même pas de moyen régulier d'en constater la formation. En fait cependant, surtout pour distinguer le mariage du concubinat, il y a comme preuves les cérémonies qu'on vient de voir et la conclusion d'un contrat de mariage. Le contrat s'appelle tabulae nuptiales, matrimoniales, dotales ou dotis instrumenta dotis ou dotalia. Il n'est pas absolument nécessaire et ne constitue pas à lui seul le mariage, puisqu'il peut être signé même après l'union. A défaut de ces preuves, les jurisconsultes classiques paraissent avoir admis que, chez des personnes honorables, la cohabitation était une présomption de mariage ; cette présomption fut également admise par Théodose II et Valentinien III, et confirmée par Justin (ou Justinien) quand les deux personnes étaient libres et ingénues ; Justinien exigea pour les sénateurs et les illustres un contrat renfermant une constitution de dot et une donation ante nuptias, et, au moins pendant quelque temps, pour les autres dignitaires un écrit rédigé par le defensor en présence de trois membres du clergé.
- Les éléments communs aux deux formes du mariage étaient :
- CONDITIONS DE FOND COMMUNES AUX DEUX FORMES DE MARIAGE
- Age requis
Il était déterminé primitivement par le chef de famille, et, en pratique, il coïncidait avec la puberté, c'est-à-dire l'aptitude à engendrer chez l'homme (pubes), l'aptitude à concevoir chez la femme (nubilis, viri patiens, viri potens). Par conséquent, les non-pubères ne se mariaient pas valablement, non plus que les castrats. Pour les femmes, l'âge de douze ans révolus fut toujours une présomption de la puberté. Pour les hommes, il y eut des variations dans la législation et dans les moeurs. Une cérémonie religieuse, célébrée régulièrement le jour des Liberalia (17 mars), marquait l'époque où le jeune homme atteignait l'âge de la puberté. Il déposait devant les Lares de sa maison sa toga praetexta et sa bulla qu'on suspendait au-dessus du foyer, et revêtait la tunica recta et la robe des hommes, la toga virilis, pura, libera ; il devenait vesticeps après un sacrifice célébré dans sa maison, il était conduit solennellement au Forum et inscrit sur les listes civiques [Census, Tribus]. Il avait dès lors la pleine capacité juridique, sortait de tutelle, pouvait tester et se marier. A quel âge avait lieu cette constatation de la puberté ? Il est vraisemblable que dans le droit primitif, d'après la prétendue constitution de Servius, c'était à dix-sept ans. Cet âge de dix-sept ans, la plena pubertas, eut pendant longtemps une certaine importance juridique. Mais dès la fin de la République les parents pouvaient, pour différentes raisons, avancer cette date. Sous l'Empire, de nombreux textes montrent que la prise de la toge virile variait entre quatorze ans et seize ans révolus, sauf dans la famille impériale, où pour des raisons particulières on trouve même commes limites extrêmes douze et dix-neuf ans. Dans le droit public, nous trouvons l'âge de quatorze ans indiqué pour la première fois dans la lex coloniae Juliae Genetivae de 44 av. JC., et c'est cet âge qui prévalut, malgré les divergences des jurisconsultes : si les Sabiniens l'acceptaient, les Cassiens tenaient encore pour l'époque réelle de la puberté, constatée par un examen physique, et une troisième opinion exigeait ces deux conditions. Justinien établit décidément l'âge de quatorze ans. Quand la condition d'âge n'avait pas été respectée, il n'y avait pas mariage véritable ; mais le vice était couvert quand les deux conjoints avaient atteint la puberté, mais cependant il n'y avait pas d'effet rétroactif. On peut admettre que l'âge moyen du mariage était, pour les femmes, de treize à seize ou dix-sept ans, pour les hommes, de vingt à vingt-cinq ; les lois caducaires d'Auguste frappaient de leur déchéance les célibataires, femmes, dès l'âge de vingt ans, hommes, dès l'âge de vingt-cinq ans. Dans l'ordre sénatorial, les jeunes gens paraissent souvent avoir attendu pour se marier l'exercice de la questure. -
Connubium
Nous renvoyons à l'article Connubium. Ajoutons seulement ici l'interdiction du mariage légal qui frappe les simples soldats citoyens au service, pendant toute la durée de l'Empire jusqu'au IVe siècle ap. J.-C. Ce point de droit, qui était resté douteux malgré des textes formels, a éte confirmé d'une manière décisive par des documents découverts en Egypte. Si le mariage a été contracté avant le service, ses effets légaux sont suspendus. -
Consentement
A l'époque primitive, le consentement des conjoints n'avait à intervenir que quand ils étaient sui juris ; au cas contraire, l'accord des chefs de famille était la seule condition nécessaire. Dans le droit classique, à la suite de l'affaiblissement de la puissance paternelle, le père ne peut pas imposer un mariage à son fils ou à sa fille, quoiqu'en fait cette dernière ne puisse guère résister à ses injonctions. Le consentement des conjoints est donc théoriquement nécessaire ; par conséquent, un fou ne se marie valablement que pendant ses intervalles de lucidité. Quand le futur n'est pas sui juris, le consentement du chef de famille est toujours nécessaire, quel que soit l'âge de l'enfant ; il se donne sans forme solennelle, expressément ou tacitement ; on ne consulte ni la mère, ni les ascendants maternels, non plus que les ascendants paternels qui n'ont plus la puissance ; pour les petites filles, placées sous la puissance du grand-père, le consentement du père n'est pas nécessaire, mais il l'est pour les petits-fils qui sont dans le même cas. L'enfant sui juris n'a besoin d'aucune autorisation, quel que soit son âge ; pendant toute l'époque où il y a toujours la tutelle perpétuelle des femmes, la fille a besoin de l'auctoritas tutoris, qui devient, il est vrai, de plus en plus une simple formalité ; cependant on constate plus tard une tendance à restreindre sa liberté d'après une loi de Septime Sévère, on consulte le magistrat quand il y a désaccord entre le tuteur, la mère et les autres parents sur le choix d'un mari ; d'après des lois de Valentinien Ier, et de Gratien, puis d'Honorius et de Théodose, la fille ne se marie librement qu'après vingt-cinq ans ; auparavant elle a besoin du consentement du père, à son défaut, de celui de la mère, et à défaut de la mère, de celui des plus proches parents.
Jusqu'à Auguste, la loi ne peut intervenir contre le père qui refuse son consentement : il n'encourt que la réprimande du censeur pour abus de la puissance paternelle à partir d'Auguste, dont la législation favorise le mariage, le magistrat est autorisé à intervenir quand l'opposition du père n'a pas de motif valable. Que se passe-t-il en cas de folie, de captivité ou d'absence du père ? Dans le cas de folie du père, la fille est de bonne heure considérée comme sui juris ; jusqu'à Marc-Aurèle le fils a besoin de l'autorisation de l'empereur pour se marier ; Justinien fait en outre donner aux enfants, par le curateur du fou, une dot ou une donation ante nuptias sous le contrôle du préfet de la ville à Constantinople, et, dans les provinces, du gouverneur ou de l'évêque. Dans le cas de captivité, le mariage contracté par les enfants est valable, si le père meurt captif ; sinon, malgré les effets théoriques du postliminium, le mariage est encore considéré comme valable par la majorité des jurisconsultes, même pour les garçons ; Justinien exige un délai de trois ans depuis le début de la captivité. Dans le cas d'absence, nous ne savons pas exactement si l'ancien droit admet la validité du mariage ; Justinien demande encore un délai de trois ans. La cohabitation effective n'est pas nécessaire pour la formation du mariage ; elle résulte du consentement (consensus ou affectus) et non du concubitus. Cependant il faut que cette cohabitation soit actuellement possible, c'est-à-dire que la femme soit mise à la disposition du mari ; aussi l'homme absent peut se marier, la femme absente ne le peut pas.
- Age requis
- BUT ET EFFETS DU MARIAGE
- Il a pour but essentiel la procréation des enfants (liberum quaesundum, quaerendorum gratia). Théoriquement et dans le droit primitif, il est conclu à vie. Il exclut la polygamie. La femme qui vit avec un homme marié (paelex, pelex, pellex) est frappée de réprobation par le vieux droit pontifical qui lui interdit de toucher à l'autel de Juno Lutina, sous peine de lui offrir un sacrifice expiatoire.
- Il y a d'abord un certain nombre d'effets généraux communs aux deux formes du mariage.
Les justae nuptiae impliquent une association pleine et entière, l'égalité de droit divin et humain. Au point de vue social, les époux ont le même rang, la même dignitas ; la femme (uxor) s'élève ou s'abaisse par le mariage, et la situation qu'elle acquiert subsiste même quand il est dissous, à moins qu'elle ne contracte un second mariage de rang inférieur ; sous l'Empire, la femme entre dans la classe sénatoriale quand son mari en fait partie ; et alors elle porte dès Hadrien, régulièrement depuis Marc-Aurèle, l'épithète de clarissima ; la femme d'un vir consularis porte aussi le titre de consularis, titre que l'empereur peut également décerner à des femmes, surtout de sa famille, par faveur spéciale. La femme garde sa condition quand elle épouse, ingénue un affranchi, affranchie un ingénu, patricienne un plébéien, plébéienne un praticien. Elle a de plein droit le domicile légal du mari et le garde après la dissolution du mariage, à moins qu'un second mariage ne lui en donne un autre. Dans la maison, elle participe aux cultes particuliers du mari, à ses sacra privata. Elle tient le premier rang au foyer domestique [Gynaeceum] ; elle exerce sur ses enfants la même autorité morale que le mari, elle dirige leur première éducation [Educatio]. Elle a droit à la reverentia de la part des affranchis du mari. Le mari lui doit protection ; elle lui doit respect. Ils se doivent réciproquement fidélité [Adulterium]. Un second mariage, contracté avant la dissolution du premier, est nul, et s'il y a eu mauvaise foi, entraîne, comme stuprum, l'infamie et une peine corporelle, plus tard même, dans le droit de Justinien, la mort, contre le coupable, mari ou femme. Le mariage engendre l'alliance ou l'affinité, c'est-à-dire la relation qui se forme entre les deux époux, entre chaque époux et les parents de son conjoint, entre les parents des deux époux. Sauf quelques exceptions, l'affinité ne produit plus d'effets juridiques après la dissolution du mariage.
A la belle conception du mariage qu'on a vue répondent le rôle et le caractère de la matrone romaine à l'époque ancienne : elle n'est point enfermée dans un gynécée comme la femme grecque ; exempte, au moins dans les grandes familles, de tout travail servile, elle est occupée à filer et à tisser avec ses esclaves, à administrer la maison, à nourrir et à élever ses enfants. Elle ne doit pas boire de vin. Elle n'a de relations que celles de son mari. Elle reçoit les souhaits et les présents de sa famille au 1er mars, jour des Matronalia. Elle conseille son mari dans toutes ses affaires. Au dehors elle porte la stola matronalis ; on lui cède le pas dans la rue ; on ne doit pas la toucher, même pour une citation en justice. Elle peut paraître devant les tribunaux, soit comme demanderesse, sauf, à partir d'une certaine époque, pour autrui, soit comme témoin, et dans les procès criminels pour intercéder en faveur de parents. Elle assiste aux repas solennels, à un certain nombre de spectacles publics, aux fêtes des femmes mariées (les Carmentalia, les Matronalia, la fête de la Fortuna virilis, les Matralia, le sacrum Cereris, la fête de la Bona Dea). Les mères de trois enfants ont, sans doute depuis Auguste, une stola particulière : ce sont les stolatae matronae. Il y eut à Rome, probablement depuis une époque très ancienne, un conventus matronarum, collège sans doute religieux, dont nous ne connaissons presque rien ; il avait son local, sa curia, sur le Quirinal et peut-être un second lieu de réunion au Forum de Trajan. On sait qu'il se réunissait pour certaines fêtes et quand une femme entrait par le mariage dans la classe des consulaires. Elagabal en fit un senaculum auquel il donna un nouveau local sur le Quirinal, et toutes sortes de règlements sur le costume, la préséance, les différentes formes de véhicules. Aurélien parait l'avoir rétabli dans son état primitif, en donnant le premier rang aux femmes qui avaient été prêtresses. -
Rapports des époux
Quand il y a manus, nous renvoyons à l'article Manus. Dans le mariage sans manus, si la femme était sui juris, elle restait sui juris, sous la tutelle de ses agnats ; lorsque la tutelle perpétuelle des femmes eut disparu, elle put disposer librement de tous ses biens. Si elle était alieni juris, elle restait sous la puissance du paterfamilias, soumise à sa juridiction domestique ; elle acquérait pour lui, il était responsable de ses torts, avait pour la réclamer les interdits de liberis exhibendis, ducendis, pouvait, jusqu'à l'époque d'Antonin, la revendiquer malgré son mari. Les deux patrimoines restaient distincts, sauf la dot. De bonne heure les femmes possédèrent ainsi des fortunes si considérables que la loi Voconia défendit à tout citoyen possesseur d'une fortune d'au moins cent mille as d'instituer pour héritière testamentaire une femme ou une jeune fille. Elles avaient souvent, pour administrer leurs biens, des mandataires propres, des procuratores, qui étaient souvent leurs affranchis. A ce point de vue, les deux époux étaient donc l'un par rapport à l'autre des étrangers ; mais ce régime subit quelques atténuations ; ainsi les époux ne purent s'intenter réciproquement des actions pénales ou infamantes ; en cas de poursuite par son conjoint, l'époux n'était condamné que jusqu'à concurrence de ses ressources ; les donations faites par l'un des conjoints à l'autre étaient nulles ; dans l'application du senatus consultum Silanianum, les esclaves de l'un d'eux étaient censés communs ; l'édit du préteur et les lois des empereurs établirent entre eux un droit de succession [Bonorum possessio, Heres] ; enfin le mari eut pour réclamer sa femme des interdits analogues à ceux du père (de uxore exhibenda, ducenda), et vers l'époque d'Antonin on enleva au père le droit qu'il avait encore de rompre malgré elle, malgré l'existence d'enfants, le mariage de sa fille. Quant au nom, dans le mariage par confarréation, la femme prenait probablement au début le nom gentilice de l'époux ; dans le mariage sans manus, la femme gardait régulièrement le gentilice paternel ; cependant, sous l'Empire, elle a pris quelquefois, abusivement, celui du mari. A l'époque primitive et, encore sous l'Empire, dans les grandes familles, elle ajoutait à son nom le génitif du nom du mari ; plus tard, le mot uxor indiquait généralement le mariage. -
Rapports de la mère et de l'enfant
Ils étaient tout autres dans le mariage sans manus que dans le mariage avec manus. Dans le premier cas, en effet, la mère et l'enfant appartenaient légalement à des familles différentes ; l'enfant n'était pas l'héritier ab intestat de sa mère ; sauf sa dot, les biens de cette dernière restaient à sa famille. Mais sur ce terrain le droit primitif subit aussi de graves modifications, lorsque la parenté naturelle, la cognatio, fut admise comme une source de droits et de devoirs [Cognati]. Le droit prétorien, puis des sénatusconsultes, le S. C. Tertullianum et le S. C. Orfitianum, et des lois impériales établirent entre la mère et ses enfants un droit de succession réciproque [Heres]. La mère put réclamer des aliments à l'enfant ; ce dernier ne put intenter contre elle des actions infamantes ni lui opposer l'exception de dot, ni la citer en justice sans l'autorisation du magistrat, ni obtenir de condamnation contre elle que jusqu'à concurrence de ses ressources. Elle acquit le droit de réclamer la garde de ses enfants impubères quand le tuteur était un tiers, ou même quand, on cas de divorce, ils restaient sous la puissance de l'autre conjoint, et mème, sous les empereurs chrétiens, elle en obtint la tutelle. Inversement, quand le père et les ascendants males paternels étaient décédés ou trop pauvres, la mère dut fournir à l'enfant des aliments, le faire élever veiller sur sa tutelle, provoquer la nomination d'un tuteur, sous peine de perdre tout droit à sa succession. - Rapports du père et de l'enfant
Ici les deux formes de mariage produisaient les mêmes effets. Ils se résumaient dans la formule : liberi patrem sequuntur. Le père transmettait donc à son enfant la qualité de citoyen, son rang social, sous l'Empire la noblesse sénatoriale s'il appartenait au Sénat, son origo, son domicile légal [Tribus]. L'enfant naissait soumis à la puissance paternelle ; la puissance appartenait au grand-père quand il avait encore sous sa puissance le père de l'enfant au moment de la conception [Patria potestas]. L'enfant était l'agnat des agnats de son père [Agnatio], le gentilis de ses gentiles [GENS].
Ces effets supposaient la certitude de la filiation : le fait de l'accouchement la rendait de constatation facile pour la mère ; il était plus difficile de prouver la paternité du mari : à l'époque primitive il tranchait lui-même la question, puisqu'il avait le droit de reconnaître (tollere, suscipere) ou de rejeter l'enfant [Expositio]. Plus tard il y eut deux présomptions : une présomption morale, exprimée par l'axiome « pater... is est quem nuptiae demonstrant », d'après laquelle l'enfant conçu pendant le mariage était censé issu des oeuvres du mari ; une présomption scientifique d'après laquelle les limites extrêmes des grossesses étaient de cent quatre-vingts et de trois cents jours : par conséquent, l'enfant né au moins cent quatre-vingts jours après le début du mariage et au plus trois cents jours après sa dissolution avait le bénéfice de la légitimité ; mais la preuve contraire paraît avoir été admise contre les deux présomptions, surtout contre la première, par exemple en cas de maladie, temporaire ou permanente, du mari.
- Il a pour but essentiel la procréation des enfants (liberum quaesundum, quaerendorum gratia). Théoriquement et dans le droit primitif, il est conclu à vie. Il exclut la polygamie. La femme qui vit avec un homme marié (paelex, pelex, pellex) est frappée de réprobation par le vieux droit pontifical qui lui interdit de toucher à l'autel de Juno Lutina, sous peine de lui offrir un sacrifice expiatoire.
- DISSOLUTION DU MARIAGE
- Par la mort de l'un des époux.
- Par la perte de la liberté. L'établissement de la servitude jure civili était devenu de plus en plus rare. Justinien supprime la servitus poenae. La captivité chez l'ennemi rompait le mariage, sauf celui de l'affranchie, femme de son patron, qui, en pareil cas, n'était pas autorisée à se remarier ; dans le droit de Justinien, l'épouse du prisonnier ne fut autorisée à se remarier qu'au bout de cinq ans, lorsque l'existence de ce dernier était incertaine, sous peine de subir les mêmes déchéances que le conjoint qui était la cause du divorce.
- Par la perte de la cité, qui amenait une capitis deminutio media, par exemple dans le cas de déportation. Cependant dans ce dernier cas, d'après quelques textes, le mariage subsistait, si le conjoint y consentait ; mais nous ne savons pas exactement s'il y avait là une exception à la règle, ou s'il se formait un nouveau mariage du droit des gens.
- Par un changement dans la condition juridique, par une capitis deminutio minima. Ce fait devait être fort rare. Il se produisait par exemple quand un beau-père adoptait son gendre sans émanciper sa fille, et probablement aussi, pendant l'Empire, quand le mari d'une affranchie devenait sénateur.
- Par le divorce [Divortium]. La femme veuve devait porter le deuil du mari pendant dix mois, à l'époque primitive en blanc. Le mari n'était pas astreint à cette obligation. Si les moeurs n'étaient pas très favorables aux seconds mariages, Auguste dut cependant en augmenter le nombre par les lois caducaires, puisque le veuf redevenait immédiatement coelebs, et que la veuve n'avait que deux ans (vacatio biennii) pour se remarier. Le veuf pouvait se remarier de suite : la veuve devait attendre la fin de la période de deuil : autrement la loi frappait d'infamie le père de la femme, le père du second mari qui avait ordonné ou toléré le mariage, le second mari lui-même, à moins qu'il n'y eût été contraint. Au Bas-Empire, la femme elle-même devenait infâme ; en outre elle perdait tout ce que son premier mari lui avait laissé en mourant, elle ne pouvait rien recueillir par testament ou à cause de mort, ni ab intestat au delà du troisième degré ; elle ne pouvait donner à son second mari plus du tiers de ses biens en dot ou par testament. D'autre part, les empereurs chrétiens infligèrent de graves incapacités au conjoint qui se remariait, ayant des enfants d'un premier lit. Sur ses biens propres il ne put ni donner entre vifs ni léguer à son nouveau conjoint une part supérieure à celle que recueillait le moins favorisé de ses enfants du premier lit ; quant aux biens qu'il avait recueillis du premier conjoint, aux lucra nuptialia, il n'avait plus sur eux qu'un droit de jouissance et d'usufruit ; il lui était interdit de les aliéner ; ils devaient revenir intégralement aux enfants du premier lit.
- Par la mort de l'un des époux.
- UNIONS REGULIERES AUTRES QUE LES justae nuptiae
Il y en a trois formes principales :
- Le concubinat [Concubinatus].
- Le contubernium [Contubernales].
- Le mariage du droit des gens (juris gentium). C'était le mariage entre Latins et pérégrins, ou entre Romains et Latins, ou entre Romains et pérégrins, c'est-à-dire entre des personnes qui n'avaient pas le connubium. Nous ignorons quels en étaient les effets. Il est probable qu'il autorisait la constitution d'une dot et qu'il donnait au mari le droit de punir l'adultère de la femme. Il pouvait se transformer en justae nuptiae de plusieurs manières : 1° par la concession du droit de cité à un Latin ou à un pérégrin, qui, l'obtenant pour lui-même, sa femme et ses enfants, obtenait en même temps de l'empereur, par concession spéciale, la puissance paternelle sur ces derniers ; 2° par la causae probatio [Libertus] ; 3° par l'erroris causae probatio dont on a vu les principales applications [Libertus]. Ajoutons ici le cas où un Romain ou une Romaine, ignorant sa qualité, épousait soit un Latin, soit un pérégrin, en se croyant soit de droit latin, soit de droit pérégrin.
Pour les effets de la filiation qui ne résulte pas d'un mariage légal, nous renvoyons aux articles Naturales, Liberi, Spurius. - Le concubinat [Concubinatus].
Article de CH. LECRIVAIN