
Le Phare d'Alexandrie - Lithographie de Ferdinand Knab publiée dans Munchener Bilderbogen, 1886
Le phare d'Alexandrie
La ville d'Alexandrie, Alexandre et Méhémet-Ali
 |
Port d'Alexandrie
Dans la
soirée du 16 décembre 1874, le Moeris arrivait
en vue d'Alexandrie. Le Moeris, voilà un nom qui
déjà nous rappelait les souvenirs
vénérables de la terre des Pharaons. Par
malheur, il était trop tard pour qu'on nous
permît l'entrée du port.
La passe est difficile ; les bas-fonds perfides, les rochers
sous-marins dont parle Pline n'ont pas disparu, et les
paquebots pourraient tomber dans les pièges où
parfois périssaient les galères de César
et d'Antoine.
Force nous fut de rester au large, durant toute la nuit ;
seule l'étoile scintillante du phare nous
annonçait Alexandrie et l'Egypte.
Dès l'aube, un pilote vient à bord. Le Moeris
s'ébranle et s'achemine lentement vers le port. Des
bouées, de longues perches marquent et limitent la
passe.
Le premier aspect que présente l'Egypte n'a ni
grandeur ni originalité pittoresques. La côte
est basse et aride, la ville étalée
uniformément n'accuse aucun ensemble imposant, aucune
curieuse saillie, aucune silhouette harmonieuse ; le regard
erre sur cette interminable platitude, sans trouver rien qui
l'attire et le retienne. Nous laissons derrière nous
une longue digue encore inachevée ; la mer, comme
irritée de l'usurpation nouvelle que l'on
prépare, lui jette son écume et bat
furieusement les blocs encore mal assujettis.
Les objets se précisent cependant, sans devenir plus
séduisants. A notre gauche, l'île de Pharos
s'avance, entassant les bâtisses disgracieuses d'un
arsenal et d'un palais vice-royal. Un isthme de construction
antique et dit autrefois heptastade, car il avait sept
stades de longueur, relie au continent cette île
devenue ainsi une presqu'île. Cet isthme, où
deux passages étaient ménagés,
séparait le grand port, aujourd'hui
délaissé, du port d'Eunoste, le seul qui reste
en usage. Les soldats de César et les Alexandrins s'y
livrèrent à plusieurs reprises de furieux
combats.
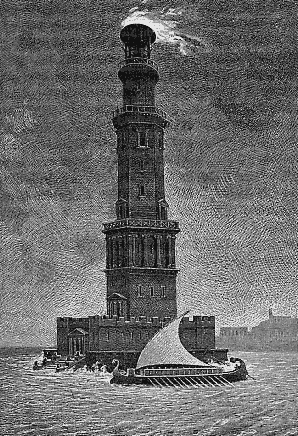 |
Phare d'Alexandrie
Pharos portait, sur
un rocher qui termine son extrémité orientale,
le phare, illustre entre tous, le plus considérable
que les anciens eussent élevé et le plus
somptueux qui fût jamais. Ce phare avait eu pour
architecte Sostrate de Cnide ; il coûta huit cents
talents, c'est-à-dire trois millions neuf cent
trente-six mille francs. Construit entièrement en
marbre, il était partagé en trois
étages. Carré à sa base, il devenait
octogone, puis rond ; il ceignait une galerie qui permettait
d'en faire le tour. Le curieux que les degrés de
marbre avaient conduit jusque-là, pouvait embrasser
d'un regard Alexandrie tout entière, ses riches
campagnes, le Delta sillonné de canaux, le Nil
traînant au loin ses eaux fauves et la mer que le limon
souille sur un espace immense. Le feu rayonnait à une
hauteur de plus de cent dix mètres au-dessus du rivage
; on pouvait l'apercevoir à une distance de quarante
kilomètres.
A l'appui de cette description sommaire, nous citons quelques
textes empruntés aux auteurs anciens et du moyen
âge.
«Cette même extrémité (orientale)
de l'île, dit Strabon, est formée par un rocher
entouré d'eau de toutes parts, surmonté d'une
tour à plusieurs étages, admirablement
construite en marbre blanc, qui porte le même nom que
l'île. Elle fut élevée par Sostrate de
Cnide, favori des rois, pour le salut des navigateurs comme
le porte l'inscription. En effet, sur un rivage qui, de
chaque côté d'Alexandrie, est bas,
dénué de ports, garni d'écueils et de
bas-fonds, il était nécessaire de placer un
signal élevé et très remarquable, afin
que les navigateurs, arrivant de la haute mer, ne pussent
manquer l'entrée du port... La bouche occidentale
n'est pas non plus d'un abord facile ; elle n'exige cependant
pas autant de précaution. Elle donne entrée
à un autre port, appelé Eunoste, en dedans
duquel est un port creusé de main d'homme et
fermé; celui dont l'ouverture est masquée par
la tour du phare, est le grand port ; les deux autres lui
sont contigus à leur extrémité et n'en
sont séparés que par la chaussée
nommée Heptastade».
«L'entrée du port, lisons-nous dans les
Commentaires de César, est si étroite
qu'un vaisseau n'y peut aborder malgré ceux qui sont
maîtres du phare. César qui craignait que
l'ennemi ne s'en emparât, le prévint pendant
qu'il était occupé ailleurs, y débarqua
ses troupes, s'en saisit et y mit garnison. Par là il
fut en état de recevoir sûrement par mer des
vivres et des secours ; aussi envoya-t-il dans toutes les
contrées du voisinage pour s'en procurer».
Flavius Josèphe, dans son Histoire de la Guerre des
Juifs et des Romains, parlant d'une tour dite de Phazael
élevée à Jérusalem, nous dit :
«Sa forme ressemblait à celle du phare
d'Alexandrie où un feu toujours allumé sert de
fanal aux mariniers pour les empêcher de donner
à travers les rochers qui pourraient leur faire faire
naufrage ; mais celle-ci était plus spacieuse que
l'autre».
«L'entrée du port d'Alexandrie, dit-il dans un
passage précédent, est très difficile
pour les vaisseaux, même durant le calme, parce que
l'embouchure en est très étroite, et que des
rochers cachés sous la mer les contraignent de se
détourner de leur droite route. Du côté
gauche, une forte digue est comme un bras qui embrasse le
port : et il est embrassé du côté droit
par l'île de Pharos, dans laquelle on a bâti une
très grande tour, où un feu, toujours
allumé et dont la clarté s'étend
jusqu'à trois cents stades, fait connaître aux
mariniers la route qu'ils doivent suivre».
Masoudi, écrivain arabe du quatrième
siècle de l'Hégire, que cite Makrisi,
écrivain arabe plus moderne, parle ainsi du phare :
«Entre le phare et la ville d'Alexandrie, à
présent, il y a un mille environ ; le phare est sur
l'extrémité d'une langue de terre
entourée d'eau de tous côtés et construit
sur la bouche du port d'Alexandrie ; mais non pas le vieux
port où les bateaux n'abordent pas à cause de
son éloignement des habitations... La hauteur du phare
actuellement est à peu près de deux cent trente
coudées. Anciennement, elle était d'environ
quatre cents coudées ; le temps, les tremblements de
terre et les pluies l'ont détérioré...
Sa construction a trois formes ; il est carré
jusqu'à un peu moins que la moitié et un peu
plus que le tiers ; là, la construction est en pierre
blanche ; ce qui fait cent dix coudées à peu
près. Ensuite, la figure en devient octogone et il est
alors construit de pierre et de plâtre (restauration
relativement moderne, sans doute) dans l'étendue de
soixante et quelques coudées. Un balcon l'entoure, qui
permet de se promener tout alentour. Enfin, la partie
supérieure en est ronde... Un écrivain dit
avoir mesuré le phare et avoir trouvé deux cent
trente-trois coudées. Il est de trois étages.
Le premier étage est un carré haut de cent
vingt et une coudées et demie ; le second est
octogone, de quatre-vingt et une coudées et demie ; le
troisième étage est rond ; il a trente et une
coudées et demie. Ebn-Joubère assure, dans son
mémoire de voyage, que le phare d'Alexandrie
paraît à plus de soixante-dix milles, que
lui-même a mesuré un des quatre
côtés de l'édifice, en 578 de
l'hégire (1200 de l'ère chrétienne), et
qu'il l'a trouvé de plus de cinquante coudées,
que la hauteur dépassait enfin cent cinquante
brasses».
Enfin, un autre Arabe, Ibn-Batouta, qui naquit à
Tanger en 1502 et voyagea durant vingt-quatre ans en Russie,
Asie-Mineure, Syrie, Espagne, Soudan et même en Egypte,
parle aussi du phare d'Alexandrie.
«Dans ce voyage, je visitai le phare et je trouvai une
de ses faces en ruine. C'est un édifice carré
qui s'élance dans les airs. Sa porte est
élevée au-dessus du sol et vis-à-vis est
un édifice de pareille hauteur qui sert à
supporter des planches sur lesquelles on passe pour arriver
à la porte du phare. Lorsqu'on enlève ces
planches, il n'y a plus moyen de parvenir à la porte
du phare. En dedans de l'entrée, est un emplacement
où se tient le gardien de l'édifice. A
l'intérieur du phare se trouvent beaucoup
d'appartements. La largeur du passage qui conduit dans
l'intérieur est de neuf empans, et l'épaisseur
du mur d'enceinte de dix empans. Le phare a quarante empans
sur chacune de ses quatre faces. Il est situé sur une
haute colline à une pararange de la ville et dans une
langue de terre que la mer entoure de tous
côtés, de sorte qu'elle vient baigner le mur de
la ville».
 |
Une médaille
antique, à l'effigie de Sabine, femme de l'empereur
Hadrien, porte sur son revers une représentation du
phare d'Alexandrie, mais sommaire, inexacte et contraire
à toute vraisemblance.
Tout a disparu du phare antique jusqu'au dernier bloc.
Le phare moderne ne marque même pas l'emplacement de
son glorieux ancêtre ; il occupe non
l'extrémité orientale, mais
l'extrémité occidentale de Pharos. C'est une
création de Méhémet-Ali, intelligente
sans doute, très heureuse, mais cette tour de
soixante-cinq mètres n'a d'autre mérite que son
utilité. Au seuil même de l'Egypte, ce qui fut
fait honte à ce qui est. Et jamais de revanche ; au
pays du Nil, le passé partout écrase le
présent, si ce n'est pas de ses magnificences, c'est,
et cela suffit, de ses souvenirs.
Le Moeris a jeté l'ancre. Tout alentour de nous, sont
mouillés de grands paquebots ; leurs cheminées
noires jettent au ciel bleu la souillure de leur
fumée. Près de Pharos, quelques vaisseaux de
guerre alignent à leurs flancs sombres les gueules des
canons. Les navires à voile, bricks, trois-mâts
robustes, goélettes mignonnes, lourdes felouques,
calques légers, rapprochés, serrés bord
à bord, nous dérobent la ville ; les vergues
s'entrelacent, forêt flottante dont les cordages sont
les lianes.
Deux hommes, deux princes, qui pensaient grandement et qui
voulaient fortement, ont fait Alexandrie : Alexandre et
Méhémct-Ali, le second, après plus de
vingt siècles d'intervalle, reprenant l'oeuvre du
premier.
Ce qu'a réalisé Méhémet-Ali,
Bonaparte avait médité de l'entreprendre, et
sans doute il aurait plu à son orgueil de
conquérant d'associer son nom à celui
d'Alexandre. Mais pour notre César Français,
l'Egypte n'était qu'une étape, il nourrissait
trop de rêves pour que ses victoires
éphémères pussent produire autre chose
qu'un fracas retentissant.
Ce qu'était Alexandrie antique, Strabon, César,
Josèphe nous le disent, à défaut des
ruines presque complètement disparues.
Dinocharès en avait dressé le plan ; il donna
à la ville une étendue de quinze mille pas et
la forme circulaire d'une chlamyde macédonienne. Aux
jours les plus florissants, la population atteignit environ
cinq cent mille âmes. Ce même Dinocharès,
nous dit le crédule Pline, avait entrepris de faire,
en pierre d'aimant, le plafond d'un temple consacré
à une certaine Arsinoé, soeur du
Ptolémée régnant. La statue de la
princesse divinisée aurait été faite en
fer, et l'aimant l'attirant et la retenant, elle aurait
plané en l'air, au-dessus de la tête de ses
adorateurs. La mort de l'architecte et du roi arrêta
les travaux, et ce rêve extravagant resta un
rêve.
Alexandrie, oeuvre d'une volonté unique,
création subitement improvisée,
présentait une parfaite symétrie, une
régularité savamment raisonnée, au
contraire des villes qu'a formées le labeur patient
des siècles. Des fouilles, des sondages ont permis de
reconstituer le plan primitif.
 |
Les rues,
régulièrement alignées et se coupant
à angle droit, formaient comme un gigantesque damier.
Il y avait des boulevards plantés d'arbres, des places
carrées, des colonnades, des portiques. Ne croyons pas
cependant qu'Alexandrie fut une cité solennellement
insipide, selon l'idéal de certains ingénieurs
; l'ingénieur d'Alexandrie était grec, il ne
pouvait l'oublier et la ville, créée par lui,
associait, à ces magnificences un peu uniformes,
quelque chose des grâces aimables où se
complaisait le génie de la Grèce. Au reste,
thermes, temples, palais s'élevaient côte
à côte, car Alexandrie n'eut pas d'enfance ;
à peine née, détrônant
Thèbes qui avait détrôné Memphis,
elle usurpa le premier rang. Les Ptolémées
n'eurent pas d'autre capitale. Dynastie grecque
adoptée par l'Egypte et personnifiant l'alliance des
deux pays, ils vivaient sur la terre que la conquête
leur avait livrée, mais aussi près que possible
de leur première patrie.
Alexandrie réunissait et résumait deux mondes.
Les proconsuls Romains y maintinrent le siège du
gouvernement.
Puis vint le temps des invasions et de leurs
dévastations terribles ; l'immense cité ne fut
plus qu'une bourgade de sept à huit mille habitants.
Damiette et Rosette tirèrent profit de cette
misère et de cet abaissement ; c'est à elles
qu'alla un peu de la vie qui abandonnait leur illustre
rivale. Au moyen âge, Damiette et Rosette avaient plus
d'importance qu'Alexandrie. Aujourd'hui, Alexandrie se
relève avec une rapidité singulière, et
Damiette et Rosette déclinent avec la même
rapidité.
Alexandrie, avons-nous dit, sortit de terre tout d'un
élan, lorsqu'eut parlé Alexandre, sa
renaissance fut aussi presque subite, et tout d'un bond,
Alexandrie renaît grande cité. Mais il n'est
plus de Dinocharès pour en dresser les plans et l'on
ne saurait trouver, dans yout l'empire ottoman, une ville
moins pittoresque. Alexandrie dépouille les guenilles
dont le moyen âge avait déshonoré ses
ruines. On découvre encore à grand'peine
quelques masures curieuses, quelques minarets
égarés et comme honteux de la déroute de
l'Islam ; mais bientôt il ne restera, conservant
quelque physionomie orientale, que le sable de la plage et
l'azur rayonnant du ciel. L'Occident triomphe de l'Orient,
non sans fracas et sans orgueil.
La place dite des Consuls est le forum d'Alexandrie.
Plusieurs consulats, dont celui de France, sont
groupés alentour. Les maisons, docilement
alignées et d'apparence tout européenne,
dessinent un vaste parallélogramme. Des acacias aux
gousses énormes et que nous trouvons, en plein mois de
décembre, couverts d'un feuillage luxuriant, sont
là plantés avec une parfaite
régularité ; ils forment un cadre vert
où chevauche, turban en tête, sabre au
côté, un gigantesque Méhémet-Ali
de bronze. Il est juché sur un haut piédestal
et affecte, non sans bonheur, les airs superbes d'un
conquérant. A droite, à gauche, deux kiosques
de bois, bariolés de couleurs criardes, abritent les
orchestres militaires contre les pluies qui ne tombent
jamais. La musique de quelque régiment joue là,
attirant, comme dans nos villes de provinces, ceux et celles
qui veulent voir et se faire voir.
La moitié de la population d'Alexandrie est
formée d'un assemblage cosmopolite où les Grecs
tiennent, par le nombre, le premier rang, les Français
et les Italiens, à peu près égaux, le
second et le troisième. Au reste, la confusion des
langues accuse la confusion des races ; trois langues se
disputent les enseignes, le Français, le Grec et
l'Italien ; l'Arabe n'apparaît que par exception, il
semble n'être que toléré. Les rues
développent d'interminables perspectives ; leurs
hautes maisons, coupées de grands balcons, rappellent
assez bien les maisons de Naples.
La population est généralement aussi peu
intéressante que ses maisons. Mais Alexandrie, comme
le Caire, a ses ânes qui partout attendent le
promeneur. Qui n'a pas vu l'âne d'Egypte ne
connaît pas l'âne. L'âne d'Egypte est une
petite bête mignonne, éveillée, docile ;
il est à ces malheureux et tristes roussins de nos
pays ce qu'un généreux coursier de bataille est
à la famélique Rossinante de nos fiacres.
L'âne ne vit bien que dans un pays un peu chaud : le
climat de l'Egypte lui est particulièrement favorable.
Chez nous il dépérit ; plus au nord, il ne peut
vivre qu'avec des soins tout particuliers, il est aussi
difficile de conserver un âne à Moscou qu'une
girafe à Paris. Ayons donc quelque indulgence pour la
disgracieuse apparence de nos baudets et leur
caractère difficile ; ils sont dépaysés,
ils souffrent, c'est leur excuse.
L'âne d'Egypte, à la bonne heure ! il a la jambe
fine et solide, le poil gris clair, la tête bien
construite et d'un joli dessin, l'oeil vif ; ses longues
oreilles se dressent fièrement et mobiles dès
que vous parlez, elles s'agitent comme d'un
frémissement intelligent. La charmante bête !
Comme elle trotte ! Elle vous portera, elle vous conduira
mieux que bien des ciceroni, et toujours
sûrement, mollement, rapidement. Indiquez-lui la
direction que vous voulez prendre, elle devinera
aussitôt si vous voulez voir la colonne de
Pompée ou les obélisques de
Cléopâtre. La foule est compacte, partout
fourmillante, n'ayez nulle peur, vous ne heurterez ni rien,
ni personne, vous passerez partout, puis un braiemcnt joyeux
vous annoncera que vous êtes arrivé.
Le harnachement est pittoresque et digne de la bête qui
le porte : la selle est rouge, parfois relevée de
broderies bleuâtres, et rouges aussi les rênes.
Enfin l'ânier, pieds nus, jambes nues, toujours
courant, criant, frappant, complète à merveille
l'âne.
L'âne est la monture vraiment nationale de l'Egypte, et
cela sans doute depuis la plus haute antiquité ; nous
verrons, par le témoignage des monuments pharaoniques,
que l'âne fut connu et employé bien
antérieurement au cheval. Aujourd'hui encore, en
dehors d'Alexandrie et du Caire, où
l'élément Européen est très
nombreux, le cheval est fort rare. Certains ânes
d'Arabie coûtent jusqu'à mille francs, et
souvent les personnages les plus riches n'ont pas d'autre
monture.
Peu séduits par les squares poudreux, les places
bruyantes et toutes ces splendeurs banales du présent,
nous nous empressons à chercher dans la ville moderne,
quelques vestiges de la ville qu'elle remplace. Deux
monolithes sont restés debout, glorieux survivants ;
ils dominent de haut l'Alexandrie moderne, et font planer
au-dessus d'elle le souvenir de l'antique Alexandrie. Ce sont
l'obélisque, dit Aiguille de
Cléopâtre et la Colonne dite de
Pompée.
L'obélisque se dresse à
l'extrémité orientale de la ville, sur le bord
de la mer. Quelques bastions qu'une herbe maigre s'efforce en
vain de tapisser, des masures croulantes, un chantier de
pierre, des débris de toutes sortes, des haillons,
voilà le cadre. Le granit rose s'entaille
malaisément sous les morsures de l'acier ; ici il a
subi des morsures qui semblaient moins redoutables, mais qui,
les siècles aidant, ont fait plus rude besogne ;
rongé des vents salins, le bloc a perdu ses
hiéroglyphes sur deux de ses faces. Cet
obélisque avait un frère qui lui tenait
compagnie ; nous ne pûmes le voir, car on l'avait
recouvert de terre pour le protéger de tout nouvel
outrage. Il était tombé, nous dit Touvet qui
voit dans ce fait un prodige, et s'était rompu en deux
morceaux le jour même de l'entrée des Turcs
à Rhodes. Les Anglais viennent cependant de
l'emporter, et le voilà condamné à la
souillure des brouillards de Londres.
Ces beaux blocs décoraient les abords d'un
édifice dit le Caesareum qui fut construit par
les ordres de Cléopâtre, de là leur nom
vulgaire. Mais ils peuvent s'enorgueillir d'une bien plus
lointaine origine ; Tothmès III, dont ils gardent le
cartouche, les avait dressés à
Héliopolis, quinze siècles auparavant.
Pour des yeux qui n'ont connu longtemps que l'Europe
décolorée, tout est surprise et joie aux pays
d'Orient. Le plus petit incident amuse, un rien
séduit, car la lumière enveloppe les choses les
plus misérables d'une magnificence inattendue.
Nous tournons le dos à l'obélisque, et
voilà que débouche une file de chameaux. Ils
cheminent lentement, gravement, balançant en une
régulière cadence, leurs ballots et l'homme qui
s'y tient accroupi. Comme fond à ce tableau tout
à coup improvisé, ce sont des baraques de
planches vermoulues, des arbres gris de poussière, un
rempart blanc, un ciel fait d'azur et d'or, puis jetant dans
ces clartés, de sombres taches, des femmes qui passent
drapées dans leur robe bleuâtre.
Nous sortons de la ville par une porte voisine de
l'obélisque. La ville d'Alexandrie conserve une
ceinture de bastions ; mais toujours plus peuplée,
toujours grandissante, elle s'acharne, dirait-on, à la
rompre et déjà, sur plus d'un point, elle l'a
fait éclater. Les boulevards font brèche et des
quartiers nouveaux, tout pimpants, tout joyeux, vont germer
sur les ruines des escarpes renversées, des
fossés comblés, des glacis disparus.
Envolés de quelque geôle farouche, des captifs
ne feraient pas plus brillant étalage de leur
liberté reconquise.
Nous franchissons une voie ferrée et descendons
jusqu'à la mer. Le sol est partout semé de
poteries en pièces ; débris, ruines confuses
encombrent le rivage. Briques, pierres, marbres, granits ont
souvent croulé en gros blocs, sans échapper au
mortier qui les soude. On reconnaît deux petites salles
voûtées. Les colonnes qui les partagent en deux
nefs, enchâssent, disposition bizarre, un tambour
cubique entre deux tambours arrondis. Le mode de
construction, les matériaux employés, les
moulures des chapitaux, la présence du mortier et de
la brique cuite (les anciens Egyptiens n'employaient
guère que la brique crue), tout annonce un travail
Romain. Le populaire, toujours empressé à
donner aux plus humbles vestiges des noms retentissants et
surtout à associer les souvenirs du passé aux
choses encore présentes, appelle ces ruines bains
de Cléopâtre. Cléopâtre
certainement ne les a jamais connues ; et il est fort douteux
qu'on y doive reconnaître des bains. Au reste, la mer
réserve à ces incertitudes une conclusion
radicale. L'homme avait envahi son domaine, elle le
ressaisit. Cintres interrompus, murailles incomplètes
se dressent en falaise, elles les ébrèche
furieusement. Déjà aux chapiteaux qui ont
roulé sur la grève, la guirlande verte des
algues remplace les acanthes effacées ; les grands
dallages apparaissent visibles encore mais inondés. Un
fût de granit est là gisant, le flot le heurte,
l'enveloppe, comme s'il avait mission de l'emporter.
 |
Colonne dite de Pompée
Des
bains de Cléopâtre pour gagner la colonne de
Pompée, le second monument d'Alexandrie vraiment digne
de ce nom, il faut rentrer en ville et la traverser tout
entière. Chemin faisant, nous trouvons,
enchâssées à l'encoignure d'une maison
moderne, quelques statuettes de basalte sans tête ni
mains. Un colosse de porphyre apparaît plus loin,
gravement assis sur son frône. On l'a rompu par le
milieu, et sa poitrine décapitée git à
ses pieds. C'est là une oeuvre de l'époque
byzantine ; la lourdeur, la grossièreté du
travail ne le prouvent que trop bien.
Un bruyant débat attire la foule. Une discussion
violente s'est élevée entre un chameau et son
chamelier. Le chamelier veut aller de l'avant, le chameau
veut aller de l'arrière. Celui-ci tire le licou d'un
côté, celui-là le tire d'un autre,
celui-là crie, celui-ci grogne. L'homme veut rentrer
en ville, la bête veut retourner aux champs qu'elle
regrette. Les deux entêtements s'équilibrent
longtemps. L'homme à la fin triomphe cependant, une
grêle de coups venge son autorité
méconnue.
Plus loin une large porte encadre des oignons
amoncelés qui forment des pyramides jaunes. De la
marchandise aux marchands accroupis alentour, la
lumière promène ses reflets, répandant
comme une poudre d'or. Sans cesse passent trottinant les
petits ânes suivis de leur ânier.
Nous voici bientôt et sans être sortis de
l'enceinte, au milieu de riches cultures. D'innombrables
palmiers y jaillissent, couronnés de leur panache
vert. Des irrigations, ingénieusement
combinées, entretiennent partout la fraîcheur et
la fécondité. L'air est plein du grincement
interminable des norias ; de jeunes mulets sont
condamnés au labeur éternel d'en tourner les
roues. Les légumes verdoient, encadrés de
petits fossés que tour à tour on inonde. Les
figuiers renversent leur ramure sur la margelle ruisselante
des puits.
Parfois un homme enlace le fût svelte d'un palmier ; il
grimpe, le voilà qui se suspend à la cime que
ses pieds font vaciller, puis il saisit les grappes pendantes
et cueille à pleines mains les dattes noires ou
rouges.
Après les murailles blanches, les rivages arides,
combien ces vergers opulents reposent les yeux ! Mais la
ville grandit et les attaque de toutes parts ; elle lance ses
rues à travers les futaies, les arbres tombent sous la
hache et les troncs décapités vont rouler dans
la poussière.
Au bord d'un petit sentier d'aspect encore tout
champêtre, un édifice, de l'époque
romaine, a laissé debout deux colonnes doriques et
quelques vagues substructions. Près de là
apparaît la colonne de Pompée.
On sait que Pompée ne vint en Egypte que pour s'y
faire couper la tête. Lorsque la
postérité, obsédée de ce souvenir
sanglant, donna le nom de cette illustre victime au plus beau
des monuments d'Alexandrie, elle faisait peut-être un
acte de légitime expiation, mais en même temps
un contre-sens archéologique de la plus flagrante
invraisemblance. La fameuse colonne fut en
réalité érigée par le
préfet d'Egypte, Publius sous l'empereur
Dioclétien et en son honneur. Elle mesure trente-deux
mètres de hauteur totale, et le fût seul,
monolithe de granit rose, vingt-deux mètres.
Cette colonne ne paraît pas avoir été
primitivement isolée comme nous la voyons aujourd'hui
; elle décorait probablement une des cours de
Sérapéum. Ce temple le plus riche et le plus
vénéré d'Alexandrie attirait encore un
nombreux concours de fidèles, au temps même de
l'empereur Théodose, après le triomphe officiel
du Christianisme. On sait que les cultes païens
restèrent très longtemps en grande faveur
auprès d'une partie considérable de la
population Egyptienne ; Philae avait encore des
collèges de prêtres sous l'empereur Marcien,
c'est-à-dire vers 450. Aussi le même
Théodose promulgua-t-il un édit qui ordonnait
la destruction de tous les temples et sanctuaires païens
de l'Egypte ; cet édit, par bonheur, ne fut que
très incomplètement exécuté ;
mais à Alexandrie, vint un peu plus tard un homme qui
ne pouvait manquer une aussi belle occasion de signaler ses
haines et surtout de remplir ses coffres. Nous voulons parler
du patriarche Théophile, l'adversaire furieux de saint
Jean Chrysostome qui lui dut ses persécutions, son
bannissement de Constantinople et sa mort. Théophile
souleva la populace, et ce n'était que trop facile
dans une ville partagée entre plusieurs cultes
ennemis. Les dévots de Sérapis voulurent
défendre leur temple, mais vainement, on en massacra
quelques-uns, et tout fut pillé,
dévasté, mis en pièces. Le triste
héros de cette victoire ne manqua pas de se faire
large part dans le butin.
Le Sérapéum était, au dire des anciens,
après le Capitole, un des plus magnifiques temples du
monde. Entièrement construit de marbre, il
présentait, à l'intérieur, trois
revêtements de métal, le premier de cuivre, le
second d'argent, le troisième d'or.
De tant de splendeurs le souvenir seul est resté, car
si la colonne de Pompée s'est encadrée dans
quelque cour du Sérapéum, elle est l'oeuvre
d'un autre âge et d'un autre peuple ; le
Sérapéum existait bien antérieurement
à Dioclétien. Ibn-Batouta, le voyageur arabe
que déjà nous avons cité, prétend
que de son temps, l'escalade de la colonne de Pompée
fut entreprise et heureusement accomplie. Une flèche
à laquelle une corde était fixée, fut
lancée par dessus le chapiteau et la corde, glissant
sur le granit, alla pendre de l'autre côté. Au
moyen de cette corde, très légère sans
doute, on éleva un câble beaucoup plus fort et
un homme s'y accrochant, se hissa jusqu'au faîte.
La colonne de Pompée occupe le sommet d'un plateau
poudreux et rocailleux. Une haute base carrée porte le
fût qui, à son tour, porte un chapiteau dont le
ciseau a un peu brutalement sculpté les acanthes
corinthiennes. Rien de plus simple, mais par sa masse
même, ce monument est imposant et son isolement le
grandit encore. Près de là sont gisantes des
statues de basalte noir, brisées, couchées le
nez dans la poussière ; elles encadrent de leurs
ruines, le colosse qui leur survit. Parfois une fillette les
escalade, souple, légère, espiègle et
farouche comme une chèvre, elle enjambe leurs jambes
énormes, elle accroche ses petits pieds nus à
leurs cartouches royaux, et triomphante, se fait un
piédestal de leur haute tiare.
Plus loin s'étale un vaste cimetière, car
Alexandrie nouvelle s'écarte, comme avec un respect
religieux, de cette terre qui si longtemps fut sainte. Aucune
enceinte, aucune barrière n'enferme ce
cimetière ; les tombes pressées côte
à côte, toutes blanches, semblent des blocs de
marbre abandonnés sur un vaste chantier. Souvent une
pierre dressée, stèle funèbre, porte le
nom du mort ; à ses pieds, dans un petit cercle de
maçonnerie, végète un aloès
maigre, triste plante, sainte cependant et qui
préserve du mauvais oeil, la seule du reste qui
consente à vivre dans ce sol aride et fait de cendres
humaines. Tout cela rayonne furieusement et, sur le sable
jaune, s'enlèvent brutalement les guenilles brunes de
quelques femmes qui prient. Plus loin la ville se
déploie, ce sont des minarets, des toits, des
terrasses, des palmiers, des acacias tout verts.
Le plateau où trône la colonne de Pompée
recouvre de grandes catacombes. Plusieurs puits
taillés à pic, y donnent accès,
accès malaisé, dangereux, car il faut, pour
entreprendre cette descente aventureuse, avoir, comme les
Arabes, des jambes qui ne plient jamais et des pieds qui
jamais ne glissent. Aussi, peu soucieux d'essayer une
gymnastique téméraire, nous allons, un peu plus
loin, chercher une entrée plus commode. Au reste, la
promenade, dans cette ville souterraine, est bientôt
interrompue ; les plafonds se sont écroulés en
plusieurs endroits et les décombres obstruent les
galeries. Trois salles d'une disposition
régulière, et d'une assez grande hauteur sont
taillées dans le tuf. Elles superposent, à
leurs parois, plusieurs rangs d'entailles profondes qui sans
doute ont enfermé des restes humains.
Un canal relie Alexandrie au Nil et par le Nil au Caire.
Créé par les anciens, il fut rétabli par
Méhémet-Ali. Alexandrie ne pourrait exister
sans lui, car seul il apporte, sur cette plage sablonneuse,
l'eau douce et avec elle la verdure, la
fécondité, la vie.
Les bords de ce canal sont la promenade favorite des
Alexandrins. Saules, acacias, sycomores, entrelaçant
leur ramure puissante, y forment une voûte de feuillage
ininterrompue. Les jardins échelonnés, comme
autant d'oasis charmantes, étalent une splendide
végétation. Là les conifères,
venus d'Amérique, dressent leur pyramide gracieusement
symétrique, les orangers forment des bosquets, les
bananiers lancent leurs feuilles immenses et parfois
fléchissent au poids de leurs grappes de fruits, puis
les cactus se blottissent au pied de quelques rochers et les
lianes, suspendues en guirlandes, jettent d'un arbre à
l'autre, des passerelles de fleurs. Ce sont des grilles peu
jalouses qui enferment ces beaux jardins ou parfois des haies
de roseaux géants. Le canal a des eaux limoneuses
comme le Nil à qui il les emprunte ; les canges,
dépassant de leur longue vergue la cime des arbres les
plus hauts, y naviguent lentement, tandis que la flottille
des canards caquette et croise près du bord.
Tel est l'aspect que présente le canal aux abords
d'Alexandrie ; mais là où il débouche
dans la ville, l'aspect change complètement. Les
canges sont plus nombreuses et semblent se livrer bataille
pour trouver place au quai. Plus de vergers, plus de jardins
; des magasins, des entrepôts ; plus d'arbres, des
mâts ; plus de cavaliers élégants, plus
de riches équipages, une foule affairée et de
bruyants portefaix. On ne flâne plus, on travaille. Les
ballots énormes s'entassent en remparts ; on les
roule, on les pousse, on les lance lourdement, parfois la
toile se déchire, et le coton s'échappe de ces
blessures.
La gare d'Alexandrie se trouve un peu en dehors de la ville.
Une voie, tout récemment ouverte, y donne un
accès facile. Jalonnée de becs de gaz et de
poteaux télégraphiques, elle se déploie,
large, solennelle, triomphante ; mais ce triomphe a
coûté cher. Que de ruines tout alentour ! Il
semble que le progrès se soit ici frayé passage
à coups de canon. Le sol, tranché,
creusé à une profondeur parfois
considérable, forme de chaque côté des
falaises poudreuses. Dès maisonnettes de limon,
tanières misérables y suspendent leurs
murailles croulantes et leurs chambres béantes ; la
lumière en pénètre librement les plus
intimes mystères. Ce sont des quartiers, des villages
entiers que la pioche a éventrés. Et cependant
ces décombres sont encore habités : on y voit
s'agiter des chiffons fangeux qui sont des femmes, des
êtres grouillants dans l'ordure qui sont des enfants.
Pauvres gens, ces débris suffisent à abriter
leurs misères ; ils attendent pour partir que ces
lambeaux de maisons leur tombent sur la tête.
Les vergers ont eu leur part dans le désastre. Bien
des palmiers sont tombés pour faire place à la
voie nouvelle et quelques-uns restent encore couchés
en travers des trottoirs. Près de là
apparaissent quelques colonnes antiques découvertes
dans les fouilles. Les ruines des arbres et les ruines des
palais sont confondues dans la poussière.
La gare d'Alexandrie est une baraque honteuse, sale de
fumée, souillée de suie. Rien d'étonnant
à cela. En Egypte, les monuments qui comptent quelques
douzaines de siècles, sont robustes, puissants, beaux
de leur immortalité ; les monuments, ou pour mieux
dire, les bâtisses qui datent d'hier, sont toujours
croulantes. Plus une chose est moderne et plus elle est
vermoulue.
Le train du Caire nous emporte. La campagne est plate, nous
courons sur un terrain d'alluvion que le limon du Nil a peu
à peu formé. A notre droite, le lac Mariout
(Mareotis) étale ses eaux fangeuses que de grands
oiseaux effleurent de leurs ailes. Puis viennent d'opulentes
cultures. Voilà bien la grasse Egypte dont les
Hébreux regrettèrent si souvent les bons
légumes et surtout les oignons succulents. La canne
à sucre forme des carrés symétriques et
ses roseaux sont hérissés de longues feuilles ;
on dirait des phalanges en bataille. Le blé, germant
à peine, couvre la terre comme d'un léger
duvet.
Au corps de l'homme, les artères, les veines, partout
circulant, partout entrelacées, portent partout le
sang et la vie, ainsi, dans ce riche delta, les canaux
d'irrigation courent, s'entrecroisent et fécondent le
sol. Nous ne voyons pas encore le Nil, mais
déjà il se révèle par ses
bienfaits. Son eau arrose la terre que lui-même a faite
de son limon, et ce limon battu, séché au
soleil a fait les petits villages qui, s'échelonnent
dans la campagne. Heureusement qu'il ne pleut pas en Egypte ;
un orage passant, il ne resterait du plus beau village qu'un
tas de boue.
Au reste, ces villages de la basse Egypte se ressemblent
tous. Ils composent un décor pittoresque, mais peu
varié. Ce sont toujours les mêmes huttes
carrées et basses, les mêmes terrasses que
défendent les chiens toujours grognant, les
mêmes chameaux qui cheminent par les rues,
dépassant les maisons de toute la hauteur de leur
bosse, la même mosquée qu'un petit minaret
annonce de loin, et les mêmes palmiers sveltes,
gracieux, qui se groupent alentour.
Enfin, nous franchissons le Nil ; une première fois,
c'est le bras de Rosette, les eaux jaunâtres
s'encadrent dans des rives assez plates : une seconde fois,
c'est le bras de Damiette, celui-ci plus petit que le
premier. Après cinq heures de marche environ, nous
atteignons le Caire.
Et pour compléter cette visite, vous pouvez voir sur la toile
- Une page de Wikipedia.
- Et surtout l'excellent dossier de Musagora