LI - Impuissance du gouvernement de la République |
I - TROUBLES INTERIEURS ; COMMENCEMENTS DE
CESAR
Au temps de Sylla, les aruspices toscans consultés sur
certains prodiges avaient répondu qu'un nouvel
âge du monde approchait et que la forme de l'univers
allait changer. Il n'était pas nécessaire de
savoir lire dans le ciel pour voir que sur la terre une
révolution se préparait.
Depuis soixante ans, deux tentatives avaient
été faites en sens contraire pour reconstituer
la république, l'une en vue des intérêts
populaires, l'autre au nom des intérêts
aristocratiques. La première échoua, parce que
les Gracques comptèrent trop sur cette tourbe
d'affranchis qui avaient remplacé l'ancien peuple
romain ; l'autre parut un moment réussir, parce que
Sylla se servit de la seule force qui restât dans Rome,
la noblesse : mais cette noblesse, qui aurait pu gouverner le
monde si elle avait su se gouverner elle-même, se
montra incapable de garder l'empire, et Pompée lui
ôta, pour payer les applaudissements du peuple, une
partie de ce que Sylla lui avait donné. C'était
encore une restauration inintelligente du passé, un
retour aux temps de Sulpicius et de Saturninus, sans plus de
garanties contre l'esprit de faction ; c'était la
guerre ramenée au Forum : elle y éclata bien
vite. Le consulat de Pison, en l'année 67, peut
être compté parmi ceux des plus mauvais jours de
la république.
Un ancien questeur de Pompée, C. Cornelius,
était alors tribun ; il voulut réprimer les
prêts usuraires dont les nobles ruinaient les
provinces, et empêcher quelques sénateurs vendus
de dispenser, au nom de leur compagnie, de l'observation
d'une loi. Pison combattit sa rogation et, le peuple
murmurant, il fit saisir plusieurs mutins ; mais la foule se
rua sur les licteurs, brisa leurs faisceaux et chassa le
consul du Forum sous une grêle de pierres. Comme son
patron, Cornelius n'était pas un démagogue, il
congédia l'assemblée, et modifia sa proposition
: pour valider un sénatus-consulte qui dispenserait
d'une loi, il faudra la présence de deux cents membres
au moins. Il essaya aussi d'étendre le crime de brigue
à ceux qui auraient aidé le candidat
incriminé, et il formula contre eux des peines
sévères. Pison, à qui la violence venait
de mal réussir, usa de l'adresse ; il s'empara de
cette loi, afin de n'en pas laisser l'honneur au tribun, et,
sous prétexte qu'avec des peines
immodérées on ne trouverait ni accusateur ni
juges, il ne demanda pour les coupables que l'expulsion du
sénat, l'interdiction des charges et une amende. Cette
fois encore une émeute l'obligea à fuir du
Forum ; il fit appel à ses amis, revint en force, et
la loi passa. A peine Cornelius fut-il sorti de charge que
les deux Cominius l'accusèrent du crime de
majesté pour n'avoir pas tenu compte du veto de ses
collègues ; mais un autre agent de Pompée,
Manilius, à la tête d'une troupe armée,
les menaça de mort. Ils s'enfuirent, sous la
protection des consuls, dans une maison d'où ils
s'échappèrent la nuit par les toits (66).
Ainsi les luttes à main armée
recommençaient : naguère Licinius Macer
accusait le sénat de despotisme, maintenant les
consuls reprochent aux tribuns leurs violences ; nobles et
peuple étaient donc également convaincus
d'impuissance à gouverner, et il n'y avait plus qu'une
expérience à tenter : la monarchie. Trois
hommes y tendaient alors : Pompée, à la
manière de Périclès, par les lois
mêmes de son pays ; Catilina, comme les Denys et les
Agathocle, par les conspirations et la soldatesque ;
César, à la façon d'Alexandre, par
d'irrésistibles séductions et l'ascendant de
son génie. Entre ces trois hommes un autre se
plaça, qui, meilleur que son temps, croyait à
la vertu, au pouvoir de la raison, et qui ne se
résignait pas à la pensée qu'on ne
pût sauver la liberté. Comme Drusus,
Cicéron cherchait le salut de la république,
non dans la domination exclusive d'une classe de citoyens,
mais dans la conciliation de tous les ordres : avec un seul,
c'était le despotisme ; avec deux, la guerre ; avec
trois, l'harmonie, la paix. Il avait déjà
contribué à faire rendre aux chevaliers les
jugements, et il travaillait à mettre de leur
côté l'opinion publique en exaltant dans tous
ses discours leur impartialité et leurs services. Il
aurait voulu enchaîner Pompée à leur
cause, et, comme il avait compris de quelle nature
était son ambition, il n'avait rien
épargné pour la favoriser. D'ailleurs, homme
nouveau, Cicéron avait besoin pour se faire jour de
l'appui de Pompée ; son ambition personnelle se
trouvait ainsi d'accord avec ce qu'il croyait être
l'intérêt public.

Jules César jeune |
Un autre personnage flattait aussi Pompée et, à l'ombre de ce nom alors si grand, se faisait une place dans l'Etat. Nous connaissons Jules César. Son influence dans Rome était déjà considérable, et il ne la devait ni aux charges qu'il avait remplies, il n'était que pontife ; ni à ses exploits, il n'avait pas encore commandé ; ni à son éloquence, bien qu'elle fût prouvée par des succès. Le peuple mettait ses espérances dans ce gendre de Cinna, dans ce neveu de Marius, sorti de la plus noble des maisons patriciennes, et il subissait le charme répandu sur toute la personne du descendant de Vénus et d'Anchise. Son esprit et ses manières avaient une séduction qu'un autre dominateur a aussi possédée ; mais elle s'alliait dans César à une élégance naturelle que Napoléon ne put jamais acquérir. C'est que l'un était, malgré lui-même, le représentant d'une jeune et rude démocratie, l'autre l'héritier d'une vieille noblesse, un grand seigneur égaré au milieu du peuple. |
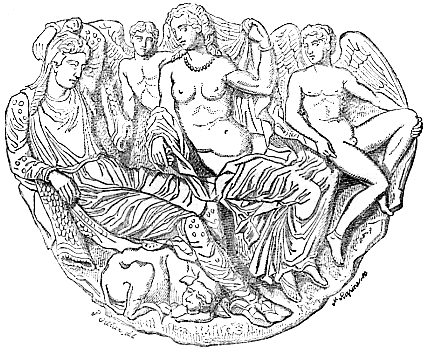
Vénus et Anchise - Fragment de boîte à miroir |
Il faut bien le dire, le futur maître du monde
ne fut d'abord que le roi de la mode : les plus
élégants désespéraient de porter
comme lui leur toge, et les femmes ne savaient pas lui
résister. Magnifique et prodigue, comme s'il eût
compté sur les richesses du monde, il jetait l'or,
moins pour ses plaisirs que pour ses amis, pour le peuple
qu'il conviait à des fêtes splendides.
Cicéron, trop grand artiste pour bien juger les
hommes, Cicéron, qui crut au repentir de Catilina,
comme plus tard au désintéressement d'Octave,
se laissa tromper à cette frivolité apparente.
«Quand je le vois si bien frisé, disait-il, et
craindre de déranger sa chevelure du bout du doigt, je
me rassure ; un tel homme ne peut songer à bouleverser
l'Etat». Il eût été moins confiant,
s'il se fût rappelé ce voyage en Asie (76),
durant lequel César, tombé aux mains des
pirates, étonna, maîtrisa ces brigands par sa
fierté, les forçant à l'écouter,
à le servir, et les menaçant de la croix, tout
captif qu'il était. Ils lui avaient demandé 20
talents pour sa rançon : «Ce n'est pas assez,
vous en aurez 50, mais ensuite, je vous ferai tous
pendre» ; et il leur avait tenu parole. Sa
rançon arrivée de Milet, il avait
ramassé quelques vaisseaux, les avait poursuivis,
enlevés et fait attacher à des croix,
malgré le gouverneur de la province. De retour
à Rome, il accusa le syllanien Dolabella pour les
concussions commises par lui dans son gouvernement de
Macédoine, puis Antonius Hybrida, un des lieutenants
du dictateur, qui avait pillé plusieurs villes
grecques. Ces procès retentissants étaient un
moyen pour un jeune homme d'attirer sur soi l'attention ;
mais, par le choix de ses victimes, César affirmait
ses opinions populaires. Quelque temps après, tandis
qu'il étudiait à Rhodes, il avait appris que
Mithridate attaquait les alliés de la
république. Aussitôt il était
passé sur le continent ; avait rassemblé des
troupes, battu plusieurs détachements de
l'armée pontique, retenu les villes dans l'alliance
romaine ; et tout cela il l'avait fait sans titre, sans
mission. Sylla, auquel il avait résisté, en lui
refusant de répudier la fille de Cinna, l'avait mieux
compris. «Redoutez, disait-il aux nobles, redoutez ce
jeune élégant, à la robe
flottante». L'élégant
débauché cachait en effet une grande ambition,
parce qu'il sentait son génie et qu'il voyait les maux
dont souffrait la république, l'impuissance du
remède imaginé par Sylla et l'absolue
incapacité de ses héritiers. Ses amis
assuraient l'avoir vu pleurer devant une statue d'Alexandre
en répétant : A mon âge, il avait
conquis le monde, et je n'ai encore rien fait.
Il avait fait plus qu'il ne voulait dire. Déjà
le sénat redoutait le neveu de Marius et de cet
Aurelius Cotta qui lui avait enlevé les jugements,
l'orateur populaire qui avait provoqué le rappel des
amis de Lépide, le prodigue qui éclipsait toute
la noblesse par ses magnificences. Crassus, consul et
triomphateur, voyait en lui un rival, Pompée, un ami
nécessaire, et le peuple l'aimait, le peuple qu'il
courtisait sans bassesse, qu'il menait, en contenant ses
passions mauvaises, comme ces chevaux fougueux qu'il se
plaisait à dompter au Champ de Mars. Les grands
espéraient que, ruiné par ses folles
dépenses, il cesserait d'être redoutable en
cessant de pouvoir acheter les charges ; mais ils oubliaient
que le peuple lui donnerait peut-être ce qu'il vendait
à d'autres. Les usuriers d'ailleurs, avec leur
instinct rapace, avaient deviné l'avenir du jeune
prodigue, et personne ne refusait à celui qui aurait
un jour tant à donner. Avant d'avoir exercé
aucune charge, il devait 1300 talents !
Quand Pompée était revenu d'Espagne, il avait
trouvé César en possession d'un tel
crédit, qu'il avait dû compter avec lui. Il
avait pensé s'en faire un instrument, il en servit
lui-même ; du moins, il tomba sous le charme, il
écouta des conseils déguisés sous les
éloges, et César contribua beaucoup à la
détermination qui sépara Pompée de la
noblesse, où était sa véritable place,
pour le mettre à la tête du peuple, où
son caractère ne pouvait le laisser longtemps.
Il était habile de rendre favorable au parti populaire et au tribunat un homme qui devait inévitablement un jour blesser le peuple et les tribuns. Il ne l'était pas moins, après l'avoir compromis avec l'aristocratie, de l'en éloigner plus encore en lui faisant décerner des honneurs presque monarchiques. César appuya vivement les propositions de Gabinius et de Manilius. Cette fois il se rencontrait avec Cicéron sur le même terrain, mais avec des intentions bien différentes ; l'homme nouveau ne songeait qu'à gagner un patron et des voix pour sa prochaine candidature au consulat. Le patricien populaire voyait avec plaisir le peuple s'habituant à conférer de grands pouvoirs que lui-même réclamerait peut-être un jour. Cependant il y avait bien de la hardiesse à entasser tant de puissance dans les mains de Pompée ; n'était-ce pas travailler à se donner un maître ? Mais ce rival, a-t-on dit, César le connaissait ; du jour où il avait vu les façons royales de ce héros populaire, il n'avait pas cru à la durée de sa popularité. Pompée n'avait pour lui que ses succès militaires ; mais des victoires, César en gagnera : ces succès, il les effacera par des succès plus grands, et il lui restera l'avantage, immense dans une république qui périt, de savoir dominer et conduire cette foule du Forum dont la souveraineté nominale pouvait toujours être changée par un habile homme en souveraineté réelle. |
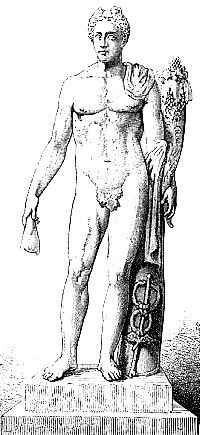
Manilius en Mercure - Musée du Vatican |
On a trop insisté sur ces patients calculs, et
on en a exagéré la subtile profondeur. Si
Pompée eût été capable d'un acte
de virilité, tout cet échafaudage d'ambition se
serait écroulé. Dans les commencements de sa
vie politique, César suivit les
événements plutôt qu'il ne les domina ;
tout au plus les aida-t-il à s'engager dans la voie
qu'ils prenaient d'eux-mêmes. Il commanda à
l'avenir de la seule manière dont l'homme puisse
contraindre l'avenir à servir ses vues, en
pressentant, par une nette intelligence du présent,
vers quel but éloigné la société
s'avance. La phrase suivante de Cicéron citée
par Suétone : Dès son édilité
il rêva l'empire, et il se l'assura quand il fut
consul, est un de ces mots sonores, comme le grand
orateur aimait à en faire. César ne rêva
pas de dictature dès sa jeunesse. Sa naissance l'avait
mis dans le parti populaire, celui qui voulait des
réformes, il y resta sans dévier jamais ;
consul, il commença ces réformes
nécessaires ; dictateur, il les continua en les
portant plus loin, et l'empire naquit de la guerre
civile.
Mais tous les plans pour le présent et l'avenir, ceux
de César ou de Pompée, comme ceux du
sénat ou des tribuns, faillirent être
déjoués par une conjuration sortie des sentines
les plus impures de la république.