LI - Impuissance du gouvernement de la République |
II - CATILINA (63-62)
Sylla croyait avoir fait de ses vétérans des
laboureurs paisibles, et de ses sicaires enrichis
d'honnêtes citoyens. Mais ces soldats paresseux firent
travailler pour leur compte, puis vendirent leurs terres et
ne gardèrent que leur épée, dans
l'espérance d'une autre guerre civile et de nouveaux
pillages. Il avait fallu moins de temps encore à leurs
anciens chefs pour dissiper l'or des proscrits. Les classes
riches, aisées, virent avec effroi au-dessous d'elles,
non plus les pauvres de Rome, populace oisive,
résignée maintenant à ses
misères, et ne demandant pour vivre dans le repos que
quelques mesures de blé, mais une autre populace ayant
le goût et le besoin de la débauche, des hommes
aux regards sinistres, à la main prompte, ennemis de
l'ordre et de la société, quelque gouvernement
qui la régît, et vivant à ses
dépens de mille industries criminelles. Chaque jour,
cette tourbe menaçante augmentait.
Longtemps il ne sortit de là que des crimes
individuels ; mais un homme vint qui voulut se faire de cette
classe, en guerre avec la société, une arme
pour son élévation. Catilina avait toutes les
qualités d'un chef de parti : une naissance illustre,
l'air noble, un corps de fer qui supportait tous les
excès, de grands talents, une audace et un courage
sans bornes, au besoin la tempérance du plus rude
soldat. Libéral, officieux, insinuant, il savait
être austère, grave ou enjoué, selon le
caractère et l'âge de ceux qu'il voulait gagner.
Toujours prêt à servir ses amis de son argent,
de son crédit et de sa personne, n'épargnant
pour eux ni les travaux ni le crime, il exerçait
autour de lui, dans cette sphère de la
débauche, un irrésistible ascendant. Deux
siècles plus tôt, Catilina eût
été un grand citoyen, mais l'état social
et les moeurs de la Rome nouvelle lui donnèrent une
autre ambition, et il en poursuivit le succès avec
l'emportement de sa fougueuse nature. Par son âge,
Catilina appartenait à cette génération
qui était arrivée à la vie publique sous
la dictature de Sylla. Les temps où la terreur est
dans les cités, que ce soit la nature qui frappe par
la contagion ou les hommes qui tuent par le glaive, ces temps
sont souvent mêlés, toujours suivis de la plus
effroyable licence. C'est au milieu d'une pareille
époque, quand la fortune et la vie n'étaient
qu'un jeu, que Catilina, préparé par les
désordres de sa jeunesse, avait achevé son
éducation politique. Aussi, comme il se jouait
lui-même de la vie et de la fortune ! Nous avons dit
qu'il se signala parmi les massacreurs les plus
féroces ; il avait tué son beau-frère
pour être libre dans un amour incestueux ; il
égorgea son épouse et son fils pour
décider une femme à lui donner sa main. Durant
sa propréture en Afrique, il commit de terribles
concussions (67) ; à son retour, il brigua le
consulat, mais une députation de la province
étant venue l'accuser, le sénat raya son nom de
la liste des candidats. Catilina se retira frémissant
; on lui interdisait même la brigue légale : il
prépara une révolution.
Il y avait longtemps qu'il s'était uni à tout
ce que Rome renfermait de gens infâmes et coupables.
Mais c'était un parti qu'il voulait, et non pas
seulement des complices ; il s'étudia donc à
gagner les pauvres et la jeunesse ruinée en se faisant
le ministre de ses passions. Il avait toujours, pour qui lui
en demandait, de beaux chiens de chasse, des chevaux, des
gladiateurs, de folles femmes ; puis du plaisir il les
faisait passer au crime : il les tenait alors. Cette jeunesse
débauchée ne faisait pas encore une
armée. De longue main Catilina s'eu était
préparé une par ses relations avec les colons
militaires, ses anciens compagnons d'armes. Il leur rappelait
Sylla et ses dons, leurs terres engagées à des
usuriers ; s'il arrivait au consulat, lui, s'il devenait le
maître, il saurait bien conserver aux vainqueurs les
fruits de leur courage. Une abolition des dettes serait le
prélude de nouvelles gratifications. Aussi les
vétérans s'étaient-ils tenus prêts
à venir en foule voter pour lui. Catilina avait donc
déjà de grandes ressources. La
sévérité des nouveaux tribunaux lui
fournit d'autres alliés.
Un jugement venait de condamner les deux consuls
désignés pour l'année 65, P. Autronius
Paetus et P. Corn. Sylla, comme coupables d'avoir
acheté les suffrages ; les accusateurs L. Aurelius
Cotta et L. Manlius Torquatus avaient été
élus à leur place. Catilina envenima leur
ressentiment, et un complot fut formé pour
égorger, aux calendes de janvier, les nouveaux
consuls, quand ils iraient sacrifier au Capitole. Crassus et
César entrèrent, dit-on, dans cette conjuration
; le premier aurait été créé
dictateur, et, dans cette charge, aurait
réintégré au consulat Autronius et
Sylla. Ce doit être une calomnie. Crassus, si riche,
avait tout à perdre en s'associant à des gens
ruinés, dont le premier soin eût encore
été de bouleverser les fortunes. Pour
César, sa douceur répugnait aux violences
préméditées par les conjurés ;
mais tous deux ne voyaient certainement pas cette agitation
avec colère, et, sans s'y mêler, ils ont
dû en attendre l'issue pour la faire tourner au profit
de leur ambition. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient donner la
main à ces désespérés en
révolte contre tout l'ordre social, et ils
n'entendaient pas davantage se faire les souteneurs de
l'oligarchie. Ils se réservaient donc, laissant les
grands et Catilina s'affaiblir mutuellement en un mortel
combat.
Deux fois le coup manqua, aux calendes de janvier et aux
nones de février, par l'attitude des consuls, qui
avaient été avertis. Il semble qu'alors un
rapprochement ait eu lieu, ou plutôt que le
sénat tremblant ait cherché, par des
concessions, à désarmer ces furieux. Cn. Pison,
un des conjurés les plus redoutés, fut
envoyé comme préteur en Espagne ; il est vrai
que son escorte espagnole l'assassina. Mais lorsque Clodius
reprit contre Catilina l'accusation de concussion, l'un des
consuls qui avaient failli être tués, Torquatus,
défendit l'accusé, et nous ne savons pas si
Cicéron ne partagea point avec lui cette
défense. Du moins il s'y prépara, et, dans une
lettre qui nous est restée, il se félicite
d'avoir obtenu tons les juges qu'il souhaitait. «S'il
est acquitté, ajoute-t-il, j'espère m'entendre
avec lui pour notre candidature». Voilà une
lettre qui donne beaucoup à penser au sujet de la
grande journée des nones de décembre 63. Mais
il nous faut raconter cette histoire avec les seuls documents
que le temps nous a laissés, sauf à faire de
discrètes réserves.
Catilina fut acquitté, mais ruiné. Tout l'or
qu'il avait apporté d'Afrique était
passé à ses juges (65).
Ce qui disposait le sénat à fermer les yeux sur
de tels projets, c'était le sentiment de sa faiblesse
et la crainte que lui inspirait César. L'ambition de
Catilina paraissait encore n'être que celle d'un seul
homme ; derrière César, les sénateurs
voyaient tout un parti. Cette année même (65),
il avait été nommé édile curule,
et n'avait pas perdu cette occasion de faire
légalement une brigue plus sûre que celle du
jour des comices, en achetant d'un coup le peuple entier par
la magnificence de ses jeux et par des prodigalités
inouïes. Il décora de tableaux et de statues le
Forum, les basiliques, les temples ; et, pour honorer la
mémoire de son père, il fit paraître
trois cent vingt couples de gladiateurs, couverts d'armures
dorées ; jamais le cirque n'avait vu un tel carnage ;
jamais le peuple n'avait si bien rassasié ses joies
féroces. Le sénat s'alarma de cette boucherie,
ou plutôt des facilités que fournissaient pour
un coup de main tant de bravi qui formaient une
armée ; un décret fixa le nombre de gladiateurs
qu'à l'avenir on ne pourrait plus dépasser. Les
Mégalésies et les grands Jeux romains furent
célébrés avec la même pompe : aux
malheureux condamnés à combattre les
bêtes, il avait donné des lances d'argent.
A ces fêtes, à ces jeux, Bibulus, son
collègue, qui faisait alors l'apprentissage de
l'abnégation, disait d'un air étonné :
Nous nous ruinons tous deux, et il semble que lui seul
paye ; le peuple ne voit que lui. César eut bien
d'autres applaudissements quand un matin on découvrit
de toute la ville, aux portes du Capitole, des statues
étincelantes d'or : c'était le vieux Marius qui
reparaissait avec ses trophées de la guerre de
Jugurtha et des Cimbres. Déjà quelques
années auparavant, César avait fait porter
l'image de Marius aux funérailles de sa tante Julie,
et, du haut de la tribune, il avait prononcé
l'éloge de cette femme, veuve du vainqueur des
Cimbres. Mais ces trophées, le sénat les avait
proscrits, Sylla les avait arrachés, et un
édile les rétablissait ! Les grands
restèrent muets devant tant d'audace et devant la joie
de la multitude, accourue pour saluer l'image de l'homme qui,
malgré son égoïste ambition, avait
toujours été aimé, comme le plus
glorieux représentant du peuple. Catulus eut beau
s'écrier : Ce n'est plus par de sourdes
menées mais à la face du ciel que César
attaque la constitution, personne n'osa le soutenir, et
les trophées du héros populaire
continuèrent de briller au-dessus de la tête des
sénateurs tremblants.
Cette journée était décisive ; un parti
venait de retrouver son vrai chef et son drapeau : dans les
affections du peuple, Pompée descendait au second
rang, César montait au premier. Le vainqueur de
Sertorius, des pirates et de Mithridate peut maintenant
revenir, l'édile est en état de le forcer
à compter avec lui.
Au sortir de l'édilité (64), César
essaya de se faire donner la mission d'aller réduire
l'Egypte en province, en vertu d'un testament de
Ptolémée Alexandre Ier. Ce royaume, par
où passait alors tout le commerce de l'Orient avec
l'Europe, était le plus riche pays du monde. S'il
n'avait pas les trente-trois mille villes que
Théocrite lui donne, il est certain qu'il payait,
chaque année, un impôt de 14.800 talents. Avec
de tels revenus, on pouvait solder bien des dettes, et avec
les moissons de l'Egypte faire au peuple bien des largesses.
Crassus et César se disputèrent cette riche
proie. Ils ne l'eurent ni l'un ni l'autre. L'affaire fut
remise, et le tribun Papius chassa par une loi tous les
étrangers que les deux compétiteurs, surtout
César, déjà en relation intime avec les
Transpadans, avaient attirés à Rome pour faire
passer leur demande.
Au lieu de cette brillante mission, César fut
appelé à présider le tribunal
chargé de punir les meurtriers, de sicariis.
Jusqu'alors il s'était borné à protester
contre la dictature de Sylla : il voulut la frapper d'une
flétrissure légale. Parmi les affaires qu'il
évoqua à son tribunal, fut celle de deux
meurtriers des proscrits, L. Bellianus, le centurion qui
avait tué Lucretius Ofella, et un autre assassin plus
obscur ; il les condamna. Pour frapper le sénat, il
remonta plus haut encore. A son instigation, un tribun du
peuple, Labienus, accusa, l'année suivante, le vieux
sénateur Rabirius d'avoir, près de quarante ans
auparavant, sur un décret du sénat, tué
un magistrat inviolable, le tribun Saturninus, et il
réclama l'application de la vieille loi de
perduellion, qui ne laissait pas, comme la loi de
majesté, la faculté de l'exil volontaire.
Condamné par les duumvirs, Rabirius en appela au
peuple. Mais Labienus plaça sur la tribune aux
harangues l'image du tribun égorgé, et
n'accorda au défenseur de l'accusé qu'une
demi-heure pour son plaidoyer. Malgré les
éloquents efforts de Cicéron, malgré les
prières, les larmes des principaux sénateurs,
Rabirius eût été déclaré
coupable, si le préteur Metellus Celer n'eût
arraché le drapeau blanc qui flottait sur le Janicule.
Ce peuple formaliste céda, en riant de lui-même,
au vieil usage ; l'assemblée fut
déclarée dissoute, et César, content
d'avoir encore une fois prouvé sa force, laissa tomber
l'affaire ; mais les sénateurs étaient avertis
que, s'ils essayaient un jour des coups d'Etat, le peuple
briserait leurs instruments.
Ce même Labienus, qui lui servait de lieutenant dans le tribunat, comme il lui en servira dans la guerre des Gaules, fit encore abroger la loi cornélienne relative aux pontifes, dont la nomination fut rendue aux comices. Le peuple en témoigna aussitôt à César sa reconnaissance en lui donnant le grand pontificat, charge à vie qui le rendait inviolable. Ni ses moeurs ni l'athéisme qu'il professait ouvertement n'avaient été pour lui des obstacles. Ses moeurs et ses opinions étaient celles de la plupart des hommes de son temps ; en ce moment même, Lucrèce écrivait son poème audacieux contre la crédulité populaire. La religion officielle n'était plus qu'une institution d'Etat ; mais elle donnait à son chef une grande situation, et César ne voulait pas laisser à d'autres ce moyen d'influence. Catulus, un de ses compétiteurs, le sachant obéré, avait essayé de le désintéresser en lui offrant des sommes considérables : J'en emprunterai de plus grandes pour réussir, dit-il ; et l'on pourrait croire qu'il s'était préparé à recourir à la force, si sa dernière parole à sa mère, en partant pour les comices, était vraie : Aujourd'hui je serai banni ou vous me reverrez grand pontife. La même année (63), il fut désigné pour la préture, et, continuant ses bons rapports avec Pompée, il lui fit accorder par un plébiscite le droit d'assister aux jeux avec une couronne de laurier et la robe triomphale. |
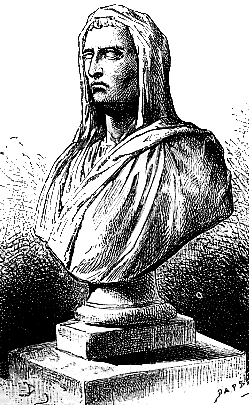
César grand pontife - Musée du Louvre |
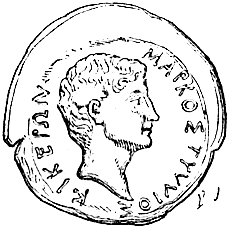
Cicéron - Monnaie de Magnésie de Lydie |
Cicéron était alors consul. La crainte
de César et de Catilina avait fait accepter de la
noblesse l'homme nouveau, le brillant avocat qui avait su
gagner tant de causes, et qui répétait tout bas
à chaque consulaire : De coeur, j'ai
été toujours, avec vous, du parti des grands,
jamais du côté du peuple. Si j'ai parfois
parlé dans le sens populaire, c'est qu'il me fallait
gagner Pompée, dont le crédit est si
nécessaire à une candidature. D'ailleurs
ceux qui se présentaient ne valaient guère
mieux que Catilina. Galba et Cassius étaient inconnus
; Antonius avait été chassé du
sénat, et il n'aurait pu, disait-il lui-même,
plaider dans Rome à crédit égal contre
un Grec. Rejeter, par un refus, du côté de
Pompée ou de César, un homme que sa
modération classait naturellement parmi les
conservateurs, c'eût été une imprudence
et de plus un effort inutile. Soutenu par les publicains et
l'ordre équestre qu'il avait tant servis ; par les
municipes italiens, qui se souvenaient de son origine ; par
la jeune noblesse, enthousiaste de son éloquence, et
par les principaux meneurs des tribus, qui lui avaient fait
depuis deux ans des promesses formelles, Cicéron
serait arrivé au consulat sans le sénat et
malgré lui. En l'accueillant de bonne grâce, les
nobles gagnaient le dévouement du parvenu, et ils
donnaient à leur parti, pour les luttes du Forum, un
grand orateur, c'est-à-dire une force
considérable.
Cicéron fut élu d'une voix unanime, sans
même que le peuple voulût aller au scrutin. Ce
succès blessa César au vif, mais il
était facile de mettre cette popularité
à l'épreuve en soulevant une question où
il faudrait se prononcer entre le peuple et le sénat.
- Le tribun Rullus proposa une loi agraire, dont les dix
commissaires investis de l'imperium auraient pendant
cinq années un pouvoir absolu pour vendre en Italie,
en Sicile, en Espagne, dans la Macédoine, la
Grèce, l'Asie Mineure et jusque dans le Pont, les
terres du domaine public, excepté celles qui avaient
été assignées pendant la dictature de
Sylla. Avec le produit de cette vente et les revenus de
toutes les provinces, moins ceux de l'Asie,
réservés à Pompée, que
César ménageait toujours, avec la restitution
du butin de guerre et de l'or coronaire que les
généraux n'auraient pas remis au trésor
ou employés en monuments publics, les décemvirs
devaient acheter en Italie des champs labourables pour les
distribuer aux pauvres, notamment dans la Campanie et dans le
fertile territoire de Venafrum et de Casinum. La rogation
leur reconnaissait enfin le droit d'exiger la redevance due
au trésor pour toute terre du domaine publie, qu'ils
laisseraient aux détenteurs. En offrant aux colons de
Sylla un échange contre espèces ou une garantie
de leur propriété, et en accordant un
dédommagement à ceux qui,
dépossédés par le dictateur,
étaient tombés dans la misère, on aurait
fait cesser les haines excitées par les proscriptions.
Le but de Rullus, ou plutôt de César,
était donc patriotique. Ils voulaient
réconcilier les anciens et les nouveaux
propriétaires, et en même temps abolir le
prolétariat, cette plaie des grandes cités et
des sociétés riches, qu'aujourd'hui nous
cherchons à former par une distribution plus
équitable des bénéfices de l'industrie,
et qui alors ne pouvait être guérie qu'avec des
concessions de terre. Mais la loi eût aussi
renversé toutes les fortunes aristocratiques, en
forçant les grands à restituer le butin de
guerre, qui appartenait aussi bien à l'Etat que les
terres conquises par ses armes et dont Rullus disposait. Pour
les Romains de l'âge vraiment républicain, ce
droit de l'Etat avait toujours été
respecté ; un siècle plus tôt, Caton le
censeur agissait encore conformément à ce
principe, et Caton d'Utique ne détourna pas une
drachme du trésor cypriote. Dans la nouvelle
république on avait pensé autrement : les
soldats de Rome combattaient et mouraient, plus encore pour
donner de l'or à leurs chefs que des provinces
à leur patrie. La clause introduite par le tribun
eût ruiné le fils de Sylla, Lucullus, Metellus,
Catulus et cent autres. C'était donc une refonte de
l'Etat et une conception profonde qui révèle
l'inspiration de César, et de son génie
réformateur ; mais c'était aussi une loi bien
compliquée et d'application difficile. Les nobles,
détenteurs du domaine public, les chevaliers, fermiers
de l'impôt, étaient également
menacés ; ils annonçaient qu'une dictature
sortirait d'une loi qui conférait de tels pouvoirs. Ce
fut une raison pour Cicéron, leur avocat ordinaire, de
l'attaquer ; il le fit dans quatre discours éloquents.
Avec une suprême habileté, il démontra
aux pauvres qu'en leur donnant des terres, on les
dépouillait ; qu'en leur parlant de liberté, on
allait les asservir ; et, au milieu de cette fertile Campanie
qu'on voulait leur partager, il leur montra le fantôme
menaçant de Capoue ressuscitée et aussi
redoutable pour Rome qu'aux jours d'Annibal. Son
éloquence, aidée de l'argent des riches,
empêcha la loi de passer. Mais, tout en
répétant qu'il voulait être un consul
populaire, Cicéron avait été
forcé, par sa nouvelle position, d'expliquer comment
il comprenait la popularité. Ses raisons sont
excellentes. Cependant le peuple, en ne l'entendant parler
que de soumission à l'ordre établi, devait
trouver que le portrait fait par son consul d'un chef
populaire ressemblait singulièrement à celui
d'un ami dévoué des grands. César, que
Cicéron avait attaqué à mots couverts,
était battu ; il avait toutefois atteint un but
important : le brillant avocat qui venait de plaider si bien
était désormais classé ; aux yeux de
tous, Cicéron n'était plus que l'orateur des
riches.
Un autre tribun proposa de mettre un terme à la
dégradation civique dont Sylla avait frappé la
postérité de ses victimes. Ce décret
était une cruauté, Cicéron l'avouait, et
le premier acte de la dictature de César sera la
suppression de cette iniquité. Mais, après
avoir recouvré leurs droits politiques, les fils des
proscrits redemanderaient peut-être aux clients de
Cicéron leurs biens confisqués ; il fit encore
rejeter cette rogation. Quand le peuple siffla le tribun
Roscius, pour avoir donné aux chevaliers des places
séparées au théâtre, le consul,
qui aimait à monter à la tribune,
entraîna la foule au temple de Bellone, lui fit honte
de céder à une basse envie, magnifia l'ordre
équestre, et la ramena repentante au
théâtre. Ce fut, dit Quintilien, son plus beau
triomphe oratoire. Mais, quand le peuple n'était plus
sous le charme de ce beau langage, il retrouvait ses rancunes
et sa colère. La popularité de Cicéron
ne paraissait plus redoutable.
Durant tout ce consulat, César avait harcelé
sans relâche Cicéron. Les attaques du parti
populaire ne furent cependant pas pour le consul sa plus
grande affaire. Catilina l'inquiétait bien davantage.
Effrayé des progrès que faisait la conjuration
dans Rome et dans toute l'Italie, il commençait
à voir que, s'il y avait entre le sénat et
César une question d'influence et de pouvoir, entre
Catilina et les grands il y avait une question de vie ou de
mort. Aux dernières élections consulaires,
Antonius ne l'avait emporté sur Catilina que de
quelques voix, et celui-ci s'était remis sur les rangs
pour l'année 62. Afin de l'écarter,
Cicéron et le sénat appuyèrent Silanus
et Murena, l'un et l'autre amis de Crassus et de
César, afin de gagner ces deux puissants personnages,
qu'on soupçonnait de voir avec plaisir les dangers
dont Catilina menaçait l'oligarchie. Comme
dernière ressource, le cas où ce dernier serait
élu, Cicéron fit ajouter aux peines
portées par les lois contre la brigue un exil de dix
ans pour le coupable. Catilina, à bout de patience,
était décidé, s'il ne réussissait
pas cette fois, à jouer enfin le tout. Ses
préparatifs étaient achevés ; des armes
étaient réunies en divers lieux. Des
vétérans de l'Ombrie, de l'Etrurie et du
Samnium, depuis longtemps travaillés par ses
émissaires, se préparaient sans bruit. La
flotte d'Ostie paraissait gagnée. Sittius Nucerinus,
en Afrique, promettait de soulever cette province et
peut-être l'Espagne. A Rome sans doute Cicéron
montrait une fâcheuse vigilance, mais il n'avait pas de
forces sous la main, toutes les légions étant
en Asie avec Pompée, et Catilina croyait pouvoir
compter sur l'autre consul, Antonius ; enfin un des
conjurés, L. Bestia, était tribun
désigné, un autre préteur. Il
espérait donc qu'il suffirait d'un signal pour que des
armées apparussent tout à coup sous les murs de
Rome, où d'autres complices allumeraient sur divers
points l'incendie, afin d'arriver, au milieu de la confusion,
jusqu'au sénat et aux consuls. Quelques
conjurés, surtout le préteur Lentulus Sura,
homme ruiné et flétri, parlaient d'armer les
esclaves qui remuaient dans l'Apulie. Catilina hésita
à déchaîner une tourbe qu'il craignait de
ne pouvoir ensuite maîtriser. Ses complices ne
voulaient qu'échapper à leurs créanciers
et à leurs juges ; il avait une ambition plus haute.
En plein sénat, il osa dire : Le peuple romain est
un corps robuste, mais sans tête ; je serai cette
tête. Et une autre fois : On veut porter
l'incendie dans ma maison, je l'éteindrai sous des
ruines. Moins habile que César et que
Pompée, il se plaçait en dehors de la
constitution pour la renverser d'un coup, sûr que les
siens, une fois gorgés d'or, lui laisseraient le
pouvoir, même ce Lentulus qui se croyait
prédestiné à régner sur
Rome.
Il attendait avec anxiété l'issue des comices
consulaires. Cicéron, qui, par les
révélations d'un des conjurés, tenait
déjà tous ses secrets, vint présider
l'assemblée avec une cuirasse qu'il laissait voir sous
sa toge ; des soldats occupaient les temples voisins, et la
foule des chevaliers entourait le consul. Silanus et Murena,
les deux candidats du parti sénatorial,
l'emportèrent.
Le même jour, des émissaires sortaient par
toutes les portes de Rome, et, à quelque temps de
là, le sénat apprenait que des rassemblements
armés avaient été vus dans le Picenum et
l'Apulie ; que la place forte de Préneste avait failli
être surprise ; que dans Capoue l'on redoutait un
soulèvement d'esclaves ; qu'un ancien officier de
Sylla, Mallius, campait devant Fésules avec une
armée de soldats tirés des colonies militaires
et de paysans ruinés ; qu'enfin, à Rome, deux
conjurés avaient essayé de
pénétrer au point du jour chez Cicéron
pour l'assassiner. Par bonheur, deux proconsuls, Marcius Rex
et Metellus Creticus, venaient d'arriver d'Orient, et
attendaient aux portes de la ville, avec quelques troupes, le
triomphe qu'ils sollicitaient. Le premier fut aussitôt
dirigé contre Mallius, le second sur l'Apulie ; un
autre préteur alla dans le Picenum, et Pompeius Rufus
courut à Capoue pour en faire sortir les gladiateurs,
qu'il distribua par petites bandes dans les municipes
voisins. Rome même fut mise, comme nous dirions, en
état de siège. Les consuls, investis par le
sénat d'un pouvoir discrétionnaire,
provoquaient des révélations par des promesses
; ils levaient des troupes, plaçaient des gardes aux
portes, sur les murailles, et ordonnaient des rondes dans
tous les quartiers. Cet appareil militaire, ces craintes
contre un ennemi invisible, augmentaient l'effroi : tous les
riches se sentaient menacés d'un grand péril,
qui n'était pas aux frontières, mais autour
d'eux, sur leurs têtes, et ils ne savaient où le
combattre. Cicéron comprenait que, au milieu de cette
terreur, il suffirait du plus léger incident pour
déranger tous les calculs, mais il ne voulait rien
précipiter : on n'était plus au temps de
Servilius Ahala ; la violence n'eût peut-être pas
réussi ; et il savait qu'un acte d'énergie qui
échoue tue un gouvernement débile : le
sénat devait couvrir sa faiblesse de son respect pour
la légalité. Il avait bien d'autres ennemis :
quel parti prendraient Crassus et César ? A coup
sûr, ils s'opposeraient à une justice qu'il
serait facile d'appeler proscription et tyrannie. Pour isoler
les conjurés, il fallait donc les contraindre à
démasquer leurs projets incendiaires ; et Catilina
restait dans Rome, Catilina venait au sénat !

Cicéron - Musée Saint Marc - Venise |
Le 8 novembre, le consul avait réuni les sénateurs dans le temple de Jupiter Stator. Catilina s'y présente ; à sa vue, Cicéron éclate : «Jusques à quand abuseras-tu, Catilina, de notre patience ? Quoi ! ni la garde qui veille la nuit sur le mont Palatin, ni les troupes réunies dans la ville, ni la consternation du peuple, ni ce concours des bons citoyens ni ce lieu fortifié où le sénat s'assemble, ni les regards indignés que tous ici jettent sur toi, rien ne t'arrête !... O temps ! ô moeurs ! Tous ces complots, le sénat les connaît, le consul les voit et Catilina vit encore ! Que dis-je, il vit ? Il se rend au sénat, il désigne aux poignards ceux de nous qu'il veut immoler et nous, qui avons reçu du sénat le décret dont Opimius frappa Caïus Gracchus, nous le laissons inutile, comme un glaive qu'on n'ose tirer du fourreau !... Oui ! j'attends encore, car je veux que tu ne périsses que quand tu ne pourras plus trouver quelqu'un d'assez pervers pour te plaindre et te défendre. Jusque-là tu vivras, mais tu vivras comme tu vis maintenant, entouré, assiégé d'hommes qui à ton insu te gardent et te surveillent ; des yeux toujours ouverts, des oreilles toujours attentives, suivront et recueilleront tes paroles.... Renonce, crois-moi, à tes desseins ; tu es enveloppé, tes projets nous sont connus. Veux-tu que je te les dise ? Rappelle-toi que le 20 octobre j'avais annoncé pour le 27 la prise d'armes de Mallius : me suis-je trompé ? Pour le 28, le massacre de toute la noblesse : n'est-ce pas ma vigilance qui ce jour-là t'a arrêté ? Et le 1er novembre, quand tu as voulu surprendre la colonie de Préneste, n'était-elle pas bien gardée ? Va, tu ne fais pas une action, tu n'as pas un projet, pas une pensée, que je n'entende, que je ne voie, que je ne comprenne. |
Je te dirai encore ce que tu as fait la nuit
dernière : tu as été chez Laeca ; tu as
partagé l'Italie entre tes complices ; tu as
désigné ceux qui partiraient avec toi, ceux qui
resteraient à Rome ; à ceux-ci tu as
marqué les lieux où ils devaient allumer
l'incendie ; aux autres tu as demandé quelques
instants encore, jusqu'à ce que j'aie
été assassiné, et deux chevaliers sont
venus dans ma maison pour te débarrasser de ce dernier
souci ; mais déjà je savais tout... Quoi donc
t'arrête encore ? Achève tes desseins, sors de
Rome, les portes te sont ouvertes. Si j'ordonnais ta mort, la
lie impure que tu as soulevée resterait dans notre
ville ; pars, et qu'avec toi elle s'écoule hors de nos
murs. Dans cette enceinte même, plusieurs ne paraissent
pas convaincus ; si je te frappais, ils diraient que je fais
le roi. Mais, quand tu sens dans le camp de Mallius, qui
doutera encore ? Alors d'un coup nous écraserons nos
ennemis, et ce mal qui a tant grandi sera enfin
arraché du sein de la république. Ecoute, je
crois entendre la patrie elle-même qui te crie :
Catilina, depuis quelques années, il ne s'est pas
commis un forfait dont tu ne sois l'auteur, aucun scandale
où tu n'aies trempé ; contre, toi les lois sont
muettes et les tribunaux impuissants. Ne me
délivreras-tu pas des terreurs que tu causes
?»
Et en disant ces mots Cicéron se hâtait, pour
empêcher que Catilina ne les regardât comme une
faiblesse, de lui montrer les chevaliers romains qui
entouraient la curie en frémissant, prêts
à frapper, sur un signe, l'ennemi de tous les riches.
Mais le consul voyait la populace favorable au rebelle ; il
craignait que le sang du coupable ne retombât un jour
sur sa tête comme celui d'une victime, et il le
poussait de toutes ses forces à la guerre ouverte,
afin de pouvoir le déclarer légalement ennemi
public. Il se rappelait Scipion Nasica et Opimius morts
misérablement pour avoir servi une oligarchie bien
autrement forte que celle qu'il défendait maintenant,
et il se serait contenté de l'exil volontaire de
Catilina.
Chassé par l'éloquente parole du grand orateur,
Catilina sortit du sénat, la menace à la
bouche. La nuit venue, il quitta Rome, et, après
quelques hésitations, il alla se mettre à la
tête des troupes de Mallius, leur portant, comme gage
de victoire, une aigle d'argent sous laquelle les soldats de
Marius avaient combattu à Aix et à
Verceil.
En partant, il avait mis sa femme Orestilla sous la
protection de Q. Catulus par une lettre où il disait :
«Poussé à bout par l'injustice qui me
prive des récompenses méritées par mes
services, tandis qu'on les accorde à des hommes
indignes, j'ai embrassé la cause des malheureux.
C'était le seul parti qui me restât à
prendre pour sauver mon honneur». Aux yeux de ces
patriciens, un échec électoral était un
outrage, parce qu'il diminuait leur dignité. Catilina
n'avait peut-être pas le droit de parler ainsi, mais le
sentiment de ce qui était dû à un Romain
de grande race remplissait l'âme de ces nobles, lors
même qu'ils étaient tombés dans le
mépris public.
Avant de s'éloigner, Catilina avait mandé aux
conjurés qu'il laissait dans la ville, de compter
toujours sur lui, et que bientôt il serait aux portes
de Rome. Cicéron essaya de se débarrasser
d'eux, comme il avait fait du chef, en dévoilant dans
une assemblée du peuple leurs projets, en les
accablant tour à tour de ses sarcasmes et de ses
menaces.
«Enfin, Quirites, cet audacieux est sorti de nos murs ;
Catilina a fui ; sa frayeur ou sa rage l'a emporté
loin de nous. Les coutumes de nos ancêtres, la
sécurité de l'Etat, demandaient son supplice.
Mais combien parmi vous refusaient de croire à ses
crimes ! Combien les traitaient de chimères ou les
excusaient ! Maintenant personne ne doutera, et vous le
combattrez face à face, puisqu'il se déclare
publiquement votre ennemi. Que n'a-t-il emmené avec
lui ses dangereux complices ! Pour son armée, pour
cette tourbe de vieillards désespérés,
de paysans sans ressources et de débiteurs fugitifs,
j'ai le plus profond mépris : ce n'est pas devant
l'épée qu'ils fuiront ; il suffira de leur
montrer l'édit du préteur. Mais il en est
d'autres qui, parfumés d'essences et habillés
de pourpre, courent çà et là dans le
Forum, assiégent les portes du sénat, entrent
même dans la curie. Voilà ceux de ses soldats
que j'aurais voulu voir partir avec lui. Les portes sont
ouvertes, les chemins sont libres. Qu'attendent-ils ? Ils se
trompent étrangement, s'ils croient que ma longue
patience ne se lassera pas. Qui remuera dans la ville, qui
entreprendra contre la patrie apprendra que Rome a des
consuls vigilants, un sénat courageux, des armes, une
prison, où nos ancêtres ont voulu que les crimes
manifestes fussent expiés».
Un petit nombre seulement de conjurés
s'effrayèrent et partirent. Parmi eux était le
fils d'un sénateur ; son père, averti, le fit
poursuivre et tuer par ses esclaves. Mais Lentulus, Cethegus,
Bestia, restaient à Rome, tantôt parlant
d'accuser Cicéron pour avoir exilé un citoyen
sans jugement, tantôt s'arrêtant au projet d'un
massacre général des magistrats pendant les
Saturnales. Cicéron, servi par de nombreux espions,
suivait tous leurs mouvements ; il n'osait cependant frapper,
parce qu'il manquait de preuves écrites ; l'imprudence
des conjurés lui en donna.
Il y avait alors à Rome des députés
allobroges, qui depuis longtemps réclamaient vainement
justice pour leur peuple, ruiné par les exactions des
gouverneurs. Lentulus les fit sonder par Umbrenus, comptant
exploiter leur mécontentement au profit de sa cause.
Ils cédèrent, promirent l'assistance de leur
cavalerie ; puis, réfléchissant aux dangers
d'une telle alliance, ils allèrent tout
révéler à Fabius Sanga, leur patron.
Celui-ci se hâta de les conduire au consul, qui leur
commanda d'exiger de Lentulus un engagement écrit,
sous prétexte que leurs compatriotes ne pourraient,
sans cela, croire à leurs paroles. Lentulus, Cethegus
et Statilius scellèrent de leurs sceaux les lettres
demandées, et donnèrent leurs pleins pouvoirs
à Volturcius qui partit en même temps que les
députés. Le pont Milvius, par où ils
devaient passer, était cerné : on les saisit
avec leurs dépêches, et, avant que la nouvelle
s'en fût répandue, Cicéron manda les
principaux conjurés, qui, n'ayant aucun
soupçon, se rendirent à son appel. Sans les
interroger, sans décacheter leurs lettres, il les mena
au temple de la Concorde, où le sénat
s'était réuni, pour commencer l'instruction.
Accablés par les dépositions de Volturcius et
des Allobroges, les accusés reconnurent leurs sceaux,
n'osant rien avouer, n'osant non plus rien nier. Lentulus,
plongé dans un indigne abattement, abdiqua,
séance tenante, la préture ; il fut remis
à la garde de l'édile Spinther, Statilius
à César, Gabinius à Crassus, Cethegus
à Cornificius, Ceparius au sénateur Cn.
Terentius. Avant de se séparer, le sénat vota
des actions de grâces au consul dont la vigilance avait
sauvé la république, et décréta
que de solennelles supplications seraient adressées
aux dieux, comme pour les victoires des armées :
Cicéron était le premier qui, sans avoir
revêtu l'habit de guerre, eût
mérité cet honneur.
Il se hâta de porter au peuple ces
révélations, et la foule, jusque-là
indifférente aux dangers de l'oligarchie,
s'émut de cette alliance des conjurés avec un
peuple barbare, de cet appel fait à Catilina
d'accourir sur Rome, fût-ce avec une armée
d'esclaves, tandis que ses complices mettraient le feu en
divers endroits de la ville et commenceraient le massacre.
Chacun, même le plus pauvre, se sentit menacé,
et le consul, rassuré du côté du peuple,
précipita les choses au sénat. Le 5
décembre, ce jour des nones qu'il
célébra si souvent, Cicéron ouvrit la
délibération sur le sort des conjurés.
Plusieurs songeaient à profiter de cette circonstance
pour faire envelopper leurs ennemis personnels dans la
proscription qu'on allait prononcer. Catulus, Pison surtout,
fatiguèrent Cicéron de leurs instances pour
qu'il fît parler les Allobroges contre César.
D'autres suscitèrent des accusateurs contre Crassus.
Mais Cicéron savait bien qu'en les attaquant le
sénat aurait affaire à trop forte partie.
C'était bien assez de Catilina à vaincre, d'une
guerre civile à terminer, d'une exécution
illégale à accomplir.
Le sénat n'avait pas le pouvoir judiciaire ; à
l'assemblée du peuple seule était
réservé le droit de prononcer une sentence
capitale. Le sénat allait donc commettre une
usurpation, et la responsabilité devait en retomber
sur celui qui s'en faisait honneur, sur le consul. Aussi la
conduite de Cicéron était-elle à la fois
pleine de réserve et d'audace. Il poursuivait la
tâche qu'il s'était donnée pour le repos
de l'Etat, pour sa propre gloire et pour sa fortune politique
; mais, s'il ne reculait pas devant les périls du
moment, il tâchait, à force de prudence, de
conjurer ceux de l'avenir. Tout en violant l'esprit de la
constitution, il suivait scrupuleusement les formes : il ne
faisait pas arrêter les conjurés dans leurs
maisons, afin de respecter le domicile des citoyens ; il ne
livrait pas Lentulus aux licteurs : il le conduisait
lui-même par la main au milieu du sénat, parce
qu'un consul seul pouvait contraindre un préteur ;
enfin il faisait déclarer les conjurés ennemis
publics, perduelles, pour qu'on pût
procéder contre eux comme s'ils n'étaient plus
citoyens. Mais il semblait craindre d'augmenter le nombre des
accusés, et, au milieu de tant de coupables, il ne
demandait que cinq têtes. Dans la curie, s'il disait
hautement qu'il prenait tout sur lui, il n'oubliait pas de
montrer la solidarité qui unissait le sénat
à son consul. Pendant près de deux mois il
avait laissé inutile le décret qui lui donnait
toute puissance ; aujourd'hui encore il voulait que la
sentence fût portée par cette assemblée,
afin qu'il ne parût qu'un instrument, et que sa cause
devînt celle du sénat.
Il n'avait, du reste, négligé aucun moyen de
rassurer les sénateurs par un déploiement de
forces inusité. Tous les citoyens avaient dès
la veille prêté le serment militaire ; beaucoup
étaient enrôlés et gardaient en armes le
Capitole et les principaux édifices ; de fortes
patrouilles parcouraient les rues, et l'escorte ordinaire du
consul, les jeunes chevaliers, entouraient le temple de la
Concorde, où les Pères étaient
réunis. Le consul désigné, Silanus,
interrogé le premier, vota pour la peine
dernière ; tous les consulaires se rangèrent
à son avis. César, alors préteur
désigné, osa soutenir une opinion plus douce ;
il vota pour la détention perpétuelle dans un
municipe avec la confiscation des biens. Chef du parti
populaire, il était dans son rôle d'invoquer les
lois pour s'opposer au coup hardi que voulait frapper une
oligarchie tremblante et irritée. Le peuple d'ailleurs
ne voyait pas la conspiration du même oeil que les
grands. Le manifeste, publié quelques jours auparavant
par Mallius, semblait être celui de tous les pauvres de
Rome. Parler en faveur des conjurés, c'était
donc braver l'oligarchie au milieu de sa victoire et plaire
au peuple, qui oublie si vite, connue César le disait,
les crimes des grands coupables pour s'apitoyer sur leur
supplice.
Déjà la plupart des sénateurs,
ébranlés, passaient à son avis,
même Quintus, le frère du consul, et Silanus
expliquait ses propres paroles dans le sens de César.
Cicéron alors se leva, fit voir le danger de
s'arrêter après être allé si loin ;
mais, quoiqu'il eût encore, dans ce discours,
courageusement assumé sur lui seul la
responsabilité à force de la montrer terrible
et menaçante, pour agrandir son rôle, il avait
effrayé ses collègues, qui l'eussent
peut-être abandonné si Caton ne fût venu
à son aide avec sa rude éloquence et
d'amères récriminations contre César.
L'assemblée, entraînée, vota la mort.
Cicéron, pour compromettre César, voulut y
faire joindre la confiscation des biens qu'il avait
proposée ; la discussion recommença, mais
pleine de colère et de violence. «Il est odieux,
disait César, de rejeter ce que mon avis avait
d'humain et de n'en prendre que la disposition
rigoureuse». Le consul, pressé de terminer
l'affaire, consentit à ce que le
sénatus-consulte ne parlât point de
confiscation. Un moment le tumulte avait été si
grand que les chevaliers qui entouraient le temple avaient
envahi la curie ; ils cherchaient César, pour
l'égorger ; des sénateurs lui firent un rempart
de leur corps.
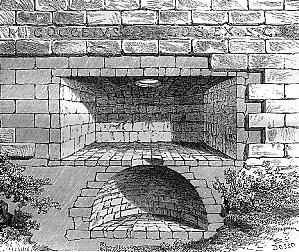
Coupe de la prison du Tullianum |
Cicéron ne perdit pas un instant, pour ne pas
laisser à César le temps de faire intervenir
les tribuns, ni au sénat, qu'il avait
enchaîné à sa cause, celui de se
rétracter. Il alla prendre lui-même Lentulus
dans la maison où il était détenu au
Palatin, et le conduisit au Tullianum, où les
préteurs amenèrent les autres conjurés.
Les triumvirs capitaux les attendaient. Lentulus fut
étranglé le premier. Sur son cadavre, Cethegus,
Gabinius, Statilius et Ceparius subirent l'un après
l'autre la même mort. Quand le consul traversa pour la
seconde fois le Forum, en descendant de la prison, il ne dit
que ces mots : ils ont vécu ; et la foule,
frappée de stupeur, s'écoula en silence (5
décembre 63). Personne ne se dit alors que les
Pères et leur consul venaient de faire un coup d'Etat,
en usurpant le pouvoir judiciaire que la loi ne leur donnait
pas. Mais un jour Clodius en demandera compte à
Cicéron et César au sénat. Tôt ou
tard, les fautes politiques sont expiées.
Les succès des généraux du sénat
avaient sans doute donné à Cicéron la
confiance d'accomplir ce qu'il regarda comme l'honneur de son
consulat et un grand service rendu à son pays. Partout
les mouvements avaient été
réprimés par la seule présence des
troupes. Il n'y avait eu de résistance sérieuse
qu'en Etrurie. Cicéron, qui avait acheté, par
la cession du gouvernement lucratif de la Macédoine,
la coopération de son collègue Antonius,
l'avait placé à la tête des troupes
dirigées contre Catilina, mais en faisant surveiller
toutes ses démarches par un de ses amis les plus
dévoués, le questeur Sextius. Cette
armée couvrait Rome, tandis qu'une autre, sous les
ordres de Metellus, occupait la Cisalpine et menaçait
les derrières de Catilina. Celui-ci avait réuni
vingt mille hommes, dont le quart seulement était
armé. Au lieu d'attaquer à l'improviste, il
perdit un temps précieux à négocier la
défection d'Antonius. Mais, à la nouvelle de
l'exécution de Lentulus, le consul sentit que la cause
des conjurés était perdue, et il ébranla
enfin son armée. La désertion se mit
aussitôt dans celle de Catilina ; au bout de quelques
jours, il ne lui restait plus que trois à quatre mille
hommes. Il voulut battre en retraite, percer l'Apennin,
gagner les Alpes et la Gaule pour recommencer Sertorius.
Derrière lui Metellus gardait tous les passages ; il
se retourna en désespéré sur
l'armée consulaire qu'Antonius avait placée
sous les ordres d'un vieux et habile soldat, Petreius, et la
rencontra non loin de Pistoïa. Avant la bataille
Catilina renvoya son cheval, comme Spartacus, et se
plaça au centre avec un corps d'élite. L'action
fut acharnée ; pas un de ses soldats ne recula ou ne
demanda quartier ; lui-même fut trouvé, bien en
avant des siens, au milieu d'un monceau de cadavres ennemis,
et respirant encore. On lui coupa la tête et on la fit
porter à Rome. L'histoire, tout en les condamnant,
garde quelque pitié pour ces grands factieux qui
savent bien mourir, et l'imagination populaire fait mieux
encore que l'histoire : à Rome, on couvrit de fleurs
son tombeau, comme on le fera plus tard pour Néron, et
dans les plus vieilles chroniques de Florence, Catilina joue
le rôle d'un héros national.
A voir ce facile succès et le peu de sang qu'il fallut
verser, à Rome celui de cinq personnages obscurs ou
décriés, sur le champ de bataille celui d'une
troupe, plutôt que d'une armée, de vieux soldats
que tout le monde abandonnait, on est contraint de penser que
l'éloquence de Cicéron a fait illusion sur
l'importance véritable de cette affaire. Il croyait
avoir étouffé une grande faction, il n'avait
tué qu'une conspiration vulgaire. Les
éléments impurs que Catilina réunissait
n'avaient pu prendre, en effet, la consistance d'un parti
politique. De ces conciliabules pouvaient bien sortir le
meurtre et l'incendie, mais non une révolution : car
les révolutions sont faites par les idées et
par les besoins d'une classe nombreuse qui est ou qui va
être la majorité. Les passions
égoïstes n'enfantent que des complots
stériles.