LXI - Le duumvirat d'Octave et d'Antoine (36-30) |
I - SAGE ADMINISTRATION D'OCTAVE, REVERS ET FOLIES
D'ANTOINE EN ORIENT
Le problème des destinées futures de la
république se simplifiait. Naguère encore il y
avait des partis, le peuple, le sénat, les nobles et
des ambitieux grands ou petits. Au-dessus de ce chaos
d'intrigues, trois hommes s'étaient
élevés, puis deux, puis un seul.
Celui-là mort, l'anarchie avait reparu ; et trois
hommes encore avaient ressaisi le pouvoir, pour recommencer
l'expérience avortée. Voici qu'il n'en reste
plus que deux, comme dix-sept ans auparavant ; mais combien
les idées monarchiques ont fait de progrès ! Au
temps du triumvirat de César et de Pompée,
Brutus, Caton et Cicéron vivaient encore. Ces nobles
coeurs sont froids maintenant, et le peuple, le sénat,
ont abdiqué sans retour, on pourrait dire sans
regrets. Antoine est maître de l'Orient, Octave de
l'Occident, et ils règnent tous deux, en attendant
qu'un seul l'emporte.
Depuis la déposition de Lépide, Octave avait
quarante-cinq légions, vingt-cinq mille cavaliers,
près de quarante mille hommes de troupes
légères, et six cents vaisseaux portaient ses
enseignes. Mais le lendemain de la victoire est plus à
craindre que le jour du combat, pour les chefs
révolutionnaires. Les soldats, sentant leur force,
demandèrent impérieusement les mêmes
récompenses qu'après la bataille de Philippes.
Il leur promit des couronnes, des armes d'honneur ; à
leurs tribuns, à leurs centurions, il donnera la robe
prétexte ; il les fera sénateurs de leurs
villes. Toutes ces belles choses sont des jouets
d'enfants, répondit le tribun Ofilius ;
à un soldat il faut de l'argent et des terres.
Octave ne parut pas s'offenser de cette liberté ;
mais, la nuit suivante, le tribun disparut. Au reste, il
distribua vingt mille congés et des gratifications
pour lesquelles la Sicile seule fournit 1600 talents, chaque
soldat reçut 500 drachmes. Après avoir
réglé l'administration de la Sicile et
envoyé Statilius Taurus en Afrique, pour prendre
possession de cette province, il revint à Rome ; le
sénat le reçut aux portes de la ville ; le
peuple, qui voyait renaître soudainement l'abondance,
l'accompagna au Capitole, couronné de fleurs. On
voulait le combler d'honneurs. Commençant
déjà son rôle de
désintéressement et de modestie, il n'accepta
que l'inviolabilité tribunitienne, l'ovation et une
statue d'or. On proposait encore de lui donner la
dignité de grand pontife qui serait enlevée
à Lépide ; il refusa, pour ne pas violer la loi
qui déclarait cette charge à vie.
César s'était perdu en affichant tout haut son
mépris pour ces hypocrisies politiques qui
prêtent la vie à des morts. Octave accepta comme
tout le monde le mensonge encore aimé, que la
république durait. Le second triumvirat était
devenu, en vertu d'un plébiscite, une magistrature
légale, à la différence du premier, qui
n'avait été qu'une association secrète
de trois hommes puissants. Ce fut de cette
légalité qu'Octave se montra le scrupuleux
observateur. Avant de rentrer dans la ville, en dehors du
pomoerium, car un imperator ne pouvait
haranguer au Forum, il avait lu un discours dans lequel il
rendait compte au peuple de tous ses actes, et il en fit
distribuer des copies. Il y invoquait la
nécessité comme excuse des proscriptions ; il
promettait, pour l'avenir, la paix, la clémence, et,
en preuve de sa modération nouvelle, il fit
brûler publiquement des lettres écrites à
Sextus Pompée par plusieurs grands personnages. Afin
de montrer que les besoins seuls de la guerre et non un
esprit de rapine l'avaient obligé à lever tant
d'or, il supprima plusieurs impôts et fit aux
débiteurs de l'Etat et aux publicains une remise des
arrérages dus par eux au trésor. Enfin il
déclara qu'il abdiquerait aussitôt qu'Antoine
aurait terminé sa guerre contre les Parthes. En
attendant, il rendit aux magistratures urbaines leurs
anciennes attributions, afin qu'on ne pût douter de la
sincérité de ses promesses, et il ne voulut au
bas de sa statue d'autre inscription que celle-ci : Pour
avoir, après de longues tourmentes, rétabli la
paix sur terre et sur mer.
Et elle était véridique, car son administration
énergique remettait tout à sa place dans la
péninsule : Sabinus en chassait les bandits ; les
esclaves qui s'étaient échappés à
la faveur des troubles étaient saisis et rendus
à leurs maîtres, ou mis à mort quand ils
n'étaient point réclamés ; plusieurs
cohortes de gardes de nuit qu'il organisa poursuivirent dans
Rome les malfaiteurs ; et, en moins d'une année, la
sécurité, depuis si longtemps perdue, se
retrouva dans la ville et dans les campagnes. Enfin donc,
Rome était gouvernée. Au lieu de magistrats,
n'usant de leurs charges que dans l'intérêt de
leur ambition et de leur fortune, elle avait une
administration vigilante, qui se préoccupait du
bien-être et de la sûreté des habitants.
Aussi les villes d'Italie, sauvées de la famine par sa
victoire et rendues au repos par l'ordre qu'il mettait en
tout, bénissaient cette autorité bienfaisante ;
déjà quelques-unes plaçaient l'image
d'Octave parmi les statues de leurs dieux protecteurs.
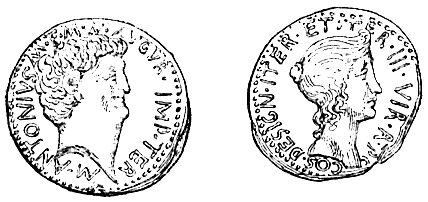
Antoine et Octavie |
Après le traité de Brindes, Antoine
était resté à Athènes,
auprès d'Octavie, veillant à la fois, au milieu
des fêtes, sur les événements d'Italie et
sur les affaires d'Orient. Les Parthes étaient peu
redoutables hors de leurs plaines immenses. Sur le sol
accidenté de la Syrie et de l'Asie Mineure, leur
cavalerie n'avait pu tenir contre l'infanterie romaine, et
les lieutenants d'Antoine avaient remporté partout
d'éclatants avantages. Sosius les avait chassés
de la Syrie ; Canidius, vainqueur des Arméniens et des
gens d'Albanie et d'Ibérie, leurs alliés, avait
porté ses enseignes jusqu'au pied du Caucase. Mais les
plus beaux succès revenaient à Ventidius, cet
Asculan que, dans la guerre sociale, le père du grand
Pompée avait conduit captif derrière son char
de triomphe. Il avait battu, en Cilicie, les Parthes et
Labienus, qui fut tué dans sa fuite. Une nouvelle
armée parthique avait eu le même sort ; son
chef, Pacorus, était aussi resté sur le champ
de bataille, et les Parthes avaient été
chassés au delà des frontières de
l'empire. Ventidius n'avait cependant osé les
poursuivre, dans la crainte peut-être d'exciter la
jalousie de son chef ; mais, pour leur fermer la route de
l'Asie Mineure, il s'était arrêté au
siège de la forte place de Samosate, en
Commagène, dont le roi, Antiochus, avait livré
passage aux Parthes.

Antiochus IV de Commagène |
En l'honneur de ces succès, Antoine donna,
dans Athènes, des jeux magnifiques, où il se
montra avec les attributs d'Hercule. Les Athéniens,
qui déjà avaient épuisé pour lui
toutes les sortes d'adulations, ne surent trouver, durant ces
fêtes, d'autre flatterie nouvelle, que de lui offrir la
main de Minerve, leur protectrice. Il accepta, en exigeant,
comme dot de la déesse, 1000 talents. «Quand ton
père, le puissant Jupiter, épousa ta
mère Sémélé, disaient les
malheureux pris au piège, il ne demanda pas qu'elle
lui apportât de patrimoine. - Jupiter était
riche, répondit le triumvir, et moi je suis
pauvre». Cependant, réveillé par les
victoires de ses lieutenants, Antoine se montra un instant en
Asie, au siège de Samosate, dont il enleva la conduite
à Ventidius, en le renvoyant triompher à Rome.
Antiochus lui avait offert, à son arrivée, 1000
talents comme rançon de la ville ; le triumvir fut
heureux d'en obtenir 300 pour s'éloigner. Il revint
encore à Athènes, laissant Sosius en
Syrie.
Ce général eut fort à faire avec les
Juifs. L'agent de tous les troubles, dans ce petit royaume,
était le ministre d'Hyrcan, l'Iduméen
Antipater. Nommé par César procurateur de la
Judée et soutenu par son fils Hérode,
tétrarque de Galilée, il avait conçu le
projet d'enlever le trône à la famille des
Maccabées. Les Parthes le chassèrent et
remplacèrent le faible Hyrcan par son neveu Antigone ;
mais Hérode, réfugié à Rome, y
gagna la faveur d'Antoine, qui le fit reconnaître, par
le sénat, roi des Juifs, pour l'opposer au
protégé des Parthes. Sosius, chargé de
soutenir le nouveau roi, prit d'assaut Jérusalem, et
le dernier représentant de l'héroïque
famille des Maccabées, traîné à
Antioche, y fut battu de verges et décapité.
Hérode prit sans obstacle possession du trône,
où il crut s'affermir en épousant Mariamne,
l'héritière de la dynastie qui venait de finir
(37).
En quittant, pour la dernière fois, Tarente et
l'Italie (36), Antoine y avait laissé Octavie et ses
enfants. Il était décidé à
prendre enfin lui-même la conduite de la guerre contre
les Parthes. Mais à peine eut-il touché le sol
de l'Asie que sa passion pour Cléopâtre se
réveilla plus insensée que jamais. Il la fit
venir à Laodicée, reconnut les enfants qu'il
avait eus d'elle, Alexandre et Cléopâtre, et
donna au premier le titre de roi des rois, comme s'il lui
réservait, pour héritage, les royaumes qu'il
allait conquérir. Les ennemis de Rome ne devaient pas
faire seuls les frais de sa générosité.
Cléopâtre, fidèle à la politique
immuable de tous les maîtres intelligents de l'Egypte,
fit ajouter à son royaume ce que les Pharaons et les
Ptolémées, les Arabes et les Mameluks,
Bonaparte et Méhémet-Ali ont toujours
convoité, la Phénicie, la Coelésyrie,
Chypre, avec une partie de la Judée et de l'Arabie, et
toute la Cilicie Trachée, qui fournissait les cadres
du Taurus exploités pour la marine,
c'est-à-dire presque tout le littoral du Nil à
l'Asie-Mineure. Ces pays étaient, pour la plupart, des
provinces romaines. Mais est-ce qu'il y avait encore une
Rome, un sénat, des lois, autre chose que le caprice
du tout-puissant triumvir ?
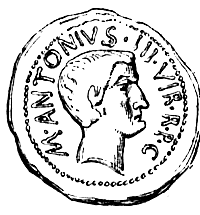 |
 |
Antoine et Mars casqué |
|
Antoine avait alors treize légions, présentant un effectif de soixante mille hommes, dix mille cavaliers et trente mille auxiliaires, principalement fournis par l'Arménien Artavasde, ennemi d'un autre Artavasde, roi de la Médie Atropatène. L'Asie trembla au bruit de ces préparatifs. Jusque dans la Bactriane, jusque dans l'Inde, on parlait de l'immense armée des guerriers de l'Occident ; et la division était parmi ses ennemis ! Une nouvelle révolution avait ensanglanté le trône de Ctésiphon. Au récit de la mort de son fils Pacorus, Orodès, tombé dans un profond abattement, avait désigné Phrahate comme son successeur. Celui-ci, impatient de régner, avait tué son père et tous ses frères. Plusieurs nobles, menacés par lui, s'étaient enfuis, et Antoine, renouvelant, en faveur du plus considérable d'entre eux, Monaesès, la générosité d'Artaxerxés envers Thémistocle, lui avait donné trois villes pour son entretien. |

Orodès |
Du mont Ararat, point culminant de l'Arménie, descendent deux chaînes de montagnes qui enveloppent l'immense bassin où coulent le Tigre et l'Euphrate. L'une couvre de ses hauteurs la Syrie et la Palestine ; l'autre la Médie, la Susiane et la Perse. De la première se détache, au nord, le Taurus, qui se prolonge jusqu'à l'extrémité de l'Asie Mineure ; de la seconde, les montagnes qui forment, à l'est, la rive méridionale de la mer Caspienne. Pour arriver à Ctésiphon, placé sur le Tigre, il y avait donc deux routes : l'une, plus courte, faisait traverser les plaines arides de la Mésopotamie, c'était celle de Crassus ; l'autre, plus longue, par les montagnes de l'Arménie et de la Médie Atropatène, tournait ces solitudes brûlantes et conduisait l'infanterie romaine, par un terrain favorable à sa tactique, vers Ecbatane et Ctésiphon, au coeur même de l'empire. Ce fut celle-ci que choisit Antoine. La saison était déjà trop avancée quand il entra en campagne ; il aurait dû prendre ses quartiers d'hiver en Arménie, pour y faire reposer ses troupes, fatiguées d'une marche de 8.000 stades, et, aux premiers jours du printemps, avant que les Parthes eussent quitté leurs cantonnements, il aurait aisément fait la conquête de la Médie ; mais, pressé du désir de retrouver Cléopâtre, il continua d'avancer pour terminer promptement la guerre.
Trois cents chariots portaient toutes ses machines, parmi lesquelles on voyait un bélier long de 80 pieds. Retardé par ce lourd attirail, Antoine se décida à le laisser derrière lui, sous l'escorte d'une division, et pénétra jusqu'à Phrahate, à peu de distance de la mer Caspienne. Il reconnut la faute qu'il avait faite d'abandonner ses machines, en votant toutes ses attaques échouer devant cette place, plus encore en apprenant que Phrahate avait surpris le corps qui les gardait, tué dix mille hommes et brûlé le convoi. Artavasde, découragé par cet échec, se retira avec ses Arméniens. Pour relever le courage de ses troupes, Antoine, avec dix légions, alla chercher l'ennemi, le rencontra à une journée de son camp, le mit en fuite et le poursuivit longtemps. Mais quand, revenus sur le champ de bataille, les légionnaires n'y trouvèrent que trente morts, cette victoire, que tout à l'heure ils croyaient si grande, leur parut être à peine une escarmouche, et, comparant le résultat avec l'effort qu'il avait coûté, ils tombèrent dans le découragement. Le lendemain, en effet, ils revirent l'ennemi aussi hardi, aussi insultant que la veille. Pendant cette affaire, une sortie des assiégés avait jeté l'effroi dans le camp romain ; les trois légions laissées dans les lignes avaient fui ; à son retour, Antoine les fit décimer. |

Phrahate |
L'hiver approchait : s'il était à
redouter pour les Romains, qui déjà manquaient
de vivres, Phrahate craignait de ne pouvoir, durant les
froids, garder ses Parthes sous la tente. Il fit des
ouvertures qu'Antoine s'empressa d'accepter : les
légions devaient lever le siège, et le roi
s'engageait à ne point les inquiéter dans leur
retraite. Pendant deux jours la marche fut tranquille ; le
troisième, les Parthes attaquèrent en un
endroit qu'ils croyaient favorable. Mais un Marse, longtemps
leur prisonnier, avait averti le triumvir : ses troupes
étaient en bataille, et l'ennemi fut repoussé.
Les quatre jours suivants furent comme les deux premiers ; le
septième, l'ennemi se montra de nouveau. Les
légions étaient formées en carré,
et les troupes légères, répandues sur
les ailes et à l'arrière-garde, tenaient
l'ennemi à distance. Malheureusement le tribun Gallus,
après avoir poussé quelque temps l'ennemi,
s'opiniâtra dans une position où il fut
entouré : trois mille hommes avaient
déjà péri, lorsqu'on put le
dégager. Depuis ce moment les Parthes, enhardis par le
succès, renouvelèrent chaque matin leurs
attaques, et l'armée n'avança qu'en combattant.
Dans le péril, Antoine retrouva les qualités
qui lui avaient valu autrefois l'amour des troupes ; brave,
infatigable, il animait par son exemple, durant l'action,
l'ardeur des siens, et le soir il parcourait les tentes,
prodiguant aux blessés les secours et les
consolations. O retraite des Dix Mille !
s'écria-t-il plus d'une fois en pensant avec
admiration au courage heureux des compagnons de
Xénophon. Enfin, au bout de vingt-sept jours de
marche, pendant lesquels ils avaient livré dix-huit
combats, les Romains atteignirent la frontière de
l'Arménie, au bord de l'Araxe dont ils
baisèrent pieusement la rive, comme le navigateur,
échappé au naufrage, embrasse la terre
où la tempête le jette. Leur route depuis
Phrahate était marquée par les cadavres de
vingt-quatre mille légionnaires !
Si le roi d'Arménie n'eût pas quitté
sitôt le camp romain, la retraite eût
été moins désastreuse, parce que ses six
mille cavaliers eussent permis de profiter des succès.
Antoine ne lui adressa cependant aucun reproche, et ajourna
sa vengeance, pour n'être point forcé de
retarder son retour auprès de Cléopâtre.
Malgré un hiver rigoureux et des neiges continuelles,
il précipita sa marche, et il perdit encore huit mille
hommes. Il atteignit enfin la côte de Syrie, entre
Béryte et Sidon, où Cléopâtre vint
le rejoindre avec des vêtements, des vivres et des
présents pour les officiers et les soldats.
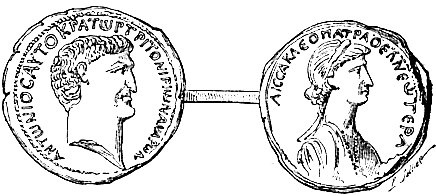
Antoine et Cléopâtre |
Une occasion s'offrit à lui de réparer
sa défaite ; Phrahate et le roi des Mèdes se
querellèrent au sujet du partage des
dépouilles, et le Mède irrité fit savoir
qu'il était prêt à se réunir aux
Romains avec toutes ses forces pour une nouvelle campagne.
Cléopâtre empêcha son amant de
répondre à cet appel d'honneur et
l'entraîna, à sa suite, dans Alexandrie.
Malgré cette retraite désastreuse, qui
contrastait avec les succès remportés cette
même année par son collègue, Antoine
envoya à Rome des messagers de victoire ; mais Octave
eut soin que la vérité fût connue, bien
qu'en public il ne parlât qu'avec éloge de
l'armée d'Orient et qu'il fit décréter
des fêtes et des sacrifices en son honneur. Aux jeux
qu'on célébra l'année suivante pour la
mort de Sextus, il voulut encore que le char d'Antoine
parût avec une pompe triomphale, et, en signe de la
cordiale entente qui existait entre eux, il fit placer sa
statue dans le temple de la Concorde. C'était bien
là l'homme qui avait toujours à la bouche le
proverbe : Hâte-toi lentement ; et cet autre :
Tu arriveras assez tôt, si tu arrives.
Octavie n'entrait pas dans ces égoïstes calculs ;
elle essaya, au contraire, d'arracher son époux
à l'influence fatale qui le menait à sa perte,
et demanda à son frère la permission de quitter
Rome pour rejoindre Antoine. Il céda, voulant jusqu'au
bout temporiser, ou dans la secrète espérance
qu'un affront fait à sa soeur lui fournirait un
prétexte de guerre et ôterait à son rival
ce qui lui restait de popularité. Antoine était
alors de retour en Syrie, où il faisait les
préparatifs d'une nouvelle expédition, en
apparence dirigée contre les Parthes, en
réalité contre le roi d'Arménie. Il
apprit là que sa femme était déjà
arrivée à Athènes ; comme Octave l'avait
prévu, il lui ordonna de ne pas aller plus loin.
Elle devina sans peine les motifs d'un message si offensant ;
cependant elle ne lui répondit qu'en lui demandant
où il désirait qu'elle fît passer ce
qu'elle aurait voulu lui conduire elle-même.
C'étaient des habits pour les soldats, un grand nombre
de bêtes de somme, de l'argent et des présents
considérables pour ses officiers et ses amis, enfin
deux mille hommes d'élite couverts d'aussi belles
armes que les cohortes prétoriennes. Les
manèges de Cléopâtre rendirent vains ces
nobles efforts ; elle affecta une profonde tristesse et un
dégoût de la vie qui firent craindre à
Antoine une résolution désespérée
: il n'osa briser sa chaîne ; et elle, pour qu'il ne
pût lui échapper, ne lui laissa pas faire cette
année l'expédition de Médie (35).
Au retour d'Octavie à Rome, son frère lui
ordonna de quitter la demeure de cet indigne époux.
Elle refusa et continua d'élever avec ses enfants ceux
d'Antoine et de Fulvie, en leur donnant les mêmes
soins, presque la même tendresse. Et, s'il arrivait
dans la ville quelque ami de son mari pour briguer une charge
ou suivre une affaire particulière, elle le recevait
chez elle et lui faisait obtenir de son frère les
grâces qu'il sollicitait. Mais cette conduite allait
contre son but. Le contraste de tant de vertu et d'injustice
augmentait contre Antoine la haine publique.
L'année suivante (34), il fit une courte
expédition en Arménie. Dellius l'y avait
précédé, sous prétexte de
demander pour un fils d'Antoine et de Cléopâtre
la main d'une fille du roi Artavasde, en
réalité pour endormir la vigilance de ce
prince. Antoine pénétra jusqu'à
Nicopolis dans la petite Arménie et invita le roi
à venir s'entendre avec lui sur l'expédition
contre les Parthes. Malgré toutes les assurances,
Artavasde craignait quelque trahison ; cependant, lorsqu'il
apprit que le triumvir marchait sur Artaxata, il
espéra conjurer l'orage en se rendant à
l'invitation ; il fut saisi, chargé de chaînes
d'or et traîné à Alexandrie, où
Antoine entra en triomphe. Ce qui restait de chefs-d'oeuvre
laissés en Asie par les proconsuls allèrent
décorer la nouvelle capitale de l'Orient ; toute la
Bibliothèque de Pergame, deux cent mille volumes, y
fut portée.
Rome s'offensa de cette atteinte à ses droits, mais le triumvir avait oublié qu'il était Romain. A peu de temps de là, il fit dresser, sur un tribunal d'argent, deux trônes d'or, l'un pour lui-même, l'autre pour Cléopâtre. Il la déclara reine d'Egypte et de Chypre, lui associa Césarion, et donna le titre de rois à Alexandre et à Ptolémée, les deux fils qu'il avait eus d'elle : au premier avec l'Arménie, la Médie et le royaume des Parthes, qu'il regardait déjà comme sa conquête ; au second avec la Phénicie, la Syrie et la Cilicie ; il assigna pour dot à leur soeur Cléopâtre, la future épouse de Juba II, la Libye voisine de la Cyrénaïque. Puis il présenta les deux princes au peuple, Alexandre portant la robe médique et la tiare, Ptolémée revêtu du long manteau et du diadème des successeurs d'Alexandre. |
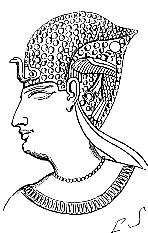
Ptolémée Césarion
|

Juba II, roi de Maurétanie |

Cléopâtre Séléné |
Les nouveaux rois ne parurent désormais en
public qu'entourés d'une garde d'Asiatiques ou de
Macédoniens. Antoine lui-même quitta la toge
pour une robe de pourpre, et on le vit, comme les monarques
de l'Orient, couronné d'un diadème, portant un
sceptre d'or, avec le cimeterre au côté ; ou
bien, auprès de Cléopâtre, parcourir les
rues d'Alexandrie, tantôt en costume d'Osiris, plus
souvent en Bacchus, traîné sur un char,
paré de guirlandes, chaussé du cothurne, une
couronne d'or au front et le thyrse en main. Il avait fait de
ses légionnaires les serviteurs et les gardes de la
reine : leurs boucliers portaient son chiffre, et sur les
monnaies on volait la double effigie d'Antoine et de
Cléopâtre. Qu'il fallait que le besoin d'un
maître fût impérieux, pour que cet
insensé trouvât cent mille hommes qui voulussent
combattre encore, afin de lui donner l'empire !
Un jour cependant il se souvint de Rome, et n'eut pas honte
de faire demander au sénat la confirmation de tous ses
actes. Les consuls alors en charge, Domitius Ahenobarbus et
Sosius, n'osèrent, quoique ses amis, donner lecture de
ses folles dépêches.
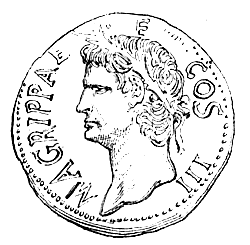
Agrippa |
Tandis qu'Antoine se déshonorait en Orient, que faisait Octave ? Nous l'avons dit, il gouvernait ; il donnait à l'Italie ce repos dont elle était affamée. Agrippa, pour avoir le droit de faire d'utiles innovations, accepta, par ordre d'Octave, lui consulaire et général tant de fois victorieux, la charge modeste de l'édilité (33). Aussitôt il entreprit d'immenses travaux ; les édifices de l'Etat furent réparés, les chemins reconstruits, des fontaines publiques ouvertes. Des aqueducs s'étaient écroulés, il les releva et en construisit un nouveau, l'Aqua Julia.
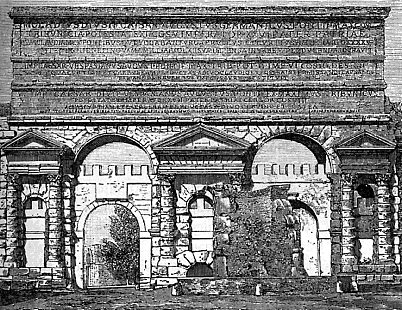
La porta Maggiore à Rome, portant trois
aqueducs superposés,
|
Les égouts engorgés étaient devenus une cause d'insalubrité, il en visita, dans une barque, l'artère principale, et les fit nettoyer. Il ouvrit au public cent soixante-dix bains gratuits et décora le Cirque de dauphins et de signaux en forme ovale qui marquaient le nombre des courses. Pour achever la réconciliation du peuple avec le triumvir, il célébra des jeux qui durèrent cinquante-neuf jours, et au théâtre il jeta des billets qu'on allait échanger contre de l'argent, des habits ou d'autres dons. Déjà avant les fêtes il avait fait des distributions gratuites de sel et d'huile, et abandonné sur la place d'immenses quantités de denrées de toute sorte que la foule s'était partagées. Ce rude soldat croyait à l'influence heureuse de l'art : il achetait des tableaux pour les placer en des lieux publics, et, du temps de Pline, on conservait de lui un magnifique discours sur l'avantage qu'il y aurait à tirer les objets d'art de leur exil dans les villas des riches, pour les réunir en des expositions permanentes. La pyramide de Cestius est de cette époque.
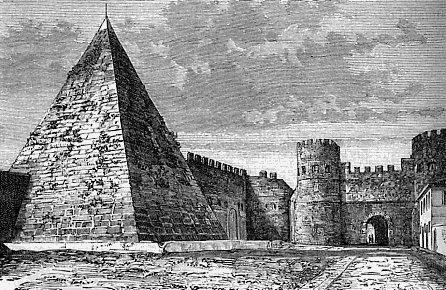
Pyramide de Caius Cestius |
La gloire militaire ne manquait pas à ce
gouvernement préoccupé de
l'intérêt public, et elle était acquise
par des expéditions nécessaires. Si Octave
parla d'une descente en Bretagne, c'était pour frapper
les esprits que les guerres de César, de Pompée
et d'Antoine aux extrémités du monde avaient
blasés sur les entreprises modestes ; il voulait
aussi, en laissant courir ces bruits belliqueux, se donner le
prétexte d'entretenir des forces considérables.
Il avait déjà compris qu'au lieu de se lancer
en de lointaines conquêtes, Rome devait soumettre les
barbares placés à ses portes ; qu'il fallait
donner la sécurité à l'Italie et
à la Grèce, en domptant les pirates de
l'Adriatique et les remuantes tribus établies au nord
des deux péninsules.
Après une courte apparition en Afrique, pour y
consolider son pouvoir, il mena ses légions contre les
Illyriens, se proposant d'éloigner ses soldats de
l'Italie, où ils s'amollissaient, de raffermir leur
discipline dans une guerre étrangère et de les
tenir prêts, sans fouler le peuple, pour la lutte
inévitable avec Antoine. Les Japodes, les Liburnes,
les Dalmates, furent écrasés. Au siège
d'une place, courageusement défendue par les Japodes,
ses troupes, un jour, s'enfuirent ; il saisit un bouclier et
s'avança, lui cinquième, sur le pont de bois
qui conduisait à la muraille. En voyant le danger de
leur général, les soldats revinrent en si grand
nombre, que le pont se brisa ; Octave fut grièvement
blessé. C'était une réponse à
ceux qui, durant la guerre civile, l'avaient accusé de
lâcheté. Les Alpes ne laissent qu'une porte
largement ouverte sur l'Italie du bord, celle que les Alpes
Juliennes défendent si mal. Pour la bien garder,
Octave alla, par delà ces montagnes, établir
des garnisons dans la vallée de la Save, où il
prit la forte place de Sida : une partie des Pannoniens lui
promit obéissance. Dans le Val d'Aoste, il
réprima les brigandages des Salasses, et, s'il ne les
domptait pas encore, il rendait leurs incursions difficiles
par la fondation de deux colonies qui devinrent Augusta
Taurinorum et Augusta Praetoria (Turin et Aoste). En Afrique
enfin, le dernier prince de la Maurétanie
césarienne étant mort, il réunit ses
possessions à la province. Agrippa et Messala avaient
montré dans ces guerres leur talent ordinaire
(35-33).