
I. Tu viens d'affranchir ton esclave. Mais toi, qui l'as mis en liberté, es-tu libre ? N'es-tu point l'esclave de ton argent, d'une femme, d'une fille, d'un tyran, du dernier valet du tyran ?
II. Tu dis que la confiance et la précaution sont incompatibles ; c'est une erreur, et tu peux les allier. Applique seulement la précaution aux choses qui dépendent de toi, et la confiance à celles qui n'en dépendent point. Ainsi tu seras confiant et précautionné. Car, en évitant par ta prudence les véritables maux, tu soutiendras avec courage les faux maux dont on te menace.
III. Le malheur des hommes vient toujours de ce qu'ils placent mal leur précaution et leur confiance. Ils sont tous comme les cerfs qui, pour éviter l'oiseau, qui menace de fondre sur eux, et cherchant à se mettre à couvert, tombent dans les filets où ils périssent.
IV. Je compose de beaux dialogues, je fais de bons livres. - Eh ! mon ami, montre-moi plutôt que tu domptes tes passions, que tu règles tes désirs, et que tu suis la vérité dans tes opinions. Assure-moi que tu ne crains ni la prison, ni l'exil, ni la douleur, ni la pauvreté, ni la mort. Sans cela, quelques beaux livres que tu fasses, sois bien persuadé que tu n'es encore qu'un ignorant.
V. Diogène répondit un jour à un homme qui lui demandait des lettres de recommandation : «Mon ami, celui à qui tu veux que j'écrive en ta faveur verra d'abord sans moi que tu es un homme, et, s'il est bon connaisseur, il verra encore si tu es bon ou méchant. Au lieu que, s'il n'est pas bon connaisseur, je lui écrirais cent lettres, qu'il ne t'en connaîtrait pas mieux. Tu n'as qu'à être comme une pièce d'or qui se recommande d'elle-même à quiconque sait distinguer le bon or d'avec le faux».
VI. Que fait un homme qui poursuit la femme de son prochain ? Il foule aux pieds la pudeur, la fidélité ; il viole le voisinage, l'amitié, la société, les lois les plus saintes ; il ne peut plus être regardé ni comme ami, ni comme voisin, ni comme citoyen. Il n'est pas même bon à être esclave ; il est comme un vaisseau qui n'est plus d'aucun usage, et qui n'est bon qu'à être jeté.
VII. Les femmes sont communes, c'est la loi de la nature, disait à Diogène un débauché qui avait été surpris en adultère. Diogène lui répondit : «Les viandes qu'on sert à table sont communes d'abord ; mais, dès que les portions sont faites et distribuées, tu aurais perdu toute pudeur et toute honte, si tu allais prendre la part de ton voisin sur son assiette. Le théâtre est commun à tous les citoyens ; mais sitôt que les places sont prises, tu ne peux ni ne dois déplacer ton voisin pour te mettre à sa place. Les femmes sont communes de même ; mais sitôt que le législateur les a distribuées, et qu'elles ont chacune leur mari, en bonne foi, t'est-il permis de ne pas te contenter de la tienne et de prendre celle de ton voisin ? Si tu le fais, tu n'es plus un homme, mais un singe, ou un loup carnassier».
 |
VIII. En toutes choses, il faut faire ce qui dépend de soi, et du reste être ferme et tranquille. Je suis obligé de m'embarquer ; que dois-je donc faire ? Bien choisir le vaisseau, le pilote, les matelots, la saison, le jour, le vent, voilà tout ce qui dépend de moi. Dès que je suis en pleine mer, il survient une grosse tempête ; ce n'est plus là mon affaire, c'est l'affaire du pilote. Le vaisseau coule à fond, que dois-je faire ? Je fais ce qui dépend de moi, je ne criaille point, je ne me tourmente point. Je sais que tout ce qui est né doit mourir, c'est la loi générale ; il faut donc que je meure. Je ne suis pas l'éternité ; je suis un homme, une partie du tout, comme une heure est une partie du jour. Une heure vient et elle passe ; je viens et je passe aussi : la manière de passer est indifférente ; que ce soit par la fièvre ou par l'eau, tout est égal.
IX. Il ne faudrait se réjouir avec les hommes et les féliciter que des choses dont ils ont un véritable sujet de se réjouir, et qui leur sont honorables et utiles.
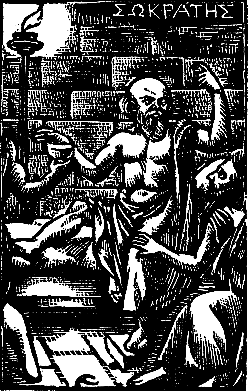 |
X. Si nous étions en prison et à la veille d'être jugés sur une accusation capitale, pourrions-nous souffrir un homme qui viendrait nous demander : «Voulez-vous que je vous lise des hymnes que j'ai composés ?» - Mon ami, pourquoi viens-tu m'importuner si mal à propos ? j'ai bien d'autres affaires. Ne sais-tu pas que je dois être jugé demain ? - Socrate était en prison et à la veille d'être condamné, et il composait des hymnes. |
XIII. Pourquoi aller consulter les devins sur les choses où notre devoir est si marqué ? S'il s'agit de m'exposer à quelque danger pour mon ami, s'il est question de mourir pour lui, qu'ai-je besoin de devin ? N'ai-je pas au dedans de moi un devin sûr et infaillible, qui m'a appris la nature du bien et du mal, et qui m'a expliqué tous les signes auxquels je puis les reconnaître ?
XIV. Le faible que l'homme a pour les devins vient de sa timidité : il craint les événements. Voilà pourquoi il a pour les devins une complaisance outrée. Il les fait les arbitres et les juges de toutes ses affaires, il leur confie tout ce qu'il a, et, s'ils lui prédisent du bien, il les remercie comme s'ils le lui donnaient. Quel aveuglement ! Si nous étions sages, nous consulterions les devins comme nous demandons le chemin dans un voyage, sans nous mettre en peine si c'est à droite ou à gauche qu'il faut passer. Car qu'est-ce que consulter les devins ? C'est consulter les dieux pour connaître leur volonté et la faire. Nous devrions donc nous servir des oracles comme nous nous servons de nos yeux. Nous ne prions point nos yeux de nous faire voir tels ou tels objets, mais nous voyons ceux qu'ils nous montrent. Agissons de même avec les devins ; ne les flattons point, ne les prions point, mais faisons ce qu'ils nous ordonnent.
XV. Une dame romaine voulait envoyer une grosse somme d'argent à une de ses amies appelée Gratilla, que Domitien avait exilée. Quelqu'un lui dit que Domitien mettrait la main sur cet argent et qu'il le confisquerait. «N'importe, répondit-elle, j'aime mieux encore que Domitien le ravisse, que de ne pas l'envoyer».
XVI. Quand nous consultons les augures, c'est en tremblant et en faisant aux dieux d'ardentes prières : «Dieux, ayez pitié de moi, permettez que je me tire heureusement de telle et telle affaire». Eh ! vil esclave, veux-tu autre chose que ce qui est le meilleur pour toi ? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour toi que de faire ce que les dieux trouveront agréable ? Pourquoi veux-tu donc tâcher de corrompre ton arbitre et ton juge, autant qu'il est en ton pouvoir ?
XVII. Quelle est la nature de la divinité ? c'est intelligence, science, ordre, raison. Par là tu peux connaître quelle est la nature de ton véritable bien qui ne se trouve qu'en elle.
XVIII. Si tu es né de parents nobles, tu es si plein de ta noblesse, que tu ne cesses d'en parler et que tu en étourdis tout le monde. Mais tu as la divinité pour père, tu l'as au dedans de toi, et tu oublies cette noblesse, et tu ignores d'où tu es venu, et ce que tu portes ? Voilà pourtant de quoi tu devrais te souvenir dans toutes les actions de ta vie. Dis-toi à tout moment : «C'est la divinité qui m'a créé, elle est au dedans de moi, je la porte partout. Pourquoi la souillerais-je par des pensées obscènes, par des actions basses et impures, et par d'infâmes désirs ?»
XIX. Tu te ferais scrupule de commettre des actions déshonnêtes devant une statue ou une image des dieux : ils te voient, ils t'entendent ; et tu ne rougis point d'avoir en leur présence des pensées obscènes et de faire des actions impures qui les blessent, qui les déshonorent et qui les affligent. O l'ennemi des dieux ! O le lâche qui a oublié sa nature !
XX. Si tu étais une statue de Phidias, sa Minerve ou son Jupiter, et que tu eusses quelque sentiment, tu te donnerais bien garde, en te souvenant de l'ouvrier qui t'aurait formé, de rien faire qui fût indigne de lui et de toi-même, et pour rien au monde tu ne voudrais paraître dans un état indécent, qui déshonorât ta beauté. En ne t'inquiétant nullement dans quel état tu parais devant les dieux, tu déshonores la main qui t'a formé. Quelle différence pourtant d'ouvrier à ouvrier, et d'ouvrage à ouvrage !
XXI. Si les dieux t'avaient donné en garde un pupille, tu en aurais soin, et tu ne laisserais pas gâter un si précieux dépôt. Ils t'ont donné en garde à toi-même ; ils t'ont dit : «Nous n'avons pas cru pouvoir te mettre entre les mains d'un tuteur plus fidèle, plus affectionné ; garde-nous ce fils tel qu'il est par sa nature ; conserve-le-nous plein de pudeur, de fidélité, de magnanimité, de courage, exempt de trouble et de passion». Et tu te négliges ! Quelle infidélité ! Quel crime !
XXII. D'où vient cette fierté, ce sourcil haut à ce petit philosophe ? - Attends un peu, mon ami, je serai bientôt plus fier ; je ne suis pas encore bien ferme dans les maximes que j'ai apprises et auxquelles j'ai donné mon consentement ; je crains encore ma faiblesse. Attends que je sois fortifié, et tu verras une fierté toute autre. La statue n'est pas encore finie, les dieux n'y ont pas mis encore la dernière main ; dès qu'elle sera achevée, tu verras. Mais ne pense pas que ce soit une fierté d'orgueil, ce sera une fierté d'assurance et de confiance dans la vérité. Cette fierté et ce sourcil que tu vois à cette tête de Jupiter, est-ce orgueil, à ton avis ? Non. C'est fermeté, c'est stabilité, c'est constance. C'est ainsi que doit être un dieu qui te dit : «Tout ce que j'ai confirmé par un signe de ces sourcils, ne trompe point, est irrévocable et ne manque jamais d'arriver». Je tâcherai d'imiter ce grand modèle. Tu me verras fidèle, plein de pudeur, plein de courage, et inaccessible au trouble et aux émotions que causent les accidents qu'on appelle terribles. - Mais te verrai-je immortel et exempt de vieillesse et de maladie ? - Non. Mais tu verras que je sais mourir, et que je sais être vieux et malade. Tu verras les nerfs d'un philosophe, des nerfs bien réglés. - Quels nerfs ? - Désirs jamais frustrés ; craintes bien placées, et qui préviennent tous les maux ; mouvements réglés et convenables ; desseins formés avec réflexion, et consentements qui ne sont jamais suivis de repentir.
XXIII. Ce n'est pas une chose bien commune d'accomplir ce que promet la qualité d'homme. C'est un animal mortel, doué de raison, et c'est par la raison qu'il se distingue des bêtes. Toutes les fois donc qu'il s'éloigne de la raison, qu'il agit sans raison, l'homme périt, et la bête se montre.
XXIV. Nous ressemblons à ceux qui ont de grandes provisions, et qui demeurent maigres et décharnés, parce qu'ils ne s'en nourrissent point. Nous avons de beaux préceptes, de belles maximes, mais c'est pour en discourir, et non pour les pratiquer ; nos actions démentent nos paroles. Nous ne sommes pas encore des hommes, et nous voulons jouer le rôle de philosophes. Le fardeau est trop lourd pour nous. C'est comme si un homme qui n'aurait pas la force de porter un poids de deux livres, entreprenait de porter la pierre d'Ajax.
XXV. Tu réunis en toi des qualités qui demandent chacune des devoirs qu'il faut remplir. Tu es homme ; tu es citoyen du monde ; tu es fils des dieux, tu es le frère de tous les hommes. Après cela, tu es sénateur ou dans quelque autre dignité ; tu es jeune ou vieux ; tu es fils, tu es père, tu es mari. Pense à quoi tous ces titres t'engagent, et tâche de n'en déshonorer aucun.
XXVI. Tu as perdu des biens, et tu regardes cela comme une grande perte, dont tu ne peux te consoler. Mais quand tu as perdu la fidélité, la pudeur, la douceur, la modestie, tu crois n'avoir rien perdu. Cependant, ces biens extérieurs, c'est une cause étrangère et involontaire qui nous les ravit, et il n'est honteux ni de ne pas les avoir, ni de les perdre. Et ces derniers, les biens intérieurs, nous ne les perdons jamais que par notre faute, et comme il est honteux et très malheureux de ne pas les avoir, il est aussi très honteux et très malheureux, quand on les a, de les perdre.
XXVII. Personne ne peut être méchant et vicieux, sans une perte sûre et sans un dommage certain.
XXVIII. Ne faut-il pas que je me venge et que je rende le mal qu'on m'a fait ? - Eh ! mon ami, on ne t'a point fait de mal, puisque le bien et le mal ne sont que dans ta volonté. D'ailleurs, si un tel s'est blessé lui-même en te faisant injustice, pourquoi veux-tu te blesser aussi toi-même en la lui rendant ?
XXIX. Le commencement de la philosophie, c'est de connaître notre faiblesse et notre ignorance dans les devoirs nécessaires et indispensables.
XXX. Il n'y a point d'homme qui n'ait naturellement une certaine idée, une certaine notion du bien, du mal, de l'honnête, du déshonnête, du juste, de l'injuste, du bonheur, du malheur, et des devoirs ou pratiqués ou négligés. D'où vient donc que, sur ces matières, on se trompe si souvent, quand on juge des faits particuliers ? Cela vient, comme je l'ai déjà dit, de ce que nous appliquons mal nos actions communes, et que nous jugeons par des préjugés peu approfondis. Le beau, le bon, le mal, le bien, le juste, l'injuste, ce sont des termes que tout le monde emploie également avant que d'avoir appris à les appliquer avec raison et avec justice. De là naissent les disputes, les querelles, les guerres. Je dis : «Cela est juste». Un autre dit : «Cela est injuste». Comment se mettre d'accord ? Quelle règle avons-nous pour bien juger ? Sera-ce l'opinion ? Mais nous voilà deux, et nous avons deux opinions contraires. D'ailleurs, comment l'opinion peut-elle être un juge sûr ? Les fous n'ont-ils pas leur opinion ? Il faut pourtant bien qu'il y ait une règle sûre pour connaître la vérité ; car il n'est pas possible que les dieux aient laissé les hommes dans une entière ignorance de ce qu'ils doivent savoir pour se conduire. Cherchons donc cette règle, qui peut seule nous délivrer de nos erreurs et guérir la témérité et la folie de l'opinion. Cette règle est d'appliquer à l'espèce les caractères que l'on donne au genre, afin que ces caractères, connus et avoués de tout le monde, nous servent à redresser nos préjugés sur chaque fait particulier. Par exemple, nous avons l'idée du bien ; il s'agit de savoir si la volupté est un bien, examinons-la selon cette idée, et pesons-la dans cette balance. Je la pèse avec ces caractères du bien qui sont mes poids. Je la trouve légère, je la rejette, car le bien est une chose solide et d'un très grand poids.
XXXI. Tu pâlis, tu trembles et tu es embarrassé quand tu vas voir un prince ou quelque grand seigneur. - Comment me recevra-t-il ? Comment m'entendra-t-il ? - Vil esclave, il te recevra, il t'entendra comme il le jugera à propos ; tant pis pour lui s'il reçoit mal un homme sage, il en souffrira seul. Peux-tu souffrir de la faute d'un autre ? - Mais comment lui parlerai-je ? - Tu lui parleras comme tu voudras. - J'ai peur de me troubler. - Eh quoi ! ne sais-tu pas parler avec discrétion, avec prudence, et avec une honnête liberté ? Pourquoi t'avises-tu de craindre un homme ? Zénon ne craignait point Antigone, mais Antigone craignait Zénon. Socrate était-il embarrassé quand il parlait aux tyrans et à ses jugea ? Diogène était-il embarrassé quand il parlait à Alexandre, à Philippe, aux pirates, au maître qui l'avait acheté ?
XXXII. Si nous voulons être philosophes véritablement, réglons notre volonté sur les événements de telle sorte que nous soyons toujours contents et de ce qui arrive, et de ce qui n'arrive point. De là nous tirerons ce grand avantage que nous ne manquerons jamais d'obtenir ce que nous désirons, et que nous ne tomberons jamais dans ce qui fait le sujet de nos craintes. Et ainsi nous passerons notre vie avec notre prochain, sans chagrin et sans trouble, et nous conserverons toutes nos liaisons naturelles et acquises, c'est-à-dire que nous remplirons parfaitement nos devoirs de père, de fils, de frère, de citoyen, de mari, de voisin, d'associé, de magistrat et de sujet.
XXXIII. La première chose qu'il faut apprendre, c'est qu'il y a un Dieu, qu'il gouverne tout par sa providence, et que non seulement nos actions, mais nos pensées et nos mouvements ne sauraient lui être cachés. Ensuite il faut examiner quelle est sa nature. Sa nature étant bien connue, il faut nécessairement que ceux qui veulent lui plaire et lui obéir fassent tous leurs efforts pour lui ressembler, qu'ils soient libres, fidèles, bienfaisants, miséricordieux, magnanimes. Que toutes tes pensées donc, que toutes tes paroles, que toutes tes actions, soient les actions, les paroles et les pensées d'un homme qui imite Dieu, qui veut lui ressembler.
XXXIV. Rien n'est si ordinaire que de voir des grands qui croient tout savoir, quoiqu'ils ne sachent rien et qu'ils ignorent les choses les plus nécessaires. Comme ils nagent dans les richesses et qu'ils n'ont besoin de rien, ils ne soupçonnent pas seulement qu'il leur manque quelque chose. C'est ce que je disais un jour à un des plus considérables : «Vous êtes bien vu du prince ; vous avez quantité d'amis très puissants, et de grandes alliances ; par votre crédit, vous pourrez servir vos amis et nuire à vos ennemis. - Qu'est-ce donc qui me manque ? me dit-il. - Tout ce qu'il y a de plus important, et de plus nécessaire pour le véritable bonheur. Et jusqu'ici vous avez fait tout autre chose que ce qui vous convenait. Voici ce qu'il y a de plus capital : vous ne savez ni ce que sont les dieux, ni ce que c'est que l'homme. Vous ignorez la nature du bien et du mal, et, ce qui vous surprendra plus que tout, vous ne vous connaissez pas vous-même... Ah ! vous fuyez et vous êtes en colère de ce que je vous parle si franchement ! Quel mal vous fais-je ? Je ne fais que vous présenter le miroir qui vous rend tel que vous êtes».
XXXV. Un médecin vient voir un malade, il lui dit : «Vous avez la fièvre, abstenez-vous pour aujourd'hui de toute nourriture, et ne buvez que de l'eau». Le malade le croit, le remercie et le paie. Un philosophe dit à un ignorant : «Vos désirs sont déréglés, vos craintes sont basses et serviles, et vous n'avez que de fausses opinions». Celui-ci s'en va tout en colère, et dit qu'on l'a insulté. D'où vient cette différence ? C'est que le malade sent son mal, et que l'ignorant ne sent pas le sien.
XXXVI. N'as-tu jamais vu une foire où les hommes se rendent de tous les pays voisins ? Les uns y sont pour acheter, les autres pour vendre. Il y en a peu qui y soient par curiosité, pour voir seulement la foire, et qui s'informent pourquoi elle se tient et qui l'a établie. Il en est de même de ce monde. Tous les hommes s'y rendent, les uns pour vendre, les autres pour acheter. Il y en a très peu qui y soient pour admirer ce grand spectacle, pour connaître ce qu'il est, celui qui l'a fait, pourquoi il l'a fait, et comment il le gouverne. Car il n'est pas possible qu'il n'ait été fait et qu'il ne soit gouverné par quelqu'un. Une ville, une maison n'existent point sans un ouvrier, et ne durent point si quelqu'un ne les gouverne ; et une machine si vaste et si admirable existerait et durerait par un pur hasard ? Cela est impossible. Il y a donc quelqu'un qui l'a faite et qui la gouverne. Qui est-il donc, et comment la gouverne-t-il ? Et nous, qui sommes aussi son ouvrage, qui sommes-nous, et pourquoi sommes-nous ? Il y en a très peu qui fassent ces réflexions, et qui, après avoir admiré l'ouvrage et béni l'ouvrier, se retirent contents. S'il y en a quelques-uns qui le fassent, ils sont la risée des autres, comme, à la foire, les marchands se moquent des simples curieux, qu'ils appellent des badauds. Et si les boeufs et les cochons pouvaient parler, ils se moqueraient de même de ceux qui penseraient à tout autre chose qu'à la pâture.
XXXVII. Tu as ouï dire aux philosophes qu'il faut être ferme et constant dans ses résolutions, et sur cela tu t'opiniâtres à demeurer ferme dans tes faux préjugés, dans tes erreurs, dans tes folies. Mais, mon ami, la chose la plus nécessaire c'est que les résolutions soient bonnes, c'est-à-dire, qu'elles soient prises avec prudence, vérité et raison. Je te dis qu'il faut qu'un homme ait des nerfs, mais il faut que ce soient les nerfs d'un corps sain, d'un athlète vigoureux et robuste, et tu me montres des nerfs enflés, les nerfs d'un frénétique; ce ne sont pas là des nerfs, c'est plutôt faiblesse de nerfs.
XXXVIII. Les fous sont incorrigibles, et, comme dit le proverbe, on romprait plutôt un fou que de le changer.
XXXIX. Il ne faut avoir peur ni de la pauvreté, ni de l'exil, ni de la prison, ni de la mort. Mais il faut avoir peur de la peur.
XL. Quand je suis embarqué, et que je ne vois plus que le ciel et la mer, cette vaste étendue d'eau qui m'environne m'effraie, comme si, en faisant naufrage, je devais l'avaler tout entière, et je ne pense pas qu'il ne faut que trois mesures d'eau pour me noyer. De même, dans un tremblement de terre, je m'imagine que la ville entière va me tomber sur le corps, et je ne pense pas qu'une tuile suffit pour me casser la tête. Ah ! malheureux esclave de l'opinion !
XLI. Ah ! quand reverrai-je Athènes et l'Acropole ? - Mon ami, peux-tu rien voir de plus beau que le ciel, ce soleil, cette lune, ces étoiles, cette terre, cette mer ? Si tu es si affligé pour avoir perdu Athènes de vue, eh ! que feras-tu quand il te faudra perdre de vue le soleil ?
XLII. Mon ami, ne veux-tu donc pas être enfin sevré, et quitter le lait pour te nourrir de viande solide ? Veux-tu encore pleurer et crier après le téton de ta nourrice et regretter les contes et les chansons dont elle t'endormait ?
XLIII. Tu ne peux être ni un Hercule, ni un Thésée, pour purger la terre de monstres, mais tu peux les imiter en te purgeant toi-même des monstres qui sont en toi. Tu as au dedans de toi le sanglier, le lion, l'hydre ; dompte-les. Au lieu de dompter Procuste et Sciron, dompte la douleur, la crainte, la cupidité, l'envie, la malignité, l'avarice, la mollesse et l'intempérance. Le seul moyen de dompter ces monstres, c'est de n'avoir que les dieux seuls en vue, c'est de leur être attaché, de leur être dévoué, et de n'obéir qu'à leurs ordres.
XLIV. Secoue enfin le joug, et, délivré de la servitude, lève les yeux vers le ciel et dis à ton dieu : «Fais de moi désormais ce que tu voudras ; je ne refuse rien de tout ce que tu voudras m'envoyer, et je justifierai ta conduite auprès de tous les hommes».
XLV. Quand ton imagination tâche de te séduire par quelque idée de luxure, ne te laisse point entraîner, mais dis-lui sur l'heure : «Attends, mon imagination, que je voie un peu ce que tu es et ce que tu me présentes, que je t'examine». Ne lui permets pas d'aller plus loin et de te présenter des images plus séduisantes, car, si tu la laisses faire, tu es perdu, elle t'entraînera. Au lieu de ces peintures affreuses, force-la à te présenter des images plus heureuses, plus belles et plus nobles. Voilà les moyens de lui échapper.
XLVI. Si je résiste à une belle femme qui est prête à m'accorder ses faveurs, je me dis à moi- même : Voilà qui va bien, Epictète, cela vaut mieux que d'avoir réfuté le sophisme le plus subtil. Si je résiste à ses avances et que je repousse ses caresses, je puis me glorifier de cette victoire bien plus que d'avoir triomphé de tous les syllogismes les plus embarrassants... Mais comment résister à une tentation si pressante ? Il ne faut pour cela que vouloir te plaire à toi-même, et être beau aux yeux des dieux. Il ne faut que vouloir conserver la pureté du corps et de l'âme.
XLVII. A chaque tentation, dis en toi-même : «Voici un grand combat ; voici une action toute divine ; il s'agit ici de la royauté, de la liberté, de la félicité, de l'innocence ; souviens-toi des dieux, appelle-les à ton secours, et ils combattront pour toi». Tu invoques bien Castor et Pollux, dans une tempête ; la tentation est une tempête plus dangereuse pour toi.
XLVIII. Quand tu es attaqué par une tentation, si tu diffères jusqu'au lendemain à la combattre, le lendemain viendra, et tu ne combattras point. Ainsi, de lendemain en lendemain, il arrivera que non seulement tu seras vaincu, mais que tu te trouveras plongé dans une insensibilité telle qu'il te sera impossible de t'apercevoir même que tu pèches, et tu éprouveras effectivement en toi la vérité de ce vers d'Hésiode : «Celui qui diffère d'un jour à l'autre est toujours accablé de maux».
XLIX. Pourquoi fais-tu le stoïcien ? Prends donc le nom que tes actions demandent, et ne t'orne point d'un nom qui ne te convient point et que tu ne fais que déshonorer. Je vois bien des hommes qui débitent les maximes des stoïciens. Mais je ne vois point de stoïcien. Montre-moi donc un stoïcien, je n'en demande qu'un. Un stoïcien, c'est-à-dire un homme qui, dans la maladie, se trouve heureux, qui, dans le danger, se trouve heureux, qui, mourant, se trouve heureux, qui, méprisé et calomnié, se trouve heureux ! Si tu ne peux me montrer ce stoïcien parfait et achevé, au moins montre-m'en un qui commence à l'être. Ne frustre point un vieillard comme moi de ce grand spectacle, dont j'avoue que je n'ai encore pu jouir ; montre-moi un homme qui veuille se conformer à la volonté des dieux, qui ne se plaigne jamais ni des dieux, ni des hommes ; qui ne soit jamais frustré dans ses désirs, qui ne soit blessé de rien, qui n'ait ni envie, ni colère, ni jalousie, qui dans ce corps mortel entretienne un secret commerce avec les dieux, et qui désire dépouiller l'homme pour devenir un dieu.
L. Il n'y a naturellement aucune société entre les hommes ; les dieux ne se mêlent point des choses humaines, et il n'y a d'autre bien que la volupté. - Voilà ce qu'Epicure nous enseigne. - Eh, malheureux ! était-ce la peine de veiller tant de nuits pour écrire ces beaux livres ? Ne valait-il pas mieux te tenir chaudement dans ton lit, et mener la vie d'un ver, puisque c'est la seule dont tu te sois jugé digne ? Selon toi, la piété et la sainteté ne sont que des inventions d'hommes arrogants et de sophistes ; la justice n'est que faiblesse, et la pudeur que folie ; il n'y a plus ni père, ni fils, ni frère, ni citoyen. O l'impudence ! ô l'imposture ! Oreste, agité par les noires Furies, n'était pas plus dément que toi.
LI. Tu veux plaire aux dieux. Souviens-toi donc qu'ils ne haïssent rien tant que l'impureté et que l'injustice.
LII. Ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de vérité connue démentent cette assertion par une prétendue vérité. Car ce qu'ils disent est vrai ou faux : c'est donc une vérité connue.
LIII. Tu viens de t'emporter contre tes valets, de mettre toute ta maison en désordre, et de troubler et de scandaliser tes voisins, et ensuite, prenant l'apparence d'un homme sage, tu viens écouter un philosophe discourir des devoirs de l'homme et de la nature des vertus. Mon ami, tous ces beaux préceptes te sont inutiles. Car comme tu ne viens pas les entendre avec les dispositions nécessaires, tu t'en retourneras comme tu es venu.
LIV. Il n'y a que le sage qui soit capable d'amitié. Comment celui qui ne sait pas connaître ce qui est bon ou mauvais pourrait-il aimer ?
LV. Tu vois jouer ensemble ces petits chiens ; ils se caressent, ils s'accolent, ils se flattent, ils te paraissent bons amis. Jette un petit os au milieu d'eux, et tu verras. Telle est l'amitié des frères, et celle des pères et des enfants. Qu'ils aient à se disputer une terre, un champ, une maîtresse, il n'y a plus ni père, ni frère, ni enfant.
LVI. Il n'y a rien au monde à quoi tout animal soit si attaché qu'à son propre intérêt. Tout ce qui le prive de ce qui lui est utile, soit père, frère, fils, ami, tout lui est insupportable, car il n'aime que son intérêt, qui lui tient lieu de père, de frère, de fils, d'ami, de parent, de patrie et de dieu même.
LVII. Pour aimer, il faut mettre ensemble l'utilité, la sainteté, l'honnêteté, la patrie, les parents, les amis, et la justice même. Que l'on sépare toutes ces choses, il n'y a plus d'amitié, car partout où est le moi et le mien, il faut que l'animal s'y porte. Si le moi se trouve où est l'honnêteté et la justice, je suis bon ami, bon père, bon fils, bon mari. Mais si le moi et le mien sont ici, et l'honnêteté et la justice là, adieu l'amitié, adieu tous les devoirs les plus saints et les plus indispensables.
LVIII. L'esprit du vicieux n'est jamais rassis. Il est toujours inconstant, sans tenue, et flottant au gré de ses opinions. Il est donc incapable d'amitié.
LIX. Veux-tu savoir si ces deux hommes sont amis ? Ne demande point s'ils sont frères, s'ils ont été élevés ensemble, s'ils ont eu les mêmes maîtres et le même précepteur ; cherche seulement où ils placent leur bien. Et si c'est dans les choses qui ne dépendent point de nous, garde-toi bien de dire qu'ils sont amis. Ils ne le sont pas plus qu'ils ne sont fidèles, constants et libres. Mais s'ils le placent dans les choses qui dépendent de nous et dans les saines opinions, ne te mets point en peine s'ils sont père et fils ou frères, ni s'ils se connaissent depuis longtemps, et prononce hardiment qu'ils sont amis. Car l'amitié est-elle ailleurs que là où est la pudeur, la fidélité et la communication de tout ce qui est beau et honnête ?
LX. Amphiaraüs avait vécu longtemps avec sa femme Eriphyle. Ils avaient eu plusieurs enfants. Nulle part un si bon ménage. On offre un collier. Plus de femme, plus de mère.
LXI. C'est être ingrat et timide que de soutenir qu'il n'y a point de différence entre la beauté et la laideur. Quoi ! Thersite sera aussi agréable qu'Achille ? Cette laide femme fera autant de plaisir à voir qu'Hélène ? Cela est grossier et impie. C'est le langage de gens qui ne connaissent pas la nature des choses et qui craignent que, s'ils en sentaient la différence, ils seraient entraînés et vaincus. Ce n'est point en niant la beauté qu'on lui échappe ; on peut la connaître et lui résister.
LXII. S'il y a un art de bien parler, il y a aussi un art de bien entendre.
LXIII. Je ne condamne pas l'éloquence, ni les talents de bien écrire et de bien parler, mais je condamne qu'on leur attribue la première place ; car il y a quelque chose de plus important et de plus considérable.
LXIV. Si tu démontres au méchant qu'il fait ce qu'il ne veut pas et qu'il ne fait pas ce qu'il veut, tu le corrigeras ; mais si tu ne le lui démontres pas, ne te plains point de lui, ne te plains que de toi-même.
LXV. O homme ! ne sois point ingrat des biens que tu as reçus des dieux et n'oublie point leurs plus grands bienfaits. Rends-leur des grâces continuelles de la vue, de l'ouïe qu'ils t'ont données, que dis-je ? de la vie même, et de tous les secours qu'ils t'ont accordés pour la soutenir, comme du vin, de l'huile et de tous les autres fruits de la terre. Mais en même temps, souviens-toi qu'ils t'ont donné quelque chose de plus précieux encore, c'est la faculté qui se sert de toutes ces choses, qui les éprouve et qui met à chacune son prix.
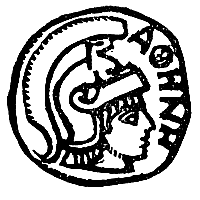 |