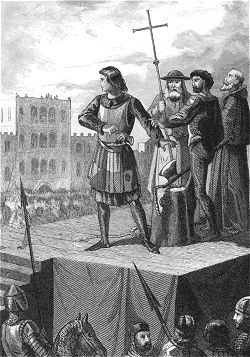Charles d'Anjou
Il y a, à un mille à peu près de Palerme,
sur les bords de l'0rèthe, et près du Campo-Santo
actuel, une petite église qu'on appelle l'église
du Saint-Esprit. Elle n'a rien de remarquable sous le rapport de
l'art, mais elle garde pour les Palermitains un grand souvenir.
C'est à la porte de cette église que
commença le massacre des Vêpres siciliennes. Aussi
n'avions-nous garde de manquer à lui faire notre
visite.
Que ceux qui m'ont suivi dans mes excursions pittoresques
veuillent bien m'accompagner un instant dans cette excursion
historique, la chose en vaut la peine.
Le pape Alexandre IV venait de mourir. La bataille de
Monte-Aperto, au succès de laquelle Manfred avait
concouru en envoyant mille de ses cavaliers en aide aux
gibelins, avait consolidé la puissance impériale
en Italie, et avait placé Manfred à la tête
du parti aristocratique. Urbain IV, en montant sur le
trône pontifical, vit que, s'il voulait rendre à
Rome son ancienne suprématie, c'était Manfred
qu'il fallait frapper.
La chose était d'autant plus facile que Manfred donnait
par sa conduite grande prise à la censure
ecclésiastique. On le soupçonnait d'avoir
accéléré la mort de son père
Frédéric, et, de son frère Conrad. En
outre, au lieu de combattre les Sarrasins partout où il
les rencontrait, comme l'avaient fait ses
prédécesseurs normands, il s'était
allié avec eux, et il avait un corps d'infanterie et de
cavalerie arabe dans son armée.
Urbain IV, de son côté, devait être plus
qu'aucun autre de ses prédécesseurs porté
à soutenir le parti guelfe de tout son pouvoir. Né
à Troyes en Champagne, dans les derniers rangs du peuple,
il avait grandi soutenu par son seul génie. Evêque
de Verdun d'abord, puis patriarche de Jérusalem, il
était revenu en 1261 de la Terre-Sainte, et avait
trouvé le saint-siège vacant. Huit cardinaux,
dernier reste du sacré collège, étaient
réunis en conclave pour élire un successeur
à Alexandre IV, et venaient de passer trois mois à
essayer inutilement de réunir la majorité sur l'un
d'entre eux. Lassé de ces tentatives infructueuses, un
des votants mit sur son billet le nom du patriarche de
Jérusalem. Au scrutin suivant, ce nom réunit la
majorité, et l'élu du sort devint le vicaire de
Dieu sous le nom d'Urbain IV.
Il était temps que l'interrègne cessât ;
des fenêtres du Vatican le nouveau pape pouvait voir les
Sarrasins errants dans la campagne de Rome. Urbain IV non
seulement leur ordonna d'en sortir, mais encore, les traitant
comme leurs frères d'Afrique et de Syrie, il publia une
croisade contre eux. Quelques-uns disent même que, couvert
d'une cuirasse et le visage voilé par un casque, il prit
rang parmi les chevaliers, et, joignant le tranchant du glaive
à la force de la parole il les repoussa de sa main au
delà des frontières du saint-siège.
Mais Urbain n'était pas homme à s'arrêter
là. Manfred apprit en même temps que ses soldats
avaient été repoussés et qu'il était
cité à comparaître devant le pape, pour
rendre compte de ses liaisons avec les Sarrasins, de son
obstination à faire célébrer les saints
mystères dans les lieux interdits, et des
exécutions de deux ou trois de ses sujets,
exécutions que la bulle pontificale qualifiait de
meurtres. Manfred, comme on le pense bien, se rit de cet ordre
et refusa d'obéir.
Alors Urbain IV se tourna vers la France, son pays natal. Le
saint roi Louis régnait. Le pape lui offrit le royaume de
Sicile pour lui ou pour un de ses fils. Mais Louis avait un
coeur d'or ; c'était la loyauté, la noblesse et la
justice faites homme. Tout en révérant les
décisions du saint-père, il lui sembla
instinctivement qu'il n'avait pas le droit de prendre une
couronne posée légitimement sur la tête d'un
autre, et dont à défaut de cet autre son neveu
était héritier. Il exprima des scrupules qu'une
longue lettre d'Urbain IV ne put vaincre. Le pape alors se
tourna vers Charles d'Anjou, frère du roi, et lui envoya
le bref d'investiture.
Charles d'Anjou était une des puissantes organisations
du XIIIe siècle, qui a vu naître tant d'hommes de
fer. Il pouvait avoir à cette époque quarante-huit
ans environ ; c'était le frère puîné
de saint Louis, avec lequel il avait fait la croisade d'Egypte,
et dont il avait partagé la captivité à
Mansourah. Il avait épousé Béatrix, la
quatrième fille de Raimond Béranger, qui avait
marié les trois autres : l'aînée,
Marguerite, à Louis IX, roi de France ; la seconde
Léonor, à Henri III, roi d'Angleterre ; et la
troisième, à Richard, duc de Cornouailles et roi
des Romains. Charles d'Anjou était donc, après les
rois régnants, un des plus puissants princes du monde,
car, comme fils de France, il possédait le duché
d'Anjou, et, comme mari de Béatrix, il avait
hérité de la comté de Provence.
En outre, dit Jean Villani, son historien, c'était un
homme sage et prudent au conseil, preux et fort dans les armes,
sévère et redouté des rois eux-mêmes,
car il avait de hautes pensées qui l'élevaient aux
plus hautes entreprises : car il était
persévérant dans le bonheur et inébranlable
dans l'adversité ; car il était ferme et
fidèle dans ses promesses, parlant peu, agissant
beaucoup, ne riant presque jamais, ne prenant plaisir ni aux
mimes, ni aux troubadours, ni aux courtisans ; décent et
grave comme un religieux, zélé catholique, et apte
à rendre justice. Sa taille était haute et
nerveuse, son teint olivâtre, son regard terrible. Il
paraissait fait plus qu'aucun autre seigneur pour la
majesté royale, demeurait douze ou quinze heures à
cheval, couvert de son harnais de guerre, sans paraître
fatigué, ne dormait presque point, et s'éveillait
toujours prêt au conseil ou au combat. Voilà
l'homme sur lequel Urbain IV, dans son instinct de haine contre
les Gibelins, avait jeté les yeux. Simon, cardinal de
Sainte-Cécile, partit pour la France, et, au nom du pape,
lui remit le bref d'investiture.
Charles d'Anjou tenait ce bref à la main, lorsqu'en
rentrant chez lui, il trouva sa femme en pleurs ; cette douleur
l'étonna d'autant plus que Béatrix avait
près d'elle, à cette époque, les deux
soeurs qu'elle aimait le plus, Marguerite et Léonor. En
apercevant son mari, qu'elle n'attendait point, elle essaya de
cacher ses larmes : mais ce fut inutilement. Charles lui demanda
ce qu'elle avait ; au lieu de lui répondre,
Béatrix éclata en sanglots. Charles insista plus
fortement encore, et alors Béatrix lui raconta que
quelques minutes auparavant elle avait été faire
une visite à ses deux soeurs, et qu'après les
avoir embrassées, elle avait voulu s'asseoir
auprès d'elles sur un fauteuil pareil au leur, mais
qu'alors la reine d'Angleterre lui avait tiré ce fauteuil
des mains et lui avait dit : - Vous ne pouvez vous asseoir sur
un siège pareil au nôtre ; prenez donc un tabouret
ou tout au plus une chaise, car ma soeur est reine de France, et
moi je suis reine d'Angleterre : tandis que vous n'êtes,
vous, que duchesse d'Anjou et comtesse de Provence.
Charles d'Anjou laissa errer sur ses lèvres un de ces
sourires rares et amers qui assombrissaient son visage au lieu
de l'éclairer : et, ayant embrassé Béatrix,
il lui dit :
- Allez retrouver vos soeurs, asseyez-vous sur un siège
pareil à leurs sièges : car si elles sont reines
de France et d'Angleterre, vous êtes, vous, reine de
Naples et de Sicile.
Mais ce n'était pas le tout que de prendre un vain titre
: il fallait en réalité conquérir le
trône auquel ce titre était attaché. Charles
leva un impôt sur ses vassaux d'Anjou et de Provence,
Béatrix vendit tous ses bijoux, à l'exception de
son anneau de mariage. Saint-Louis lui-même,
désireux de voir son frère occuper ailleurs qu'en
France son esprit actif et entreprenant, vint à son aide
; et Charles, grâce à tous ces moyens
réunis, aux promesses qu'il fit, et dont son honneur et
son courage étaient les garants, parvint à
réunir une armée de cinq mille chevaux, quinze
mille fantassins et dix mille arbalétriers. Mais, dans la
hâte qu'il avait d'arriver à Rome et de remplir
dans la ville pontificale l'office de sénateur, qui lui
avait été déféré, il prit
avec lui mille chevaliers seulement, s'embarqua sur une petite
flotte de vingt galères qu'il tenait prête et fit
voile pour Ostie, laissant la conduite de son armée
à Robert de Béthune, son gendre.
Manfred plaça à l'embouchure du Tibre le comte
Guido Novello, qui commandait pour lui en Toscane. Le comte
Guido Novello qui gouvernait les galères réunies
de Pise et de Sicile, avait une flotte triple de celle de
Charles d'Anjou mais Dieu avait décidé que Charles
d'Anjou serait roi. Il ouvrit la main et en laissa tomber la
tempête ; la tempête faillit jeter la flotte de
Charles d'Anjou sur les côtes de Toscane, mais elle
éloigna celle de Guido Novello des côtes romaines.
Charles d'Anjou poussa en avant avec son vaisseau, aborda seul
à Ostie ; puis, se jetant sur une barque avec cinq ou six
chevaliers seulement, il remonta le Tibre et vint loger au
couvent de Saint-Paul-hors-les-murs, bien plus comme un fugitif
que comme un conquérant.
Pendant ce temps, Urbain IV était mort ; mais,
poursuivant son projet au delà de sa vie, il avait, avant
de mourir, créé une vingtaine de cardinaux
auxquels il avait fait jurer de lui donner pour successeur le
cardinal de Narbonne, Français comme lui, et de plus
sujet immédiat de Charles d'Anjou. Les cardinaux avaient
tenu parole, et Guido Fulco, élu presque à
l'unanimité pendant le temps même qu'il
était en mission près de Charles, était
monté sur le trône pontifical en prenant le nom de
Clément IV.
Charles avait donc la certitude d'être bien reçu
à Rome ; seulement, il n'y voulait faire son
entrée qu'avec une suite digne d'un prince tel que lui.
Il resta donc au couvent de Saint-Paul-hors-les-murs, au risque
d'être enlevé par quelque parti de Gibelins,
jusqu'au moment où les galères qu'il avait perdues
dans la mer de Toscane arrivèrent à leur tour
à Ostie. Charles assembla aussitôt ses chevaliers,
et le 24 mai 1265, il fit son entrée dans la capitale du
monde chrétien avec le titre solennel de défenseur
de l'Eglise.
Pendant ce temps, le reste de l'armée passait les Alpes,
descendait dans le Piémont, traversait le Milanais,
évitait Florence la gibeline, gagnait Ferrare, et, se
recrutant partout des Guelfes qu'elle rencontrait sur son
chemin, arrivait devant Rome dans les derniers jours de
l'année 1265.
Il était temps. Tous les sacrifices avaient
été faits pour l'amener là : Charles
d'Anjou et le pape y avaient épuisé leurs
trésors ; tous deux manquaient d'argent : il n'y avait
donc pas une minute à perdre, il fallait marcher à
l'ennemi, et payer les soldats par une victoire.
Charles d'Anjou ne voulut pas même attendre le retour du
printemps : il se mit à la tête de son
armée, et, dans les premiers jours de février, il
s'avança vers Naples par la route de Ferentino.
En arrivant à Ceperano, les Français
aperçurent les avant-postes ennemis, commandés par
le comte de Caserte, beau-frère de Manfred : il
défendait un passage du Garigliano, admirablement
fortifié par la nature. Les Français
examinèrent la position et reconnurent sa
supériorité ; décidés toutefois
à traverser le fleuve, ils n'en marchèrent pas
moins à l'ennemi ; mais l'ennemi ne les attendit pas, et
à leur grand étonnement leur livra le passage.
Alors Charles d'Anjou reconnut qu'il y avait folie ou trahison
parmi les lieutenans de Manfred, et en remercia Dieu tout haut.
Le fleuve fut donc franchi sans que l'on frappât un cour
de lance. et l'on avança vers les deux forteresses de
Rocce et de San-Germano ; celles-ci n'étaient point
défendues pat des Napolitains, mais par des Arabes ;
aussi la lutte fut-elle longue et sanglante. Enfin toutes deux
furent escaladées, et comme les Sarrasins qui les
défendaient ne purent pas fuir et
dédaignèrent de se rendre, ils furent
massacrés jusqu'au dernier.
A la nouvelle de ces deux succès si inattendus, le
découragement se mit parmi les Apuliens. Aquino ouvrit
ses portes, les gorges d'Alifes furent livrées, et
Charles et ses soldats débouchèrent dans les
plaines de Bénévent, où les attendaient
Manfred et son armée.
On peut dire, sans exagération aucune, que l'Europe tout
entière avait les yeux fixés sur ce petit coin de
terre, où allait se décider la grande question
guelfe et gibeline, qui séparait l'Italie et l'Allemagne
depuis un siècle et demi ; c'étaient le pape et
l'empereur aux mains dans la personne de leurs lieutenants, et
ces lieutenants étaient, non seulement deux des plus
grands princes, mais encore deux des plus braves capitaines qui
fussent an monde.
Aussi ni l'un ni l'autre ne faillirent à leur
renommée ni à leur destin. Charles d'Anjou, en
apercevant les soldats de Manfred, se retourna vers ses
chevaliers et dit : - Comtes, barons, chevaliers et hommes
d'armes, voici le jour que nous avons tant désiré
: donc, au nom de Dieu et de notre saint-père le pape, en
avant !
Et alors il fit quatre brigades de sa cavalerie ; la
première, qui était de mille chevaliers
français commandés par Guy de Montfort et le
maréchal de Mirepoix ; la seconde, qui était de
neuf cents chevaliers provençaux et des auxiliaires
romains, qu'il se réserva de mener lui-même ; la
troisième, qui était de sept cents chevaliers
flamands, brabançons et picards, et qui fut mise sous les
ordres de Robert de Flandre et de Gilles Lebrun,
connétable de France ; enfin la quatrième, qui se
composait de quatre cents émigrés florentins,
vieux débris de Monte-Aperto, et que conduisait Guido
Guerra, cet éternel ennemi des Gibelins.
Lorsque Manfred aperçut de son côté les
troupes françaises, il s'arma, à l'exception de
son casque, dont il attacha lui-même le cimier, qui
était un aigle d'argent, afin de n'avoir plus qu'à
le mettre sur sa tête ; puis, montant à cheval, il
s'avança au milieu de ses capitaines en disant : - Comtes
et barons, c'est ici qu'il me faut vaincre en roi ou mourir en
chevalier, quoique ce ne soit pas l'avis de quelques-uns de
vous, je le sais ; je ne ferai donc pas un pas pour
éviter la bataille. Appareillez-vous sans plus tarder,
car voici les Français qui viennent à nous !
Et au même instant il disposa son armée en trois
brigades : la première de douze cents chevaux allemands
commandés par le comte Giordano Lancia, et la
troisième de quatorze cents chevaux apuliens et
sarrasins, dont il se réserva le commandement pour
lui-même. - On voit que, pour l'un et l'autre parti, les
historiens ne font aucun compte de l'infanterie. - Le fleuve
Calore, qui coule devant Bénévent, séparait
les deux armées.
Au moment où Manfred prit ses dispositions pour soutenir
la bataille et où il devint évident pour les
Français qu'ils allaient en venir aux mains avec leurs
ennemis, le légat du pape monta sur un bouclier que
quatre hommes élevèrent sur leurs épaules ;
puis il bénit Charles d'Anjou et ses chevaliers, donnant
à chacun l'absolution de ses péchés ; et
tous la reçurent à genoux, comme devaient le faire
des soldats du Christ et des défenseurs de
l'Eglise.
Les Français s'avancèrent vers la rivière
avec lenteur et précaution, car ils ignoraient par quel
moyen ils pourraient la franchir, lorsqu'ils virent les archers
sarrasins qui leur en épargnaient la peine en la
traversant eux-mêmes et en venant au-devant d'eux. Ces
archers sarrasins passaient, avec les anglais, pour les plus
adroits tireurs de la terre, et ils étaient bien
autrement légers et rapides que ceux-ci. Aussi
l'infanterie française, mal armée, sans cuirasses,
et ayant à peine quelques jaques rembourrées ou
quelques casques en cuir, ne put-elle tenir contre la
nuée de flèches que les voltigeurs arabes firent
pleuvoir sur elle, et se retira-t-elle en désordre. Alors
Guy de Montfort et le marechal de Mirepoix, craignant que cet
échec n'ébranlât la confiance du reste de
l'armée, fondirent sur les archers avec la
première brigade, en criant : Montjoie, chevaliers ! Les
archers n'essayèrent pas même de résister
à cette avalanche de fer qui roulait sur eux ; ils se
dispersèrent dans la pleine, fuyant, mais tirant
toujours. Les chevaliers français, ardents à leur
poursuite, commencèrent à se débander ;
alors le comte Galvano, qui commandait la première
brigade, pensant que le moment était venu de charger
cette troupe en désordre, leva sa lance en criant :
Souabe, Souabe, chevaliers ! et descendant à son tour
dans la plaine, vint donner dans le flanc de la brigade
française, qu'il coupa presque en deux. Mais
aussitôt le comte de Galvano se vit chargé
lui-même par Guide Guerra et ses Guelfes ; en même
temps le cri : Aux chevaux, aux chevaux ! circula dans les
brigades française et florentine. Les chevaliers de
Charles d'Anjou commencèrent à frapper les animaux
au lieu de frapper les hommes : les chevaux, moins bien
armés que les cavaliers, se renversèrent les uns
sur les autres ; le trouble commença de se mettre parmi
les cavaliers allemands. La seconde brigade de Manfred,
commandée par le comte Giordano Lancia, et
composée de Toscans et de Lombards, vint à leur
secours : mais leur charge, mal dirigée. rencontra les
Allemands qui commençaient à fuir, et, au lieu de
rétablir le combat, ne fit qu'augmenter le
désordre. En ce moment, Charles d'Anjou fit passer
l'ordre à sa troisième brigade de donner. Les
Allemands, les Lombards et les Toscans de Manfred se
trouvèrent presque enveloppés : au milieu de tout
cela, on reconnaissait les Guelfes, qui, ayant à venger
la défaite de Monte-Aperto, faisaient merveille et
frappaient les plus rudes coups. Les archers sarrasins
étaient devenus inutiles, car la mêlée
était telle que leurs flèches tombaient
également sur les Allemands et sur les Français.
Manfred pensa qu'il ne fallait rien moins que sa présence
et celle des douze cents hommes de troupes fraîches qu'il
s'était réservés pour rétablir la
bataille, et ordonna à ses capitaines de se
préparer à le suivre. Mais, au lieu de le
seconder, les barons de la Pouille, le grand-trésorier
comte de la Cerra et le comte de Caserte tournèrent bride
et s'enfuirent, entraînant avec eux neuf cents hommes
à peu près. C'est alors que Manfred vit que
l'heure était venue, non plus de vaincre en roi, mais de
mourir en chevalier : ayant regardé autour de lui, et
voyant qu'il lui restait encore environ trois cents lances, il
prit son casque des mains de son écuyer ; mais, au moment
où il le posait sur sa tête, l'aigle d'argent qui
en formait le cimier tomba sur l'arçon de sa selle. -
C'est un signe de Dieu, murmura Manfred ; j'avais attaché
ce cimier de mes propres mains, et ce n'est point le hasard qui
le détache. N'importe ! en avant, Souabe, chevaliers ! -
Et, abaissant sa visière et mettant sa lance en
arrêt, il alla donner dans le plus épais de
l'armée française, où il disparut, n'ayant
plus rien qui le distinguât des autres hommes d'armes.
Bientôt la lutte s'affaiblit de la part des Allemands. Les
Toscans et les Lombards lâchèrent pied ; Charles
d'Anjou, avec ses neuf cents chevaliers provençaux, se
rua sur ceux qui tenaient encore ; les Gibelins, sans chef, sans
ordres, appelant Manfred qui ne répondait pas, prirent la
fuite ; les vainqueurs les poursuivirent pêle-mêle
et traversèrent Bénévent avec eux. Nul
n'essaya de rallier les vaincus, et en un seul jour, en une
seule bataille, en cinq heures à peine, la couronne de
Naples et de Sicile échappa aux mains de la maison de
Souabe et roula aux pieds de Charles d'Anjou.
Les Français ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils
furent las de tuer. Leur perte avait été grande,
mais celle des Gibelins fut terrible. Pierre des Uberti et
Giordano Lancia furent pris vivants ; la soeur de Manfred, sa
femme Sibylle et ses enfants, furent livrés et s'en
allèrent mourir dans les cachots de la Provence ; enfin
cette belle armée, si pleine de courage et d'espoir le
matin, semblait s'être évanouie comme une vapeur,
et il n'en restait que les cadavres couchés sur le champ
de bataille.
Pendant trois jours on chercha Manfred, car la victoire de
Charles d'Anjou était incomplète si l'on ne
retrouvait Manfred mort ou vif. Pendant trois jours on examina
un à un les chevaliers qui avaient été
tués ; enfin un valet allemand le reconnut, mit son
cadavre en travers sur un âne, et l'amena à
Bénévent, dans la maison qu'habitait Charles ;
mais, comme Charles ne connaissait pas Manfred, et craignait
qu'on ne le trompât, il ordonna de coucher ce cadavre tout
nu au milieu d'une grande salle, puis il appela près de
lui Giordano Lancia. Pendant qu'on obéissait à son
ordre, Charles tira une chaise près du cadavre et s'assit
pour le regarder ; il avait deux larges et profondes blessures,
l'une à la gorge et l'autre au côté droit de
la poitrine, et des meurtrissures par tout le corps, ce qui
indiquait qu'il avait reçu un grand nombre de coups avant
de tomber.
Pendant l'examen que faisait Charles de ce corps tout
mutilé, la porte s'ouvrit, et Giordano Lancia parut. A
peine eut-il jeté un coup d'oeil sur le cadavre,
quoiqu'il eût le visage couvert de sang, qu'il
s'écria en se frappant le front : - O mon maître !
mon maître ! que sommes-nous devenus! Charles d'Anjou n'en
demanda point davantage, il savait tout ce qu'il désirait
savoir : ce cadavre était bien celui de Manfred.
Alors les chevaliers français qui avaient
été querir Giordano Lancia, et qui étaient
entrés derrière lui, demandèrent à
Charles d'Anjou de faire au moins enterrer en terre sainte celui
qui trois jours auparavant était encore roi de deux
royaumes. Mais Charles répondit : - Ainsi ferais-je
volontiers ; mais, comme il est excommunié, je ne le
puis. Les chevaliers courbèrent la tête, car ce que
disait Charles était vrai, et la malédiction
pontificale poursuivait l'excommunié jusqu'au delà
de la mort. On se contenta donc de lui creuser une fosse au pied
du pont de Bénévent, et de rejeter la terre sur
lui, sans mettre sur cette tombe isolée aucune marque de
ce qu'avait été celui qu'elle renfermait.
Cependant, les vainqueurs ne pouvant souffrir que le lieu
où reposait un si grand capitaine restât
ignoré, chaque soldat prit une pierre, et alla la
déposer sur sa fosse ; mais le légat ne voulut pas
même permettre que les restes de Manfred reposassent sous
ce monument élevé par la pitié de ses
ennemis : il fit exhumer le cadavre, et, ayant ordonné
qu'on le portât hors des Etats romains, le fit jeter sur
les bords de la rivière Verte, où il fut
dévoré par les corbeaux et par les animaux de
proie.
Avec Charles d'Anjou, le pape, et par conséquent les
Guelfes, triomphaient par toutel'Italie ; c'était
à Florence qu'était pour le moment la puissance
gibeline. Une révolte qui s'éleva le jour
même où l'on apprit la bataille de
Bénévent la renversa ; puis, pour ne lui laisser
ni le temps, ni les moyens de se reconnaître, Charles
d'Anjou envoya un de ses lieutenants en Sicile et marcha sur
Florence.
Florence lui ouvrit ses portes, comme elle devait le faire deux
cents ans plus tard à Charles VIII ; Florence lui donna
des fêtes ; Florence le conduisit voir, en grande pompe,
son tableau de la Madone, que venait d'achever Cimabué.
Pendant ce temps les capitaines français se partageaient
le royaume, et les soldats pillaient les villes ; cette
conduite, qui devait dépopulariser promptement le nouveau
roi, rendit quelque espoir aux Gibelins : ils tournèrent
les yeux vers l'Allemagne ; là était la seule
étoile qui brillât dans le ciel. Conradin, fils de
Conrad, petit-fils de Frédéric, neveu de Manfred,
élevé à la cour de son aïeul le duc de
Bavière, venait d'atteindre sa seizième
année. C'était un jeune homme plein d'âme et
de coeur, qui n'attendait que le moment de régner ou de
mourir : il bondit de joie et d'espérance lorsque les
messagers des Gibelins lui annoncèrent que ce moment
était venu.
Sa mère, Elisabeth, l'avait élevé pour le
trône ; c'était une femme au noble coeur et
à la puissante pensée : elle vit avec douleur
arriver ces messagers ; mais, loin de mettre son amour maternel
entre eux et son fils, elle laissa les hommes décider de
ces choses souveraines dont les hommes seuls doivent être
les arbitres.
Il fut décidé que Conradin marcherait à la
tête des Gibelins, et, soutenu par l'empereur, tenterait
de reconquérir le royaume de ses pères.
Toute la noblesse d'Allemagne accourut autour de Conradin.
Frédéric, duc d'Autriche, orphelin comme lui,
dépouillé de ses Etats comme lui, jeune et
courageux comme lui, s'offrit pour être son second dans ce
terrible duel. Conradin accepta. Les deux jeunes gens
jurèrent que rien ne les pourrait séparer, pas
même la mort, se mirent à la tête de dix
mille hommes de cavalerie, rassemblés par les soins de
l'empereur, du duc de Bavière et du comte de Tyrol, et
arrivèrent à Vérone vers la fin de
l'année 1267.
Charles d'Anjou avait d'abord l'intention de fermer le passage
de Rome à son jeune rival, et de l'attendre entre Lucques
et Pise, appuyé de toute la puissance des Guelfes de
Florence. Mais les exactions de ses ministres, les violences de
ses capitaines et le pillage de ses soldats, avaient
excité une révolte dans ses nouveaux Etats. Il
avait bien écrit à Clément IV de l'aider de
sa parole et de son trésor ; mais Clément,
indigné lui-même de ce qui se passait presque sous
ses yeux, lui avait répondu :
«Si ton royaume est cruellement spolié par tes
ministres, c'est à toi seul qu'on doit s'en prendre,
puisque tu as conféré tous les emplois à
des brigands et à des assassins, qui commettent dans tes
Etats des actions dont Dieu ne peut supporter la vue. Ces hommes
infâmes ne craignent pas de se souiller par des viols, des
adultères, d'injustes exactions, et toutes sortes de
brigandages. Tu cherches à m'attendrir sur ta
pauvreté ; mais comment puis-je y croire ? Eh quoi ! tu
peux ou tu ne sais pas vivre avec les revenus d'un royaume dont
l'abondance fournissait à un souverain tel que
Frédéric, déjà empereur des Romains,
de quoi satisfaire à des dépenses plus grandes que
les tiennes, de quoi rassasier l'avidité de la Lombardie,
de la Toscane, des deux Marches et de l'Allemagne
entière, et qui lui donnait en outre les moyens
d'accumuler d'immenses richesses !»
Force avait donc été à Charles d'Anjou de
revenir à Naples et d'abandonner le pape, qui
l'abandonnait. Quant à la révolte, à peine
de retour dans sa capitale, il l'avait prise corps à
corps, et l'avait vite étouffée entre ses bras de
fer.
Clément IV, qui ne pouvait pas compter sur Rome, mal
fortifiée et incapable de soutenir un siège, se
retira à Viterbe. De là il envoya trois fois
à Conradin l'ordre de licencier son armée et de
venir pieds nus recevoir, aux genoux du prince des
apôtres, la sentence qu'il lui plairait de porter contre
lui. Mais le fier jeune homme, tout enivré des
acclamations qui l'avaient accueilli à Pise, et qui de
Pise le suivaient juqu'à Sienne, n'avait pas même
daigné répondre aux lettres du saint-père,
et Clément, le jour de Pâques, avait
prononcé la sentence d'excommunication contre lui et ses
partisans, qui le déclarait déchu du titre de roi
de Jérusalem, le seul que lui eût laissé son
oncle Manfred en le dépouillant de ses Etats, et qui
déliait ses vassaux de leur serment de
fidélité.
Quelques jours après, on vint annoncer à
Clément IV que Conradin venait de battre à
Pontavalle Guillaume de Béselve, maréchal de
Charles. Clérnent était en prière ; il
releva la tête, et se contenta de prononcer ces mois
:
- Les efforts de l'impie se dissiperont en fumée.
Le surlendemain, on vint dire au pape que l'armée
gibeline était en vue de la ville. Le pape monta sur les
remparts, et de là il vit Conradin et
Frédéric qui, n'osant pas l'attaquer, faisaient du
moins passer orgueilleusement leurs dix mille hommes sous ses
yeux. Un des cardinaux, effrayé de voir tant de braves
hommes d'armes de fière mine, s'écria alors : O
mon Dieu! quelle puissante armée !
- Ce n'est point une armée, répondit
Clément IV ; c'est un troupeau que l'on mène au
sacrifice.
Clément parlait au nom du Seigneur, et le Seigneur
devait ratifier ce qu'il avait dit.
Comme l'avait prévu Clément, Rome ne fit aucune
résistance ; le sénateur Henri de Castille vint
ouvrir la porte de ses propres mains. Conradin s'arrêta
huit jours dans la capitale du monde chrétien pour y
faire reposer son armée et retrouver les trésors
que son approche avait fait enfouir dans les églises ;
puis, à la tête de cinq mille gens d'armes, il
passa sous Tivoli, traversa le val de Celle et entra dans la
plaine de Tagliacozzo. C'était là que l'attendait
Charles d'Anjou.
Malgré le besoin que le prince français aurait eu
en pareille occasion de toutes ses bonnes lances, il n'avait pu
les réunir autour de lui, forcé qu'il avait
été de mettre des garnisons dans toutes les villes
de Calabre et de Sicile ; mais il avait tourné les yeux
vers un allié tout naturel : c'était Guillaume de
Villehardoin, prince de Morée ; il lui avait donc
écrit pour lui demander du secours, et Villehardoin,
traversant l'Adriatique, était accouru avec trois cents
hommes.
Villehardoin était près de Charles d'Anjou, avec
son grand connétable Jadie, et messire Jean de Tournay,
seigneur de Calavrita, lorsqu'on commença d'apercevoir
l'armée de Conradin. Vêtu d'un costume
léger, moitié grec moitié français,
montant un de ces rapides coursiers d'Elide dont Homère
vante la vélocité, il demanda à Charles
d'Anjou la permission de partir en éclaireur, pour
reconnaître l'armée allemande ; cette permission
accordée, Guillaume de Villehardoin lâcha la bride
à son cheval, et, suivi de deux des siens, il alla se
mettre en observation sur un monticule d'où il dominait
toute la plaine.
L'armée de Conradin était d'un tiers plus forte
à peu près que celle du duc d'Anjou, et toute
composée des meilleurs chevaliers d'Allemagne. Guillaume
revint donc trouver Charles avec un visage sérieux, car,
si brave prince qu'il fût, il ne se dissimulait pas toute
la gravité de la position.
Le roi causait avec un vieux chevalier français, plein
de sens et de courage, bon au conseil, bon au combat ;
c'était le sire de Saint-Valery : le sire de
Saint-Valery, tout éloigné qu'il était
resté des Allemands, n'avait pas moins remarqué la
supériorité de leur nombre, et il essayait de
calmer l'ardeur du roi, qui, sans rien calculer, voulait s'en
remettre à Dieu et marcher droit à l'ennemi,
lorsque, comme nous l'avons dit, Guillaume de Villehardoin
arriva.
Aux premiers mots que prononça le prince, Saint-Valery
vit que c'était un renfort qui lui arrivait, et insista
davantage encore pour que Charles d'Anjou se laissât
guider par leurs deux avis. Charles d'Anjou alors s'en remit
à eux, et Guillaume de Villehardoin et Allard de
Saint-Valery arrêtèrent le plan de bataille, qui
fut communiqué au roi, et adopté par lui à
l'instant même.
On forma trois corps de cavalerie légère,
composés de Provençaux, de Toscans, de Lombards et
de Campaniens ; on donna à chaque corps un chef parlant
sa lange et connu de lui, puis on mit ces trois chefs sous le
commandement de Henri de Cosenze, qui était de la taille
du roi, et qui lui ressemblait de visage ; en outre, Henri
revêtit la cuirasse de Charles d'Anjou et ses ornements
royaux, afin d'attirer sur lui tout l'effort des
Allemands.
Ces trois corps devaient engager la bataille, puis, la bataille
engagée, paraitre plier d'abord et fuir ensuite à
travers les tentes que l'on laisserait tendues et ouvertes, afin
que les Allemands ne perdissent rien des richesses qu'elles
contenaient. Selon toute probabilité, à 1a vue de
ces richesses, les vainqueurs cesseraient de poursuivre les
ennemis et se mettraient à piller. En ce moment, les
trois brigades devaient se rallier, sonner de la trompette, et
à ce signal Charles d'Anjou, avec six cents hommes, et
Guillaume de Villehardoin avec trois cents, devaient prendre en
flanc leurs ennemis et décider de la
journée.
De son côté, Conradin divisa son armée en
trois corps, afin que le mélange des races n'amenât
point de ces querelles si fatales un jour de combat ; il donna
les Italiens à Galvano de Lancia, frère de cet
autre Lancia qui avait été fait prisonnier
à la bataille de Bénévent ; les Espagnols
à Henri de Castille, le même qui avait ouvert les
portes de Rome ; enfin, il prit pour lui et
Frédéric les Allemands, qui l'avaient suivi du
fond de l'empire.
Ces dispositions prises de chaque côté, Charles
jugea que le moment était venu de les mettre à
exécution ; il renouvela à Henri de Cosenze et
à ses trois lieutenans les instructions qu'il leur avait
déjà données, et cette poignée
d'hommes, qui pouvait monter à deux mille cinq cents
cavaliers, s'avança au-devant de Conradin.
Les chefs de l'armée impériale, voyant au premier
rang l'étendard de Charles d'Anjou, et croyant le
reconnaître lui-même à ses ornements royaux
et à son armure dorée, ne doutèrent point
qu'ils n'eussent en face d'eux toute l'armée guelfe. Or,
comme il était facile de voir qu'elle était de
moitié moins nombreuse que l'armée gibeline, leur
courage s'en augmenta ; et Conradin ayant fait entendre le cri
de Souabe, chevaliers ! mit sa lance en arrêt, et
chargea le premier sur les Provençaux, les Lombards et
les Toscans.
Le choc fut rude ; on avait dit aux chefs de ne tenir que le
temps suffisant pour faire croire aux impériaux à
une victoire sérieuse ; mais, quand tant de braves
chevaliers se virent aux mains, ils eurent honte de lâcher
pied, même pour faire tomber leurs ennemis dans une
embuscade ; ils se défendirent donc avec tant
d'acharnement, que Charles d'Anjou, ne comprenant rien à
la non-exécution de ses ordres, quitta le petit vallon
où il était caché avec ses six cents
hommes, et monta sur une colline pour voir ce qui se
passait.
La lutte était terrible ; tous les efforts des
impériaux s'étaient concentrés sur le point
où ils avaient cru reconnaître le roi ; Henri de
Cosenze avait été entouré, et craignant,
s'il se rendait, qu'on ne reconnût qu'il n'était
pas le vrai roi, il voulait se faire tuer. De leur
côté, ses lieutenants et ses soldats ne voulaient
point l'abandonner, et au lieu de fuir tenaient ferme. En les
voyant entourés ainsi et lutter si courageusement contre
des forces doubles des leurs, Charles d'Anjou voulait abandonner
le plan de bataille et courir à leur secours ; mais
Allard de Saint-Valery le retint. En ce moment Henri de Cosenze
tomba percé de coups, et les autres lieutenants, perdant
l'espoir de le sauver, donnèrent l'ordre de la retraite,
qui bientôt se changea en déroute.
Alors ce qui avait été prévu arriva, les
soldats de Charles d'Anjou et ceux de Conradin se
jetèrent pêle-mêle à travers le camp,
les uns fuyant, les autres poursuivant ; mais à peine les
impériaux eurent-ils vu les tentes ouvertes,
qu'attirés par les étoffes précieuses, par
les vases d'argent, par les armures splendides qu'elles
renfermaient, croyant d'ailleurs Charles d'Anjou tué et
son armée dispersée, ils rompirent leurs rangs et
se mirent à piller. Vainement les deux jeunes gens
firent-ils tous leurs efforts pour les maintenir ; leur voix ne
fut point entendue, ou ceux qui l'entendirent ne
l'écoutèrent point, et à peine si de leurs
cinq mille hommes d'armes, il en resta autour d'eux cinq cents
avec lesquels ils continuèrent de poursuivre les fugitifs
; tous les autres s'arrêtèrent, et, rompant
l'ordonnance, s'éparpillèrent par la plaine.
C'était le moment si impatiemment attendu par Charles
d'Anjou. Avant même que les fuyards donnassent, en sonnant
de la trompette, le signal convenu, il se dressa sur ses
arçons, et criant : Montjoie ! Montjoie, chevaliers
! il vint donner avec ses six cents hommes de troupes
fraîches au milieu des pillards, qui étaient si
loin de s'attendre à cette surprise, que, le prenant pour
un détachement des leurs qui rejoignait le corps
d'armée, ils ne se mirent pas même en
défense. De son côté Villehardoin arrivait
comme la foudre ; en même temps on entendit la trompette
des troupes légères : l'armée de Conradin
était prise entre trois murailles de fer.
Avant que les Allemands eussent reconnu le piège dans
lequel ils venaient de tomber, ils étaient perdus ; aussi
n'essayèrent-ils pas même de résister, et
commencèrent-ils à fuir par toutes les ouvertures
que leur présentaient entre elles les trois batailles de
leurs ennemis. Conradin voulait se taire tuer sur la place ;
mais Frédéric et Galvano Lancia prirent chacun son
cheval par la bride et l'emmenèrent au galop,
malgré ses efforts pour se débarrasser
d'eux.
Ils firent quarante-cinq milles ainsi, ne s'arrêtant
qu'une seule fois peur faire manger leurs chevaux : enfin ils
arrivèrent à Astur, villa située à
un mille de la mer. Là, ils furent reconnus pour des
Allemands par des gens du seigneur de Frangipani, à qui
appartenait cette villa, et qui allèrent prévenir
leur maître que cinq ou six hommes, couverts de sang et de
poussière, avaient mis pied à terre et venaient de
faire prix avec un pêcheur pour les conduire en Sicile :
le départ était fixé à la nuit
suivante.
Le seigneur de Frangipani, après quelques questions sur
la manière dont les Allemands étaient vêtus,
ayant appris qu'ils étaient couverts de cuirasses
dorées et portaient des couronnes sur leurs casques, ne
douta plus que ce ne fussent d'illustres fugitifs ; il fut
encore confirmé dans cette idée lorsqu'il apprit
dans la journée que Conradin avait été
battu par Charles d'Anjou. Alors, l'idée lui vint que
l'un de ces fugitifs était peut-être le
prétendant lui-même, et il comprit que, si cela
était ainsi, et s'il pouvait le livrer à Charles
d'Anjou, celui-ci lui paierait son ennemi mortel au poids de
l'or.
En conséquence, s'étant informé à
quelle heure les fugitifs devaient s'embarquer, il fit
préparer une barque du double plus grande que celle qui
leur était destinée, y fit coucher une vingtaine
d'hommes d'armes, s'y rendit lui-même lorsque la nuit
commença de tomber, et, caché dans une petite
crique, il attendit que le pécheur mît à la
voile : à peine y fut-il, qu'il appareilla à son
tour, et, comme sa barque était de moitié plus
grande que celle qu'il poursuivait, il l'eut bientôt
rejointe et même dépassée. Alors il se mit
en travers, et, coupant le chemin aux fugitifs, il leur ordonna
de se rendre. Conradin essaya de se mettre en défense,
mais il n'avait que quatre hommes avec lui, et le seigneur de
Frangipani en avait vingt ; il fallut donc céder au
nombre, et les deux jeunes gens furent ramenés
prisonniers, avec leur suite, à la tour d'Astur.
Le seigneur de Frangipani ne s'était pas trompé :
il reçut de Charles d'Anjou la seigneurie de Pilosa,
située entre Naples et Bénévent, et livra,
en échange, ses prisonniers au roi de Sicile.
Une fois maître du dernier rival qu'il crût devoir
craindre, Charles d'Anjou hésita entre la mort et une
prison éternelle : la mort était plus sûre,
mais aussi c'était un exemple bien terrible à
donner au monde, que de faire tomber la tête d'un jeune
roi de dix-sept ans sous la hache du bourreau. Il crut alors
devoir en référer au pape, et lui fit demander
conseil.
L'inflexible Clément 1V se contenta de répondre
cette seule ligne, terrible par son laconisme même :
Vita Corradini, mors Caroli. - Mors Corradini, vita
Caroli.
Dès lors Charles n'hésita plus : un crime
autorisé par le pape cessait d'être un crime et
devenait un acte de justice. Il convoqua donc un tribunal : ce
tribunal se composait de deux députés de chacune
des deux villes de la Terre de Labour et de la
Principauté. Conradin fut amené devant ce
tribunal, sous l'accusation de s'être
révolté contre son souverain légitime,
d'avoir méprisé l'excommunication de l'Eglise, de
s'être allié avec les Sarrasins, d'avoir
pillé les couvents et les églises de Rome.
Une seule voix osa s'élever en faveur de Conradin :
celui qui donna cette preuve de courage s'appelait Guido de
Lucaria ; un seul homme se présenta pour lire la sentence
: l'histoire n'a pas conservé le nom de celui qui donna
cette preuve de lâcheté. Seulement, Villani raconte
que ce juge avait à peine fini la lecture
régicide, que Robert, comte de Flandre, propre gendre de
Charles d'Anjou, se leva et, tirant son estoc, lui en donna un
coup à travers la poitrine en s'écriant :
- Tiens, voici pour t'apprendre à oser condamner
à mort un aussi noble et si gentil seigneur.
Le juge tomba, en jetant un cri, et expira presque au
même instant. Et il n'en fut pas autre chose de ce
meurtre, ajoute Villani, le roi et toute sa cour ayant reconnu
que Robert de Flandre venait de se conduire en vaillant
seigneur.
Conradin n'était pas présent lorsque
l'arrêt fut prononcé ; on descendit alors dans sa
prison, et on le trouva jouant eux échecs avec
Frédéric.
Les deux jeunes gens, sans se lever, écoutèrent
la sentence que leur lut le greffier ; puis, la lecture
achevée, ils se remirent à leur partie.
Le supplice était fixé pour le lendemain, huit
heures du matin : Conradin y fut conduit accompagné de
Frédéric, duc d'Autriche, des comtes Gualferano et
Bartolomeo Lancia, Gérard et Gavano Donoratico de Pise.
La seule grâce que Charles d'Anjou lui eût
accordée était d'être exécuté
le premier.
Arrivé au pied de l'échafaud, Conradin repoussa
les deux bourreaux qui voulaient l'aider à monter
l'échelle, et monta seul d'un pas ferme.
Arrivé sur la plate-forme, il détacha son
manteau, puis, s'agenouillant, il pria un instant.
Pendant qu'il priait, ayant entendu le bourreau qui
s'approchait de lui, il fit signe qu'il avait fini, et, se
relevant en effet :
|
- O ma mère ! ma mère ! dit-il à
haute voix, quelle profonde douleur te causera la nouvelle
qu'on va te porter de moi !
A ces mots, qui furent entendus de la foule, quelques
sanglots éclatèrent : Conradin vit que parmi
ce peuple il lui restait encore des amis, et
peut-être des vengeurs.
Alors il tira son gant de sa main, et le jetant au milieu
de la place :
- Au plus brave, cria-t-il.
Et il présenta sa tête au bourreau.
Frédéric fut exécuté
immédiatement après lui, et ainsi
s'accomplit la promesse que les deux jeunes gens
s'étaient faite, que la mort même ne pourrait
les séparer.
Puis vint le tour de Gualferano et de Bartolomeo Lancia,
des comtes Gérard et Gavano Donoratico de
Pise.
Le gant jeté par Conradin au milieu de la foule
fut ramassé par Henri d'Apifero, qui le porta
à don Pierre d'Aragon, seul et dernier
héritier de la maison de Souabe comme mari de
Constance, fille de Manfred.
|
|
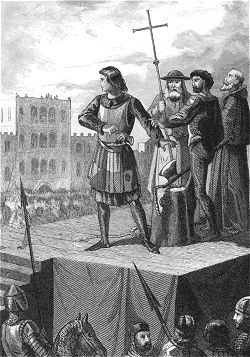
Lithogravure d'Urrabieta (XIXe siècle)
|