Livre I, chapitre 2 |
La bouquetière aveugle, et la beauté à la mode. - La confession de l'Athénien. - Présentation au lecteur d'Arbacès d'Egypte
Les deux jeunes gens, en parlant légèrement
de mille choses, se promenèrent dans les rues ; ils se
trouvaient dans le quartier rempli des plus attrayantes
boutiques, dont l'intérieur ouvert laissait voir le
luxe et les harmonieuses couleurs de peintures à
fresque incroyablement variées de forme et de dessin.
Les fontaines brillantes, qui de toutes parts
lançaient leurs gracieux jets dans l'air pour
rafraîchir les ardeurs de l'été ; la
foule des passants, ou plutôt des promeneurs
nonchalants vêtus de leurs robes pourprées ; les
joyeux groupes rassemblés autour des boutiques qui les
séduisaient le plus ; les esclaves passant
çà et là avec des seaux de bronze d'une
forme agréable, et qu'ils portaient sur leurs
têtes ; les filles de la campagne s'échelonnant
à peu de distance les unes des autres, près de
leurs corbeilles de fruits vermeils ou de fleurs plus
appréciées des anciens Italiens que de leurs
descendants (on dirait que, pour ceux-ci, «latet anguis
in herba» et que chaque violette ou chaque rose cache
un parfum malfaisant (1) ; les divers lieux de repos qui remplissaient, pour ce peuple
paresseux, l'office de nos cafés et de nos clubs ; les
vases de vin et d'huile rangés sur des tablettes de
marbre, les entrées garnies de bancs et de tentures de
pourpre qui offraient un abri contre le soleil, et invitaient
la fatigue ou l'oisiveté à se reposer ou
à s'étendre à son aise : tout cela
formait une scène pleine d'animation et de
gaieté, qui donnait à l'esprit athénien
de Glaucus raison de se féliciter d'une si heureuse
vie.
«Ne me parlez plus de Rome, dit-il à Claudius,
le plaisir est imposant et pesant dans ses sublimes murailles ; même dans l'enceinte de la cour, même dans la
maison dorée de Néron, même au milieu des
splendeurs nouvelles du palais de notre Titus, la
magnificence a quelque chose de majestueusement ennuyeux qui
fatigue les yeux et l'esprit : en outre, cher Claudius, ne
sommes-nous pas mécontents lorsque nous comparons
l'énorme faste et la richesse des autres avec la
médiocrité de notre fortune ? Ici nous nous
livrons facilement au plaisir, et nous possédons
l'éclat du luxe sans la lassitude qui en accompagne la
pompe.
- C'est pour ce motif que vous avez choisi votre retraite
d'été à Pompéi ?
- Oui, certes, je préfère Pompéi
à Baia. J'apprécie les charmes de Baia, mais je
n'aime pas les pédants qui s'y réunissent et
qui semblent peser leurs plaisirs au poids de la
drachme.
- Cependant vous aimez aussi le savoir, et quant à la
poésie, Homère et Eschyle, le poème et
le drame, trouvent chez vous un asile éloquent.
- Oui ; mais ces Romains qui contrefont mes ancêtres
d'Athènes se montrent si lourds en toute chose ! Dans
leurs chasses même, ils commandent à leurs
esclaves d'emporter Platon ; et, lorsque le sanglier leur a
échappé, ils prennent leurs livres et leur
papyrus, afin de ne pas perdre leur temps comme ils ont perdu
le sanglier. Lorsqu'un essaim de jeunes filles s'en vient
tourbillonner autour d'eux avec toute la grâce des
danses persanes, quelque stupide affranchi à la face
de marbre leur lit un chapitre du traité de
Cicéron De officiis. Ne ressemblent-ils pas
à d'ignorants droguistes ? Le plaisir et
l'étude ne sont pas des éléments faits
pour être mêlés ensemble : on doit les
employer séparément. Les Romains se privent des
deux choses par cette affectation raffinée ; c'est
prouver qu'ils n'ont de goût ni pour l'une ni pour
l'autre. Eh ! mon cher Claudius, combien vos compatriotes se
rendent peu compte de l'heureuse mobilité d'un
Périclès, ou des vrais enchantements d'une
Aspasie ! Ce n'est que l'autre jour que j'ai rendu visite
à Pline. Il était assis dans le cabinet de
travail de sa maison d'été, écrivant,
pendant qu'un esclave infortuné jouait de la
flûte. Son neveu (fatuité philosophique qui
mériterait le fouet) lisait dans Thucydide la
description de la peste ; il inclinait de temps en temps sa
petite tête pleine de suffisance en signe d'assentiment
à la musique, tandis que ses lèvres
répétaient tout bas les répugnants
détails de cette terrible peinture. Ce jeune sot ne
voit rien d'incompatible entre une chansonnette d'amour et
une description de la peste.
- C'est quelquefois la même chose, dit Claudius.
- Je lui en fis justement l'observation ; pour excuser son
impertinence ; mais le jeune homme, visage renfrogné,
reçut mal la plaisanterie ; il me répondit que
la musique ne plaisait qu'à nos oreilles, et qu'un
livre (rappelez-vous que c'était la description de la
peste) élevait le cœur. «Ah ! dit le gros oncle
avec un ronflement, mon neveu est presque un Athénien,
il mêle toujours l'utile au dulce.»
O Minerve ! comme je riais dans ma manche ! Pendant que
j'étais là, on vint dire à notre petit
sophiste que son affranchi le plus cher était mort de
la fièvre. «Inexorable mort ! s'écria-t-il ; qu'on me donne mon Horace ! Ce grand
poète seul nous console merveilleusement de tels
malheurs ! » Est-ce que ces hommes aiment, ô
Claudius ? à peine ont-ils des sens ! Qu'il est rare
qu'un Romain ait un cœur ! ce n'est qu'un mécanisme
sans os et sans chairs.»
|
Quoique Claudius entendît avec un peu de
contrariété ces remarques sur ses
compatriotes, il feignit de sympathiser avec son ami,
en partie à cause de sa nature de parasite, et
en partie parce qu'il était de mode, parmi les
jeunes Romains dissolus, d'affecter un certain
mépris pour leur origine, qui, en
réalité, les rendait si arrogants ; il
était de mode d'imiter les Grecs, et pourtant de
rire d'une malencontreuse imitation. |

Le marché aux fleurs, in Estes (1891) p.7 |
|
CHANSON DE LA BOUQUETIERE AVEUGLE I |
«Je veux prendre ce bouquet de violettes, douce
Nydia, s'écria Glaucus en fendant la foule, et en
jetant dans la corbeille une poignée de petites
pièces. Ta voix est plus charmante que
jamais.»
La jeune fille aveugle tressaillit aux accents de
l'Athénien ; elle se rendit presque aussitôt
maîtresse de ce premier mouvement ; mais une vive
rougeur colora son cou, ses joues et ses tempes.
«Vous êtes donc de retour ? dit-elle à
voix basse. Et elle se répéta à
elle-même : Glaucus est de retour !
- Oui, mon enfant ; je ne suis revenu à Pompéi
que depuis quelques jours. Mon jardin réclame tes
soins, comme d'habitude ; j'espère que tu le visiteras
demain. Souviens-toi qu'aucune guir-lande ne sera
tressée chez moi, si ce n'est de la main de la jolie
Nydia ! »
Nydia sourit joyeusement, mais ne répondit pas ; et
Glaucus, mettant sur son sein les violettes qu'il avait
choisies, s'éloigna de la foule avec autant de
gaieté que d'insouciance.
«Ainsi cette enfant est une de vos clientes ? dit
Claudius.
- Oui. Ne chante-t-elle pas agréablement ? Elle
m'intéresse, la pauvre esclave. D'ailleurs elle est du
pays de la montagne de dieux ; l'Olympe a projeté son
ombre sur son berceau, elle est Thessalienne.
- Le pays des magiciennes.
- C'est vrai. Mais, selon moi, toute femme est magicienne ; et, par Vénus ! l'air à Pompéi semble
lui-même un philtre d'amour, tant chaque figure qui n'a
pas de barbe a de charme pour mes yeux.
- Eh ! justement j'aperçois une des belles de
Pompéi, la fille du vieux Diomède, la riche
Julia, s'écria Claudius, pendant qu'une jeune dame, la
figure couverte d'un voile et accompagnée de deux
suivantes, s'approchait d'eux en se dirigeant vers les bains.
Belle Julia, nous te saluons, dit Claudius.»

Joseph M. Gleeson, 1891 |
Julia leva en partie son voile, de façon à
montrer avec coquetterie un beau profil romain, un grand oeil
noir plein d'éclat, et une joue un peu brune, à
laquelle l'art avait jeté une fine et douce couleur de
rose.
«Glaucus est de retour ? dit-elle, en arrêtant
son regard avec intention sur l'Athénien ; puis elle
ajouta à demi-voix : A-t-il oublié ses amis de
l'année dernière ?
- Divine Julia ! le Léthé lui-même, bien
qu'il disparaisse dans un endroit de la terre, se remontre
sur un autre point. Jupiter ne nous permet l'oubli que pour
un moment ; mais Vénus, plus exigeante, ne nous
accorde même pas ce moment-là.
- Glaucus ne manque jamais de belles paroles.
- Peuvent-elles manquer devant un objet si beau ?
- Nous nous verrons tous les deux à la maison de
campagne de mon père, continua Julia en se tournant
vers Claudius.
- Nous marquerons le jour de notre visite d'une pierre
blanche», répondit le joueur.
Julia abaissa son voile, mais lentement, en laissant se
reposer son dernier regard sur l'Athénien avec une
timidité affectée et une hardiesse
réelle. Ce regard exprimait en même temps la
tendresse et le reproche.
Les amis suivirent leur chemin.
«Julia est assurément belle, dit Glaucus.
- L'année dernière, vous auriez fait cet aveu
avec plus de vivacité.
- J'en conviens. J'ai été ébloui au
premier coup d'oeil et j'ai pris pour une pierre
précieuse une imitation parfaitement
réussie.
- Bah ! répondit Claudius, toutes les femmes sont les
mêmes au fond. Heureux celui qui épouse un beau
visage et un large douaire ! que peut-il désirer de
plus ? »
Glaucus soupira.
Ils se trouvaient maintenant dans une rue moins
fréquentée que les autres, à
l'extrémité de laquelle ils pouvaient voir
cette vaste mer toujours souriante, qui, sur ces côtes
délicieuses, semble avoir renoncé à son
privilège d'inspirer de la terreur, tant ont de
douceur les vents qui courent sur sa surface, tant sont
brillantes et variées les nuances qu'elle emprunte aux
nuages de rose, tant les parfums que les brises de la terre
apportent à ses profondeurs ont quelque chose de
pénétrant et de suave. Vous n'avez aucune peine
à croire que Vénus Aphrodite soit sortie d'une
mer pareille pour s'emparer de l'empire de la terre.
«Ce n'est pas encore l'heure du bain, dit le Grec, qui
était un homme d'impulsion toute poétique ; éloignons-nous de la ville tumultueuse pour contempler
à notre aise la mer, alors que le soleil de midi se
plaît à sourire encore aux flots.
|
Pompéi était la miniature de la
civilisation de cette époque. Cette ville
renfermait dans l'étroite enceinte de ses murs
un échantillon de tout ce que le luxe peut
inventer au profit de la richesse. Dans ses
étroites mais élégantes boutiques,
dans ses palais de petite dimension, dans ses bains,
dans son forum, dans son théâtre, dans son
cirque, dans l'énergie et la corruption, dans le
raffinement et les vices de sa population, on voyait un
modèle de tout l'empire. C'était un jouet
d'enfant, une lanterne magique, un microcosme,
où les dieux semblaient prendre plaisir à
refléter la grande représentation de la
terre, et qu'ils s'amusèrent plus tard à
soustraire au temps, pour livrer à
l'étonnement de la postérité cette
maxime et cette moralité, qu'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil. |
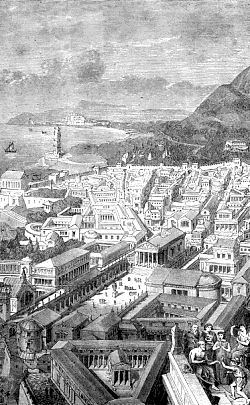
Pompéi à vol d'oiseau, in Lagrèze (1888) p.79 |
Le Grec, attirant son compagnon loin de la foule, dirigea
ses pas vers un endroit solitaire du rivage, et les deux
amis, assis sur un petit rocher qui surmontait des cailloux
polis par la mer, aspirèrent la brise voluptueuse et
rafraîchissante dont les pieds invisibles, en se jouant
sur les flots, leur communiquaient un harmonieux murmure. Il
y avait dans cette scène un charme qui invitait au
repos et à la rêverie. Claudius,
protégeant ses yeux contre les ardeurs du jour,
calculait les gains de la semaine ; et le Grec, appuyé
sur sa main et sans se défendre du soleil,
divinité tutélaire de sa patrie, dont la pure
lumière, inspiratrice de la poésie, de la joie
et de l'amour, s'infiltrait dans ses veines, regardait avec
ravissement la vaste étendue des eaux, en enviant
peut-être chaque souffle qui prenait son vol vers les
rivages de la Grèce.
«Dites-moi, Claudius, s'écria le Grec
après un long silence, avez-vous jamais
été amoureux ?
- Oui, très souvent.
- Celui qui a souvent aimé, répondit le Grec,
n'a jamais aimé : il n'y a qu'un Eros, quoiqu'il y ait
beaucoup de contrefaçons de ce dieu.
- Les contrefaçons ont bien, après tout, leur
mérite de petits dieux, répliqua
Claudius.
- Je l'accorde, répondit le Grec, j'adore
jusqu'à l'ombre de l'Amour ; mais, lui, je l'adore
bien davantage.
- Etes-vous donc sérieusement et véritablement
amoureux ? Eprouvez-vous ce sentiment que les poètes
décrivent, un sentiment qui vous fait négliger
vos repas, fuir le théâtre, et écrire des
élégies ? Je ne l'aurais jamais
soupçonné ! Vous savez bien dissimuler.
- Je ne suis pas si avancé que cela, reprit Glaucus en
souriant ; je dis plutôt avec Tibulle :
Celui qui prend l'amour pour guide et pour appui,
Marche tranquille et sûr. Les dieux veillent sur
lui.
En réalité, je ne suis pas amoureux, mais je
le serais volontiers, si j'avais l'occasion de voir l'objet
que je désire. Eros voudrait bien allumer sa torche ; mais les prêtres ne lui donnent pas d'huile.
- L'objet est aisé à deviner. N'est-ce pas la
fille de Diomède ? Elle vous adore, et n'affecte pas
de le cacher. Par Hercule, je le dis de nouveau, elle est
à la fois jeune et riche ; les jambages des portes de
son époux seront attachés avec des cordons
d'or.
- Non, je ne veux pas me vendre. La fille de Diomède
est belle, je l'avoue ; et, dans un temps, si elle n'avait
pas été la petite-fille d'un affranchi,
j'aurais pu... mais non, elle porte toute sa beauté
sur son visage ; ses manières n'ont rien d'une vierge,
et son esprit n'est cultivé que dans la science du
plaisir.
- Vous êtes un ingrat. Dites-moi alors quelle est la
vierge fortunée.
- Ecoutez donc, Claudius.
Il y a quelques mois, je séjournais à
Néapolis (2), une
ville selon mon cœur, car elle conserve encore les moeurs et
l'empreinte de son origine grecque, et elle mérite le
nom de Parthénope par l'air délicieux qu'on y
respire et par ses magnifiques rivages. Un jour, j'entrai
dans le temple de Minerve pour offrir mes voeux à la
déesse, moins pour moi-même que pour la
cité à laquelle Pallas ne sourit plus. Le
temple était vide et désert. Les souvenirs
d'Athènes revenaient en foule et avec douceur à
ma mémoire ; m'imaginant être seul encore dans
le temple, et absorbé par mon zèle religieux,
je laissai échapper de mon cœur les sentiments qui le
remplissaient, et des larmes s'échappèrent de
mes yeux en même temps que des paroles de mes
lèvres. Un profond soupir interrompit ma prière ; je me retournai aussitôt, et je vis derrière
moi une femme. Elle avait relevé son voile et elle
priait aussi. Nos yeux se rencontrèrent, et il me
sembla qu'un regard céleste s'élançait
de ces astres brillants et pénétrait jusqu'au
fond de mon cœur. Jamais, mon cher Claudius, je n'avais vu
une figure de forme plus exquise ; une certaine
mélancolie adoucissait et ennoblissait en même
temps l'expression de ses traits. Ce je ne sais quoi qu'on ne
peut décrire et qui vient de l'âme, et que nos
sculpteurs ont réservé pour idéaliser
Psyché, donnait à sa beauté un noble et
divin attrait ; des pleurs tombaient de ses yeux. Je devinai
sur-le-champ qu'elle était comme moi d'origine
athénienne, et que les voeux que j'avais faits pour
Athènes avaient trouvé un écho dans son
cœur. Je lui parlai d'une voix émue :
«N'êtes-vous pas aussi athénienne, lui
dis-je, ô vierge charmante ? » Aux accents de ma
voix, elle rougit et ramena son voile sur son visage :
«Les cendres de mes aïeux, dit-elle, reposent sur
les bords de l'Ilyssus ; je suis née à
Néapolis, mais ma famille est d'Athènes et mon
âme est tout athénienne. - Prions donc
ensemble», repris-je. Et, comme le prêtre survint
en ce moment, nous mêlâmes nos prières aux
siennes, en restant ainsi l'un près de l'autre ; ensemble nous touchâmes les genoux de la déesse,
ensemble nous déposâmes nos guirlandes d'olivier
sur l'autel. J'éprou-vai une étrange
émotion de tendresse sacrée et de
confraternité. Tous deux étrangers nés
sur une terre lointaine et déchue, nous étions
seuls dans ce temple dédié à une
divinité de notre pays : n'était-il pas naturel
que mon cœur s'élançât vers ma
compatriote, car je pouvais l'appeler ainsi. Il me parut que
je la connaissais depuis longtemps ; on eût dit que ces
simples rites, comme par miracle, serraient entre nous les
liens de la sympathie et du temps. Nous quittâmes le
temple en silence, et j'allais lui demander où elle
demeurait et s'il me serait permis de la visiter, lorsqu'un
jeune homme, dont les traits avaient quelque ressemblance
avec les siens, et qui se tenait sur les degrés du
temple, vint la prendre par la main. Elle se retourna et
m'adressa un adieu. La foule nous sépara. Je ne la
revis plus. En revenant chez moi, je trouvai des lettres qui
m'obligeaient à partir pour Athènes, où
des parents m'intentaient un procès au sujet de mon
héritage. Le procès gagné, je
m'empressai de retourner à Néapolis ; je fis
des recherches dans toute la ville, sans pouvoir
découvrir aucune trace de ma compatriote ; et, dans
l'espérance de perdre au milieu d'une vie joyeuse le
souvenir de cette brillante apparition, je me plongeai
avidement dans les voluptés de Pompéi. Telle
est mon histoire. Je n'aime pas ; mais je me souviens et je
regrette.»
Claudius se disposait à répondre, lorsque des
pas lents et graves se firent entendre, et, au bruit des
cailloux remués par la grève, chacun des
interlocuteurs se retourna et reconnut le nouvel
arrivant.
C'était un homme qui avait à peine atteint sa
quarantième année, de haute taille, peu
chargé d'embonpoint, mais dont les membres
étaient nerveux et saillants. Son teint sombre et
basané révélait son origine orientale,
et ses traits possédaient quelque chose de grec dans
leurs contours (surtout le menton, les lèvres, le
front), à l'exception du nez un peu prononcé et
aquilin ; les os de son visage, durs et fortement
accusés, le privaient de ces gracieuses et
harmonieuses lignes qui, sur les physionomies grecques,
conservent les apparences de la jeunesse jusque dans
l'âge mûr ; ses yeux larges et noirs comme la
plus sombre nuit, brillaient d'un éclat qui n'avait
rien de changeant ni d'incertain. Un calme profond,
rêveur et à moitié mélancolique,
semblait s'être fixé dans leur regard imposant
et majestueux. Sa démarche et son maintien avaient
surtout de la gravité et de la mesure ; et quelque
chose d'étranger dans la mode et dans les couleurs
foncées de ses longs vêtements ajoutait à
ce qu'il y avait de frappant dans son air plein de
tranquillité et dans sa vigoureuse organisation.
Chacun des jeunes gens, en saluant le nouveau venu, fit
machinalement, et en se cachant de lui avec soin, un
léger geste ou signe avec les doigts ; car
Arbacès l'Egyptien était censé avoir le
don fatal du mauvais oeil.
«Il faut que le point de vue soit magnifique, dit
Arbacès avec un froid mais courtois sourire, pour
attirer le gai Claudius et Glaucus, si admiré, loin
des rues populaires de la cité.
- La nature manque-t-elle donc de puissants attraits ? demanda le Grec.
- Pour les gens dissipés, oui.
- Austère réponse, mais peu sage. Le plaisir
aime les contrastes. C'est en sortant de la dissipation que
la solitude nous plaît, et de la solitude il est doux
de s'élancer vers la dissipation.
- Ainsi pensent les jeunes philosophes de l'Académie,
répliqua l'Egyptien, ils confondent la lassitude avec
la méditation, et s'imaginent, parce qu'ils sont
fatigués des autres, connaître le charme des
heures solitaires. Mais ce n'est pas dans ces cœurs
blasés que la nature peut éveiller
l'enthousiasme, qui seul dévoile les mystères
de son inexprimable beauté ! Elle vous demande, non
l'épuisement de la passion, mais cette ferveur unique
pour laquelle vous ne cherchez, en l'adorant, qu'un temps de
repos. O jeune Athénien ! lorsque la lune se
révélait, dans une vision lumineuse, à
Endymion, ce n'était pas après un jour
passé dans les fiévreuses agitations des
demeures humaines, mais sur les hautes montagnes et dans les
vallons solitaires consacrés à la chasse.
- Belle comparaison ! s'écria Glaucus, mais
application injuste. Epuisement, ce mot est fait pour la
vieillesse, non pour la jeunesse. Quant à moi, je n'ai
jamais connu un moment de satiété.»
L'Egyptien sourit encore, mais son sourire fut sec et
glacé, et Claudius lui-même, qui ne se laissait
pas entraîner par son imagina-tion, ressentit une
impression désagréable. L'Egyptien ne
répondit pas néanmoins à l'exclamation
passionnée de Glaucus ; mais, après un moment
de silence, il dit d'une voix douce et mélancolique
:
«Après tout, vous faites bien de profiter du
temps pendant qu'il vous sourit ; la rose se flétrit
vite, le parfum s'évapore bientôt ; et
d'ailleurs, ô Glaucus ! à nous étrangers
dans cette contrée et loin des cendres de nos
pères, que nous reste-t-il, si ce n'est le plaisir ou
le regret ? L'un, le plaisir, pour vous ; l'autre, le regret
pour moi ! »
Les yeux brillants du Grec se remplirent soudain de
larmes.
«Ah ! ne parlez pas ainsi, Arbacès,
s'écria-t-il, ne parlez pas de vos ancêtres ; oublions qu'il y a eu d'autres villes libres que Rome. Et la
gloire ! ... Oh ! nous voudrions vraiment évoquer son
fantôme des champs de Marathon et des
Thermopyles.
- Ton cœur n'est pas
d'accord avec tes paroles, dit l'Egyptien ; et, dans la
gaieté de la nuit que tu vas passer, tu te souviendras
plus de Leaena (3) que de
Laïs. Vale ! »
Il dit et, s'enveloppant dans sa robe, s'éloigna
lentement.
«Je respire plus à mon aise, reprit Claudius. A
l'imitation des Egyptiens, nous introduisons quelquefois un
squelette dans nos festins. En vérité, la
présence d'un tel personnage, semblable à celle
d'un spectre, suffirait pour faire aigrir la plus belle
grappe du raisin de Falerne.
- Homme étrange ! murmura Glaucus d'un air pensif ; quoiqu'il semble mort au plaisir et froid pour tous les
objets de ce monde, si ce n'est pas un bruit calomnieux, sa
maison et son cœur démentent ses discours.
- Ah ! oui, l'on dit que sa sombre maison est vouée
à d'autres orgies que celles d'Osiris. Il est riche
aussi, assure-t-on. Ne pourrions-nous l'entraîner dans
nos fêtes et lui faire connaître les charmes du
dé, le plaisir des plaisirs ? Fièvre
d'espérance et de crainte, passion qui ne lasse
jamais, et dont on ne peut exprimer les délices ! que
tu es beau et terrible, ô Jeu !
- Il est inspiré, vraiment inspiré,
s'écria Glaucus en riant. L'oracle fait de Claudius un
poète. Il n'y a plus de miracle possible après
celui-là ! »
|
||||||||