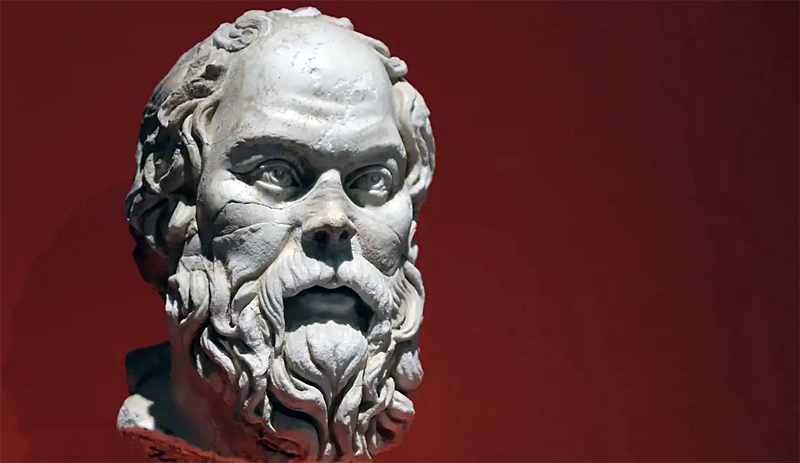
Buste de Socrate - IVe s. apr.JC - Musee archéologique d'Ephèse, Turquie
Enregistrement audio intégral de l'Apologie |
Je ne sais, Athéniens, quelle impression a faite
sur vous le discours de mes accusateurs. Pour moi, j'avoue
que je me suis presque méconnu moi-même, tant
ils ont parlé d'une manière persuasive ;
cependant, je puis l'assurer, ils n'ont pas dit un seul mot
qui soit véritable.
Mais, de toutes leurs calomnies, celle qui m'a le plus
surpris, c'est lorsqu'ils vous ont avertis de vous bien tenir
sur vos gardes, pour n'être pas séduits par mon
éloquence. Car de n'avoir pas craint la honte du
démenti que je vais leur donner tout à l'heure,
en faisant voir que je ne suis point du tout éloquent,
voilà le comble de l'impudence, à moins qu'ils
n'appellent éloquent celui qui dit la
vérité. Si c'est là ce qu'ils
prétendent, j'avoue que je suis un très grand
orateur, mais non pas à leur manière ; car,
encore une fois, ils n'ont pas dit un seul mot de vrai ; et
vous allez apprendre de moi la vérité toute
pure, Athéniens, non point, par Jupiter, dans un
discours orné de sentences brillantes et de termes
choisis, comme sont les discours de mes accusateurs, mais
dans un langage simple et spontané ; car j'ai cette
confiance que je dis la vérité, et aucun de
vous ne doit s'attendre à autre chose de moi. Il ne
serait pas convenable à mon âge de venir devant
vous, Athéniens, comme un jeune homme qui aurait
préparé un discours.
C'est pourquoi la seule grâce que je vous demande,
c'est, Athéniens, lorsque dans ma défense
j'emploierai les termes et les manières les plus
ordinaires dont j'ai accoutumé de me servir, toutes
les fois que je m'entretiens avec vous, sur la place
publique, dans les banques, et tous les autres lieux
où vous m'avez souvent rencontré, de n'en pas
être surpris, et de ne pas vous emporter contre moi ;
car c'est aujourd'hui la première fois de ma vie que
je parais devant un tribunal, quoique j'aie plus de
soixante-dix ans.
Je suis donc tout à fait étranger au langage
qu'on parle ici. Et comme, si j'étais
réellement un étranger, vous me pardonneriez de
vous parler à la manière et dans la langue de
mon pays, je vous conjure aussi, et je crois ma demande
juste, de ne pas prendre garde à ma façon de
parler, bonne ou mauvaise, et de regarder seulement, avec
toute l'attention possible, si je vous dis des choses justes
ou non ; car c'est en cela que consiste toute la vertu du
juge, comme celle de l'orateur est de ne dire que la
vérité.
Il est juste que je commence
par répondre à mes premiers accusateurs, et par
réfuter les premières accusations, avant d'en
venir aux dernières qu'on a élevées
contre moi. Car j'ai bien des accusateurs auprès de
vous, depuis bien des années, et qui n'ont rien
avancé qui ne soit faux. Je crains bien plus
ceux-là qu'Anytus et ses complices (1), quoique ces derniers
soient fort éloquents ; mais les autres sont beaucoup
plus redoutables, en ce que, vous entourant pour la plupart
dès votre enfance, ils vous ont donné de moi
une fausse opinion, et vous ont dit qu'il y a un certain
Socrate, homme savant, qui recherche ce qui se passe dans les
cieux et dans le sein de la terre, et qui d'une
méchante cause sait en faire une bonne.
Ceux qui ont semé ces faux bruits sont mes plus
dangereux accusateurs ; car en y prêtant l'oreille on
reste persuadé que les hommes occupés à
de telles recherches ne croient point à l'existence
des dieux. D'ailleurs, ces accusateurs sont en fort grand
nombre, et il y a déjà longtemps qu'ils
travaillent à ce complot. Ils vous ont prévenus
de cette opinion dans un âge qui est ordinairement
très crédule ; car vous étiez enfants
pour la plupart, ou dans la première jeunesse,
lorsqu'ils m'accusaient auprès de vous tout à
leur aise, sans que l'accusé les contredît ; et
ce qu'il y a encore de plus injuste, c'est qu'il ne m'est pas
permis de connaître ni de nommer mes accusateurs, si ce
n'est un certain faiseur de comédies. Tous ceux qui,
par envie ou par malice, vous ont persuadé toutes ces
faussetés, et ceux qui, persuadés
eux-mêmes, ont persuadé les autres, demeurent
cachés, je ne puis ni les appeler devant vous, ni les
réfuter ; et il faut, pour me défendre, que je
me batte, comme on dit, contre une ombre, et que j'attaque et
me défende sans qu'aucun adversaire paraisse.
Mettez-vous donc bien dans l'esprit, Athéniens, que
j'ai affaire à deux sortes d'accusateurs, comme je
vous l'ai dit : ceux qui m'ont accusé depuis
longtemps, et ceux qui m'ont cité en dernier lieu ; et
croyez, je vous prie, qu'il est nécessaire que je
réponde d'abord aux premiers ; car ce sont là
ceux que vous avez écoutés d'abord, et ils ont
fait beaucoup plus d'impression sur vous que les
autres.
Eh bien donc ! Athéniens, il faut se défendre,
et tâcher d'arracher de votre esprit, dans un espace de
temps fort court, une calomnie que vous y avez reçue
depuis longtemps, et qui y a pris de profondes racines. Je
souhaiterais de tout mon coeur que ce fût à
votre avantage comme au mien, et que mon Apologie pût
servir à ma justification ; mais je sais combien cela
est difficile, et je ne suis pas aveugle à cet
égard. Qu'il arrive tout ce qu'il plaira aux dieux, il
faut obéir à la loi et se
défendre.
Remontons donc à la
première origine de l'accusation, sur laquelle j'ai
été tant décrié, et qui a
donné à Mélitus la confiance de
m'appeler en justice. Que disaient ces premiers accusateurs ?
car il faut mettre leur accusation dans les formes, comme si
elle était écrite, et les serments
prêtés (2) : Socrate est un impie
; par une curiosité criminelle, il veut
pénétrer ce qui se passe dans les cieux et sur
la terre. Il fait une bonne cause d'une mauvaise, et enseigne
aux autres ses doctrines.
Voilà l'accusation ;
vous l'avez vu dans la comédie d'Aristophane (3), où l'on
représente un certain Socrate qui dit qu'il se
promène dans les airs, et autres semblables
extravagances auxquelles je n'entends absolument rien : ce
que j'en dis, ce n'est point du tout mépris pour ces
sortes de connaissances, s'il se trouve ici quelqu'un qui y
soit habile (et que Mélitus ne me fasse pas à
ce propos de nouvelles affaires) ; c'est seulement pour vous
faire voir que je ne me suis jamais mêlé de ces
sciences, comme j'en puis prendre à témoin la
plupart d'entre vous.
Je vous conjure donc tous tant que vous êtes avec qui
j'ai conversé, et il y en a ici un fort grand nombre,
je vous conjure de déclarer si vous m'avez jamais
entendu parler de ces sortes de sciences, ni de près,
ni de loin ; par là, vous connaîtrez
certainement que dans tous les mauvais bruits que l'on
répand encore sur moi, il n'y pas non plus un mot de
vrai ; et si vous avez quelquefois ouï dire que je me
mêle d'enseigner, et que j'exige un salaire, c'est
encore une fausseté.
Ce n'est pas que je ne
trouve fort beau de pouvoir instruire les hommes, comme font
Gorgias de Léontium, Prodicus de Céos, et
Hippias d'Elée. Ces grands personnages (4), dans quelque ville
qu'ils aillent, ont ce merveilleux talent de persuader aux
jeunes gens, qui, sans qu'il leur en coûtât la
moindre chose, pourraient s'attacher à tel de leurs
concitoyens qu'il leur plairait, de quitter leurs concitoyens
pour s'attacher à eux. Ceux-ci les payent bien, et
leur ont encore une obligation infinie. J'ai ouï dire
aussi qu'il est venu ici un homme de Paros, qui est fort
habile ; car m'étant rencontré l'autre jour
chez un homme qui dépense plus en sophistes que tous
nos autres citoyens ensemble, Callias, fils d'Hipponicus, je
m'avisai de lui dire, en parlant de ses deux fils :
Callias, si tu avais pour enfants deux jeunes chevaux ou deux
jeunes taureaux, ne chercherions-nous pas à les mettre
entre les mains d'un habile homme, que nous payerions bien,
afin qu'il les rendit aussi beaux et aussi bons qu'ils
peuvent être, et qu'il leur donnât toutes les
qualités qu'ils doivent avoir ? Et cet habile homme,
ne serait-ce pas un bon écuyer ou quelque bon
laboureur ? Mais puisque tu as pour enfants des hommes, quel
maître as-tu donc résolu de leur donner ? Quel
maître habile avons-nous pour les devoirs de l'homme et
du citoyen ? Car je ne doute point que tu n'y aies
pensé depuis que tu as des enfants ; en connais-tu
quelqu'un ? - Sans doute, me répondit Callias. - Qui
est-il ? repris-je, d'où est-il ? combien prend-il ? -
C'est Evénus, Socrate, me dit-il ; il est de Paros, et
il prend cinq mines. Là-dessus, je trouvai
Evénus bien heureux, s'il est vrai qu'il ait ce
talent, et qu'il puisse l'enseigner aux autres. Pour moi,
Athéniens, je serais bien fier et bien glorieux si
j'avais cette habileté ; mais malheureusement je ne
l'ai point. Quelqu'un de vous me dira peut-être : Mais,
Socrate, que fais-tu donc ? et d'où viennent ces
calomnies que l'on a répandues contre toi ? car si tu
n'avais jamais rien fait que ce que font les autres citoyens,
jamais on n'aurait fait courir ces bruits-là sur toi.
Dis-nous donc ce que c'est, afin que nous ne portions pas un
jugement téméraire. Cette objection me parait
juste ; je vais donc tâcher de vous expliquer ce qui
m'a tant décrié et a rendu mon nom si fameux.
Ecoutez-moi donc ; peut-être quelques-uns d'entre vous
croiront-ils que je ne parle pas sérieusement, mais
soyez bien persuadés que je ne vous dirai que la
vérité.
La réputation qu'on m'a faite ne vient que d'une
certaine sagesse qui est en moi. Quelle est cette sagesse ?
C'est peut-être une sagesse purement humaine ; et je
cours grand risque de n'être sage que de
celle-là, au lieu que les hommes dont je viens de vous
parler sont sages d'une sagesse bien plus qu'humaine.
Je n'ai rien à vous dire de cette sagesse, car je ne
la connais point, et tous ceux qui me l'imputent mentent, et
ne cherchent qu'à me calomnier. Mais je vous conjure,
Athéniens, de ne pas vous émouvoir si je parais
vous parler trop avantageusement de moi-même ; je ne
vous dirai rien qui vienne de moi, mais j'attesterai une
autorité digne de confiance : car pour témoin
de ma sagesse, je vous donnerai le dieu même de
Delphes, qui vous dira si elle est, et quelle elle est. Vous
connaissez tous Chéréphon ; c'était mon
camarade d'enfance ; il l'était aussi de la plupart
d'entre vous ; il fut banni avec vous et revint avec vous.
Vous savez donc quel homme c'était que
Chéréphon, et combien il était ardent
dans tout ce qu'il entreprenait. Un jour, étant parti
pour Delphes, il eut la hardiesse de demander à
l'oracle (et je vous prie encore une fois de ne pas vous
émouvoir de ce que je vais dire) s'il y avait au monde
un homme plus sage que moi ; la Pythie lui répondit
qu'il n'y en avait aucun. Chéréphon est mort,
mais son frère, qui est ici, pourra vous le certifier.
Considérez bien, Athéniens, pourquoi je vous
dis toutes ces choses : c'est uniquement pour vous faire voir
d'où viennent les faux bruits qu'on a fait courir
contre moi.
Quand je sus la réponse de l'oracle, je pensai en
moi-même : que veut dire le Dieu ? quel sens cachent
ces paroles ? car je sais bien qu'il n'y a en moi aucune
sagesse, ni petite, ni grande ; que veut-il donc dire, en me
déclarant le plus sage des hommes ? car il ne ment
point, la Divinité ne saurait mentir. Je doutai donc
pendant longtemps du sens de l'oracle, jusqu'à ce
qu'enfin, après bien de la peine, je m'avisai de faire
l'épreuve que voici : j'allai chez un de nos
concitoyens qui passe pour un des plus sages de la ville ; et
j'espérais que là, mieux qu'ailleurs, je
pourrais réfuter l'oracle, et lui faire voir un homme
plus sage que moi, bien qu'il m'eût
déclaré le plus sage des hommes. Examinant donc
cet homme, dont je n'ai que faire de vous dire le nom, il
suffit que c'était un de nos plus grands politiques,
et m'entretenant avec lui, je trouvai que tout le monde le
croyait sage, qu'il se croyait tel lui-même, et qu'il
ne l'était point. Après cette
découverte, je m'efforçai de lui faire voir
qu'il n'était nullement ce qu'il croyait être ;
et voilà déjà ce qui me rendit odieux
à cet homme et à tous ses amis, qui assistaient
à notre conversation.
Quand je l'eus quitté, je raisonnais en moi-même
et me disais : Je suis plus sage que cet homme. Il peut bien
se faire que ni lui ni moi ne sachions rien de beau ni de bon
; mais il y a cette différence, que lui, il croit
savoir, quoiqu'il ne sache rien, et que moi, ne sachant rien,
je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc qu'en cela
j'étais tant soit peu plus sage, parce que je ne
croyais pas savoir ce que je ne savais point.
De là, j'allai chez un autre, qui passait pour plus
sage encore que le premier ; je trouvai la même chose,
et je me fis là de nouveaux ennemis. Je ne me rebutai
point, j'allai encore chez d'autres, sentant bien que je me
faisais haïr, et en étant très
fâché, parce que j'en craignais les suites ;
mais il me paraissait que, sans balancer, je devais
préférer à toutes choses la voix du
Dieu, et pour en trouver le véritable sens, aller de
porte en porte chez tous ceux qui avaient le plus de
réputation : et, par le Chien, voici,
Athéniens, tout le fruit que je tirai de mes
recherches, car il faut vous dire la vérité :
tous ceux qui passaient pour les plus sages me parurent
l'être le moins ; et ceux dont on n'avait aucune
opinion, je les trouvai beaucoup mieux disposés
à la sagesse.
Il faut achever de vous dire toutes mes courses, comme autant
de travaux que j'entreprenais pour connaître le sens de
l'oracle.
Après avoir
été à tous ces grands hommes d'Etat,
j'allai aux poètes, tant à ceux qui font des
tragédies qu'aux poètes dithyrambiques (5) et autres, ne doutant
point que je ne me prisse là, comme on dit, en
flagrant délit, en me trouvant beaucoup plus ignorant
qu'eux. Là, prenant ceux de leurs ouvrages qui me
paraissaient les plus travaillés, je leur demandais ce
qu'ils voulaient dire, et quel était leur dessein,
comme pour m'instruire moi-même. J'ai honte,
Athéniens, de vous dire la vérité, mais
il faut pourtant vous la dire : il n'y avait pas un seul
homme de tous ceux qui étaient là
présents qui ne fût plus capable de parler et de
rendre raison de leurs poèmes qu'eux-mêmes qui
les avaient faits. Je connus tout de suite que les
poètes ne sont point guidés par la sagesse,
mais par certains mouvements de la nature, et par un
enthousiasme semblable à celui des prophètes et
des devins, qui disent tous de fort belles choses sans rien
comprendre à ce qu'ils disent. Les poètes me
parurent dans le même cas, et je m'aperçus en
même temps qu'à cause de leur poésie ils
se croyaient les plus sages des hommes dans toutes les autres
choses, bien qu'ils n'y entendent rien. Je les quittai donc,
persuadé que j'étais encore au-dessus d'eux,
par le même endroit qui m'avait mis au-dessus des
politiques.
Enfin, j'allai trouver les artistes. J'étais bien
convaincu que je n'entendais rien à leur profession,
et bien persuadé que je les trouverais très
capables en beaucoup de belles choses, et je ne me trompais
point. Ils savaient bien des choses que j'ignorais, et en
cela ils étaient beaucoup plus savants que moi. Mais,
Athéniens, les plus habiles me parurent tomber dans le
même défaut que les poètes ; car il n'y
en avait pas un qui, parce qu'il réussissait
admirablement dans son art, ne se crût très
capable et très instruit des plus grandes choses, et
cette seule extravagance ôtait du prix à leur
habileté.
Je me demandais donc à moi-même, comme parlant
pour l'oracle, si j'aimerais mieux être tel que je
suis, sans toute l'habileté de ces gens-là, et
aussi sans leur ignorance, ou bien avoir l'une et l'autre et
être comme eux : et je me répondais à
moi-même et à l'oracle qu'il valait mieux pour
moi être comme je suis. C'est de cette recherche,
Athéniens, que sont nées contre moi toutes ces
haines et ces inimitiés dangereuses, qui ont produit
toutes les calomnies que vous savez, et m'ont fait donner le
nom de sage ; car tous ceux qui m'entendent croient que je
sais toutes les choses sur lesquelles je découvre
l'ignorance des autres. Or, il me semble, Athéniens,
qu'il n'y a que Dieu seul qui soit véritablement sage,
et que c'est aussi ce qu'il a voulu dire par son oracle, en
faisant entendre que toute la sagesse humaine n'est pas
grand'chose, ou, pour mieux dire, qu'elle n'est rien ; et si
l'oracle a nommé Socrate, il s'est sans doute
servi de mon nom comme d'un exemple, et comme s'il disait
à tous les hommes : Le plus sage d'entre vous, c'est
celui qui reconnaît, comme Socrate, que sa sagesse
n'est rien.
Convaincu de cette vérité, pour m'en assurer
encore davantage et pour obéir au Dieu, je continue
ces recherches non-seulement parmi nos citoyens, mais aussi
parmi les étrangers, pour voir si je n'en trouverai
aucun véritablement sage ; et n'en trouvant point, je
sers d'interprète à l'oracle, en leur faisant
voir qu'ils n'ont aucune sagesse. Cela m'occupe si fort, que
je n'ai pas le loisir de m'occuper de la république,
ni d'avoir soin de mes affaires, et que je vis dans une
grande pauvreté, à cause de ce culte que je
rends au Dieu.
D'ailleurs beaucoup de jeunes gens des plus riches familles,
qui ont du loisir, s'attachent à moi de bon gré
et prennent un si grand plaisir à voir de quelle
manière j'éprouve tous les hommes, qu'ils
tâchent ensuite de m'imiter en ceux qu'ils rencontrent
; et il ne faut pas douter qu'ils ne trouvent une abondante
moisson ; car il y a bon nombre de gens qui croient tout
savoir, quoiqu'ils ne sachent rien ou très peu de
chose.
Tous ceux qu'ils convainquent ainsi d'ignorance s'en prennent
à moi, et non pas à eux, et vont disant qu'il y
a un certain Socrate, qui est un scélérat et un
infâme, qui corrompt les jeunes gens ; et quand on leur
demande ce qu'il fait ou ce qu'il enseigne, ils n'en savent
rien ; mais pour ne pas demeurer court, ils se rejettent sur
ces reproches triviaux qu'on fait ordinairement aux
philosophes : qu'il recherche ce qui se passe dans les cieux
et dans le sein de la terre, qu'il ne croit point aux dieux,
et qu'il rend bonnes les plus méchantes causes ; car
ils n'osent dire ce qui en est, que Socrate les prend sur le
fait, et découvre qu'ils font semblant de savoir,
quoiqu'ils ne sachent rien. Ainsi, ambitieux, violents, et en
fort grand nombre, et d'ailleurs bien ameutés et munis
d'une éloquence fort capable de séduire, ils
vous soufflent depuis longtemps aux oreilles toutes ces
calomnies qu'ils ont forgées contre moi ; et
présentement, ils m'ont détaché
Mélitus, Anytus et Lycon. Mélitus prend fait et
cause pour les poètes ; Anytus pour les politiques et
pour les artistes, et Lycon pour les orateurs. C'est
pourquoi, comme je le disais au commencement, je regarderais
comme un grand miracle, si, en si peu de temps, je pouvais
détruire une calomnie qui a eu tout le loisir de
prendre racine et de se fortifier dans votre esprit.
Voilà, Athéniens, la vérité toute
pure ; je ne vous cache et ne vous déguise rien,
quoique je n'ignore pas que tout ce que je dis là ne
fait qu'envenimer la plaie ; et c'est cela même qui
prouve que je dis la vérité, et que telle est
la source de ces calomnies : toutes les fois que vous voudrez
prendre la peine de les approfondir, soit
présentement, soit dans un autre temps, vous en serez
pleinement convaincus. Voilà contre mes premiers
accusateurs une apologie suffisante.
Venons présentement
aux derniers, et tâchons de répondre à
Mélitus, à cet homme de bien, si
affectionné, s'il faut l'en croire, à sa
patrie. Reprenons donc cette dernière accusation comme
nous avons énoncé la première. La voici
à peu près : Socrate est coupable, en ce
qu'il corrompt les jeunes gens, en ce qu'il ne croit pas aux
dieux de l'Etat, en ce qu'il met à leur place, sous le
nom de démons, des divinités nouvelles
(6). Voilà
l'accusation ; nous en examinerons tous les chefs l'un
après l'autre. Il dit que je suis coupable en ce que
je corromps les jeunes gens ; et moi, Athéniens, je
dis que c'est Mélitus qui est fort coupable, en ce
que, de gaieté de coeur, il appelle les gens en
justice, pour faire semblant de se soucier beaucoup de choses
dont il ne s'est jamais mis en peine ; et je m'en vais vous
le prouver.
Viens ici, Mélitus ; dis moi : As-tu rien tant
à coeur que de rendre les jeunes gens le plus vertueux
possible ?
MELITUS
Rien, sans doute.
SOCRATE
Eh bien, donc, dis à nos juges quel est l'homme qui
rendra les jeunes gens meilleurs. Car il ne faut pas douter
que tu ne le saches, puisque cela t'occupe si fort. En effet,
puisque tu as trouvé celui qui les corrompt, et que tu
l'as dénoncé devant ces juges, il faut que tu
dises qui est celui qui les rendra meilleurs. Parle, voyons,
quel est-il ?...
Tu vois bien, Mélitus, tu te tais, tu es là
interdit, et ne sais que répondre. Cela ne te
semble-t-il pas honteux, et n'est-ce pas une preuve certaine
que tu ne t'es jamais soucié de l'éducation de
la jeunesse ? Mais, encore une fois, excellent
Mélitus, qui donc peut rendre les jeunes gens
meilleurs ?
MELITUS
Les lois.
SOCRATE
Ce n'est pas là, Mélitus, ce que je te demande.
Je te demande qui est-ce ? quel est l'homme ? Car il est bien
sûr que la première chose qu'il faut que cet
homme sache, ce sont les lois.
MELITUS
Ce sont, Socrate, les juges ici assemblés.
SOCRATE
Comment dis-tu, Mélitus ? Quoi ! ces juges sont
capables d'instruire les jeunes gens et de les rendre
meilleurs ?
MELITUS
Très certainement.
SOCRATE
Mais sont-ce tous ces juges, ou y en a-t-il parmi eux qui le
puissent, et d'autres qui ne le puissent pas ?
MELITUS
Tous ces juges.
SOCRATE
C'est à merveille, par Junon, tu nous as trouvé
un grand nombre de bons précepteurs : mais, voyons,
ces auditeurs qui nous écoutent peuvent-ils aussi
rendre les jeunes gens meilleurs, ou ne le peuvent-ils pas
?
MELITUS
Ils le peuvent aussi.
SOCRATE
Et les sénateurs ?
MELITUS
Les sénateurs de même.
SOCRATE
Mais, mon cher Mélitus, tous ceux qui viennent dans
les assemblées du peuple corrompent-ils aussi les
jeunes gens, ou sont-ils aussi tous capables de les rendre
meilleurs ?
MELITUS
Ils en sont aussi tous capables.
SOCRATE
Il suit donc de là que tous les Athéniens
peuvent rendre les jeunes gens meilleurs, hors moi seul ; il
n'y a que moi qui les corrompe ; n'est-ce pas là ce
que tu dis ?
MELITUS
C'est cela même.
SOCRATE
Vraiment, c'est avoir du malheur ! Mais continue de me
répondre : Te paraît-il qu'il en soit de
même des chevaux ? tous les hommes peuvent-ils les
rendre meilleurs, et n'y en a-t-il qu'un seul qui ait le
secret de les gâter ? ou est-ce tout le contraire ? n'y
a-t-il qu'un homme seul, ou un petit nombre d'écuyers
qui puissent les rendre meilleurs ? et le reste des hommes,
s'ils s'en servent, ne les gâtent-ils pas ? n'en est-il
pas de même de tous les animaux ? Oui, sans doute, soit
qu'Anytus et toi vous en conveniez, ou que vous n'en
conveniez point. Car ce serait un grand bonheur et un grand
avantage pour la jeunesse qu'il n'y eût qu'un homme
capable de la corrompre, et que tous les autres pussent la
redresser. Mais tu as suffisamment prouvé,
Mélitus, que l'éducation de la jeunesse ne t'a
jamais fort inquiété ; et tu viens encore de
faire paraître clairement que tu ne t'es jamais mis en
peine de la chose même pour laquelle tu m'as fait
mettre en accusation.
D'ailleurs, je te prie, par Jupiter, Mélitus, de
répondre à ceci : Lequel est le plus avantageux
d'habiter avec des gens de bien, ou d'habiter avec des
méchants ? Réponds-moi, mon ami, car je ne te
demande rien de difficile. N'est-il pas vrai que les
méchants font toujours quelque mal à ceux qui
les fréquentent, et que les bons font toujours quelque
bien à ceux qui vivent avec eux ?
MELITUS
Sans doute.
SOCRATE
Y a-t-il donc quelqu'un qui préfère recevoir du
préjudice de ceux qu'il fréquente à en
recevoir de l'utilité ! Réponds-moi ; car la
loi ordonne de répondre. Y a-t-il quelqu'un qui aime
mieux recevoir du mal que du bien ?
MELITUS
Non, il n'y a personne.
SOCRATE
Mais voyons, quand tu m'accuses de corrompre la jeunesse et
de la rendre plus méchante, dis-tu que je la corromps
sciemment, ou sans le vouloir ?
MELITUS
Sciemment.
SOCRATE
Quoi donc, Mélitus, à ton âge, ta sagesse
surpasse-t-elle de si loin la mienne à l'âge
où je suis, que tu saches fort bien que les
méchants font toujours du mal à ceux qui les
fréquentent, et que les bons leur font du bien, et que
je sois, moi, tellement ignorant que je ne sache pas que si
je rends méchant quelqu'un de ceux qui me suivent, je
m'expose à en recevoir du mal, et que je ne laisse pas
de m'attirer ce mal, le voulant et le sachant? En cela,
Mélitus, je ne te crois point, et je ne pense pas
qu'il y ait un homme au monde qui puisse te croire. Il faut
de deux choses l'une, ou que je ne corrompe pas les jeunes
gens, ou, si je les corromps, que ce soit malgré moi
et sans le savoir : de quelque manière que ce soit, tu
es un calomniateur. Si c'est malgré moi que je
corromps la jeunesse, la loi ne veut pas qu'on appelle en
justice pour des fautes involontaires ; mais elle veut qu'on
prenne en particulier ceux qui les commettent, qu'on les
reprenne et qu'on les instruise ; car il est bien sûr
qu'étant instruit, je cesserai de faire ce que je fais
malgré moi. Mais toi, c'est à dessein que tu
n'as pas voulu me voir et m'instruire, et tu me traduis
devant ce tribunal, où la loi veut qu'on cite ceux qui
ont mérité des punitions, et non pas ceux qui
n'ont besoin que de remontrances. Ainsi, Athéniens,
voilà une preuve bien évidente de cc que je
vous disais, que Mélitus ne s'est jamais mis en peine
de toutes ces choses-là, et qu'il n'y a jamais
pensé.
Cependant, réponds encore, et dis-nous comment je
corromps les jeunes gens : n'est-ce pas, selon ta
dénonciation, en leur apprenant à ne pas
reconnaître les dieux que reconnaît la patrie, et
en leur apprenant à honorer sous le nom de
démons d'autres divinités ? N'est-ce pas
là ce que tu dis ?
MELITUS
C'est cela même.
SOCRATE
Je te conjure donc, Mélitus, au nom de tous les dieux
dont il s'agit maintenant, de t'expliquer d'une
manière un peu claire, et pour moi et pour ces juges ;
car je ne comprends pas bien si tu dis que j'enseigne
à croire qu'il y a des dieux (et si, en effet, je suis
persuadé qu'il y a des dieux, je ne suis pas un
athée, et ce n'est pas là mon crime), ou que
j'enseigne à ne pas croire aux dieux de l'Etat, mais
à d'autres. Est-ce là ce dont tu m'accuses ? Ou
bien m'accuses-tu de ne croire à aucun Dieu, et
d'enseigner aux autres à n'en pas reconnaître
?
MELITUS
Je t'accuse de ne croire à aucun Dieu.
SOCRATE
0 merveilleux Mélitus ! pourquoi dis- tu cela ? Quoi !
je ne crois pas, comme les autres hommes, que le soleil et la
lune sont des dieux ?
MELITUS
Non, par Jupiter, Athéniens, il ne le croit pas ; car
il dit que le soleil est une pierre, et la lune une
terre.
SOCRATE
Mais tu crois donc accuser Anaxagore, mon cher Mélitus
! Tu méprises assez les juges, tu les crois assez
ignorants pour t'imaginer qu'ils ne savent pas que les livres
d'Anaxagore (7) de
Clazomène sont pleins d'assertions de cette sorte ! Du
reste, comment les jeunes gens apprendraient-ils de moi des
choses qu'ils peuvent, tous les jours, aller entendre
à l'Orchestre (8), pour une drachme au
plus ; belle occasion pour eux de se moquer de Socrate, s'il
s'attribuait ainsi des doctrines qui ne sont pas de lui, et
d'ailleurs si étranges et si absurdes ! Mais dis-moi,
au nom de Jupiter, prétends-tu que je ne reconnais
aucun Dieu ?
MELITUS
Oui, par Jupiter, tu n'en reconnais aucun.
SOCRATE
Tu dis là des choses incroyables, Mélitus, et
tu n'es seulement pas d'accord avec toi-même. Pour moi,
Athéniens, il me paraît que Mélitus est
un insolent, qui n'a intenté cette accusation que pour
m'insulter, et par une audace de jeune homme ; car il est
venu ici justement comme pour me tenter, en proposant une
énigme, et se disant en lui-même : Voyons si
Socrate, cet homme qui passe pour si sage, reconnaîtra
que je me moque, et que je dis des choses qui se
contredisent, ou si je le tromperai, lui, et tous les
auditeurs. En effet, il paraît entièrement se
contredire dans son accusation ; c'est comme s'il disait :
Socrate est coupable, en ce qu'il ne reconnaît point de
dieux, et en ce qu'il reconnaît des dieux ; n'est-ce
pas là, vraiment, se moquer ? Voici comment j'en juge
; suivez-moi, je vous en prie, Athéniens, et comme je
vous en ai conjurés au commencement, ne vous irritez
pas contre moi, si je vous parle à ma manière
ordinaire.
Réponds-moi, Mélitus ; y a-t-il quelqu'un dans
le monde qui croie qu'il y ait des choses humaines, et qui ne
croie pas qu'il y ait des hommes ?... Juges, ordonnez qu'il
réponde et qu'il ne fasse pas tant de bruit. Y a-t-il
quelqu'un qui croie qu'il y a des règles pour dresser
les chevaux, et qu'il n'y a pas de chevaux ? qu'il n'y a
point de joueur de flûte, et qu'il y a pourtant des
airs de flûte ?... Il n'y a personne, excellent
Mélitus ; car je répondrai pour toi, si tu ne
veux pas répondre. Mais réponds à ceci :
Y a-t-il quelqu'un qui croie qu'il y a des choses propres aux
démons, et qui croie pourtant qu'il n'y a point de
démons ?
MELITUS
Non, sans doute.
SOCRATE
Qu'on a eu de peine à t'arracher ce mot ! Tu
réponds enfin, mais il faut que les juges t'y forcent.
Tu dis donc que je reconnais et que j'enseigne des choses
propres aux démons ? Qu'elles soient vieilles ou
nouvelles, il est toujours vrai, de ton propre aveu, que je
crois à des choses touchant les démons ; et
c'est ainsi que tu l'as juré dans ton accusation. Si
je crois à des choses démoniaques, il faut
nécessairement que je croie aux démons,
n'est-ce pas ? Oui, sans doute ; car je prends ton silence
pour un consentement. Mais ces démons, ne croyons-nous
pas que ce soient des dieux, ou des enfants des dieux ?
Est-ce ainsi, oui ou non ?
MELITUS
Oui.
SOCRATE
Et ar conséquent, puisque je crois à des
démons de ton propre aveu, et que les démons
sont des dieux, voilà justement la preuve de ce que je
disais, que tu nous proposais des énigmes, pour te
divertir à mes dépens, en disant que je ne
crois point aux dieux, et qui je crois pourtant aux dieux,
puisque je crois aux démons. Et si les démons
sont enfants des dieux, enfants bâtards si tu veux,
puisqu'on dit qu'il les ont eus de nymphes ou d'autres
mortelles, quel est l'homme qui peut croire qu'il y ait des
enfants des dieux, et qu'il n'y ait pas de dieux ? Cela est
aussi absurde que de croire qu'il y a des mulets nés
de chevaux et d'ânes, et qu'il n'y a ni chevaux, ni
ânes. Ainsi, Mélitus, il ne se peut que tu ne
m'aies pas intenté cette accusation pour
m'éprouver, ou, à défaut de
prétexte légitime, pour me citer devant ce
tribunal ; car tu ne persuaderas jamais à qui que ce
soit d'un peu de sens, que le même homme qui croira
qu'il y a des choses qui concernent les dieux et les
démons puisse croire pourtant qu'il n'y a ni
démons, ni dieux, ni héros ; cela est
entièrement impossible. Mais je n'ai pas besoin d'une
plus longue défense, Athéniens, et ce que je
viens de dire suffit pour faire voir que je ne suis pas
coupable, et que l'accusation de Mélitus est sans
fondement.
Et pour ce que je vous disais au commencement, que je me suis
attiré beaucoup de haines, soyez bien persuadés
que cela est vrai ; et ce qui me perdra si je succombe, ce ne
sera ni Mélitus, ni Anytus ; ce sera cette haine et
cette envie du peuple qui font périr tant de gens de
bien et qui en feront encore périr tant d'autres ; car
il ne faut pas espérer qu'elles s'arrêtent
à moi.
Mais quelqu'un me dira peut-être ici : N'as-tu pas
honte, Socrate, de t'être attaché à une
étude qui te met présentement en danger de
mourir ? A cela j'ai une réponse très juste ;
car je dirai à cet homme qu'il se trompe fort de
croire qu'un homme qui a quelque valeur doive
considérer les dangers de la mort ou de la vie.
L'unique chose qu'il doit regarder dans toutes ses
démarches, c'est de voir si ce qu'il fait est juste ou
injuste, et si c'est l'action d'un homme de bien, ou d'un
méchant homme. Autrement, il s'ensuivrait que les
demi-dieux qui moururent au siège de Troie auraient
été des insensés tous tant qu'ils
étaient, et particulièrement le fils de
Thétis, qui, pour éviter la honte,
méprisa si fort le danger, que la déesse sa
mère, qui le voyait dans l'impatience d'aller tuer
Hector, lui ayant parlé en ces termes, si je m'en
souviens : Mon fils, si tu venges la mort de Patrocle, ton
ami, en tuant Hector, tu mourras ; car
Ta mort doit suivre celle d'Hector ;
lui, après cette menace, méprisant le péril et la mort, et craignant beaucoup plus de vivre comme un lâche, sans venger ses amis :
Que je meure à l'instant ! (Il. XVIII, 96-98)
s'écria-t-il, pourvu que je punisse le meurtrier de Patrocle, et que je ne demeure pas exposé au mépris,
Assis sur mes vaisseaux, fardeau inutile sur la terre (XVIII, 104).
Vous paraît-il qu'il s'inquiétât du
danger de la mort ? C'est une vérité constante,
Athéniens, que tout homme qui a choisi un poste qu'il
a jugé le plus honorable, ou qui y a été
placé par son chef, doit y demeurer ferme, et ne
considérer, à mon avis, ni la mort, ni ce qu'il
y a de plus terrible, mais avant tout l'honneur.
Ce serait donc me conduire
étrangement, Athéniens, si, après avoir
gardé fidèlement tous les postes où j'ai
été mis par nos généraux,
à Potidée, à Amphipolis et à
Délium (9),
et après avoir si souvent exposé ma vie,
présentement que le Dieu m'a ordonné, comme
j'en ai jugé, de passer mes jours dans l'étude
de la philosophie, en m'examinant moi-même et en
examinant les autres, la peur de la mort, ou quelque autre
danger me faisait abandonner ce poste. Ce serait là
véritablement une désertion criminelle, et qui
mériterait qu'on me citât devant ce tribunal
comme un impie qui ne croit point aux dieux, qui
désobéit à l'oracle, qui craint la mort,
qui se croit sage et qui ne l'est pas. Car craindre la mort,
Athéniens, ce n'est autre chose que se croire sage
sans l'être, et croire connaître ce que l'on ne
sait point. En effet, personne ne connaît la mort, ni
ne sait si elle n'est pas le plus grand de tous les biens
pour l'homme. Cependant on la craint, comme si l'on savait
certainement que c'est le plus grand de tous les maux. Eh !
n'est-ce pas une ignorance bien honteuse que de croire
connaître ce que l'on ne connaît point ?
Pour moi, Athéniens, je suis peut-être en cela
bien différent de tous les autres hommes ; et si je
parais plus sage qu'eux en quelque chose, c'est en ce que, ne
sachant pas bien ce qui se passe après cette vie, je
ne crois pas non plus le savoir. La seule chose que je sache,
c'est que commettre des injustices et désobéir
à ce qui est meilleur que nous et au-dessus de nous,
soit Dieu, soit homme, c'est ce qu'il y a de plus criminel et
de plus honteux. Ainsi, je ne craindrai et ne fuirai jamais
les maux que je ne connais point, et qui sont peut-être
de véritables biens ; mais je craindrai et je fuirai
toujours les maux que je sais certainement être de
véritables maux.
Si vous me disiez donc présentement, malgré les
poursuites d'Anytus, qui vous a représenté
qu'il ne fallait pas m'appeler en justice, ou qu'après
m'y avoir appelé, vous ne sauriez vous dispenser de me
faire mourir, parce que, dit-il, si j'échappais, vos
fils, qui sont déjà si attachés à
la doctrine de Socrate, ne manqueraient pas d'être
entièrement corrompus ; si vous me disiez donc :
Socrate, nous n'avons aucun égard aux instances
d'Anytus, et nous te renvoyons absous ; mais c'est à
condition que tu cesseras de philosopher et de faire tes
recherches accoutumées, et si tu y retombes, et que tu
sois découvert, tu mourras ; si vous me renvoyiez
à ces conditions, je vous répondrais sans
balancer : Athéniens, je vous honore et je vous aime,
mais j'obéirai plutôt au Dieu qu'à vous ;
et tant que je vivrai, je ne cesserai de philosopher, en vous
donnant toujours des conseils, en vous reprenant à mon
ordinaire, et en disant à chacun de vous, quand je
vous rencontrerai : Homme de bien, comment, étant
Athénien, et citoyen de la plus grande cité du
monde et pour la sagesse et pour la valeur, comment n'as-tu
point de honte de ne penser qu'à amasser des
richesses, qu'à acquérir du crédit et
des honneurs, de négliger les trésors de
vérité et de sagesse, et de ne pas travailler
à rendre ton âme aussi bonne qu'elle puisse
être ? Et si quelqu'un me nie qu'il soit en cet
état, et me soutient qu'il a soin de son âme, je
ne le quitterai point sur sa parole ; mais je l'interrogerai,
je l'examinerai, je le réfuterai ; et si je trouve
qu'il ne soit pas vertueux, mais qu'il fasse semblant de
l'être, je lui ferai honte de préférer
des choses si viles et si périssables à celles
qui sont du plus grand prix.
Voilà de quelle manière je parlerai aux jeunes
et aux vieux, aux citoyens et aux étrangers, mais
plutôt aux citoyens, parce que vous me touchez de plus
près ; car sachez que c'est là ce que le Dieu
m'ordonne, et je suis persuadé qu'il n'est jamais
arrivé un si grand bien à votre ville que ce
service continuel que je rends au Dieu. Toute mon occupation,
c'est de travailler à vous persuader, jeunes et vieux,
qu'il ne faut pas tant s'inquiéter de son corps, des
richesses et de toutes les autres choses, que de son
âme ; car je ne cesse de vous dire que la vertu ne
vient point des richesses ; mais, au contraire, que les
richesses viennent de la vertu, et que c'est de là que
naissent tous les autres biens publics et particuliers.
Si, en disant ces sortes de choses, je corromps la jeunesse,
il faut donc que ces maximes soient un poison ; car si on
prétend que je dis autre chose, on se trompe, ou l'on
vous en impose. Après cela, je n'ai qu'à vous
dire : Faites ce que demande Anytus, ou ne le faites pas ;
renvoyez-moi, ou ne me renvoyez pas, je ne ferai jamais autre
chose, quand je devrais mourir mille fois... Mais ne murmurez
pas, Athéniens, et accordez-moi la grâce que je
vous ai demandée d'abord de m'écouter
patiemment : cette patience, je le crois, ne vous sera pas
infructueuse ; car j'ai à vous dire beaucoup d'autres
choses qui, peut-être, vous feront murmurer ; mais
n'écoutez pas votre colère. Soyez
persuadés que si vous me faites mourir, étant
tel que je viens de vous le déclarer, vous vous ferez
plus de mal qu'à moi. En effet, ni Anytus, ni
Mélitus ne sauraient me faire aucun mal ; car le
méchant ne peut rien contre l'homme de bien. Ils me
feront peut-être condamner à la mort, ou
à l'exil, ou à la perte de mes biens et de mes
droits de citoyen ; et ce sont là, aux yeux de
Mélitus et de ses amis, des maux épouvantables
; mais moi je ne suis pas de leur avis. A mon sens, le plus
grand de tous les maux, c'est de faire ce qu'Anytus fait en
ce moment, de chercher à faire mourir un
innocent.
Présentement donc, Athéniens, ce n'est
nullement l'amour de moi que je me défends, on aurait
tort de le croire ; c'est pour l'amour de vous ; car me
condamner, ce serait offenser le Dieu et
méconnaître le présent qu'il vous a fait
: moi mort, Athéniens, vous ne trouverez pas
facilement un autre citoyen que le Dieu ait attaché
à votre ville (la comparaison vous paraîtra
peut-être ridicule), comme à un coursier noble
et généreux, mais appesanti par sa grandeur
même, et qui a besoin de quelque aiguillon qui l'excite
et le réveille. Il me semble que c'est moi que le Dieu
a choisi ainsi pour vous exciter, vous piquer et vous
reprendre tous les jours, sans jamais vous abandonner. Sur ma
parole, vous aurez de la peine, Athéniens, à en
trouver un autre qui s'en acquitte comme moi ; et si vous
voulez m'en croire, vous me laisserez la vie.
Mais peut-être que fâchés comme des gens
qu'on réveille quand ils ont envie de dormir, vous
rejetterez mon conseil, et que, vous dévouant à
la passion d'Anytus, vous me condamnerez bien
légèrement. Qu'en arrivera-t-il ? vous passerez
le reste de votre vie dans un assoupissement profond,
à moins que le Dieu ne prenne pitié de vous et
ne vous envoie encore un homme qui me ressemble.
Or, que ce soit le Dieu qui m'ait donné à votre
ville, voici d'où vous pouvez aisément
l'inférer : c'est qu'il y a quelque chose de plus
qu'humain à avoir négligé pendant tant
d'années mes propres affaires, pour ne m'attacher
qu'aux vôtres, en vous prenant chacun en particulier,
comme un père ou un frère aîné
pourrait faire, et en vous exhortant sans cesse à vous
appliquer à la vertu.
Que si j'avais tiré quelque récompense de mes
exhortations, vous auriez quelque chose à dire ; mais
vous voyez bien que mes accusateurs mêmes, qui m'ont
calomnié avec tant d'impudence, n'ont pourtant pas eu
le front de me reprocher et de me prouver par témoins
que j'aie jamais exigé ni demandé le moindre
salaire ; et je vous offre de la vérité de mes
paroles un irrécusable témoin, ma
pauvreté.
Mais peut-être qu'il paraîtra absurde que je me
sois mêlé de donner à chacun de vous des
avis en particulier, et que je n'aie jamais eu le courage de
me trouver dans vos assemblées du peuple, pour donner
mes conseils à la patrie. Ce qui m'en a
empêché, Athéniens, c'est ce démon
familier, cette voix divine dont vous m'avez si souvent
entendu par1er, et dont Mélitus a fait plaisamment un
chef d'accucusation. Ce démon s'est attaché
à moi dès mon enfance ; c'est une voix qui ne
se fait entendre que lorsqu'elle veut me détourner de
ce que j'ai résolu, car jamais elle ne m'exhorte
à rien entreprendre. C'est elle qui s'est toujours
opposée à moi quand j'ai voulu me mêler
des affaires de la république, et elle s'y est
opposée fort à propos ; car il y a bien
longtemps, croyez-le bien, Athéniens, que je ne serais
plus en vie si je m'étais mêlé des
affaires, et je n'aurais rien avancé ni pour vous, ni
pour moi. Ne vous fâchez point, je vous en prie, si je
ne vous déguise rien : tout homme qui voudra s'opposer
franchement et généreusement à tout un
peuple, soit à vous, soit à d'autres, e qui se
mettra en tête d'empêcher qu'il ne se commette
des iniquités dans la république, ne le fera
jamais impunément. Il faut de toute
nécessité que celui qui veut combattre pour la
justice, pour peu qu'il veuille vivre, demeure simple
particulier, et ne soit pas homme public. Je m'en vais vous
en donner de grandes preuves, non par des paroles, mais, ce
dont vous faites beaucoup plus de cas, par des faits.
Ecoutez donc ce qui m'est arrivé, afin que vous
connaissiez combien je suis incapable de céder
à qui que ce soit, contre la justice, par crainte de
la mort, et que, ne cédant point, il ne se peut que je
ne sois la victime de l'injustice. Je vous dirai des choses
peu agréables, et en homme qui a besoin de plaider son
apologie, mais cependant très vraies.
Vous savez,
Athéniens, que je n'ai jamais exercé aucune
magistrature, et que j'ai été seulement
sénateur (10). La tribu Antiochide,
dont je suis, était justement de tour au
Prytanée, lorsque, contre toutes les lois, vous vous
opiniâtrâtes à faire le procès en
même temps (11) aux dix
généraux qui n'avaient pas enseveli les corps
des citoyens morts au combat naval des Arginuses (12), injustice que vous
reconnûtes, et dont vous vous repentîtes dans la
suite (13). En
cette occasion, je fus le seul des sénateurs qui osai
m'opposer à vous pour vous empêcher de violer
les lois... Je protestai contre votre décret, et
malgré les orateurs qui se préparaient à
me dénoncer, malgré vos menaces et vos cris,
j'aimai mieux courir ce danger avec la loi et la justice que
de consentir avec vous à une si grande
iniquité, par la crainte des chaînes et de la
mort.
Cela se passa pendant que
la ville était encore gouvernée par le peuple ;
mais après qu'on eut établi l'oligarchie, les
trente tyrans (14)
m'ayant mandé, moi cinquième, au Tholos
(15), me
donnèrent l'ordre d'amener de Salamine Léon le
Salaminien, afin qu'on le fît mourir ; car ils
donnaient de ces ordres à beaucoup de personnes, pour
compromettre le plus de citoyens possible dans leurs
iniquités ; et alors je fis voir, non point en
paroles, mais en effet, que je me souciais de la mort, pour
parler grossièrement, comme de rien, et que mon unique
soin était de ne commettre ni impiétés,
ni injustices. Toute la puissance de ces trente tyrans,
quelque redoutable qu'elle fut, ne m'ébranla pas
jusqu'à me faire tremper dans cette iniquité
impie.
Quand nous fûmes sortis du Tholos, les quatre autres
s'en allèrent à Salamine et amenèrent
Léon, et moi, je me retirai dans ma maison ; et il ne
faut pas douter que ma mort n'eût suivi ma
désobéissance, si ce gouvernement n'eût
été aboli bientôt après. Il y a un
assez bon nombre de citoyens qui peuvent témoigner de
ma véracité.
Pensez-vous donc que
j'eusse vécu tant d'années si je me fusse
mêlé des affaires de la république, et
qu'en homme de bien j'eusse foulé aux pieds toutes
sortes d'intérêts pour ne penser qu'à
défendre la justice ? Il s'en faut bien,
Athéniens ; ni moi, ni aucun autre homme ne l'aurions
pu faire. Mais la seule chose que je me suis proposée
toute ma vie, en public et en particulier, c'est de ne jamais
rien céder à qui que ce soit contre la justice,
non pas même à ces tyrans, que mes calomniateurs
veulent faire passer pour mes disciples (16). Je n'ai jamais fait
métier d'enseigner : que s'il y a eu quelques gens,
jeunes ou vieux, qui aient eu envie de me voir à
l'oeuvre, et d'entendre mes entretiens, je ne leur ai pas
refusé cette satisfaction ; car comme je ne parle
point pour de l'argent, je ne me tais pas non plus quand on
ne m'en donne point, toujours également prêt
à me livrer au riche et au pauvre, et à leur
donner tout le loisir de m'interroger, ou, s'ils le
préfèrent, de répondre à mes
questions.
Et si, parmi eux, il s'en trouve qui deviennent
honnêtes gens ou malhonnêtes gens, il ne faut ni
m'en louer, ni m'en blâmer ; ce n'est pas moi qui en
suis la cause, car je n'ai jamais promis de leur rien
apprendre, et en effet, je ne leur ai jamais rien
enseigné ; et si quelqu'un se vante d'avoir appris en
particulier, ou entendu de moi quelque autre chose que ce que
je dis publiquement à tout le monde, soyez bien
persuadés qu'il ne dit pas la
vérité.
Vous savez à présent, Athéniens,
pourquoi la plupart des gens aiment à m'entendre et
à converser si longtemps avec moi ; je vous ai dit la
vérité toute pure : c'est qu'ils prennent un
singulier plaisir à réfuter ces gens qui se
prétendent sages et qui ne le sont point ; car cela
n'est pas désagréable. Aussi, comme je vous
l'ai déjà dit, c'est le Dieu même qui m'a
donné cet ordre par des oracles, par des songes, et de
toutes les autres manières dont la Divinité
peut faire entendre aux hommes ses volontés.
Si ce que je vous dis
n'était pas vrai, il vous serait aisé de me
convaincre de mensonge ; car si je corrompais les jeunes
gens, et que j'en eusse déjà corrompu, il
faudrait que ceux qui sont le plus avancés en
âge, et qui savent en conscience que je leur ai
donné de pernicieux conseils dans leur jeunesse,
vinssent s'élever contre moi et me faire punir ; et
s'ils ne voulaient pas le faire, ce serait le devoir de leurs
parents, comme de leurs pères, de leurs frères,
de leurs oncles, de venir demander vengeance contre le
corrupteur de leurs fils, de leurs neveux ou de leurs
frères ; et j'en vois plusieurs qui sont ici
présents, comme Criton, qui est du même bourg
que moi (17), et
de mon âge, père de Critobule que voici ;
Lysanias de Sphettios (18), père
d'Eschine, que voilà ; Antiphon encore, du bourg de
Céphise (19) et père
d'Epigènes, et beaucoup d'autres dont les
frères ont été en relation avec moi,
comme Nicostrate, fils de Zotidas et frère de
Théodote. Il est vrai que Théodote est mort, et
qu'ainsi il n'a plus besoin du secours de son frère.
Je vois encore Parale, fils de Démodocus et
frère de Théagès ; Adimante, fils
d'Ariston, avec son frère Platon, que vous voyez
devant vous, Eantodore, frère d'Apollodore (20), et un grand nombre
d'autres, parmi lesquels Mélitus était
obligé d'en prendre au moins un ou deux comme
témoins dans la cause.
S'il n'y a pas pensé, il est encore temps, je lui
permets de le faire ; qu'il dise donc s'il le peut ; mais
vous trouverez tout le contraire, Athéniens ; vous
verrez que tous ces gens-là sont disposés
à me défendre, moi qui ai corrompu et perdu
entièrement leurs enfants et leurs frères, s'il
en faut croire Mélitus et Anytus ; car je ne veux pas
faire valoir ici la protection de ceux que j'ai corrompus,
ils pourraient avoir leurs raisons pour me défendre ;
mais leurs parents que je n'ai pas séduits, qui ont
déjà quelque âge, quelle autre raison
peuvent-ils avoir de me protéger, que mon bon droit et
mon innocence ? Ne savent-ils pas que Mélitus est un
menteur, et que je ne dis que la vérité ?
Voilà, Athéniens, les raisons que je puis
employer pour me défendre ; les autres, que je passe
sous silence, sont de même nature.
Mais peut-être s'en trouvera-t-il quelques-uns parmi
vous qui, se souvenant d'avoir été à la
même place où je me trouve aujourd'hui, seront
irrités contre moi de ce que, dans un péril
beaucoup moins grand, ils ont conjuré et
supplié leurs juges avec larmes, et, pour exciter une
plus grande compassion, fait apporter ici leurs enfants, et
fait venir tous leurs parents et tous leurs amis, au lieu que
moi je n'ai point du tout recours à cet attirail, bien
qu'il y ait de l'apparence que je cours le plus grand de tous
les dangers. Peut-être que cette différence se
présentant à leur esprit les aigrira encore
davantage contre moi, et que, dans le moment de cette
indignation, ils donneront leur suffrage avec colère.
S'il y a ici quelqu'un qui soit dans ces sentiments, ce que
je ne saurais croire, mais enfin je le suppose, l'excuse la
plus raisonnable dont je puisse me servir auprès de
lui, c'est de lui dire : Mon ami, j'ai aussi des parents ;
car, pour me servir de l'expression d'Homère :
Je ne suis point sorti d'un chêne ou d'un rocher (Od. XIX, 163),
mais je suis né comme les autres hommes. De sorte,
Athéniens, que j'ai des parents ; j'ai aussi trois
fils, dont l'aîné est dans l'adolescence et les
autres tout enfants ; et cependant je ne les ferai pas
apporter ici, pour vous engager à m'absoudre.
Pourquoi ne le ferai-je pas ? Ce n'est ni par une
opiniâtreté superbe, ni par aucun mépris
pour vous ; et si je regarde la mort avec
intrépidité ou avec faiblesse, c'est une autre
question ; mais c'est pour votre honneur et pour celui de
toute la ville. Il ne me paraît ni beau, ni
honnête que j'aille employer ces sortes de moyens
à l'âge que j'ai, et avec toute ma
réputation, vraie ou fausse ; il suffit que l'opinion
généralement reçue soit que Socrate a
quelque avantage sur la plupart des hommes. Si ceux qui,
parmi vous, passent pour être au-dessus des autres en
sagesse, en courage, ou en quelque autre vertu,
étaient tels, chose honteuse à dire, que j'en
ai vu plusieurs qui, bien qu'ils eussent toujours
passé pour de grands personnages, faisaient pourtant
des choses d'une bassesse étonnante quand on les
jugeait, comme s'ils eussent été
persuadés qu'il leur arriverait un grand mal si vous
les faisiez mourir, et qu'ils deviendraient immortels si vous
veniez à les absoudre : s'ils étaient tels,
dis-je, ils feraient un très grand affront à
cette ville ; car ils donneraient lieu aux étrangers
de penser que, parmi les Athéniens, ceux qui ont le
plus de vertu, et que tous les autres choisissent
préférablement à eux-mêmes pour
les élever aux honneurs et aux dignités, ne
diffèrent en aucune façon des moindres femmes ;
et c'est ce que vous ne devez pas faire, Athéniens,
vous qui avez quelque renom ; et si nous voulions le faire,
vous seriez obligés de nous en empêcher, et de
déclarer que vous condamnerez bien plutôt celui
qui aura recours à ces scènes tragiques pour
exciter la compassion, et qui, par là, rendra votre
ville ridicule, que celui qui attendra tranquillement la
sentence que vous prononcerez.
Mais sans parler de l'opinion, Athéniens, il ne me
paraît pas juste de prier son juge, ni de se faire
absoudre par ses supplications. Il faut le persuader et le
convaincre : car le juge n'est pas assis sur son siège
pour faire plaisir en violant la loi, mais pour rendre
justice en obéissant à la loi. C'est ainsi
qu'il l'a juré par serment : il n'est pas en son
pouvoir de faire grâce à qui il lui plaît
; il est obligé de faire justice. Il ne faut donc pas
que nous vous accoutumions au parjure, et vous ne devez pas
vous y laisser accoutumer ; car les uns et les autres nous
serions également coupables envers les dieux.
N'attendez donc point de moi, Athéniens, que j'aie
recours auprès de vous à des choses que je ne
crois ni honnêtes, ni justes, ni pieuses, et que j'y
aie recours surtout dans une occasion où je suis
accusé d'impiété par Mélitus ;
car si je vous fléchissais par mes prières, et
vous forçais à violer votre serment, ce serait
une chose tout évidente que je vous enseignerais
à ne pas croire aux dieux, et en voulant me justifier,
je prouverais contre moi-même que je ne crois point aux
dieux. Mais il s'en faut bien, Athéniens, que je sois
dans cette croyance. Je suis plus persuadé de
l'existence de Dieu qu'aucun de mes accusateurs ; et j'en
suis si persuadé, que je m'abandonne à vous et
au Dieu de Delphes, afin que vous me jugiez comme vous le
trouverez le mieux et pour vous et pour moi.
Quand Socrate eut
ainsi parlé les juges opinèrent, et la
condamnation passa à une majorité de six voix
qui le déclara coupable (21). Après cela,
Socrate reprit la parole.
Je ne suis
nullement ému, Athéniens, du jugement que vous
venez de prononcer, et pour plusieurs raisons : la
principale, c'est que j'y étais tout
préparé. Je suis bien plus surpris du nombre de
voix pour ou contre ; je n'espérais pas être
condamné par un si petit nombre de suffrages.
Présentement je vois qu'il n'a tenu qu'a trois voix
que je n'aie été absous. Il me semble donc que
j'ai échappé à Mélitus ; et
non-seulement je lui ai échappé, mais il est
évident que si Anytus et Lycon ne se fussent
levés pour m'accuser, il aurait perdu ses drachmes
(22), n'ayant pas
obtenu la cinquième partie des voix.
Mélitus me juge
donc digne de mort, à la bonne heure ; et moi, de
quelle peine (23)
me jugerai-je digne, Athéniens, vous verrez clairement
que je ne choisis que ce que je mérite. Qu'est-ce donc
? et à quelle peine, ou à quelle amende vais-je
me condamner, pour n'avoir pas tu ce que j'ai appris de bon
dans toute ma vie, pour avoir négligé ce que
les autres recherchent avec tant d'empressement, les
richesses, le soin de ses affaires domestiques, les emplois
et les dignités, pour n'être jamais entré
dans aucune cabale , ni dans aucune conjuration, pratiques
assez ordinaires dans cette ville ; car je me suis toujours
connu trop honnête homme pour vouloir conserver ma vie
par ces indignes moyens. D'ailleurs, vous savez que je n'ai
jamais voulu prendre aucune profession où je n'aurais
pu travailler en même temps à votre
utilité et à la mienne, et que mon unique but a
été de vous procurer à chacun en
particulier le plus grand de tous les biens, en vous
persuadant de n'avoir soin d'aucune des choses qui sont
à vous, avant que de prendre soin de vous-mêmes,
pour vous rendre très sages et très parfaits,
comme il faut avoir soin de la ville, avant que de penser aux
choses qui sont à la ville ; et ainsi de tout le
reste.
Après cela, de quoi
suis-je digne ? d'un grand bien, sans doute,
Athéniens, si vous proportionnez véritablement
la récompense au mérite, et d'un grand bien qui
puisse convenir à un homme tel que moi : or, qu'est-ce
qui convient à un homme pauvre, qui est votre
bienfaiteur, et qui a besoin d'un grand loisir pour ne
s'employer qu'à vous exhorter ? Rien ne lui convient
tant, Athéniens, que d'être nourri dans le
Prytanée ; cela lui est bien plus dû qu'à
ceux d'entre vous qui ont remporté le prix des courses
des chevaux et de chariots aux jeux Olympiques (24) : car ceux-ci, par
leurs victoires, ne rendent heureux qu'en apparence, et moi
je vous rends véritablement heureux. D'ailleurs, ils
n'ont pas besoin de ce secours, et j'en ai besoin. S'il faut
donc en toute justice m'adjuger une récompense digne
de moi, voilà celle que je mérite, c'est
d'être nourri au Prytanée.
Quand je vous parle ainsi, Athéniens, vous m'accuserez
peut-être de vous parler avec l'entêtement et
l'arrogance qui m'ont fait rejeter tout à l'heure les
lamentations et les prières. Mais ce n'est nullement
cela.
Mon motif,
Athéniens, c'est que j'ai la conviction de n'avoir
jamais fait le moindre tort à personne, le voulant et
le sachant. Je ne puis pas vous le persuader aujourd'hui, le
temps qui me reste est trop court. Si vous aviez une loi qui
ordonnât qu'un jugement de mort durera plusieurs jours,
comme cela se pratique ailleurs, et non pas un seul (25), je suis
persuadé que je vous convaincrais. Mais le moyen de
détruire tant de calomnies dans un si petit espace de
temps ? Etant donc bien convaincu que je n'ai fait tort
à personne, comment m'en ferais-je à
moi-même, en avouant que je mérite d'être
puni, et en me condamnant moi-même à une peine ?
Quoi ! pour ne pas subir le supplice auquel me condamne
Mélitus, supplice dont je ne sais véritablement
s'il est un bien ou un mal, irai-je choisir quelqu'une de ces
peines que je sais certainement être des maux, et m'y
condamnerai-je moi-même ? sera-ce une prison
perpétuelle ? Mais qu'ai-je affaire de vivre toujours
esclave des Onze (26) ? Sera-ce à
une amende, et la prison jusqu'à ce que je l'aie
payée ? Mais cela revient au même ; car je n'ai
pas de quoi la payer. Me condamnerai-je donc à l'exil
? Peut-être confirmeriez-vous ma sentence. Mais il
faudrait que l'amour de la vie m'eût bien
aveuglé, Athéniens, si je ne voyais pas que si
vous, qui êtes mes concitoyens, vous n'avez pu souffrir
ma conversation ni mes maximes, et si elles vous ont
été tellement à charge, que vous n'avez
point eu de cesse jusqu'à ce que vous vous soyez
défaits de moi, à plus forte raison les autres
ne pourront les supporter. La belle vie à mener pour
Socrate, si à son âge, chassé
d'Athènes, il allait errer de ville en ville comme un
vagabond et comme un banni ! Je sais bien que partout
où j'irai les jeunes gens m'écouteront comme
ils m'écoutent ici : si je les rebute, ils me feront
chasser par leurs pères, et si je ne les rebute pas,
leurs pères et leurs parents me chasseront à
cause d'eux.
Mais quelqu'un me dira, peut-être : Quoi ! Socrate,
quand tu nous auras quittés, ne pourras-tu te tenir en
repos, et garder le silence ? Je vois bien que c'est
là ce qu'il y a de plus difficile à faire
entendre à certains d'entre vous ; car si je vous dis
que me taire, ce serait désobéir au Dieu, et
que par cette raison il m'est impossible de garder le
silence, vous ne me croirez point, et vous regarderez cela
comme une ironie ; et si, d'un autre côté, je
vous dis que le plus grand bien de l'homme , c'est de parler
de la vertu tous les jours de sa vie, et de s'entretenir de
toutes les autres choses dont vous m'avez entendu discourir,
soit en m'examinant moi-même, soit en examinant les
autres, car une vie sans examen n'est pas une vie, vous me
croirez encore moins. Cela est, Athéniens, comme je
vous le dis, quoique vous ne puissiez le croire. Enfin je ne
suis point accoutumé à me juger digne d'aucune
peine. Véritablement, si j'étais riche, je me
condamnerais à une amende telle que je pourrais la
payer, car cela ne me ferait aucun tort ; mais je ne le peux
pas, n'ayant rien, à moins que vous ne vouliez que
l'amende soit proportionnée à mon indigence ;
et je pourrais peut-être payer environ une mine
d'argent : c'est à quoi je me condamne. Mais Platon,
que voilà, Criton, Critobule et Apollodore veulent que
je pousse jusqu'à trente mines, dont ils
répondent. Je me condamne donc à trente mines ;
et voilà mes cautions, qui sont certainement
très solvables.
Socrate s'étant condamné lui-même
à l'amende, pour obéir à la loi, les
juges délibèrent, et ils le condamnent à
la mort. Socrate reprend la parole :
En vérité, Athéniens, par trop
d'impatience et de précipitation, vous allez vous
charger d'un grand reproche, et donner lieu à vos
envieux d'accuser la république d'avoir fait mourir
Socrate, cet homme sage ; car, pour aggraver votre honte, ils
m'appelleront sage, quoique je ne le sois point. Au lieu que
si vous aviez attendu encore un peu de temps, ma mort venait
d'elle-même, et vous auriez eu ce que vous demandez ;
car vous voyez bien qu'à mon âge on est bien
près de la mort. Je ne dis pas cela pour tous mes
juges, mais seulement pour ceux qui m'ont condamné
à la mort, c'est à ceux-là que je
m'adresse encore. Pensez-vous donc que j'aurais
été condamné, si j'avais cru devoir tout
faire et tout employer pour me tirer de vos mains, et
croyez-vous que j'aurais manqué de paroles touchantes
et persuasives ? Ce ne sont pas les paroles qui m'ont
manqué, Athéniens, c'est l'impudence, c'est
l'envie de vous faire plaisir en vous disant les choses que
vous aimez tant à entendre. Ç'aurait
été, sans doute, une grande satisfaction pour
vous, de me voir lamenter, soupirer, pleurer, prier et faire
toutes les autres bassesses que vous voyez faire tous les
jours aux accusés. Mais dans ce danger je n'ai pas cru
devoir m'abaisser à une chose si lâche et si
honteuse, et après votre arrêt je ne me repens
pas de n'avoir pas commis cette indignité, car j'aime
beaucoup mieux mourir après m'être
défendu comme j'ai fait, que de vivre pour vous avoir
priés. Ni en justice, ni à la guerre, un
honnête homme ne doit sauver sa vie par toutes sortes
de moyens. Il arrive souvent dans les combats qu'on peut
très facilement sauver sa vie en jetant ses armes et
en demandant quartier à son ennemi ; il en est de
même dans tous les autres dangers : on trouve mille
expédients pour éviter la mort, quand on est
capable de tout dire et de tout faire. Eh ! ce n'est pas
là ce qui est difficile, Athéniens, que
d'éviter la mort ; mais il l'est beaucoup
d'éviter la honte ; elle vient plus rapidement que la
mort. C'est pourquoi présentement, vieux et pesant
comme je suis, j'ai été atteint et pris par la
plus lente ; et mes accusateurs, gens agiles et robustes, ont
été atteints par celle qui marche le plus
légèrement, par l'infamie. Je m'en vais donc
être livré à la mort par votre ordre ; et
ceux-là vont être livrés à
l'infamie et à l'injustice par la force de la
vérité. Pour moi, je suis content de mon
arrêt ; ils le sont aussi du leur. C'est ainsi que cela
devait être, et le partage ne pouvait être mieux
fait.
Après cela, ô vous qui m'avez condamné,
je veux vous prédire ce qui vous arrivera, car me
voilà dans le moment où les hommes sont le plus
capables de prophétiser l'avenir, lorsque la mort
approche. Je vous l'annonce donc, ô vous qui m'aurez
fait mourir ! Votre châtiment ne tardera pas, quand je
serai mort, et, par Jupiter, il sera plus cruel que cette
mort que vous m'infligez. En vous défaisant de moi,
vous n'avez cherché qu'à vous décharger
de l'importun fardeau de rendre compte de votre vie ; mais il
vous arrivera tout le contraire, je vous le
prédis.
Il s'élèvera contre vous un bien plus grand
nombre de gens qui vous reprendront ; ils étaient
retenus par ma présence, et vous ne vous en aperceviez
point ; mais après ma mort ils seront d'autant plus
importuns et plus difficiles qu'ils sont plus jeunes, et vous
en serez bien plus piqués ; car si vous pensez qu'il
suffit de tuer les gens pour empêcher les autres hommes
de vous reprocher que vous vivez mal, vous vous trompez.
Cette manière de se délivrer de ses censeurs
n'est ni honnête, ni possible. Celle qui est en
même temps et très honnête et très
facile, c'est, non de fermer la bouche aux hommes, mais de se
rendre meilleur : cela suffit pour ceux qui m'ont
condamné, et je puis les quitter.
Mais pour vous qui m'avez absous par vos suffrages,
Athéniens, je m'entretiendrai volontiers avec vous
pendant que les Onze sont occupés, et qu'on ne me
mène pas encore où je dois mourir. Donnez-moi
donc, je vous prie, un moment d'attention, car rien
n'empêche que nous ne nous entretenions ensemble,
puisque j'en ai encore le loisir. Je veux vous dire, comme
à des amis, une chose qui vient de m'arriver, et vous
expliquer ce qu'elle signifie. Oui, mes juges (et en vous
appelant de ce nom je ne me trompe point), il m'est
arrivé aujourd'hui une chose bien merveilleuse. La
voix divine de mon démon familier, qui m'avertissait
si souvent, et qui dans les moindres occasions ne manquait
jamais de me détourner de tout ce que j'allais
entreprendre de mal, aujourd'hui qu'il m'arrive ce que vous
voyez, et ce que la plupart des hommes prennent pour le plus
grand de tous les maux, cette voix ne m'a rien fait entendre,
ni ce matin quand je suis sorti de ma maison, ni lorsque je
suis venu devant ce tribunal, ni lorsque j'ai commencé
à vous parler. Cependant il m'est arrivé
très souvent qu'elle m'a interrompu au milieu de mes
discours : et aujourd'hui, elle ne s'est opposée
à quoi que ce soit que j'aie pu dire ou faire.
Qu'est-ce que cela peut signifier ? Je vais vous le dire.
C'est qu'il y a de l'apparence que ce qui m'arrive est un
grand bien ; et nous nous trompons tous, sans doute, si nous
pensons que la mort soit un mal. Une preuve bien
évidente, c'est que, si je n'avais pas dû
accomplir aujourd'hui quelque bien, le Dieu n'aurait pas
manqué de m'en avertir à son ordinaire.
Approfondissons un peu la chose, pour faire voir que c'est
une espérance bien fondée, que ia mort est un
bien.
Il faut de deux choses l'une, ou que la mort soit un absolu
anéantissement et une privation de tout sentiment, ou,
comme on dit, un passage de l'âme d'un lieu dans un
autre. Si elle est la privation de tout sentiment, un
paisible sommeil, qui n'est troublé par aucun songe,
quel merveilleux avantage n'est-ce pas que de mourir ? car si
quelqu'un, après avoir passé une nuit bien
tranquille, sans aucune inquiétude, sans aucun
trouble, sans le moindre songe, la comparait avec toutes les
autres nuits et tous les autres jours qu'il a passés,
et qu'il fût obligé de dire en conscience
combien il aurait passé de jours et de nuits dans
toute sa vie plus heureusement que cette nuit-là, je
suis persuadé non seulement qu'un simple particulier,
mais que le grand roi lui-même, en trouverait un bien
petit nombre, et qu'il serait très aisé de les
compter. Si la mort est quelque chose de semblable, je
l'appelle justement un bien ; car le temps tout entier n'est
plus alors qu'une longue nuit.
Mais si la mort est un passage de ce lieu dans un autre, et
que ce qu'on dit soit véritable que là-bas est
le rendez-vous de tous ceux qui ont vécu, quel plus
grand bien peut-on imaginer, mes juges ? car si en quittant
ceux qui contrefont ici les juges, on trouve dans les enfers
les véritables juges, qui y rendent, dit-on, la
justice, Minos, Rhadamanthe, Eaque, Triptolème et tous
les autres demi-dieux qui ont été justes
pendant leur vie, ce changement n'est-il pas heureux ? A quel
prix n'achèteriez-vous pas le bonheur de vous
entretenir avec Orphée, Musée, Hésiode,
Homère ? Pour moi, si cela est véritable, je
mourrais volontiers mille fois. Dans quels transports de joie
ne serais-je point quand je me trouverais avec
Palamède, avec Ajax fils de Télamon, et avec
tous les autres héros de l'antiquité qui ont
été les victimes de l'injustice ? Quel
agrément de comparer mes aventures avec les leurs !
mais un agrément infiniment plus grand pour moi serait
de passer les jours là aussi à interroger et
à examiner tous ces personnages, pour distinguer ceux
qui sont véritablement sages d'avec ceux qui croient
l'être et ne le sont point. Est-il quelqu'un, mes
juges, qui ne donnât tout ce qu'il a au monde pour
examiner celui qui mena une si nombreuse armée contre
Troie ou Ulysse, ou Sisyphe et tant d'autres, hommes et
femmes, dont la conversation et l'examen seraient une
félicité inexprimable ? Ceux-là ne
feraient mourir personne pour cet examen, car, outre qu'ils
sont plus heureux que nous en toutes choses, ils jouissent de
l'immortalité, s'il faut croire ce qu'on a dit.
C'est pourquoi, mes juges, vous ne devez avoir que des
espérances en la mort, persuadés de cette
vérité qu'il n'y a aucun mal pour l'homme de
bien, ni pendant sa vie, ni après sa mort, et que les
dieux ont toujours soin de tout ce qui le regarde ; car ce
qui m'arrive présentement n'est point l'effet du
hasard, et je suis très convaincu que le mieux est
pour moi de mourir dès à présent, et
d'être délivré de tous les soucis de
cette vie. Voilà pourquoi la voix divine ne m'a rien
dit aujourd'hui. Je n'ai donc aucun ressentiment contre mes
accusateurs, ni contre ceux qui m'ont condamné,
quoique leur intention n'ait pas été de me
faire du bien, et qu'ils n'aient cherché qu'à
me nuire ; en quoi j'aurais bien quelque sujet de me plaindre
d'eux. Mais je leur demanderai une seule grâce. Je vous
prie, lorsque mes enfants seront grands, de les tourmenter
comme je vous ai tourmentés vous-mêmes, si vous
voyez qu'ils préfèrent les richesses à
la vertu, et qu'ils se croient quelque chose, quoiqu'ils ne
soient rien : ne manquez pas de leur faire honte de ce qu'ils
ne s'appliquent pas aux choses qui méritent tous leurs
soins, et croient être ce qu'ils ne sont point ; car
c'est ainsi que j'en ai usé envers vous. Si vous
m'accordez cette grâce, moi et mes enfants n'aurons
qu'à nous louer de votre justice. Mais il est temps
que nous nous retirions chacun de notre côté,
moi pour mourir, et vous pour vivre. Qui de vous ou de moi
tient la meilleure part ? c'est ce qui n'est connu de
personne, excepté de Dieu.
(1) Les derniers
accusateurs de Socrate étaient Anytus, Mélitus
et Lycon. Anytus était un rhéteur, qui,
après la mort de Socrate, fut contraint de s'exiler
à Héraclée, dans le Pont, où il
fut, dit-on, lapidé. Lycon était orateur
public. Ce fut lui qui dirigea l'accusation. Sur
Mélitus, voir Euthyphron.
(2) Socrate traite les
calomnies d'Aristophane et de ses premiers ennemis comme une
accusation faite en justice avec toutes les formalités
requises et les serments prêtés ; car il fallait
que l'accusateur et l'accusé jurassent tous deux
qu'ils n'emploieraient que la vérité : c'est ce
qu'on appelait antômosia.
(3) Il s'agit ici de la
comédie des Nuées,
spécialement composée pour ridiculiser Socrate.
Elle fut jouée vers l'an 423 avant J.-C.
(4) Gorgias était un
des principaux sophistes du temps de Socrate. Envoyé
de Léontium (Sicile), sa patrie, à
Achènes, pour demander du secours, il fut retenu par
les Athéniens, charmés de son éloquence.
Son scepticisme fit bon nombre de prosélytes. Il
composa un livre intitulé : Du non-être, ou
de la nature, dans lequel il voulut démontrer :
1° que rien n'existe ; 2° que si quelque chose
existe, on ne peut le connaître ; 3° que si quelque
chose existe et peut être connu, on ne peut le faire
connaître aux autres. Prodicus, autre sophiste, connu
pour faire payer fort cher ses leçons. Le bel apologue
d'Hercule adolescent sollicité par le Vice et la Vertu
est de lui. Hippias, autre sophiste, sur lequel on peut
consulter les deux dialogues où Platon l'a mis en
scène, le premier et le second Hippias.
(5) On appelait ainsi les
poètes qui faisaient des hymnes en l'honneur de
Bacchus.
(6) Voici le texte de
l'accusation tel qu'il est donné par
Diogène-Laerce (liv. II, chap. XL) :
Mélitus, fils de Mélitus, du bourg de
Pithos, accuse par serment Socrate, fils de Sophronisque, du
bourg d'Alopèce. Socrate est coupable en ce qu'il ne
reconnaît pas les dieux de la république, et met
à leur place des extravagances démoniaques. Il
est coupable en ce qu'il corrompt les jeunes gens. Peine, la
mort.
(7) Diogène-Laerce
dit au liv. II, chap. VIII : Anaxagore de
Clazomène, élève d'Anaximènes,
prétendait que le soleil n'est qu'une masse de fer ou
de pierre, et la lune une terre comme celle que nous
habitons.
(8) Euripide, disciple
d'Anaxagore, avait fait allusion dans plusieurs de ses
tragédies aux doctrines de son maître, notamment
sur la nature de la terre et du soleil.
(9) Socrate se distingua
par sa valeur dans les deux premiers sièges ; et
à la bataille de Délium, il sauva la vie
à Xénophon, son disciple, et à
Alcibiade, son ami. - Voir le Banquet.
(10) Le peuple
d'Athènes était partagé en dix tribus,
de chacune desquelles on prenait tour à tour cinquante
citoyens, qui gouvernaient pendant trente-cinq jours ; on les
appelait les Prytanes, et le temps de leur gouvernement une
Prytanie. Pour leur ôter tout autre souci que celui des
affaires publiques, ils étaient nourris aux frais de
la république dans le Prytanée. La
réunion des cinq cents Prytanes formait le
sénat.
(11) La loi commandait de
faire à chacun des accusés son procès
séparément.
(12) Ce combat fut
donné par Callicratidas, général des
Lacédémoniens, contre les dix
généraux athéniens. Ces derniers
remportèrent la victoire. Xénophon le
décrit dans le premier livre de l'histoire
grecque.
(13) Ils
ordonnèrent que ceux qui avaient séduit le
peuple seraient appelés en justice comme
calomniateurs.
(14) Les trente tyrans
furent établis la première année de
l'olympiade XCXIV (404 av. J.-C.). Socrate avait alors
soixante-quatre ou soixante-cinq ans.
(15) Le Tholos
était une salle voûtée, voisine de
l'édifice où s'assemblaient les Cinq-Cents,
dans laquelle les Prytanes sacrifiaient, prenaient leur
nourriture, et se tenaient en permanence. (Voir Pausanias, 1,
5, 1.) Là siégèrent aussi les
Trente.
(16) Allusion à
Critias, l'un des trente tyrans.
(17) Le bourg
d'Alopèce, de la tribu Antiochide.
(18) Bourg de la tribu
Acamantide.
(19) De la tribu
Erechtéide.
(20) Cet Apollodore
était aussi présent ; il aimait
extrêmement Socrate. Quand Socrate fut condamné,
comme on le menait en prison, il se mit à crier :
Socrate, ce qui m'afflige le plus, c'est de te voir mourir
innocent. Socrate, lui passant doucement la main sur la
tête, lui dit en riant : Mon ami, aimerais-tu mieux
me voir mourir coupable ?
(21) Les juges, au nombre
de 556, opinèrent ainsi : 281 contre, 275 pour
Socrate. Avec 3 voix de plus en sa faveur, les suffrages se
seraient balancés, et Socrate était
absous.
(22) Il fallait que
l'accusateur eût la moitié des voix, et encore
un cinquième, autrement il était
condamné à l'amende de mille drachmes. Les
partisans de Mélitus n'auraient pu former cette
majorité à eux seuls : ils ne la durent
qu'à l'adjonction de toutes les voix des partisans de
Lycon et d'Anytus.
(23) Pour entendre ceci,
il faut savoir que quand un accusé était
jugé coupable et que l'accusateur demandait sa
condamnation à mort, la loi permettait à
l'accusé de se condamner lui-même à une
de ces trois peines : la prison perpétuelle, l'amende
ou l'exil, ce que l'on appelait upotimasthai. La loi
avait établi cela en faveur des juges, afin qu'ils
n'eussent aucun scrupule de condamner un homme qui, en se
condamnant lui-même, se déclarait coupable de
son propre aveu. Socrate n'eut garde de donner dans ce
piège ; aussi Xénophon dit qu'il ne se condamna
point, et qu'il ne permit pas à ses amis de le faire,
disant que ce serait avouer le crime ; mais pour obéir
à la loi, au lieu d'une peine, il s'adjuge une
récompense digne de lui.
(24) Les vainqueurs aux
jeux Olympiques et les citoyens qui avaient rendu de grands
services étaient nourris au Prytanée, avec les
cinquante sénateurs en charge.
(25) Tout procès,
à Athènes, devait être jugé en un
jour.
(26) C'étaient les
magistrats chargés de la surveillance des prisons.
Traduction de Dacier et Grou, notes d'E. Chauvet et A. Saisset - Charpentier, Paris (1869)