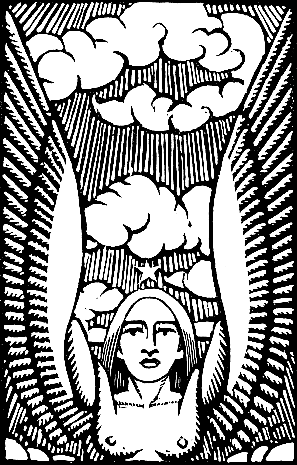 |
La Philosophie me disait toutes ces choses avec autant de majesté que de douceur ; elle allait reprendre la parole, lorsque, pressé par le chagrin que j'avais encore au fond de mon coeur, je l'arrêtai en lui disant :
«Toutes les vérités dont vous m'avez entretenu jusqu'à ce moment, me paraissent invinciblement établies, et par la solidité de vos raisons, et par l'évidence dont elles portent le divin caractère en elles-mêmes ; mais vous ne m'avez rien appris d'absolument nouveau. Vous n'avez fait que me rappeler ce que la force de la douleur m'avait fait entièrement oublier. Mais pour guérir entièrement cette douleur qui m'accable, il faudrait en détruire la cause, et la voilà. Je suis inconsolable de voir qu'un Dieu souverainement bon souffre que le mal se fasse, et le laisse impuni. Vous conviendrez que cette seule idée suffit pour jeter l'âme dans la plus grande consternation : mais voici ce qui m'alarme encore davantage. Tandis que la méchanceté prospère et règne ici-bas, la vertu non seulement est privée des justes récompenses qu'elle mérite, mais abattue, méprisée, les méchants la foulent aux pieds, et lui font souffrir les peines qui ne sont dues qu'aux crimes ; et cela se passe sous l'empire d'un Dieu qui sait tout, qui peut tout, et qui ne veut que le bien ! Voilà ce dont on ne peut ni assez s'étonner ni trop se plaindre.
- Ce serait sans doute, me répondit-elle, le renversement le plus déplorable et le plus monstrueux si, comme tu te l'imagines, dans une maison aussi bien réglée que celle du souverain Père de famille, ce qu'il y a de plus vil était en honneur, tandis que ce qu'il y a de plus précieux serait dans l'humiliation et dans le mépris. Mais il n'en est pas ainsi ; car en posant pour principes les vérités que nous venons d'établir, tu comprendras, avec l'aide de celui dont le gouvernement est le sujet de notre entretien, que la vraie puissance est le partage des bons, et que les méchants sont toujours faibles et méprisables ; que le vice n'est jamais sans châtiment, ni la vertu sans récompense ; que les gens de bien sont toujours véritablement heureux, et les méchants toujours réellement malheureux, et plusieurs autres vérités semblables qui feront cesser tes plaintes, et te rempliront d'un courage à toute épreuve. Et puisque je t'ai fait connaître la nature et le séjour de la béatitude, je crois que, sans m'arrêter à bien des choses qui ne sont pas absolument nécessaires, je dois te montrer tout de suite le chemin qui doit te conduire à ta véritable patrie. Je donnerai des ailes à ton âme, afin que sortant de l'abattement où elle est plongée, elle puisse s'élever à cette patrie désirable. Je lui en montrerai le chemin ; je lui servirai de guide, et je lui fournirai tous les moyens nécessaires pour y parvenir en sûreté.
J'ai des ailes capables de me porter au-dessus des nues : par leur secours, l'âme méprisant ces bas lieux, s'élève dans les airs, laisse derrière elle les nuages et les tempêtes, vole au-dessus de la sphère du feu, pénètre jusqu'à ces maisons brûlantes que le soleil habite successivement ; elle suit ce bel astre dans toute sa course ; elle s'élève au-dessus de la plus haute des planètes, s'élance impétueusement d'un pôle à l'autre, parvient jusqu'au plus haut de l'empirée, et vole ensuite au séjour de la lumière éternelle. C'est là que le roi des rois a établi son trône sur des fondements inébranlables. C'est de là qu'il gouverne le monde, et que, quoique immuable, il se porte partout sur son char rapide. Si tu as le bonheur de revenir un jour dans cette demeure auguste que tu cherches sans te ressouvenir que tu l'as connue, tu t'écrieras : «Ah ! voilà ma patrie, je m'en souviens ; c'est de là que je suis sorti ; c'est là que je veux demeurer éternellement». Alors, si du haut de ce séjour de lumière tu daignes abaisser tes yeux sur ces ténèbres épaisses qui couvrent la face de la terre, tu verras que ces fiers tyrans qui font trembler des peuples, ne sont, malgré toute leur grandeur, que de vils esclaves, que de malheureux exilés.
- Vous me faites là de bien magnifiques promesses : hâtez-vous de les remplir ; car je ne doute point que vous ne soyez en état de le faire : hâtez-vous de satisfaire les désirs que par ces promesses vous avez fait naître dans mon coeur.
- Je le veux bien, me répondit-elle, et je commence par te faire voir que les gens de bien sont toujours véritablement puissants, et que les méchants sont la faiblesse même. Ces deux propositions se démontrent l'une par l'autre ; car le bien et le mal étant deux contraires, dont les qualités s'excluent mutuellement, si les gens de bien sont puissants, il s'ensuit que les méchants ne le sont pas ; et si je montre, au contraire, que les méchants sont sans puissance, il est évident qu'elle est le partage des gens de bien. Mais pour rendre ma démonstration plus complète, je ne m'en tiendrai pas à l'une de ces deux propositions ; je les démontrerai alternativement l'une et l'autre. Il y a deux principes qui concourent nécessairement aux actions des hommes : la volonté et le pouvoir. Le défaut de l'une ou de l'autre est un obstacle insurmontable à tous les actes humains. Car si le vouloir manque, l'homme n'essaie seulement pas d'agir ; et s'il manque de pouvoir, en vain s'efforcerait-il de le faire. Ainsi, quand tu vois quelqu'un ne point parvenir à ce qu'il désire avec ardeur, tu conclus d'abord qu'il n'en a pas le pouvoir ; et, par une conséquence contraire, s'il y parvient, tu ne doutes point qu'il n'ait été puissant à cet égard. Or, tu ne doutes pas non plus que la force consiste à pouvoir agir, et la faiblesse à ne le pouvoir pas.
- Rien n'est plus clair que ce raisonnement.
- Eh bien ! continua-t-elle, te souviens-tu que je t'ai montré que tous les hommes, par un penchant naturel, tendent à la béatitude, quoiqu'ils prennent différentes routes pour y parvenir ? Te rappelles-tu aussi que la béatitude et le bien sont une même chose, et qu'ainsi on ne peut aspirer à celle-là sans aspirer à l'autre ? Par conséquent, tous les hommes, les méchants comme les bons, tendent naturellement au bien. Or, il est certain que les bons ne sont tels que parce qu'ils parviennent au bien : ils parviennent donc au but de leurs désirs ; et les méchants, au contraire, cesseraient de l'être, s'ils parvenaient à ce but désirable. Reprenons ce raisonnement en peu de mots. Les bons et les méchants tendent naturellement au bien : les premiers y parviennent, les autres n'y parviennent pas ; les premiers ont donc en partage le pouvoir dont il faut nécessairement que les autres manquent, puisqu'ils n'y parviennent pas.
- Cela, lui dis-je, me paraît indubitable et fondé sur la nature des choses, et sur les conséquences les plus justes.
- Supposons, reprit-elle, que de deux hommes qui ont tous les deux le même projet, l'un l'accomplisse naturellement, et que l'autre, prenant toute autre route que celle que la raison lui dicte, ne parvînt point à l'accomplir, et ne fît que l'imiter, lequel des deux croirais-tu le plus puissant ? Et pour te faire mieux comprendre mon idée : marcher, n'est-il pas vrai, est un mouvement naturel à l'homme ; ses pieds sont naturellement destinés à cet office. Si donc, pour marcher, l'un ne se sert que de ses pieds, et que l'autre ait besoin, pour le faire, de se servir encore de ses mains, lequel des deux penses-tu être le plus fort ? Certainement, c'est celui qui, tout naturellement et sans effort, fait ce que l'autre ne peut faire.
Mais tu me demanderas peut-être à quoi nous mène ce raisonnement. Le voici. Le souverain bien est l'objet désirable dont l'acquisition est proposée aux méchants comme aux bons : ceux-ci y parviennent naturellement par le véritable chemin, qui est celui de la vertu ; les méchants, au contraire, s'efforcent inutilement d'y parvenir, parce qu'ils suivent les routes égarées que leurs passions leur font prendre.
- J'entends cela, et j'en conclus avec vous, ainsi que des principes dont j'étais convenu, que la vraie puissance est le partage des bons, et la faiblesse, celui des méchants.
- Tu vas droit à la vérité, et c'est une marque assurée des progrès de ta convalescence. Mais, pour mettre à profit les heureuses dispositions où je te vois, je veux entrer dans un plus grand détail, et te donner de nouvelles preuves. Tu vois déjà quelle est la faiblesse des méchants qui ne peuvent parvenir à ce but commun, où les porte si fortement le penchant de la nature ; penchant impérieux et presque invincible, et qui pourtant est en eux sans effet. Que leur impuissance est donc grande, et qu'elle est funeste ! Car ce n'est pas seulement de quelques avantages frivoles qu'ils se voient privés, mais de la seule chose essentielle. Ils la cherchent sans cesse ; ils courent après elle jour et nuit, et, les misérables qu'ils sont ! ils ne peuvent jamais l'atteindre ; leurs vains efforts ne font que manifester leur faiblesse, tandis que les gens de bien font à cet égard le plus heureux usage de la supériorité de leurs forces. Tu regarderais, en effet, comme supérieur en force et en vigueur, celui qui, de son pied, parviendrait au bout de l'univers ; tu dois donc regarder comme un prodige de force, celui qui est parvenu au but suprême, à ce but où se terminent et ses désirs et nos idées. Par la raison contraire, tout scélérat est rempli de faiblesse. Car pourquoi les méchants se livrent-ils au vice ? Est-ce parce qu'ils ignorent le vrai bien ? Une semblable ignorance est la preuve certaine de la petitesse de leur génie. Connaissent-ils leurs devoirs, et ne s'en écartent-ils que parce que la convoitise et les passions les en éloignent et les précipitent dans l'abîme du vice ? Nouvelle preuve de leur faiblesse, puisqu'ils ne peuvent résister à ces ennemies de leur bonheur. Est-ce avec une pleine connaissance et une volonté décidée qu'ils abandonnent la vertu pour se livrer au crime ? En ce cas, non seulement je ne leur connais plus de vraie force, mais je ne les regarde plus comme des hommes. Car c'est n'être plus rien que de ne pas tendre à ce qui est la fin de tout ce qui existe. Quand je dis que les méchants, qui font le plus grand nombre des hommes, ne sont rien, cela paraît un paradoxe étrange. Rien de plus vrai pourtant ; car je ne nie pas qu'ils existent en qualité d'hommes méchants, mais je nie qu'ils soient simplement, et à proprement parler, des hommes. Un cadavre est un homme mort, mais ce n'est point véritablement un homme. Ainsi, les méchants sont des hommes vicieux ; mais ils ne méritent point au vrai la qualité d'hommes. Car pour être quelque chose, il faut en conserver le rang et le caractère ; dès qu'on s'en écarte, on cesse d'être ce qu'on était. Mais les méchants, me dira-t-on, ont pourtant une espèce de puissance. J'en conviens ; mais cette puissance pernicieuse est la suite fatale de l'excès de leur faiblesse. Ils ne sont puissants que pour le mal ; et, s'ils avaient le vrai pouvoir, qui est le partage des gens de bien, ils seraient dans l'heureuse impuissance de faire le mal. Mais plus ils ont de disposition et de force pour le faire, plus ils montrent qu'ils ne peuvent rien ; puisque, comme nous l'avons fait voir, le mal, à parler strictement, n'est rien. Pour te donner encore une idée plus précise de l'espèce de puissance dont jouissent les méchants, rappelle-toi que le souverain bien est le plus puissant de tous les êtres : et cependant il ne peut faire le mal ; tu en conviens. Revenons maintenant aux hommes : à moins que d'être insensé, on ne peut pas dire qu'ils soient tout-puissants ; or, cependant ils peuvent faire le mal.
- Ah ! je ne le sais que trop, lui dis-je ; plût au ciel qu'ils fussent impuissants à cet égard !
- Puisque donc, ajouta-t-elle, le souverain Etre, qui ne peut faire que le bien, est tout-puissant, et que les faibles mortels si puissants pour le mal, ne le sont pas pour bien d'autres choses, concluons que le pouvoir de faire le mal est au fond une impuissance réelle. Ajoutons à tout cela, que toute puissance est désirable, et que tout ce qui est désirable se rapporte au bien, comme à sa fin dernière : or, la puissance de faire le mal ne peut jamais se rapporter au bien : elle n'est donc pas désirable ; et si toute vraie puissance est en effet désirable, celle de faire mal n'en est donc pas véritablement une. De tout ceci, il est aisé de conclure que le vrai pouvoir est le partage des gens de bien, et que la plus déplorable faiblesse est celui des méchants. Platon a donc bien eu raison de dire que les sages sont les seuls qui fassent ce qu'ils désirent. Les méchants font, il est vrai, ce qui les flatte ; mais ils ne satisfont jamais leurs désirs, quoiqu'ils pensent le faire en suivant leurs goûts déréglés ; car les actions honteuses ne conduisent jamais à la félicité, qui est le but commun de tous les désirs des hommes.
Voyez sur leurs trônes ces rois superbes : la pourpre brillante qui les couvre, la garde qui les environne, cet orgueil féroce qui éclate sur leur front, ne sont que de vains dehors qui cachent le trouble et la rage qui les dévorent dans le coeur. Ces maîtres de l'univers sont des esclaves infortunés qui gémissent sous le poids de leurs chaînes. La convoitise verse à grands flots son poison dans leurs coeurs, la colère les enflamme, le chagrin les dessèche, leurs espérances trompées font leur tourment. Chacun de ces tyrans est en proie à mille tyrans intérieurs. Accablés sous le cruel empire de tant de maîtres inhumains, sont-ils jamais véritablement maîtres de faire ce qu'ils désirent ?
Comprends donc enfin à quelle bassesse indigne les vices conduisent, et de quel éclat au contraire brille toujours la probité, et conclus-en que les gens de bien ne restent jamais sans récompense, ni les scélérats sans châtiment. Car on peut regarder comme la récompense solide de nos actions, la fin pour laquelle nous les faisons. Ainsi la couronne proposée à ceux qui courent dans la lice, est la récompense qui les anime ; mais nous avons déjà vu que la béatitude est en même temps le bien suprême, auquel nous aspirons tous. Le bien est donc tout ensemble le mobile universel, la fin et la récompense de nos bonnes actions. La vertu ne manque donc jamais de sa juste récompense. Le diadème glorieux qui la couronne est à l'épreuve des attentats et de la cruauté des méchants. Ils ne dépouilleront jamais l'honnête homme de cette satisfaction intime et glorieuse inséparable de la probité. Si elle lui venait du dehors, elle pourrait peut-être lui être ravie, ou par celui dont il l'aurait reçue, ou par quelque autre ; mais puisqu'elle est essentiellement attachée à la vertu même, il ne peut la perdre qu'en perdant sa vertu. Enfin on n'aspire aux récompenses que parce qu'on les croit un véritable bien : celui donc qui pratique le bien, trouve dans le bien même sa récompense, et quelle récompense ! La plus belle et la plus grande dont nous puissions jamais avoir l'idée. Souviens-toi de la conséquence que je tirais il y a un moment, et raisonne ainsi : La béatitude et le vrai bien sont une même chose ; celui donc qui parvient au vrai bien, parvient à la béatitude : ainsi tous les gens de bien sont véritablement heureux, précisément parce qu'ils sont gens de bien. On ne peut être véritablement heureux sans participer en quelque chose à la Divinité ; les gens de bien sont donc en quelque façon des dieux, dont le bonheur et la gloire ne peuvent être altérés, ni par la durée du temps, ni par l'effort d'aucune puissance, ni par les attentats de la malignité. Par ce que je viens de dire, le sage comprend aisément que le vice ne reste jamais impuni ; car le bien et le mal, la récompense et le châtiment, étant des contraires, comme la vertu est elle-même la récompense de l'homme vertueux, la perversité des méchants fait elle-même leur supplice : car la peine étant un mal, et le mal une peine, peuvent-ils se croire exempts de peines, eux qui sont entièrement livrés au vice qui est le plus grand de tous les maux ? On peut même inférer de ce que nous avons dit ci-devant, qu'ils cessent d'être ce qu'ils étaient ; ils n'ont plus en effet que la seule apparence d'hommes. Leur perversité leur en fait perdre la nature. Car comme la probité élève l'homme au-dessus de sa condition mortelle, le vice au contraire le dégrade et le rend semblable aux bêtes. Oui, le vice opère cette honteuse métamorphose. L'injuste usurpateur n'est plus un homme, c'est un loup ravissant ; un plaideur de profession, un monstre de chicane et un chien hargneux, qui inquiète et maltraite tout son voisinage ; ces fourbes adroits, qui tendent des embûches d'autant plus dangereuses qu'elles sont plus cachées, n'ont-ils pas le caractère et l'odieuse finesse du renard ? Ces gens colères, toujours dans l'emportement et dans la rage, ne sont-ils pas des lions furieux ? Cette âme tremblante que tout alarme, qui frémit où il n'y a pas la moindre apparence de danger, n'a-t-elle pas toute la timidité du cerf ? Ce paresseux, cet insensible, qui croupit dans sa stupidité, ne mène-t-il pas la vie de la plus vile des bêtes de charge ? Cet esprit léger que rien ne fixe, qui change à chaque instant de désirs et d'idées, n'est-il pas tout semblable à l'oiseau qui voltige sans cesse de branche en branche ? Enfin ce débauché qui se plonge dans les voluptés les plus grossières et les plus honteuses, vit-il comme un homme ou comme un pourceau ? C'est ainsi qu'en cessant d'être vertueux, l'homme cesse d'être homme. La vertu en eût fait un Dieu, le vice en fait une bête immonde ; et il lui arrive quelque chose de plus funeste que ce que la fable nous raconte des compagnons d'Ulysse.
 |
Ce prince, après avoir longtemps erré sur les flots, fut poussé par les vents dans l'île où régnait la fameuse Circé, fille du soleil. Cette déesse, par la force de ses enchantements, donna à la liqueur traîtresse qu'elle offrit à ces nouveaux hôtes le pouvoir de les métamorphoser. Ils burent à longs traits la liqueur pernicieuse ; aussitôt la tête de celui-ci se change en une hure de sanglier. Celui-là est couvert de la peau d'un lion ; il en a les dents et les griffes terribles. Cet autre, mêlé parmi les loups auxquels il ressemble, veut déplorer sa triste aventure ; mais au lieu de gémissements, il pousse des hurlements affreux. Cet autre, sous la peau d'un tigre, devenu animal domestique, rôde dans toute la maison. Il est vrai qu'un dieu propice avait empêché le chef de ces malheureux de boire dans la coupe empoisonnée ; il l'avait préservé du changement honteux qui lui était préparé ; mais ses compagnons avaient éprouvé l'indigne métamorphose. Réduits à la vie des animaux, ils avaient perdu et la voix et la figure humaine ; il ne leur resta de leur premier état que l'âme seule, gémissant sans cesse sur le changement monstrueux que l'enchanteresse venait d'opérer. Impuissante enchanteresse ! ta magie n'a donc de pouvoir que sur les corps ; il ne peut s'étendre sur les âmes : elles sont à l'épreuve de tes enchantements. Ah ! il est des poisons malheureusement plus puissants et plus pernicieux. Ce sont ceux qui pénétrant jusqu'au fond de l'âme, exercent leur fureur sur elle, quoiqu'ils ne laissent à l'extérieur aucune marque du désordre affreux qu'ils y causent.
- Je le vois et je l'avoue, lui dis-je ; les hommes vicieux se dégradent par leurs mauvaises actions ; ils n'ont que l'apparence d'hommes ; leur âme a tous les sentiments des plus vils animaux ; mais je désirerais que ceux d'entre les méchants, dont l'âme atroce exerce sa cruauté sur les gens de bien, n'eussent jamais eu le pouvoir de leur nuire.
- Aussi ne l'ont-il pas, me répondit la Philosophie. Cependant s'ils étaient dans l'impuissance de faire le mal, leur peine et leur malheur seraient beaucoup moins grands. Car quoique cela paraisse incompréhensible, il est pourtant vrai que les méchants sont plus malheureux quand ils ont assouvi leurs desseins criminels, que quand ils ont été dans l'impuissance de le faire. Car si c'est un malheur de désirer le mal, c'est un plus grand malheur de pouvoir le commettre, puisque sans ce pouvoir funeste, leur mauvaise volonté resterait sans effet, et que leurs désirs pernicieux s'anéantiraient. Ainsi c'est un malheur de désirer le mal, un plus grand malheur de pouvoir le faire, le comble du malheur de le faire en effet ; et ces trois espèces d'infortunes se réunissent dans celui qui accomplit sa mauvaise volonté, pour le rendre souverainement malheureux.
- Je le crois ainsi, répondis-je, et c'est ce qui me porte à désirer qu'ils cessent d'être si malheureux en cessant de pouvoir faire le mal.
- Ils cesseront, ajouta-t-elle, ils cesseront de l'avoir, ce pouvoir funeste, plus tôt que tu ne le penses, et qu'ils ne le pensent eux-mêmes. Que cette vie en effet paraît courte, et que le terme le plus éloigné paraît proche à une âme créée pour l'immortalité ! Il ne faut qu'un moment pour anéantir les espérances perverses des méchants, pour renverser leurs projets criminels, et pour les empêcher de mettre le dernier comble à leur malheur. Si c'est en effet un malheur d'être vicieux, c'est un plus grand malheur de l'être longtemps, et c'est par conséquent un bonheur pour les méchants que la mort vienne mettre fin à leur vie criminelle. Car si ce que nous avons dit du malheur attaché au vice est bien vrai, il s'en suit que ce malheur est infini quand il est éternel.
- Cette conséquence, m'écriai-je, est bien surprenante et bien difficile à comprendre ; je vois cependant qu'elle a une connexion nécessaire avec ce que vous avez précédemment établi.
- Rien de plus vrai, me dit-elle ; car, ou il faut admettre sans difficulté cette conséquence, ou il faut démontrer que les prémisses sont fausses, ou que cette conséquence n'y est pas renfermée ; car si les prémisses sont vraies et la forme de l'argument juste, la conséquence est vraie aussi. Voici encore quelque chose d'aussi surprenant, mais qui émane également de ce que nous venons de dire. L'aurais-tu pensé ? Les méchants sont beaucoup plus heureux quand ils paient la juste peine due à leurs forfaits, que quand ils restent impunis. Pour le prouver, je pourrais dire que le châtiment les corrige, qu'il épouvante les autres et leur sert d'exemple. Mais ce n'est point par ces raisons, qui viennent d'abord à l'esprit de tout le monde, que je veux prouver combien l'impunité contribue au malheur des méchants. Ecoute-moi : que les gens de bien soient heureux, et les méchants vraiment malheureux, nous en sommes convenus. Convenons maintenant que si l'on mêle quelque bien à l'infortune d'un misérable, il est moins malheureux que celui dont la misère n'est adoucie par rien ; et que si à l'infortune de celui-ci, on ajoute encore un nouveau degré de mal, son sort est infiniment plus à plaindre que ne l'est le sort de celui dont le malheur a reçu quelque adoucissement par l'espèce de bien qu'il éprouve. Or le châtiment des méchants est un bien, puisque c'est la justice qui l'exerce ; et par une raison contraire, l'impunité de leurs crimes est un mal, puisque c'est une injustice manifeste. Les méchants sont donc beaucoup plus à plaindre, lorsque, contre les règles de la justice, ils échappent au châtiment qui leur est dû, que lorsque la justice les punit comme ils le méritent. Car on ne disconviendra pas que rien n'est plus juste que de punir le crime, ni rien de plus injuste que de le laisser impuni ; et on ne disconviendra pas non plus que ce qui est juste est un bien, et ce qui est injuste un véritable mal.
- Tout cela, lui dis-je, suit naturellement de ce que vous avez déjà établi ; mais je vous supplie de me dire si vous croyez que le malheur des méchants finitavec leur vie, et si leur âme ne souffre rien après leur mort ?
- Ah ! les supplices qui les attendent, me dit-elle, sont terribles, mais d'un genre différent ; car les uns peuvent servir à les purifier, et les autres, plus affreux, ne servent qu'à les tourmenter sans fruit. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit à présent. Revenons à ce que nous venons d'établir. Je t'ai montré le néant de cette prétendue puissance des méchants, qui te causait tant d'indignation ; je t'ai fait voir que leurs crimes ne restent jamais impunis ; que le pouvoir qu'ils ont de les commettre, pouvoir qui te faisait tant de peine, et dont tu désirais si ardemment la fin, ne peut jamais être de longue durée ; que plus il dure, plus il contribue à leur malheur, et que s'il durait toujours, leur malheur serait infini. Enfin, je t'ai fait connaître que les méchants sont plus malheureux lorsque la justice souveraine les épargne que quand elle les punit ; d'où j'ai conclu que leur punition n'est jamais plus terrible que lorsqu'ils paraissent n'en éprouver aucune.
- Quand je pèse vos raisons, lui répondis-je, rien ne me paraît plus vrai que ce que vous venez de dire : mais que la plupart des hommes sont bien peu disposés, je ne dis pas seulement à le croire, mais même à l'écouter !
- Je le sais, reprit-elle ; leurs yeux, couverts des ténèbres de l'ignorance, ne s'ouvrent pas aisément à la lumière de la vérité. Ils ressemblent à ces oiseaux nocturnes que le grand jour aveugle. Car, n'envisageant point l'ordre établi par la Providence, et ne consultant que leurs sentiments déréglés, ils regardent comme un grand bonheur le pouvoir de faire le mal, et de le faire impunément. Mais que ces idées sont contraires à la loi éternelle ! Voici ce qu'elle nous apprend. Quiconque s'efforce d'atteindre à la perfection, n'a pas besoin d'autre récompense ; il la mérite et se l'adjuge lui-même. Quiconque, au contraire, suit ses inclinations perverses et se tourne du côté du mal, devient son propre bourreau, en se précipitant dans l'abîme de l'iniquité. Ainsi, maître de s'attacher par ses pensées au ciel ou à la terre, l'esprit de l'homme tantôt s'élève, et prend sa place au milieu des astres, et tantôt se plonge dans l'ordure et dans la fange. Mais ces idées sont au-dessus du vulgaire. Eh quoi ! penserons-nous comme lui ? nous mettrons-nous au rang de ces mortels méprisables, plus semblables à de vils animaux qu'à des hommes ? Si quelqu'un, non seulement avait perdu la vue, mais ne se ressouvenait pas même d'en avoir joui, et qu'il pensât que rien ne manque à la perfection de sa nature, certainement il n'y a que des aveugles qui pussent penser comme lui, et presque tous les hommes le sont. Qui d'entre eux, par exemple, concevra que celui qui fait une injure est plus malheureux que celui qui la reçoit ? Cette vérité est pourtant fondée sur les raisons les plus solides. Juges-en. Tu conviens que tout scélérat est digne de punition, et je t'ai suffisamment montré qu'il est en même temps malheureux. Tu conviendras aisément aussi que tout homme est malheureux dès qu'il est digne de châtiment. Or, supposons que tu sois juge, et qu'assis sur le tribunal, tu décides entre celui qui a reçu l'injure et celui qui l'a faite, lequel des deux, à ton jugement, doit être puni ?
- Je n'hésiterais pas, lui dis-je ; je forcerais l'agresseur à faire à l'offensé une satisfaction proportionnée à l'injure.
- Celui qui fait l'injure est donc plus malheureux que celui qui la reçoit, puisqu'à ton jugement, il est seul digne de punition.
- J'en conviens, lui dis-je ; et je vois que par ces raisons et beaucoup d'autres qui se tirent des mêmes principes, une injure ne fait le malheur que de celui qui en est l'auteur et non de celui qui en est l'objet, parce qu'une action honteuse rend, par sa nature, ceux qui la font, réellement malheureux.
- Les orateurs, reprit-elle, ne considèrent guère cette vérité lorsqu'ils s'appliquent à émouvoir la compassion des juges en faveur de ceux qui ont reçu quelque grand outrage. En effet, ceux qui en sont les auteurs sont seuls dignes de compassion ; et leurs accusateurs, loin de se déchaîner contre eux, devraient les prendre en pitié, comme des malades qu'on mène au médecin, et les conduire ainsi avec bonté aux pieds de leurs juges, recevoir dans une punition salutaire le vrai remède aux maladies de leurs âmes déréglées. Leurs défenseurs eux-mêmes ne devraient les défendre que faiblement, ou plutôt, pour leur être d'un plus grand secours, ils devraient changer de style et devenir leurs accusateurs. Je n'en dis pas assez. Les méchants eux-mêmes, s'ils sentaient que la vertu peut encore, par quelque endroit, rentrer dans leur coeur, et que les châtiments peuvent les purifier de leurs fautes, loin de les envisager avec horreur, les regarderaient comme le principe de leur bonheur, et loin de chercher à se défendre, s'abandonneraient sans réserve aux rigueurs salutaires de la justice. Par ce que nous venons de dire, il est aisé de voir que la haine ne peut jamais avoir d'accès dans le coeur du sage ; car il faut être insensé pour haïr les gens de bien, et inhumain pour haïr les méchants. En effet, la méchanceté est une maladie de l'âme, comme la langueur est une maladie du corps. Or, si l'humanité nous apprend que les malades sont dignes de toute notre compassion, pourquoi n'aurions-nous pas la plus grande pitié de ceux qui sont engagés dans le vice, puisque le vice est la plus funeste de toutes les maladies ?
Quelle fureur vous porte, aveugles mortels, à chercher dans la guerre une fin plus prompte ? Ah ! si vous désirez la mort, la cruelle ne vient que trop vite au-devant de vous. Insensés ! les animaux féroces arment contre vous leurs dents meurtrières ; qu'est-il besoin, pour vous détruire, d'avoir recours à vos épées ? Qui peut vous porter à ces guerres barbares où vous vous préparez une mort mutuelle ? Est-ce la différence de vos moeurs avec celle de vos voisins ? Motif tout à la fois inhumain et injuste ! Guidés par la justice et la raison, voulez-vous rendre à chacun ce qui lui est dû ? Chérissez les gens de bien, ils méritent tout votre amour ; et plaignez les méchants, ils sont dignes de toute votre pitié».
Alors je repris la parole, et je lui dis :
«Je vois clairement que le bonheur des uns et le malheur des autres ont leur source dans la bonté ou dans l'iniquité de leurs oeuvres. Mais que penserons-nous de la fortune ? Il n'est certainement point d'homme sensé qui préfère l'exil, la pauvreté et l'humiliation, au plaisir de tenir dans sa patrie le premier rang par ses richesses, ses dignités et son pouvoir. La sagesse ne devient-elle pas plus glorieuse et plus utile lorsqu'elle peut communiquer aux peuples commis à ses soins la félicité dont elle jouit ? La prison, les chaînes et le reste des supplices inventés par les lois, ne sont destinés qu'aux mauvais citoyens ; ils n'ont été établis que contre eux : pourquoi donc, par un contraste injuste, les méchants ravissent-ils les récompenses qui n'étaient dues qu'à la vertu, tandis que les gens vertueux souffrent les peines qui ne devraient être infligées qu'aux méchants ? Cette confusion déraisonnable me jette dans le plus grand étonnement, et je voudrais bien en apprendre la cause ; car enfin je serais moins surpris si un aveugle hasard présidait à tout ce qui arrive ; mais c'est Dieu qui gouverne tout en ce monde, et cependant, tantôt par une juste rétribution, le sort des gens de bien est rempli d'agréments, et celui des méchants est rempli d'amertume ; et tantôt, au contraire, par un renversement étrange, les désagréments de la vie sont le partage des bons, tandis que les pervers jouissent à leur gré de tout ce qu'ils désirent. En arriverait-il autrement s'il n'y avait point de Providence ?
- Ah ! répondit la Philosophie, si tu connaissais l'ordre établi par cette Providence, tu ne penserais pas que les choses arrivent ici-bas fortuitement et sans dessein ; mais quoique cet ordre ne te soit pas connu, tu ne dois pas en être moins persuadé que ce monde est bien gouverné, puisqu'il l'est par un maître souverainement bon.
L'ignorance est la source ordinaire de notre étonnement. Voir l'étoile polaire presque immobile, et la constellation qui en est proche, prévenir avec tant d'empressement le lever des autres astres, et rester cependant sur l'horizon longtemps après eux, c'est un phénomène pour ceux qui n'entendent rien en astronomie. Quand la lune s'éclipse au milieu de la nuit, et que les étoiles recouvrent la clarté que la supériorité de sa lumière leur dérobait, le vulgaire superstitieux, saisi d'admiration et de frayeur, pousse des cris lugubres, et croit, par les sons aigus dont il frappe les airs, secourir l'astre défaillant, et lui rendre son premier éclat. Sait-on au contraire la cause de quelque événement ? on n'en est plus frappé. On voit sans surprise les flots de la mer se rompre en mugissant contre le rivage, lorsqu'ils sont poussés par un vent orageux ; on n'est point étonné de voir la neige se fondre en torrents aux premières ardeurs du soleil. Les hommes ne sont surpris que de ce qui arrive subitement ou inopinément. Ont-ils le temps d'en pénétrer la cause ? la connaissance qu'ils acquièrent, en dissipant leur erreur, fait cesser leur étonnement.
- J'en conviens, lui dis-je ; mais comme c'est à vous qu'il appartient de découvrir les choses les plus cachées, et de dévoiler les mystères les plus profonds, daignez m'expliquer celui qui me cause tant de perplexités.
- Tu me demandes, reprit-elle en souriant, la chose du monde la plus difficile. Cette matière est une source inépuisable de difficultés. Semblable aux têtes de l'hydre, quand on en tranche une, il en renaît mille autres. Il faut tout le feu du génie pour en venir à bout ; car il ne s'agit pas de moins ici que de traiter tout ensemble de la Providence, du destin, des événements fortuits, de la prescience divine, de la prédestination et de la liberté de l'homme. Sens-tu de quel poids est un pareil engagement ? Je veux pourtant bien employer le peu de temps qui me reste, à faire sur ces importantes matières une courte dissertation, puisqu'elle peut concourir à ta guérison. Mais quoique la poésie ait pour toi de si grands charmes, je différerai quelque temps pour t'en donner le plaisir. Il faut que je te développe auparavant, par des raisonnements suivis, ces matières qui sont si étroitement liées l'une à l'autre».
Alors elle commença ainsi :
«C'est de l'immuable volonté de Dieu que tout ce qui se produit en ce monde par la génération ; que tout ce qui, dans la nature, est sujet à tant de changements et à tant de mouvements divers, reçoit son existence, son arrangement et sa forme. L'intelligence infinie, sans jamais sortir de la simplicité qui lui est essentielle, est le mobile universel de tout ce qui arrive dans le monde en tant de manières. Cet enchaînement des choses et des événements, considéré dans sa source divine, est ce que nous appelons la Providence ; mais si nous l'envisageons dans son objet, c'est-à-dire dans les choses créées, qui reçoivent de la Providence la forme et le mouvement, c'est ce que les anciens nommaient destin. Au premier coup d'oeil, la Providence et le destin semblent être une même chose, mais à les approfondir on en sent la différence ; car la Providence est la souveraine intelligence elle-même, qui règle et conduit tout ; et la destinée est le différent arrangement des choses créées, par lequel elle les met chacune à sa place. La Providence en effet embrasse tout à la fois toutes les choses de ce monde, quelque différentes, quelque innombrables qu'elles soient, et la destinée est attachée à chaque chose en particulier, et diversifiée, pour ainsi dire, autant que les choses le sont par les différentes combinaisons du mouvement, des modifications, des temps et des lieux ; de sorte que cet ordre des choses et des temps réuni dans les idées de Dieu, est ce qu'on doit appeler Providence ; et quand on le considère divisé et distribué successivement aux créatures, c'est ce qu'on a nommé destin. Ces deux choses sont donc différentes : l'une cependant dépend de l'autre ; car l'ordre des destinées n'est que l'effet de la Providence. En effet, comme un ouvrier, en concevant l'idée de l'ouvrage qu'il projette, le produit intérieurement tout entier, quoiqu'il ne l'exécute ensuite que successivement au dehors; de même, la Providence, par un seul acte, règle d'une manière immuable tout ce qui doit se faire dans l'univers, et elle se sert ensuite du destin pour l'exécuter en détail successivement, et de mille manières différentes. Soit donc que le destin exerce son action par l'influence directe de la Providence, soit qu'il l'exerce par l'impulsion particulière de l'âme ou par celle de toute la nature, soit par l'influence des astres, soit par le ministère des anges ou par l'artifice des démons, soit enfin que toutes ces puissances y concourent, ou que quelques-unes seulement y aient part, il est toujours certain que l'idée universelle et invariable de tout ce qui doit se faire au monde, telle qu'elle est en Dieu, est ce que nous devons appeler Providence, et que le destin n'est que le ministre de cette Providence, qui sert à développer dans la suite des temps ce que la Providence a réglé par un seul acte de sa volonté toute puissante. Ainsi, ce qui est soumis au destin, et le destin lui-même, tout est sujet aux lois souveraines de la Providence ; mais la Providence embrasse bien des choses qui ne dépendent aucunement du destin. Telles sont celles qui sont plus prochainement et plus intimement unies à la Divinité. L'exemple suivant va éclaircir ma pensée. Supposons un grand nombre de cercles concentriques mus les uns dans les autres : le plus petit étant le plus proche du centre commun, devient à l'égard des autres une espèce de centre autour duquel ils tournent ; le plus éloigné, au contraire, est celui dont le diamètre a le plus d'étendue ; et l'espace qu'il embrasse devient plus grand à proportion qu'il s'éloigne davantage du point central. Ainsi, pendant qu'il est dans la plus grande agitation, ce qui touche de plus près au centre commun n'en éprouve aucune. De même, ce qui est le plus éloigné de Dieu, est plus sujet aux lois du destin, ce qui en est plus proche en dépend moins, et ce qui est uni invariablement à Dieu en est tout-à-fait exempt. L'ordre du destin n'est donc, par rapport à la Providence, que ce que l'effet est à son principe, le raisonnement à l'entendement, la circonférence du cercle à l'indivisibilité de son centre, et le temps à l'éternité. C'est cet ordre du destin qui donne le mouvement aux cieux et aux astres, qui conduit les éléments, et les change mutuellement les uns dans les autres. C'est par ses lois que la génération remplace sans cesse les êtres qui périssent, par d'autres qui leur succèdent ; ce sont elles qui règlent les actions et le sort des hommes, par un enchaînement aussi invariable que la Providence, qui en est le premier principe. Tel est en effet l'ordre admirable de cette Providence immuable et infiniment simple ; elle produit au dehors, d'une manière toujours entièrement conforme à ses vues, cette multitude de choses qui, sans l'ordre qu'elle leur prescrit, seraient abandonnées au caprice du hasard. Il est vrai que les hommes ne pouvant apercevoir cet ordre admirable, s'imaginent que tout ici-bas est dans une confusion universelle ; mais il n'en est pas moins certain que, par la direction de la Providence, il n'est point d'être qui de soi ne tende au bien. Car (comme je te l'ai déjà évidemment démontré), les scélérats eux-mêmes ne font point le mal, comme mal ; ils ne le font que parce qu'il se présente à leur imagination sous l'apparence du bien. Ils ne cherchent que le bien, et s'ils n'y parviennent pas, c'est une erreur fatale qui les égare ; mais leur égarement n'est, ni ne peut être l'effet de cet ordre divin qui émane du bien suprême. Cependant, me diras-tu, peut-il y avoir une confusion plus déplorable et plus injuste que celle qui règne sur la terre ? Les biens et les maux y sont indistinctement le partage des bons et des méchants. Des bons et des méchants : ah ! les hommes ont-ils assez de lumière et d'équité pour discerner les gens de bien d'avec ceux qui ne le sont pas ? Leur opinion à ce sujet ne se contredit-elle pas le plus souvent ? Tel, au jugement des uns, est digne de récompense, qui, au jugement des autres, mérite les derniers supplices. Mais supposons un moment qu'il est parmi les hommes quelqu'un d'assez éclairé pour pouvoir connaître les gens de bien et les méchants, le sera-t-il assez pour approfondir cette disposition intérieure de l'âme, que j'appellerai son tempérament, s'il m'est permis de me servir à son égard d'un terme qui semble n'être propre qu'au corps ? Eh ! pourquoi n'en userais-je pas ? Celui qui ignore la différence des tempéraments n'est-il pas également surpris de ce que parmi ceux qui jouissent d'une bonne santé, il en est à qui les choses douces sont nécessaires, tandis que les amers conviennent à beaucoup d'autres, et que dans le nombre de ceux qui sont malades, il en est à qui les remèdes doux suffisent, tandis qu'il faut, pour la guérison des autres, user des plus violents ? Cela, au contraire, n'a rien d'étonnant pour les médecins qui connaissent la différence des tempéraments, et qui savent juger des différents degrés de santé et de maladie. Or, dis-moi, qu'est-ce qui fait la santé de l'âme ? n'est-ce pas la probité ? Quelles en sont les maladies ? ne sont-ce pas les vices ? Et quel est celui qui sait conserver ce qui est bien, et détruire ce qui est mal ? n'est-ce pas Dieu ? Ce souverain maître des esprits et des coeurs, qui du haut de son trône éternel, jette un regard de providence sur tous les êtres créés, connaît, par sa science infinie, ce qui convient à chacun, et le lui prépare par sa souveraine bonté. La merveille consiste donc en ce que la Providence fait avec intelligence et dessein, ce qui ne jette les hommes dans la surprise que parce qu'ils ignorent quel en est le motif, l'ordre et la fin. Car pour approfondir les secrets de cette Providence divine, autant qu'il est permis à la raison humaine de le faire, je t'apprendrai que souvent elle condamne ce qui paraît à tes yeux la justice et la probité même. Notre bon ami Lucain ne nous dit-il pas que la cause de César trouva grâce devant les dieux, tandis que celle de Pompée paraissait la plus juste aux yeux de Caton ? Ce qui se fait donc ici-bas de contraire à tes idées n'en est pas moins dans l'ordre ; le désordre apparent qui t'afflige si fort n'existe que dans ta fausse opinion. Mais supposons pour un moment quelqu'un d'assez bonne conduite pour mériter l'approbation de Dieu et des hommes, mais qui n'ait pas assez de force d'âme pour soutenir avec constance la mauvaise fortune, et qui peut-être abandonnerait la vertu, la regardant comme inutile, parce qu'elle ne l'aurait pas garanti de l'adversité ; la sagesse compatissante de la Providence le ménagera, cet homme faible, et lui épargnera des revers qui pourraient lasser sa patience, et la porter au mal. D'un autre côté, s'il est une vertu parfaite en ce monde, un homme saint, et qui approche de Dieu autant qu'il est permis à la faiblesse humaine d'en approcher, la Providence ne permettra pas qu'il lui arrive la moindre adversité ; elle le rendra inaccessible aux maladies. Car, comme l'a dit excellemment quelqu'un qui pense mieux que moi, le corps d'un homme saint est pétri de perfections et de vertus. C'est par une disposition également sage de cette Providence adorable, que souvent le pouvoir souverain est entre les mains des gens de bien, afin qu'ils soient en état de réprimer l'insolence des méchants. Quelquefois, selon la différence des caractères, elle mêle, pour les uns, les biens avec les maux ; elle interrompt, par quelques adversités, la prospérité de ceux-ci, de peur qu'elle ne les corrompe ; elle permet que ceux-là éprouvent les plus grands revers, afin d'exercer leur patience, et de perfectionner leur vertu. La timidité des uns s'effraie-t-elle sans raison ? la témérité des autres brave-t-elle tout avec audace ? la Providence leur fait faire, par les adversités, l'expérience de leurs forces, et leur apprend à se connaître eux-mêmes. Il en est qui, par une mort glorieuse, se sont acquis une réputation immortelle ; il en est d'autres dont la constance inébranlable au milieu des plus grands supplices, nous fait voir qu'il n'est rien dont la vertu ne puisse triompher. Ainsi tout, par la sagesse de la Providence, arrive à propos et pour le plus grand bien d'un chacun, jusqu'à ce mélange même de biens et de maux qu'éprouvent les méchants. Car s'il leur arrive des disgrâces, il n'est rien de plus convenable, puisqu'au jugement de tout le monde, ils sont dignes de punition ; punition salutaire pour eux, puisqu'elle sert à les corriger, et salutaire pour les autres qu'elle épouvante et qu'elle détourne du crime. Si au contraire ils jouissent de quelque prospérité, c'est une leçon vivante qui apprend aux gens de bien le peu de cas qu'ils doivent faire de la fortune, puisqu'elle se prête si indignement aux désirs de l'iniquité. Peut-être aussi la Providence n'apporte-t-elle des biens à certaines gens que parce qu'elle prévoit qu'indubitablement l'indigence porterait au mal leur naturel fougueux et incapable de rien souffrir. Ainsi, elle les retient par ses bienfaits ; elle les corrige même. Car, considérant d'un côté le mauvais état de leur conscience chargée de crimes honteux, et de l'autre l'état florissant de leur fortune, ils craignent qu'en continuant leur vie criminelle ils ne perdent tous les avantages dont ils jouissent ; et ils changent leurs moeurs corrompues, pour éviter un changement de fortune, dont l'idée seule les fait frémir. La Providence permet que d'autres ne s'élèvent au comble du bonheur que pour tomber de plus haut dans l'abîme qu'ils se sont creusé eux-mêmes. Il en est d'autres à qui elle n'accorde le droit de vie et de mort qu'afin qu'ils exercent la patience des gens de bien, et qu'ils fassent subir à ceux qui sont pervers comme eux, le juste châtiment de leur méchanceté. Car ce n'est pas seulement entre les gens de bien et les méchants, qu'il y a une guerre éternelle ; les méchants se la font entre eux-mêmes : et comment pourraient-ils s'accorder ensemble ? Chacun d'eux n'est jamais d'accord avec sa propre conscience, qui, déchirée par les remords, déteste le mal après l'avoir fait. Souvent même l'horreur qu'ils ont pour de plus méchants qu'eux les porte à haïr l'iniquité et à mener une vie vertueuse, afin de ne plus ressembler à ceux qu'ils abhorrent ; et ainsi, par un miracle insigne de la Providence, les méchants servent à la conversion des méchants mêmes. Il n'y a que Dieu seul qui puisse tirer de cette sorte le bien du mal. Telle est la sagesse de son gouvernement, que ce qui s'écarte dans un sens de l'ordre général qu'il a établi, rentre dans un autre ordre de la Providence : car, sous son empire, rien ne se fait au hasard, tout a son motif et sa fin. Au reste, il ne m'est pas possible de suivre la Providence dans toutes ses opérations ; il n'est permis ni d'entrer dans le sanctuaire de ses conseils, ni d'en développer les mystères. Je me contente donc d'avoir montré en général, que Dieu, auteur de tout être, gouverne tout par ce penchant invincible qui fait que tout tend au bien ; et que, rapprochant ainsi tout de lui-même, tout ce qui est sous son empire est bien dans l'ordre de la destinée. Aussi ce qui paraît mal aux yeux de notre aveugle raison, nous paraîtrait tout différent si nous pouvions pénétrer les ressorts secrets de la sage conduite de la Providence. Mais je vois qu'un sujet si difficile et si sublime, et un raisonnement si long, commencent à te fatiguer. Je vais donc prendre le ton poétique pour te délasser un peu, et te donner encore la force d'aller plus avant.
Si ton âme veut connaître, dans ses effets, la sagesse toute-puissante du Dieu qui lance le tonnerre, qu'elle élève ses regards jusqu'au firmament. Les astres dont il brille conservent entre eux une paix éternelle. Le soleil, malgré la rapidité de son char, ne sort point de sa carrière pour aller fondre les glaces du Nord. L'ourse, qui roule sur l'un des pôles du monde, toujours élevée sur l'horizon, voit sans envie le reste des étoiles se plongerdans les flots, et jamais ne s'y rafraîchit comme elles. C'est toujours le même astre qui dit à la nuit d'étendre sur l'univers son voile ténébreux : c'est le même qui tous les matins l'avertit de le replier pour faire place à l'aurore. Ainsi l'amour de l'ordre renouvelle sans cesse le cours des globes célestes ; ainsi il conserve entre eux une harmonie invariable. Il fait également sentir sa puissance aux éléments ; il accorde l'humide avec le sec, et le froid avec le chaud. Il donne au feu cette légèreté rapide qui le porte toujours vers les cieux ; il donne à la terre ce poids toujours égal qui la maintient invariablement dans son assiette. C'est cet amour bienfaisant qui fait éclore mille fleurs charmantes dans les beaux jours du printemps ; il mûrit dans l'été les riches dons de Cérès ; il nous fait recueillir dans l'automne les fruits les plus abondants, et ramène ensuite la triste et humide saison de l'hiver. Par cette alternative salutaire, il produit et conserve tout ce qui respire ; et, le détruisant ensuite, il le fait périr et disparaître quand le moment fatal est arrivé. Pendant ces révolutions, l'Etre suprême, assis sur son trône, tient en ses mains les rênes de l'univers ; sa toute-puissance est le principe de tout ce qui s'y fait ; sa volonté en est la loi, et sa sagesse en est le juge. Il donne le mouvement à tout ; et le dirigeant à son gré, il ramène à l'ordre tout ce qui paraît s'en écarter. Si sa providence abandonnait le soin du monde, si elle cessait un instant de contenir les êtres dans le cercle qu'elle leur a tracé, tout se détruirait et rentrerait dans le néant ; mais l'amour du bien contient tout dans l'ordre, et conserve tout, en faisant tout remonter à la source d'où il est sorti.
Vois-tu maintenant la juste conséquence de ce que nous avons dit jusqu'à présent ?
- Et quelle est-elle ? lui dis-je.
- Que chacun doit être satisfait de son sort.
- Comment cela peut-il être ? répliquai-je tout étonné.
- Le voici, continua-t-elle. Tout ce qui arrive ici-bas d'agréable ou de fâcheux sert à récompenser ou à exercer la vertu, et à punir et corriger le vice. La mauvaise fortune, comme la bonne, est donc toujours juste ou avantageuse, et nul dès lors n'a droit de s'en plaindre.
- Ce que vous dites est une vérité certaine, répondis-je ; et plus je considère ce que vous venez de dire de la Providence et du destin, plus cette vérité me paraît constante. Il faut pourtant convenir qu'elle est contraire à l'opinion de la plupart des hommes, qui pensent et qui disent hautement qu'il y a des malheureux dont la situation est très déplorable.
- Je le sais bien, me dit-elle, et je veux bien condescendre à ces idées du vulgaire, et ne point trop m'écarter de sa manière de parler, ni de ses usages. Mais, réponds-moi, ce qui est avantageux n'est-il pas un vrai bien ? Or ce qui sert à corriger le vice ou à exercer la vertu est avantageux ; n'ai-je pas droit d'en conclure que la fortune qui produit ces bons effets, est un vrai bien ? Et telle est celle de ces hommes estimables qui brisent les chaînes qui les attachent au mal, et s'efforcent d'entrer dans le chemin de la vertu, ou de ceux qui y marchent depuis longtemps, en combattant avec courage contre les obstacles qui s'y rencontrent. Quant à la prospérité, qui sert de récompense à la vertu, le vulgaire lui-même la regarde comme un vrai bonheur.
- J'en conviens, lui dis-je ; mais aussi regarde-t-il comme le comble du malheur l'adversité, qui sert de châtiment au vice.
- Prends garde, reprit-elle, de ne pas te jeter dans une erreur insoutenable, en entrant trop dans l'opinion populaire. De tout ce que tu viens de m'accorder, il résulte que toute fortune, quelle qu'elle soit, est un bien pour ceux qui pratiquent ou qui cherchent à pratiquer la vertu ; et qu'au contraire tout tourne à mal pour ceux qui persévèrent dans le vice.
- Je l'ai avoué, lui dis-je, et cela est vrai, quoique personne n'ose le dire.
- L'homme sage, ajouta-t-elle, ne doit donc pas plus s'alarmer quand il a à combattre contre l'adversité, que l'homme courageux quand il faut marcher à l'ennemi ; car plus il y a d'obstacles à vaincre, plus il y a pour celui-ci de gloire à acquérir, et plus il y a pour l'autre de moyens de croître en mérite et en sagesse. La vertu même ne tire son nom que de la vigueur avec laquelle elle résiste à tant d'adversités. Vous donc, qui y avez fait tant de progrès, fuyez une vie molle et voluptueuse qui énerverait votre âme, et combattez avec courage contre la prospérité, ainsi que contre l'adversité, ne vous laissant ni abattre par celle-ci, ni corrompre par l'autre, et tenant en tout ce juste milieu où réside la vertu. Quiconque en sort peut rencontrer une ombre de félicité, mais il n'obtiendra point le prix inestimable réservé à la pratique de la vertu. En un mot, l'homme est toujours maître de tirer avantage de sa condition quelle qu'elle soit : fût-elle des plus misérables, selon les idées du vulgaire, elle peut servir à exercer sa constance, à corriger ses défauts ou à punir ses vices.
Agamemnon paya d'un sang bien précieux le vent favorable qui conduisit sa flotte à Troie. Il fut obligé, pour l'obtenir, d'étouffer les sentiments de sa tendresse paternelle, et de consentir au sacrifice de l'infortunée Iphigénie sa fille, qu'un ministre des dieux égorgea en sa présence : il éprouva ensuite, pendant dix ans entiers, toutes les horreurs d'une cruelle guerre ; mais enfin il vengea, par la ruine de Troie, l'opprobre de son frère. Ulysse eut le coeur percé de douleur quand il vit ses compagnons dévorés par le géant Polyphème ; mais il vengea leur mort en privant de la lumière du jour ce monstre affreux, et lui faisant payer par des larmes de sang celles que le malheureux sort de ses compagnons lui avait fait répandre. C'est à ses pénibles travaux que l'immortel Alcide doit toute sa gloire. Il lui fallut dompter l'indomptable orgueil des centaures, terrasser un lion formidable et en arracher la sanglante et glorieuse dépouille, percer de ses flèches des monstres ailés, ravir le trésor confié à la garde d'un dragon furieux, enchaîner d'une main puissante ce monstre à trois têtes, gardien des enfers, faire dévorer par ses propres chevaux un prince inhumain, couper les têtes renaissantes de l'hydre de Lerne, terrasser le géant Antée, éteindre par la mort de l'infâme Cacus le juste ressentiment d'Evandre, abattre le monstrueux sanglier d'Erimanthe. Il couvrit de sa peau ces épaules robustes qui devaient un jour porter le ciel ; il en soutint en effet le poids énorme sans en être ébranlé, et ce fut le dernier de ses travaux. Le ciel, dont il avait été le soutien, devint pour jamais son séjour. Mortels courageux, suivez ces traces glorieuses ; combattez avec constance, vous triompherez des obstacles qui se rencontrent sur la terre, et le ciel sera la récompense éter-nelle de votre courage et de vos combats».