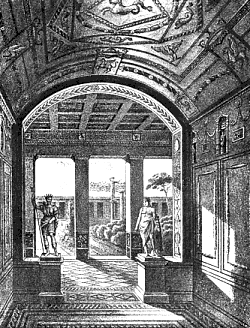La pauvre tortue : nouveau changement pour Nydia
|
Le soleil du matin éclairait le petit et
odorant jardin renfermé dans le péristyle
de la maison de l'Athénien. Glaucus était
couché, triste et distrait, sur le gazon lisse
et frais, semé par intervalles dans le
viridarium. Un dais léger protégeait sa
tête contre les rayons du soleil
d'été.
Lorsque cette maison fut exhumée dans les
fouilles de Pompéi, on trouva dans le jardin la
carapace d'une tortue, qui en avait été
un des êtres familiers (1). Cet animal,
étrange chaînon des êtres dans la
création, à qui la nature semble avoir
refusé les plaisirs de la vie, excepté la
perception de la vie passive et rêveuse, avait
été l'hôte de cette maison,
longtemps avant que Glaucus y vînt demeurer ; si
longtemps même que les années que la
tortue avait vécues dépassaient la
mémoire des hommes, et que la tradition leur
assignait une incroyable date.
|

Joseph M. Gleeson, 1891
|
La maison avait été bâtie et
rebâtie, elle avait changé bien des fois de
possesseurs ; les générations avaient fleuri et
disparu, et la tortue n'en continuait pas moins sa lente et
peu sympathique existence. Dans le tremblement de terre qui,
seize ans auparavant, avait détruit une partie des
édifices publics de la cité, et fait fuir les
habitants effrayés, la maison que Glaucus habitait
présentement avait été terriblement
atteinte. Les propriétaires l'abandonnèrent
pendant plusieurs jours ; à leur retour, ils
déblayèrent les décombres qui couvraient
le viridarium, et retrouvèrent leur tortue intacte, et
ignorante de la destruction dont elle avait été
environnée. On eût dit qu'une vie
enchantée résidait dans son sang languissant et
dans ses mouvements imperceptibles. Elle suivait sa marche
régulière et monotone ; elle traversait pas
à pas la petite étendue de son domaine, mettant
des mois à accomplir son évolution.
C'était une voyageuse sans repos que cette tortue ! elle continuait ses courses de chaque jour avec autant de
patience que de peine, sans prendre garde aux choses qui
l'entouraient ; tortue philosophe concentrée en
elle-même ! Il y avait quelque chose de grand dans son
égoïsme solitaire. Le soleil dont les rayons
l'inondaient, l'eau qui tombait sur elle tous les jours,
l'air qu'elle aspirait insensiblement, formaient ses seules
et éternelles jouissances ; les doux changements de
saison dans cet heureux climat ne l'affectaient point ; elle
se renfermait dans son écaille comme le saint dans sa
piété, comme le sage dans son
espérance.
Elle ne s'apercevait ni des secousses ni des changements du
temps. Elle était elle-même l'image du temps :
lent, régulier, perpétuel, lequel ne prend nul
intérêt aux passions qui se pressent autour de
lui, et reste indifférent aux souffrances et aux
larmes de l'humanité ! La pauvre tortue ! il ne fallut
rien moins que l'éruption des volcans, les convulsions
d'un monde qui se déchire, pour éteindre la
faible étincelle qui l'animait. La mort inexorable,
qui n'épargne ni la grandeur ni la beauté,
passait sans toucher à une chose à laquelle
elle ne semblait. devoir apporter, du reste, qu'une
légère modification. Le Grec, en qui
surabondait la vie, éprouvait pour cet animal cette
tendresse mêlée d'étonnement qui
naît des contrastes. Il passait des heures à
suivre des yeux sa marche rampante et à moraliser sur
sa construction. Joyeux, il méprisait ; triste, il
enviait son sort.
Regardant en ce moment, du lieu où il était
couché, cette grosse masse qui s'avançait sans
avoir presque l'air de se mouvoir, l'Athénien murmura
en lui-même :
«L'aigle laisse tomber une pierre de ses serres,
croyant briser cette coquille ; la pierre écrase la
tête d'un poète. Telle est l'allégorie du
destin. Etrange créature ! tu as eu un père et
une mère ? Peut-être, dans les temps
passés, tu as eu aussi une compagne ? Tes parents
aimaient-ils ? As-tu aimé toi-même ? Ton sang
paresseux circulait-il avec plus de force lorsque tu rampais
à côté de ton amante ? Etais-tu capable
d'affection ? Souffrais-tu loin d'elle ? Sentais-tu sa
présence ? Que ne donnerais-je pas pour
connaître l'histoire de ton sein écaillé,
pour contempler les ressorts de tes faibles désirs,
pour remarquer la différence, aussi
légère qu'un cheveu, qui sépare ta joie
de ta douleur ? Il me semble que, si Ione était
présente, tu le saurais. Tu la sentirais venir comme
un air plus léger... comme un rayon de soleil plus
chaud. Je t'envie pour le moment, car tu ignores qu'elle
n'est pas là. Et je voudrais être comme toi tout
le temps que je ne puis la voir. Quel doute, quel
pressentiment me tourmente ! Pourquoi ne vient-elle pas ? Des
jours ont passé sans que j'aie entendu sa voix ! Pour
la première fois, la vie me pèse. Je ressemble
à un homme demeuré seul dans un banquet quand
les lumières sont éteintes, quand les fleurs
sont flétries. O Ione ! si tu pouvais savoir combien
je t'aime ! »
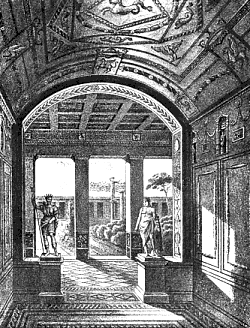
Edition Gleeson, vol.I, p.18
(1891)
|
|
Glaucus se vit interrompu dans ses amoureuses
rêveries par l'entrée de Nydia. Elle
s'avança, de son pas léger et prudent,
par le tablinum de marbre. Elle traversa le portique et
s'arrêta devant les fleurs qui bordaient le
jardin. Elle tenait à la main un arrosoir, et
elle versa de l'eau sur les fleurs
altérées, qui semblaient se
réjouir de son approche. Elle se pencha pour
respirer leur odeur, elle les toucha d'une façon
timide et caressante. Elle chercha, le long de leurs
tiges, si quelque feuille morte ou quelque insecte
rampant ne déparait pas leur beauté.
Pendant qu'elle allait ainsi de fleur en fleur, avec un
air empressé et joyeux, de la manière la
plus gracieuse, on l'aurait prise pour la plus aimable
nymphe de la déesse des jardins.
«Nydia, mon enfant ! » dit Glaucus.
Au son de cette voix elle s'arrêta,
écoutant, rougissant, respirant à peine,
les lèvres entrouvertes, le visage tourné
dans la direction de la voix qui l'appelait ; elle
laissa tomber l'arrosoir, et fit quelques pas rapides
du côté de Glaucus. C'était
merveilleux de voir comme elle trouvait son chemin
à travers les fleurs, pour arriver plus vite
près de son nouveau maître.
|
«Nydia, dit Glaucus en rejetant en arrière
avec douceur les longs et beaux cheveux de la jeune fille ; voilà trois jours que tu es sous la protection des
dieux de ma maison. T'ont-ils souri ? es-tu heureuse ?
- Oh ! oui, heureuse, dit l'esclave en soupirant.
- Et maintenant, continua Glaucus, que tu es un peu remise
des détestables souvenirs de ta condition
précédente ; maintenant qu'on t'a revêtue
d'habillements (et il toucha sa tunique brodée) plus
convenables à ton corps délicat ; maintenant
que tu t'es accoutumée à un bonheur que je prie
les dieux de te conserver toujours, je vais te demander un
service.
- Ah ! que puis-je faire pour vous ? dit Nydia en joignant
ses mains.
- Ecoute-moi, reprit Glaucus ; toute jeune que tu es, tu
seras ma confidente. As-tu jamais entendu prononcer le nom
d'Ione ? »
La jeune aveugle demeura oppressée et pâle comme
une des statues qui entouraient le péristyle.
Après un moment de silence, elle répondit avec
effroi :
- Oui, j'ai entendu dire qu'elle est de Néapolis et
qu'elle est belle.
- Bien belle ! Une beauté à éblouir le
jour. Elle est de Néapolis, oui, mais Grecque
d'origine ; la Grèce seule peut produire de si
admirables créatures. Nydia, je l'aime.
- Je le pensais, dit Nydia avec calme.
- Je l'aime, et tu le lui diras. Je vais t'envoyer chez elle.
Heureuse Nydia ! tu pénétreras dans sa
chambre... tu t'enivreras de la musique de sa voix... tu te
baigneras dans l'air radieux qui l'entoure...
- Eh quoi ! vous voulez me séparer de vous ?
- Tu seras chez Ione», poursuivit Glaucus, d'un ton qui
voulait dire : «Que peux-tu désirer de plus ? »
Nydia fondit en larmes.
Glaucus, se levant, l'attira vers lui avec les douces
caresses d'un frère.
«Mon enfant, ma douce Nydia, tu pleures dans
l'ignorance du bonheur que je te ménage ; Ione est
aimable et bonne, et douce comme le souffle du printemps.
Elle sera une soeur pour ta jeunesse. Elle appréciera
tes talents enchanteurs... elle aimera plus que personne tes
grâces simples, parce qu'elles ressemblent aux siennes.
Tu pleures toujours. Je ne prétends pas te forcer, ma
douce enfant ; ne veux-tu pas me faire cette faveur ?
- Je suis ici pour vous servir ; commandez. Voyez, je ne
pleure plus. Je suis calme.
- Je reconnais ma Nydia, reprit Glaucus en lui baisant la
main. Va donc vers Ione. Si je t'ai abusée sur sa
tendresse... si c'est une erreur de ma part, tu reviendras
chez moi quand tu le voudras. Je ne te donne pas à une
autre ; je ne fais que te prêter. Ma maison sera
toujours ton refuge, douce fille. Oh ! que ne peut-elle
abriter tous les malheureux sans amis ! Mais, si mon cœur ne
me trompe pas, tu reviendras bientôt chez moi, mon
enfant ! ma maison sera celle d'Ione, et tu demeureras avec
nous.»
Un frisson parcourut de la tête aux pieds le corps de
la pauvre aveugle ; mais elle ne pleura pas. Elle
était résignée.
«Va donc, ma Nydia, à la demeure d'Ione... on
t'en montrera le chemin. Prends les plus belles fleurs que tu
pourras cueillir. Je te donnerai le vase qui les contiendra.
Tu m'excuseras de son peu de valeur. Tu prendras aussi le
luth que je t'ai donné hier, et dont tu sais si bien
éveiller le doux esprit. Tu lui remettras aussi cette
lettre, dans laquelle, après bien des efforts, j'ai
essayé d'introduire quelques-unes de mes
pensées. Que ton oreille écoute chaque accent,
chaque modulation de sa voix, et tu me diras, lorsque nous
nous reverrons, si leur musique est favorable ou
décourageante. Je n'ai point été admis
près d'Ione depuis quelques jours ; il y a quelque
chose de mystérieux dans cette exclusion. Je suis
tourmenté par des doutes et des craintes ; apprends,
car tu es adroite et l'intérêt que tu prends
à moi augmentera ton adresse, apprends la cause de
cette cruauté ; parle de moi aussi souvent que tu le
pourras ; que mon nom erre toujours sur tes lèvres ; insinue mon amour plutôt que de le proclamer. Ecoute si
elle soupire pendant que tu parles, si elle te répond,
ou si elle te blâme ; de quelle manière elle le
fait. Sois mon amie ; plaide en ma faveur. Oh ! combien tu
payeras au centuple le peu que j'ai fait pour toi ! Tu me
comprends, Nydia ? Mais tu es encore un enfant.
Peut-être en ai-je dit plus que tu ne peux comprendre ?
- Non.
- Et tu me serviras ?
- Oui.
- Viens me retrouver lorsque tu auras cueilli les fleurs, et
je te donnerai le vase dont je t'ai parlé. Je serai
dans la chambre de Léda. Ma jolie Nydia, tu n'as plus
de chagrin ?
- Glaucus, je suis une esclave ; ai-je le droit d'avoir de la
joie ou du chagrin ?
- Ne parle pas ainsi. Non, Nydia. Sois libre. Je te donne la
liberté ; jouis-en comme tu voudras, et pardonne-moi
si j'ai compté sur ton désir de me rendre
service.
- Vous êtes offensé ? Oh ! je ne voudrais pas,
pour toutes les faveurs de la liberté, vous offenser,
Glaucus... Mon gardien, mon sauveur, mon protecteur, pardonne
à la pauvre fille aveugle... Elle ne se plaindra pas
même de te quitter, si elle peut contribuer à
ton bonheur.
- Que les dieux bénissent ton cœur tendre ! »
dit Glaucus profondément ému ; et, sans se
douter de la flamme qu'il excitait, il embrassa Nydia
plusieurs fois sur le front.
«Vous me pardonnez donc ? lui dit-elle ; et vous ne me
parlerez plus de liberté. Mon bonheur est d'être
votre esclave, et vous avez promis que vous ne me donnerez
pas à un autre.
- Je l'ai promis.
- Maintenant, je vais cueillir des fleurs.»
Nydia prit bientôt en silence des mains de Glaucus le
vase riche et artistement travaillé, dans lequel les
fleurs rivalisaient de couleurs et de parfums ; elle
reçut sans verser une larme ses dernières
instructions. Elle s'arrêta un moment lorsqu'il se tut.
Elle n'osa pas répondre. Elle chercha sa main, la
porta à ses lèvres, couvrit sa figure de son
voile et s'éloigna de lui. Elle s'arrêta de
nouveau sur le seuil, étendit ses mains vers la
maison, et dit à voix basse :
«Trois jours heureux... trois jours d'un inexprimable
bonheur se sont écoulés depuis que je t'ai
franchi, ô seuil béni ! puisse la paix demeurer
toujours avec toi pendant mon absence ! Pour moi, mon cœur
se déchire en te quittant, et le soupir qu'il fait
entendre semble me dire de mourir.»
|
 |
(1) La carapace
d'une tortue fut trouvée dans la maison
que nous assignons dans cet ouvrage à
Glaucus. Je ne sais si on l'a conservée,
je l'espère.
|
|