Livre IV, chapitre 17 |
Une chance pour Glaucus
Les heures avaient passé avec la lenteur d'une
cruelle torture sur la tête de la pauvre Nydia, depuis
le moment où elle avait été
replacée dans sa prison.
Sosie, comme s'il avait craint d'être de nouveau
trompé par elle, s'était abstenu de la visiter
jusqu'au matin du jour suivant, et encore assez tard ; il ne
fit alors que renouveler ses provisions de pain et de vin,
puis referma précipitamment la porte. La
journée entière s'écoula ; et Nydia se
sentait captive, captive sans espoir, le jour même du
jugement, et lorsque son témoignage pouvait sauver la
victime. Cependant, sachant, quelque impossible qu'il lui
parût de s'enfuir, que la seule chance de salut pour
Glaucus reposait sur elle, cette jeune fille, frêle et
passionnée, et d'une organisation si nerveuse,
résolut de ne pas s'abandonner à un
désespoir qui l'aurait rendue incapable de saisir une
occasion de s'échapper. Elle garda toute sa
liberté d'esprit, malgré sa douleur
intolérable, et, dans le tourbillon de ses
pensées, qui se succédaient avec
rapidité, elle prit même un peu de pain et de
vin, afin de soutenir sa force, et de se préparer
à tout événement.
Après avoir formé et rejeté mille plans
nouveaux de fuite, elle regarda Sosie comme sa seule
espérance, le seul instrument qu'elle pût encore
mettre à profit. Le désir de connaître
l'époque où il pourrait être libre
l'avait rendu superstitieux. Par les dieux ! ne pourrait-il
pas être tenté par l'appât même de
la liberté ? n'était-elle pas presque assez
riche pour l'acheter ? Ses bras délicats
étaient couverts de bracelets, présents d'Ione ; elle portait à son cou cette même chaîne
qui, on doit se le rappeler, avait occasionné sa
querelle jalouse avec Glaucus, et qu'elle avait ensuite
promis de porter toujours. Elle attendit donc ardemment le
retour de Sosie ; mais, comme les heures s'écoulaient,
et qu'il ne revenait pas, son impatience fut bientôt au
comble. La fièvre agitait chacun de ses nerfs ; elle
ne pouvait supporter la solitude plus longtemps. Elle
gémit ; elle cria ; elle se frappa contre la porte.
Ses cris retentirent dans la salle, et Sosie, plein d'humeur,
se hâta de venir voir ce qui se passait, afin de la
faire taire, s'il était possible.
«Oh ! oh ! qu'est-ce que cela ? dit-il avec aigreur.
Jeune esclave, si tu continues à crier ainsi, nous te
bâillonnerons de nouveau. Mes épaules courraient
des risques, si mon maître venait à
t'entendre.
- Bon Sosie, ne me gronde pas ; je ne puis demeurer seule
plus longtemps ; la solitude m'effraye : viens t'asseoir
près de moi quelques instants ; n'aie pas peur que je
cherche à m'échapper. Place ton siège
contre la porte. Surveille-moi avec attention. Je n'ai pas
l'intention de bouger.»
Sosie, qui était considérablement bavard, fut
ému de cette requête. Il eut pitié d'une
créature qui n'avait personne avec qui causer.
C'était aussi le cas où il se trouvait. Il eut
donc pitié d'elle, et se décida à se
faire plaisir à lui-même. Il profita de
l'observation de Nydia, plaça son siège devant
la porte, près de laquelle il s'appuya le dos, et
répondit :
«Je ne suis pas assez sauvage pour te refuser cela...
Je n'ai aucune objection à faire contre une innocente
conversation, pourvu que cela n'aille pas plus loin... Mais
ne me joue plus de tours, en voilà assez.
- Non, non ; dis-moi, Sosie, quelle heure est-il ?
- Le soir approche... les troupeaux rentrent à la
maison.
- O dieux ! Et quelles nouvelles du procès ?
- Tous les deux condamnés.»
Nydia réprima un cri.
«C'est bien : je pensais qu'il en serait ainsi. A quand
l'exécution ?
- Demain, aux jeux de l'amphithéâtre ; sans toi,
petite malheureuse, c'est un plaisir que je pourrais me
donner comme les autres.»
Nydia s'affaissa un moment sur elle-même ; la nature
cédait malgré son courage ; mais Sosie ne
s'aperçut pas de sa défaillance, car il faisait
presque nuit et il songeait trop à ses ennuis
personnels. Il se lamentait de la privation d'un si
délicieux spectacle, et accusait d'injustice
Arbacès, qui l'avait choisi parmi les autres esclaves
pour le constituer geôlier. Il en était encore
à exhaler ses plaintes, quand Nydia reprit
connaissance.
«Tu soupires, jeune aveugle, du malheur qui m'arrive
dans cette circonstance ? C'est bien ; cela me console un
peu. Puisque tu reconnais tout ce que tu me coûtes, je
m'efforcerai de ne pas me plaindre. Il est dur d'être
maltraité sans inspirer au moins de la
pitié.
- Sosie, combien te faut-il pour acheter ta liberté ?
- Combien ? environ deux mille sesterces.
- Les dieux soient loués ! Il ne te faut pas davantage ? Vois ces bracelets et cette chaîne : il valent deux
fois cette somme ! Je te les donnerai si...
- Ne me tente pas. Je ne puis te délivrer.
Arbacès est un maître sévère et
terrible. Qui sait si je n'irais pas nourrir les poissons du
Sarnus ? hélas ! tous les sesterces du monde ne me
rappelleraient pas à l'existence : mieux vaut un chien
vivant qu'un lion mort.
- Sosie, c'est ta liberté, penses-y bien. Si tu veux
me laisser sortir une heure seulement, rien qu'une petite
heure, à minuit, je reviendrai ici avant l'aurore ; tu
peux même venir avec moi.
- Non, dit Sosie avec force ; un esclave a
désobéi un jour à Arbacès, et
l'on n'a jamais plus entendu parler de lui.
- Mais la loi ne donne pas au maître pouvoir de vie et
de mort sur ses esclaves.
- La loi est très obligeante, mais plus polie
qu'efficace. Je sais qu'Arbacès met souvent la loi de
son côté. D'ailleurs, si je suis mort, quelle
loi me ressuscitera ? »
Nydia se tordit les mains. «N'y a-t-il donc aucun
espoir ? dit-elle, avec une agitation convulsive.
- Aucun espoir de sortir d'ici jusqu'à ce
qu'Arbacès en ait donné l'ordre.
- Eh bien donc, dit Nydia, tu ne me refuseras pas du moins de
porter une lettre de moi. Ton maître ne te tuera pas
pour cela.
- A qui?
- Au préteur.
- A un magistrat ? non pas du tout. Je serais appelé
en témoignage pour dire ce que je sais, et, avec les
esclaves, on procède par la torture.
- Pardon, je ne voulais pas dire le préteur... C'est
un mot qui m'a échappé, j'avais dans la
pensée une autre personne... Le joyeux Salluste.
- Oh ! quelle affaire as-tu avec lui ?
- Glaucus était mon maître ; il m'a
achetée à un cruel patron ; il a toujours
été bon pour moi, il va mourir. Je ne serai
jamais heureuse, si je ne puis, dans cette heure si terrible
de sa destinée, lui faire connaître que j'ai
gardé de ses bienfaits un souvenir reconnaissant.
Salluste est son ami, il portera mon message.
- Je suis sûr qu'il ne le fera pas. Glaucus a assez
à penser d'ici à demain pour ne pas se troubler
la tête du souvenir d'une fille aveugle.
- Homme, dit Nydia en se levant, veux-tu être libre ? Tu en as les moyens en ton pouvoir ; demain il sera trop
tard. Jamais liberté n'aura été
achetée à meilleur marché ! tu peux
aisément et sans que l'on s'en aperçoive
quitter la maison. Ton absence ne durera pas une demi-heure ; et pour si peu, refuserais-tu la liberté ? »
Sosie était grandement ébranlé ; la
demande en vérité, lui paraissait bien ridicule
: mais qu'est-ce que cela lui faisait ? Tant mieux d'ailleurs ! il pouvait fermer la porte sur Nydia, et, si Arbacès
s'apercevait de son absence, ce ne serait pas, après
tout, une faute majeure ; il ne s'attirerait qu'une
réprimande ; mais si la lettre de Nydia contenait plus
de choses qu'elle n'en avait dit, si elle parlait de son
emprisonnement, comme elle ne manquerait probablement pas de
le faire, qu'arriverait-il ? Arbacès ne pouvait pas
savoir que c'était lui qui avait porté la
lettre : au pis aller, le gain était énorme, le
risque léger, la tentation irrésistible ; il
n'hésita plus, il consentit à la
proposition.
«Donne-moi les joyaux et je me chargerai de la lettre ; mais attends donc, tu es esclave, tu n'as aucun droit sur les
ornements... ils appartiennent à ton
maître.
- Ce sont des présents de Glaucus ; c'est lui qui est
mon maître... il n'est guère probable qu'il les
réclame... d'ailleurs, qui saura qu'ils sont en ta
possession ?
- Cela suffit, je vais t'apporter du papyrus.
- Non, pas de papyrus ; une tablette de cire et un
style.»
Nydia, comme le lecteur l'a vu, était sortie d'une
famille distinguée ; ses parents avaient tout fait
pour alléger son malheur, et sa vive intelligence
avait secondé leurs efforts. En dépit de sa
cécité, elle avait acquis dans son enfance,
bien qu'imparfaitement, l'art d'écrire avec un style
aigu sur des tablettes de cire ; le sens exquis du toucher
qu'elle avait venait à son aide. Dès que les
tablettes eurent été apportées, elle
traça quelques mots en grec, la langue de son enfance,
et que tout Italien de haut rang est supposé
connaître. Elle entoura avec soin son
épître du fil protecteur, et couvrit le noeud
avec de la cire ; puis, avant de remettre les tablettes
à Sosie, elle lui parla ainsi :
«Sosie, je suis aveugle et en prison. Tu peux songer
à me tromper... tu peux prétendre que tu as
remis ma lettre à Salluste ; tu peux ne pas remplir ta
promesse... mais si tu trahis ma confiance, j'appelle
solennellement la vengeance sur ta tête... Je te somme
donc de mettre ta main droite dans la mienne, comme gage de
ta fidélité, et de répéter
après moi ces mots : Par la terre où nous
marchons, par les éléments que contiennent la
vie et qui peuvent l'ôter... par Orcus, le Dieu
vengeur... par Jupiter Olympien... qui voit tout... je jure
que je tiendrai ma promesse et que le message qu'on me confie
sera remis dans les mains de Salluste. Si je manque à
mon serment, que les malédictions du ciel et de
l'enfer tombent sur moi... C'est assez... je me fie à
toi ; prends ta récompense ; il est déjà
tard, pars.
- Tu es une étrange fille, et tu m'as vraiment
effrayé... mais après tout c'est naturel, et,
si je puis trouver Salluste, je lui remets cette lettre comme
je te l'ai promis, sur ma foi... Je puis avoir mes petites
peccadilles... Mais manquer à un serment, me permettre
un parjure... je laisse cela à mes
maîtres.»
Sosie sortit, après avoir eu soin de mettre la barre
à la porte de la chambre de Nydia, en assurant bien
les verrous. Puis il plaça la clef dans sa ceinture,
et se mit en devoir de faire sa commission ; il s'enveloppa
de la tête aux pieds dans un large manteau, et se
glissa dehors sans avoir été vu ni
arrêté par personne.
Les rues étaient presque vides, et il eut
bientôt gagné la maison de Salluste. Le portier
lui dit de laisser sa lettre et de s'en retourner, car
Salluste était si chagrin de la condamnation de
Glaucus qu'il ne voulait être troublé dans sa
douleur par quoi que ce fût.
«Cependant j'ai juré de remettre cette lettre
dans ses propres mains, je dois le faire.»
Et Sosie, sachant bien par expérience comment on
endort un cerbère, lui mit une douzaine de sesterces
dans la main.
«C'est bien, c'est bien, dit le portier adouci ; entre
si tu veux ; mais, pour dire la vérité,
Salluste est en train de noyer son chagrin dans le vin. C'est
son habitude, lorsque quelque chose le tourmente. Il commande
un souper excellent, les meilleurs vins, et ne quitte la
table que lorsque son chagrin est sorti de son esprit pour
faire place à la liqueur...
- Bonne méthode, très bonne ! Ah ! ce que c'est
que d'être riche ! si j'étais à la place
de Salluste, je voudrais avoir quelque chagrin à
chasser tous les jours. Mais dis un mot en ma faveur à
l'intendant. Je le vois venir.»
Salluste était trop triste pour recevoir de la
compagnie... mais trop triste aussi pour boire seul. C'est
pour cela que, selon sa coutume, il admettait son affranchi
à sa table ; et jamais plus étrange banquet
n'eut lieu que ce soir-là. De temps en temps
l'épicurien au bon cœur soupirait, pleurait,
sanglotait, puis mangeait quelques mets et remplissait sa
coupe avec une nouvelle ardeur.
«Mon brave camarade, disait-il à son
compagnon... C'est un terrible arrêt... bien
terrible... Ce chevreau ne vaut rien... Pauvre cher
Glaucus... quelle gueule que celle de ce lion ! ... ah ! ah ! ah ! »
Il sanglota de nouveau, et ses sanglots ne furent interrompus
que par le hoquet.
«Prenez cette coupe de vin, dit l'affranchi.
- Ce vin est un peu trop froid... Mais c'est Glaucus qui doit
avoir froid... que ma maison soit fermée demain... que
pas un esclave ne sorte... Je ne veux pas qu'un seul de mes
serviteurs honore de sa présence cette maudite
arène... Non, non.
- Goûtez de ce falerne... votre douleur vous absorbe...
Par les dieux ! elle vous fera perdre la raison... un peu de
cette tarte à la crème.»
Ce fut dans ce moment favorable que Sosie se vit admis devant
cet inconsolable gourmand.
«Oh ! qui es-tu ?
- Un simple messager pour Salluste ! Je lui remets ce billet
de la part d'une jeune femme : je ne crois pas qu'il y ait de
réponse ; puis-je sortir ? »
En disant cela, le discret Sosie tenait sa figure
cachée dans son manteau et déguisait sa voix,
de peur d'être reconnu plus tard.
«Par les dieux ! un entremetteur chez moi ! Malheureux
que tu es, ne vois-tu pas que j'ai du chagrin ? ... Va-t'en,
et que la malédiction de Pandarus t'accompagne ! »
Sosie ne perdit pas un moment pour se retirer.
«Ne lirez-vous pas cette lettre, Salluste ? dit
l'affranchi.
- Une lettre... quelle lettre ? ... répondit
l'épicurien courroucé, et qui commençait
à voir double... Ces misérables femmes...
suis-je un homme à penser au plaisir ?, ajouta-t-il
avec un nouveau hoquet... lorsque mon ami est sur le point
d'être dévoré ?
- Mangez une autre tartelette.
- Non, non, la douleur m'étouffe.
- Qu'on le porte au lit», dit l'affranchi. Et la
tête de Salluste s'étant inclinée sur son
sein, on le porta à son cubiculum, pendant
qu'il exhalait encore des lamentations sur le sort de
Glaucus, et des imprécations contre les invitations
malencontreuses des dames vouées au plaisir.
Sosie de son côté s'en retournait plein
d'indignation. «Un entremetteur ! vraiment, se
disait-il à lui-même... ce Salluste est un
insolent, et un grossier ; s'il m'avait appelé un
fripon, un voleur, j'aurais pu lui pardonner : mais un
entremetteur ! ... Fi ! ... Il y a dans ce mot de quoi faire
soulever le cœur le moins susceptible. Un fripon n'est
fripon que pour son propre plaisir ; un voleur est voleur
pour son propre bénéfice ; et quand on agit
pour son compte, on a beau être un gredin, on est
jusqu'à certain point honorable ; on est philosophe.
C'est ce qu'on appelle agir par principes... sur une grande
échelle. Mais un entremetteur est une créature
qui s'avilit dans l'intérêt d'autrui ; une
casserole mise sur le feu pour le potage d'un autre... une
serviette que passe un marmiton et à laquelle tous les
convives s'essuient les doigts... Un entremetteur ! J'aimerais mieux qu'il m'eût appelé un
parricide... mais il était ivre et ne savait ce qu'il
disait ; d'ailleurs, je n'étais pas reconnaissable.
S'il avait su que c'était moi, il m'eût dit,
j'en suis sûr : «Honnête Sosie ! » ou
bien : «Mon digne garçon ! » Quoi qu'il en
soit, les bijoux ont été gagnés
lestement... c'est ce qui me console. O déesse
Féronia, je serai bientôt libre, et alors je
verrai qui osera m'appeler entremetteur ! à moins
pourtant qu'on ne me paye bien pour cela.»
Tel était le monologue du généreux et
délicat Sosie, tandis qu'il suivait une étroite
ruelle conduisant à l'amphithéâtre et
vers les palais adjacents. Il se trouva tout à coup,
au détour d'une rue, au milieu d'une foule
considérable : des hommes, des femmes, des enfants,
s'agitaient, riaient, gesticulaient ; et, sans s'en douter,
le digne Sosie fut entraîné dans leur
courant.
«Qu'y a-t-il donc ? demanda-t-il à un jeune
ouvrier, son plus proche voisin ; qu'y a-t-il ? où
courent ces braves gens ? Est-ce que quelques riches patrons
font cette nuit une distribution d'aumônes et
d'aliments ?
- Non, bien mieux que cela, répliqua l'ouvrier ; le
noble Pansa, ami du peuple, a accordé la permission de
voir les bêtes dans leurs vivaria. Par Hercule,
je connais des gens qui ne les verront pas demain avec la
même sûreté !
- Cela vaut la peine d'être vu, dit l'esclave en se
laissant pousser en avant, et, puisque je ne puis assister
demain aux jeux, je veux du moins jeter un coup d'oeil sur
les bêtes cette nuit.
- Vous ferez bien, répondit sa nouvelle connaissance ; on ne voit pas tous les jours à Pompéi un lion
et un tigre.»
La foule entra dans un terrain vaste et accidenté,
assez mal éclairé de distance en distance, ce
qui offrait quelques dangers à ceux dont les membres
et les épaules pouvaient redouter la presse.
Cependant, les femmes surtout, beaucoup d'entre elles avec
leurs enfants sur les bras ou même au sein, se
montraient les plus empressées à se faire un
passage ; et leurs exclamations, soit pour se plaindre, soit
pour prier qu'on ne les étouffât pas,
s'élevaient au-dessus des voix joyeuses des hommes.
Parmi ces voix on distinguait celle d'une jeune fille, qui
paraissait trop heureuse du spectacle qu'elle allait voir
pour sentir les inconvénients de la foule.
«Ah ! ah ! criait la jeune fille à quelques-uns
de ses compagnons, je vous l'avais toujours dit. Un homme
pour le lion, un homme pour le tigre ! nous les avons. Je
voudrais être à demain ! J'aime ces jeux
où l'on voit mille têtes Suivre l'assaut des
hommes et des bêtes. J'aime ces jeux où,
redoublant d'efforts, Les combattants se prennent corps
à corps ; Vous les voyez, sous leur sanglante
étreinte, Se tordre, et puis se rouler dans l'enceinte
: Vous respirez à peine de plaisir... La mort enfin,
la mort vient les saisir. J'aime ces jeux...
- Une joyeuse fille ! dit Sosie.
- Oui, répliqua avec un peu de jalousie le jeune
ouvrier, bien fait et beau garçon ; les femmes aiment
les gladiateurs. Si j'avais été esclave,
j'aurais pris pour maître d'école un
laniste.
- L'eussiez-vous fait ? dit Sosie avec un air
dédaigneux. Chacun son goût.»
La foule était arrivée au lieu de sa
destination. Mais comme la cellule dans laquelle les
bêtes se trouvaient renfermées était
extrême-ment petite et étroite, la presse des
curieux était deux fois plus forte, à mesure
qu'on approchait pour les voir, qu'elle n'avait
été dans la route. Deux des employés de
l'amphithéâtre, placés à
l'entrée, diminuèrent sagement le danger, en ne
délivrant qu'un petit nombre de billets aux premiers
venus, et en n'admettant les survenants que lorsque la
curiosité des premiers était satisfaite. Sosie,
qui était assez vigoureusement constitué, et
qu'un scrupule exagéré de politesse et de
savoir-vivre ne gênait pas beaucoup, essaya d'arriver
parmi les premiers.
Séparé de son compagnon l'ouvrier, Sosie se
trouva dans une étroite cellule où la chaleur
de l'atmosphère était étouffante, et
qu'éclairaient plusieurs torches fumeuses.
Les animaux, gardés ordinairement dans
différents vivaria ou différentes cellules,
avaient été, pour le plus grand plaisir des
spectateurs, rassemblés dans le même lieu, mais
séparés les uns des autres par de fortes cages,
protégées de barres de fer.
On y voyait ces terribles habitants du désert, qui
vont devenir les principaux personnages de notre histoire :
le lion, d'une nature plus douce que son compagnon, avait
été poussé par la faim jusqu'à la
férocité ; il allait et venait dans sa cage
d'un air inquiet et farouche, tout contre les barreaux ; ses
regards peignaient la rage et la faim et, lorsqu'il
s'arrêtait par moments pour regarder la foule, les
spectateurs se rejetaient en arrière et respiraient
deux fois plus vite. Mais le tigre était étendu
tranquillement tout de son long dans sa cage, et le mouvement
de sa queue, avec laquelle il semblait jouer, ou un sourd
bâillement, témoignaient seulement de l'ennui
qu'il éprouvait de la prison ou de la vue de la foule
qui se pressait devant lui.
«Je n'ai jamais vu de bête plus sauvage que ce
lion, même dans l'amphithéâtre de Rome,
dit un gigantesque et musculeux garçon qui se trouvait
à la droite de Sosie.
- Je me sens humilié quand je regarde ses
membres», ajouta, à la gauche de Sosie, un
personnage moins fort en apparence, et dont les bras
étaient croisés sur sa poitrine.
L'esclave les regarda l'un après l'autre, et se dit
à lui-même Virtus in medio ; la vertu se
trouve dans le juste milieu. Un joli voisinage pour toi,
Sosie ! te voilà entre deux gladiateurs.
«Tu as raison, Lydon, reprit le plus grand des
gladiateurs, j'éprouve la même honte.
- Et penser, observa Lydon avec un ton de compassion, penser
que ce noble Grec, que nous avons vu, il y a un jour ou deux,
si plein de jeunesse, de santé, de bonheur, sera la
proie de ce monstre !
- Pourquoi pas ? reprit Niger d'un ton sauvage ; plus d'un
honnête gladiateur a été forcé
à un pareil combat par l'empereur : pourquoi la loi
n'y condamnerait-elle pas un meurtrier ? »
Lydon soupira, haussa les épaules et garda le silence.
Pendant ce temps-là, bon nombre de spectateurs
écoutaient leur conversation, les yeux fixes, la
bouche béante. Les gladiateurs étaient des
objets de curiosité aussi bien que les bêtes :
n'étaient-ce pas des animaux de la même
espèce ? Aussi la foule portait tour à tour ses
regards des hommes aux bêtes, des bêtes aux
hommes, en murmurant ses commentaires, et en savourant par
anticipation ses plaisirs du lendemain.
«Eh bien, dit Lydon en se détournant, je
remercie les dieux de n'avoir pas à combattre le lion
ou le tigre ; j'aimerais mieux, en vérité,
combattre avec toi, Niger.
- Je suis aussi dangereux qu'eux», répondit
l'autre avec un rire féroce ; et les assistants, qui
admiraient ses membres vigoureux et son air sauvage, se
mirent à rire aussi.
«Cela peut être», répondit Lydon
avec insouciance en se frayant un chemin au milieu de la
foule, et en s'éloignant de la cellule.
«Je ne ferais pas mal de profiter de ses
épaules, se dit Sosie en se hâtant de le suivre ; la foule livre toujours passage aux gladiateurs, et, en me
tenant très près derrière
celui-là, j'aurai plus de facilité à me
tirer de là.»
Le fils de Médon passa légèrement
à travers la foule ; beaucoup de personnes
connaissaient son nom et sa profession.
«C'est le jeune Lydon, un bon gladiateur ; il combat
demain, dit quelqu'un.
- Et j'ai parié pour lui, répondit un autre ; regardez comme il marche d'un pas ferme.
- Bonne chance, Lydon ! dit un troisième.
- Lydon, mes souhaits pour toi ! murmura une quatrième
personne (une femme agréable de la moyenne classe) ; et si tu triomphes, tu entendras parler de moi.
- Voilà un bel homme, par Vénus ! s'écria une cinquième, une jeune fille qui
sortait à peine de l'enfance.
- Merci», répondit Sosie, qui prit le compliment
pour lui.
Quelques purs que fussent les motifs de Lydon, et quoiqu'il
fût certain que jamais il n'aurait embrassé
cette sanglante profession sans l'espoir d'obtenir la
liberté de son père, il ne laissait pas que
d'être flatté de l'effet qu'il produisait : il
oubliait que ces voix, qui lui adressaient des voeux en ce
moment, s'élèveraient peut-être le
lendemain pour réclamer sa mort. Fier et hardi de sa
nature, aussi bien que généreux et plein de
cœur, il était déjà
pénétré de l'orgueil de ce métier
qu'il croyait dédaigner ; il avait subi l'influence de
son habituelle société tout en la
méprisant ; il se voyait un homme d'importance ; son
pas en était plus léger, son maintien plus
assuré.
«Niger, dit-il en se retournant tout à coup,
après avoir traversé la foule, nous nous sommes
souvent querellés ; nous ne combattrons pas l'un
contre l'autre ; mais, selon toute apparence, l'un de nous
deux succombera ; donne-moi ta main.
- Bien volontiers, dit Sosie en tendant la sienne.
- Ah ! quel est cet imbécile ? Je croyais que
c'était Niger qui me suivait.
- Je pardonne ta méprise, dit Sosie d'un ton
protecteur, n'en parlons plus ; l'erreur est naturelle :
Niger et moi nous sommes à peu près bâtis
de la même façon.
- Ha ! ha ! c'est excellent. Niger t'aurait
étranglé, s'il t'avait entendu.
- Vous autres, messieurs de l'arène, vous avez une
manière de parler très
désagréable, dit Sosie. Changeons de
conversation.
- C'est bon, c'est bon, dit Lydon, je ne suis pas en humeur
de causer avec toi.
- Vraiment ! répondit l'esclave ; vous avez de quoi
penser, sans aucun doute. Demain, c'est votre début
dans l'arène. Je suis sûr que vous mourrez
bravement.
- Que tes paroles retombent sur ta tête ! dit Lydon,
qui était superstitieux, car la
bénédiction de Sosie ne lui convenait
nullement. Mourir, non ; je ne pense pas que mon heure soit
encore venue.
- Celui qui joue aux dés avec la mort doit s'attendre
au coup du chien, reprit Sosie avec malice ; mais tu es un
vigoureux gaillard, et je te souhaite toute la chance
possible ; et là-dessus, vale.»
L'esclave tourna les talons et prit le chemin de sa
maison.
«J'espère que les paroles de ce coquin ne sont
pas un présage, dit Lydon. Dans mon zèle pour
la liberté de mon père, et dans la confiance
que j'ai en mes nerfs et en mes muscles, je n'avais pas
songé à la possibilité de la mort. Mon
pauvre père, je suis ton fils unique... Si j'allais
périr ! ... »
Agité par cette pensée, le gladiateur marcha
plus rapidement et d'un pas inégal, lorsque tout
à coup, dans une rue opposée, il vit l'objet
même qui causait son souci. Appuyé sur son
bâton, le dos voûté par l'âge; les
yeux baissés, les pas tremblants, le vieux
Médon, dont les cheveux étaient tout blancs,
s'approcha lentement du gladiateur. Lydon s'arrêta un
moment... It devina tout de suite le motif qui avait fait
sortir le vieillard à cette heure tardive.
«C'est moi qu'il
cherche certainement, dit-il ; la condamnation d'Olynthus l'a
frappé d'horreur ; plus que jamais il trouve
l'arène haïssable et criminelle... il vient
encore pour me détourner de combattre... Evitons-le ; je ne puis supporter ses prières ni ses
larmes...»
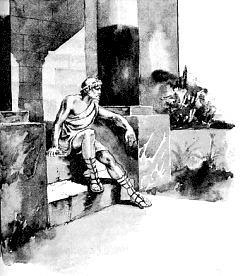
Joseph M. Gleeson, 1891 |
Ces sentiments si longs à décrire traversèrent comme un éclair l'esprit du jeune homme. Il se détourna soudainement de son chemin et prit une autre direction ; il ne s'arrêta, presque hors d'haleine, que lorsqu'il fut parvenu à une petite éminence qui dominait la partie la plus riche et la plus gaie de cette cité en miniature ; de là il contempla les rues tranquilles, éclairées par les rayons de la lune (qui venait de se lever et qui donnait un aspect tout à fait pittoresque à la foule pressée et murmurante autour de l'amphithéâtre) ; l'influence de ce spectacle l'émut, malgré la rudesse de sa nature, peu propre aux entraînements de l'imagination. Il s'assit pour se reposer sur les degrés d'un portique, et sentit que le calme de cette heure passait dans son âme. Près de lui, de l'autre côté, les lumières brillaient dans un palais dont le maître donnait une fête. Les portes étaient ouvertes pour laisser pénétrer la fraîcheur, et le gladiateur put voir de nombreux et joyeux groupes autour des tables dans l'atrium (1), pendant que derrière eux, fermant la perspective des salles illuminées, les jets d'eau d'une fontaine éloignée étincelaient à la clarté de l'astre nocturne. |
Il voyait les guirlandes de fleurs qui entouraient les colonnes des salles, les nombreuses statues de marbre, et, au milieu des éclats de rire, il entendit la musique et distingua cette chanson :
|
CHANSON EPICURIENNE |
Lorsque la piété de Lydon (qui, tout
accommodante qu'elle était, ne fut pas
médiocrement troublée par ces vers empreints de
la philosophie élégante du temps), lorsque,
disions-nous, la piété de Lydon se remit du
choc qu'elle venait de recevoir, un petit nombre d'individus
simplement habillés et appartenant à la classe
moyenne passait devant l'endroit où il était
assis ; leur entretien était animé, et ils ne
parurent pas faire attention au gladiateur en
s'avançant.
«O comble d'horreur ! dit un d'eux ; Olynthus nous est
arraché ; notre bras droit nous est ravi. Quand le
Christ descendra-t-il pour nous protéger ?
- L'atrocité humaine peut-elle aller plus loin ? dit
un autre... Condamner un innocent à l'arène
comme un meurtrier... Mais ne désespérons pas,
le tonnerre de Sinaï peut encore être entendu, et
Dieu sauver ses saints. L'insensé a dit dans son cœur
: Il n'y a pas de Dieu.»
A ce moment, s'élança du palais illuminé
le refrain de la chanson des convives.
Les dieux, amis, nous
trouveraient rebelles,
S'ils existaient... mais ils n'existent pas.(2)
Avant que l'écho eût répété ces mots, les Nazaréens, émus d'une soudaine indignation, firent éclater dans les airs un de leurs hymnes favoris :
|
HYMNE PROPHETIQUE DES NAZAREENS |
Le silence succéda soudain dans la salle du festin à ces prophétiques paroles ; les chrétiens versèrent des pleurs et disparurent bientôt à la vue du gladiateur effrayé, sans trop savoir pourquoi, par leurs mystiques menaces ; Lydon, après une courte pause, se leva pour retourner chez lui. Comme cette belle cité dormait tranquillement devant ses pas, sous la nuit étoilée ! comme les colonnades de ses rues reposaient en pleine sécurité ! comme les vagues de la mer venaient la baigner doucement ! comme les cieux sans nuages de la Campanie étendaient avec complaisance leur azur foncé ! ... Cependant c'était la dernière nuit de cette joyeuse ville de Pompéi, de cette colonie du Chaldéen à cheveux blancs ! de cette cité fabuleuse d'Hercule ! de ces débris des voluptueux Romains ! Les siècles avaient roulé sur sa tête sans y toucher, sans lui ôter une grâce, et maintenant le dernier rayon avait lui sur le cadran de sa destinée. Le gladiateur entendit quelques pas derrière lui ; un groupe de femmes s'en revenait de la visite à l'amphithéâtre ; comme il se retournait, son oeil s'arrêta sur une étrange et soudaine apparition. Du sommet du Vésuve, à peine visible à cette distance, s'élevait une lumière pâle, météorique, livide... elle trembla un instant dans l'air et s'évanouit. Au moment même où cette lueur avait frappé ses yeux, la voix d'une des plus jeunes femmes fit entendre gaiement ce populaire refrain :
«Gai, gai, pas de chagrin,
Quel beau spectacle demain ! »
|
||||||