Livre I, chapitre 8 |
Arbacès pipe ses dés avec le plaisir et gagne la partie
L'obscurité descendait dans la cité
bruyante, quand Apaecidès se dirigea vers la maison de
l'Egyptien. Il évita les rues les plus
éclairées et les plus populeuses ; et pendant
qu'il marchait, la tête appuyée sur sa poitrine
et les bras croisés sous sa robe, il y avait un
étrange contraste entre son maintien solennel, ses
membres amaigris, et les fronts insouciants, l'air
animé de ceux dont les pas rencontraient les
siens.
Cependant un homme d'une démarche plus importante et
plus tranquille, et qui avait passé deux fois devant
lui avec un regard curieux et incertain, lui toucha
l'épaule.
«Apaecidès, dit-il, et il fit un signe rapide
avec la main ; c'était le signe de la croix.
- Ah ! Nazaréen, répondit le prêtre, qui
devint pâle ; que veux-tu ?
- Certes, je ne voudrais pas interrompre ta
méditation, continua l'étranger ; mais, la
dernière fois que je t'ai vu, je reçus de toi,
ce me semble, meilleur accueil.
- Sois le bienvenu, Olynthus ; mais tu me vois triste et
fatigué,et je ne suis pas capable de discuter ce soir
sur les sujets les plus intéressants pour toi.
- O cœur lâche ! dit Olynthus : tu es triste et
fatigué ! et tu veux t'éloigner des sources qui
peuvent te rafraîchir et te guérir.
- O terre ! cria le jeune prêtre en se frappant le sein
avec passion ; de quelle région mes yeux
apercevront-ils enfin le véritable Olympe
habité réellement par les dieux ? Faut-il
croire, avec cet homme, que tous ceux que depuis tant de
siècles mes ancêtres ont adorés n'ont
été qu'un nom ? Faut-il donc briser, comme
sacrilèges et profanes, les autels mêmes que je
considérais comme sacrés, ou bien dois-je
penser avec Arbacès... quoi ? »
Il se tut, et s'éloigna rapidement, avec l'impatience
d'un homme qui essaye de se fuir lui-même.
Mais le Nazaréen était, de son
côté, un de ces hommes hardis, vigoureux,
enthousiastes, au moyen desquels Dieu, dans tous les temps, a
opéré les révolutions de la terre, un de
ceux surtout qu'il emploie dans l'établissement ou la
réforme de son culte, de ces hommes faits pour
convertir, parce qu'ils sont prêts à tout
souffrir. Les gens de cette trempe, rien ne les
décourage, rien ne les arrête, ils inspirent la
ferveur dont ils sont inspirés : leur raison allume
d'abord leur passion, mais leur passion est l'instrument dont
ils se servent ; ils pénètrent par force dans
le cœur des hommes, en ayant l'air de ne faire appel
qu'à leur jugement. Rien de si contagieux que
l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme qui est
l'allégorie réelle de la fable d'Orphée ; il fait mouvoir les pierres, il charme les bêtes
sauvages : l'enthousiasme est le génie de la
sincérité, et la vérité n'obtient
aucune victoire sans lui.
Olynthus ne laissa pas Apaecidès s'échapper si
subitement ; il le rejoignit, et s'adressa ainsi à lui
:
«Je ne m'étonne pas, Apaecidès, si je
vous importune, si j'ébranle tous les
éléments de votre esprit, si vous vous perdez
dans le doute, si vous errez dans le vaste océan d'une
rêverie ténébreuse. Je ne m'étonne
pas de cela ; mais écoutez-moi avec un peu de patience ; veillez en paix : l'obscurité se dissipera, la
tempête s'apaisera, et Dieu lui-même, comme on
l'a vu marcher sur les mers de Samarie, s'avancera sur les
vagues tumultueuses de votre esprit pour délivrer
votre âme. Notre religion est jalouse dans ses
exigences, mais infiniment prodigue dans ses bienfaits : elle
vous trouble une heure ; elle vous donne en revanche
l'immortalité.
- De telles promesses, répondit Apaecidès avec
humeur, sont des leurres avec lesquels on ne cesse de tromper
les hommes. C'est avec des paroles semblables qu'on m'a fait
tomber aux pieds de la statue d'Isis.
- Mais, poursuivit le Nazaréen, consultez votre raison ; une religion qui outrage toute moralité peut-elle
être vraie ? On vous dit d'adorer vos dieux. Que sont
vos dieux, même d'après vous ? Quelles sont
leurs actions ? quels sont leurs attributs ? Ne vous sont-ils
pas représentés comme les plus noirs des
criminels ? Cependant on vous demande de les servir comme les
plus saintes divinités. Jupiter lui-même est
parricide et adultère. Vos dieux inférieurs ne
sont que les imitateurs de ses vices ! On vous défend
d'assassiner ; vous adorez des assassins. On vous engage
à ne pas commettre d'adultère, et vous adressez
vos prières à un adultère. N'est-ce pas
là une moquerie de la plus sainte partie de la nature
de l'homme, de la foi ? Tournez maintenant vos regards vers
Dieu, le seul, le vrai Dieu, à l'autel duquel je veux
vous conduire. S'il vous semble trop sublime, trop impalpable
pour ces associations humaines, pour ces touchants rapports
entre le créateur et la créature, dont notre
faible cœur a besoin, contemplez-le dans son fils, qui s'est
fait homme comme nous. Ce n'est pas comme vos faux dieux, par
les vices de notre nature, mais par la pratique de nos
vertus, que sa personnalité humaine se déclare.
En lui s'unissent les moeurs les plus austères et les
plus tendres affections. N'eût-il été
qu'un homme ; il serait digne encore d'être un dieu.
Vous honorez Socrate ; il a sa secte, ses disciples, ses
écoles : mais que sont les douteuses vertus de cet
Athénien auprès de la sainteté
éclatante, indubitable, active, inces-sante,
dévouée du Christ ? Je vous parle ici de son
caractère purement humain. Il est apparu comme le
modèle des âges futurs, pour faire voir la forme
de la vertu à laquelle Platon désirait tant
donner un corps. Tel fut le véritable sacrifice qu'il
fit pour l'homme ; mais la gloire qui environna sa
dernière heure n'illumina pas seulement la terre, elle
nous ouvrit la perspective des cieux. Vous êtes
touché, vous êtes ému. Dieu agit sur
votre cœur. Son esprit est en vous. Allons ! ne
résistez pas à ce saint mouvement. Venez,
laissez-moi vous guider. Vous êtes triste, vous
êtes las. Ecoutez les paroles mêmes de Dieu :
«Venez à moi, dit-il, vous tous qui êtes
chargés d'un fardeau, et je vous donnerai le
repos.»
- Je ne puis vous suivre maintenant, dit Apaecidès,
une autre fois...
- Maintenant, maintenant ! » s'écria Olynthus
avec chaleur et en lui prenant le bras.
Mais Apaecidès, qui n'était pas encore
préparé à renoncer à une croyance
pour laquelle il avait déjà tant
sacrifié, et qui se trouvait d'ailleurs sous l'empire
des promesses de l'Egyptien, se dégagea avec force des
mains d'Olynthus ; sentant de plus qu'il fallait un effort
pour vaincre l'irrésolution que l'éloquence du
chrétien commençait à produire dans son
âme facilement émue, il releva vivement sa robe,
et s'éloigna d'un pas rapide qui défiait toute
poursuite.
Epuisé et presque sans haleine, il arriva enfin
à un endroit écarté et solitaire de la
ville, et ne s'arrêta que devant la maison
isolée de l'Egyptien. Pendant qu'il se remettait un
peu de sa course, la lune s'élança d'un nuage
d'argent, et jeta une pleine lumière sur les murs de
cette mystérieuse habitation. Il n'y avait aucune
maison voisine : des vignes épaisses en entouraient le
devant ; derrière s'élevaient de grands arbres,
comme endormis sous les rayons mélancoliques de la
lune ; au loin on apercevait les lignes vagues des montagnes
à l'horizon, et parmi ces montagnes, la crête
tranquille du Vésuve, moins élevée
qu'elle ne paraît à présent aux yeux du
voyageur.
Apaecidès traversa les vignes courbées en
berceau, et s'approcha du large et spacieux portique au
devant duquel, des deux côtés des marches,
reposait le sphinx égyptien. La lueur de la lune
ajoutait encore un calme solennel à ces larges,
harmonieuses, impassibles images, où les sculpteurs de
ce symbole de la sagesse s'étudiaient à unir
l'amabilité et la grandeur. A la moitié de la
hauteur, et à l'extrémité du perron,
s'étendait le vert et massif feuillage d'un
aloès, et l'ombre du palmier oriental tombait des
longues et immobiles branches de ce bel arbre sur le marbre
de l'escalier.
La tranquillité du lieu et l'aspect étrange des
sphinx avaient quelque chose d'effrayant, qui remplit
l'âme du jeune prêtre d'une terreur
superstitieuse et sans nom ; il eut plaisir à entendre
le bruit de ses pas en montant sur le seuil.
Il frappa à la porte, au-dessus de laquelle
était sculptée une inscription dont les
caractères ne lui étaient pas familiers ; la
porte s'ouvrit sans bruit, et un esclave égyptien de
haute taille, sans le questionner et sans le saluer, lui fit
signe d'avancer. La vaste salle où il entrait
était éclairée par de majestueux
candélabres de bronze travaillé avec art ; les
murs en étaient couverts d'hiéroglyphes en
couleurs sombres et sévères, qui contrastaient
étrangement avec les brillantes nuances et les formes
gracieuses en usage chez les habitants de l'Italie. Du bout
de la salle, un esclave, dont le teint, quoique ce ne
fût pas un Africain, était beaucoup plus noir
que celui des personnes du Midi, s'avança à sa
rencontre.
«Je cherche Arbacès», dit le prêtre,
et sa voix tremblait, même pour ses propres oreilles.
L'esclave inclina la tête en silence, et, conduisant
Apaecidès vers une aile extérieure de
l'appartement, il le fit passer par un étroit escalier
et traverser ensuite plusieurs chambres dont la morne et
immobile beauté du sphinx formait encore le principal
et le plus frappant objet. Apaecidès se trouva enfin
dans une salle à demi éclairée, en
présence de l'Egyptien.
Arbacès était assis devant une petite table sur
laquelle se déployaient quelques rouleaux de papyrus
chargés de caractères semblables à ceux
qu'il avait vus à l'entrée de la maison. A peu
de distance s'élevait un petit trépied
où brûlait de l'encens ; la fumée s'en
échappait légèrement ; à
côté on voyait un large globe où tous les
signes du ciel étaient peints, et, sur une autre
table, plusieurs instruments d'une forme curieuse et bizarre,
dont l'usage était inconnu à Apaecidès.
L'extrémité opposée de la salle
était cachée par un rideau, et la fenêtre
oblongue du toit laissait pénétrer les rayons
de la lune tristement mêlés à la
lumière de la lampe qui éclairait
l'appartement.
«Asseyez-vous, Apaecidès», dit l'Egyptien
sans se lever. Le jeune homme obéit.
«Vous me demandez, reprit Arbacès, après
un léger intervalle pendant lequel il parut
absorbé dans sa pensée, vous me demandez, ou
vous avez dessein de me demander, la connaissance des plus
grands secrets que l'âme humaine puisse jamais contenir ; c'est l'énigme de la vie elle-même que vous
désirez résoudre. Placés comme les
enfants dans l'obscurité, et pour un court espace de
temps dans l'existence obscure et limitée, nous nous
créons à nous-mêmes des fantômes ; nos pensées retombent tantôt sur nous, et nous
remplissent de terreur ; et tantôt se plongent dans la
sombre région qui nous entoure, en cherchant à
deviner ce qu'elle peut renfermer ; nous étendons
çà et là nos mains
désespérées, de peur de rencontrer
quelque danger imprévu. Ignorant les limites de notre
prison, nous croyons parfois les sentir se rapprocher et nous
suffoquer, et parfois nous nous imaginons qu'elles
s'étendent jusqu'à l'infini. En cet
état, toute sagesse consiste nécessairement
dans la solution de deux questions. Que devons-nous croire ? Que devons-nous rejeter ? Ces questions, vous souhaitez que
je les décide.»
Apaecidès baissa la tête en signe
d'assentiment.
«Il faut une croyance à l'homme, continua
l'Egyptien d'un ton grave, il doit attacher ses
espérances à quelque chose : c'est notre
commune nature qui parle en vous, lorsque, effrayé de
voir tomber tout ce qui servait d'appui à votre foi,
vous vous trouvez flottant sur la mer profonde et sans
rivages de l'incertitude ; vous appelez au secours, vous
cherchez une planche où vous puissiez vous cramponner,
afin d'aborder à quelque terre, si
ténébreuse et si éloignée qu'elle
soit : vous n'avez pas oublié notre conversation
d'aujourd'hui ?
- L'oublier !
- Je vous ai avoué que ces déités en
l'honneur desquelles on fait fumer tant d'encens
n'étaient que des inventions. Je vous ai
avouéque nos rites et nos cérémonies
n'étaient que des momeries, imaginées pour
abuser le troupeau des hommes dans son propre
intérêt. Je vous ai expliqué comment ces
artifices formaient les liens de la société,
l'harmonie du monde, le pouvoir du sage, pouvoir fondé
sur l'obéissance du vulgaire. Conservons donc ces
supercheries salutaires ; puisqu'il faut une croyance
à l'homme, qu'il garde celle que ses pères lui
ont rendue chère, celle que l'usage sanctifie et
fortifie. En cherchant une foi plus subtile pour nous, dont
les sens plus délicats ne sauraient s'accommoder
à celle-là, ne privons pas les autres de
l'appui qui nous manque. Cela est sage, cela est
bienfaisant.
- Continuez.
- Ainsi donc, poursuivit l'Egyptien, les anciennes limites
demeurant intactes pour ceux que nous allons abandonner, nous
ceignons nos reins, et nous partons pour les nouveaux climats
de la foi. Bannissez de vos souvenirs, de vos pensées,
tout ce que vous avez cru jusqu'à ce jour. Supposez
que votre esprit est une table rase, un papyrus sur lequel on
n'a rien écrit encore, préparé pour
recevoir une première impression. Jetez les yeux sur
le monde ; observez-en l'ordre, la régularité,
le dessein : il a été créé
indubitable-ment. L'oeuvre proclame un créateur ; nous
touchons terre ici. Mais quel est le créateur ? un
Dieu, vous écriez-vous ? Arrêtez, pas de
confusions, pas d'applications incertaines : de l'Etre qui
créa le monde nous ne connaissons, nous ne pouvons
connaître rien que ses attributs, sa puissance et sa
régularité invariable :
régularité sévère,
écrasante, impitoyable, qui ne se préoccupe pas
des cas individuels, qui va roulant, balayant, embrasant
tout, sans prendre garde aux cœurs séparés de
la masse générale broyés entre ses
serres terribles ! Le mélange du bien et du mal,
l'existence de la douleur et du crime, ont de tout temps
embarrassé les sages. En créant un Dieu, ils le
supposèrent bienveillant : d'où vient donc le
mal ? Pourquoi Dieu le permet-il ? bien plus, pourquoi
l'avoir inventé, pourquoi le perpétuer ? En
réponse à cette objection, les Perses imaginent
un second esprit, dont la nature est le Mal, et
prétendent qu'il est continuellement en guerre avec le
Dieu du Bien. Le sombre et terrible Typhon est un
démon pareil pour les Egyptiens. Erreur embarrassante
qui nous égare encore plus ! Folie produite par cette
chimère de vouloir faire un être palpable,
corporel, humain, de ce pouvoir inconnu ; folie qui
revêt l'Invisible des attributs et de la nature de
l'être visible. Non ; donnons à cette puissance
un nom qui n'exige pas ces étranges associations
d'idées, et le mystère deviendra plus clair. Ce
nom est le DESTIN. Le destin, disent les Grecs, commande aux
dieux : pourquoi des dieux alors ? leur intervention n'est
plus utile ? il faut les rejeter. Le DESTIN est le
maître de tout ce que nous voyons. Puissance,
régularité, ces deux qualités composent
sa nature ; si vous en demandez davantage, vous ne pouvez
plus rien apprendre... Qu'elle soit éternelle, et
qu'elle pousse ses créatures vers une autre vie,
après ce sombre passage que nous appelons la mort,
personne ne peut le dire. Ici nous quittons le pouvoir
ancien, invisible, insondable, et nous arrivons à
celui qui à nos yeux est le grand ministre de ses
fonctions. Nous pouvons mieux parler de celui-ci, parce que
nous pouvons apprendre plus de choses de lui; son
évidence nous entoure : il se nomme la NATURE.
L'erreur des sages a été de rechercher les
attributs du Destin dans lequel tout est obscurité
impénétrable. S'ils s'étaient
bornés à interroger la Nature, quelles
connaissances n'aurions-nous pas déjà acquises ? là, la patience et l'examen obtiennent la
récompense de leurs peines. Nous voyons ce que nous
explorons, notre esprit monte par une échelle palpable
de causes et d'effets : la Nature est le grand agent de
l'univers extérieur, et le Destin lui impose les lois
par lesquelles elle agit, et nous accorde à nous les
pouvoirs de l'examen. Ces pouvoirs consistent dans la
curiosité et dans la mémoire, dont l'union est
la raison, et dont la perfection est la sagesse. J'examine
donc, grâce à ces pouvoirs, cette
inépuisable Nature. J'examine la terre, l'air,
l'Océan, le ciel ; je trouve une mystérieuse
sympathie entre les éléments : la lune dirige
les marées ; l'air retient la terre, c'est le milieu
où tout vit, où tout sent ; la connaissance des
astres nous donne la mesure des limites de la terre, la
division du temps ; leur pâle lumière nous guide
dans les abîmes du passé ; leur science
solennelle nous enseigne les mystères de l'avenir. De
cette façon, si nous ignorons ce qu'est le Destin,
nous apprenons du moins ses secrets. Maintenant, quelle
moralité faut-il tirer de cette religion ? Car c'est
une religion. Je crois à deux divinités, la
Nature et le Destin. Le respect me courbe aux pieds du
dernier, l'étude me fait adorer la première.
Quelle est la moralité que ma religion m'enseigne ? Celle-ci : toutes les choses ne sont soumises qu'à des
règles générales ; le soleil luit pour
la joie du plus grand nombre, mais il peut apporter de la
peine à quelqu'un ; la nuit répand le sommeil
sur la multitude, mais elle protège le crime aussi
bien que le repos ; les forêts décorent la
terre, mais elles abritent le serpent et le lion ; l'Océan supporte mille barques, mais il en engloutit
une ; la Nature n'agit donc que pour le bien
général et non pour le bien universel, et le
Destin hâte sa course terrible. Telle est la
moralité de ces redoutables agents du monde ; c'est la
mienne, à moi qui suis leur créature. Je veux
conserver les artifices des prêtres, parce que ces
artifices sont utiles à la multitude ; je veux faire
participer les hommes aux arts que je découvre, aux
sciences que je perfectionne ; je veux étendre la
vaste carrière de la civilisation : en cela je sers
les masses, j'obéis à la loi
générale, je mets en action la grande morale
que prêche la nature : mais pour moi-même je
réclame l'exception individuelle, je la réclame
pour le sage, assuré que mes propres actions ne sont
rien dans la grande balance du bien et du mal ; persuadé que les produits de ma science peuvent
être plus profitables à la masse que mes
désirs ne peuvent être nuisibles au petit
nombre, car les premiers peuvent s'étendre aux
régions les plus lointaines et civiliser des nations
encore à naître. Je donne au monde la sagesse,
je garde pour moi la liberté. J'éclaire
l'existence des autres et je jouis de la mienne. Oui, notre
sagesse est éternelle, mais notre vie est courte ; sachons-en profiter pendant que nous la possédons.
Livre ta jeunesse au plaisir, et ses sens à la
volupté. Elle vient assez tôt, l'heure où
la coupe est brisée, où les guirlandes cessent
de fleurir pour nous ; jouis alors que tu peux jouir, sois
toujours Apaecidès, mon pupille et mon adepte. Je
t'enseignerai le mécanisme de la nature, ses plus
profonds et ses plus sombres secrets, la science que les fous
appellent magie, et les puissants mystères des
étoiles. Ainsi tu rempliras tes devoirs envers les
hommes ; ainsi tu éclaireras ta race. Mais je
t'initierai à des plaisirs que le vulgaire des hommes
ne connaît pas : les jours que tu sacrifieras aux
mortels seront suivis de douces nuits où tu ne
sacrifieras qu'à toi-même.»
Au moment où l'Egyptien cessa de parler, il
s'éleva de tous côtés la plus enivrante
musique que la Lydie ait jamais pu enseigner, ou l'Ionie
perfectionner. On eût dit comme des vagues d'harmonie
qui venaient baigner les sens à l'improviste, les
énervant, les subjuguant avec délices. On
aurait cru entendre les mélodies des esprits
invisibles, que les bergers ont entendues dans l'âge
d'or, courant, flottant dans les vallées de la
Thessalie, ou dans les bosquets de Paphos. Les paroles
qu'Apaecidès allait proférer, en réponse
aux sophismes de l'Egyptien, s'évanouirent sur ses
lèvres. Rompre cet enchantement lui eût
semblé une profanation. La susceptibilité de sa
nature si prompte à s'émouvoir, la mollesse
toute grecque et l'ardeur secrète de son âme,
furent saisies et captivées par suprise. Il s'inclina
sur son siège, les lèvres entrouvertes et les
oreilles attentives ; un choeur de voix, douces et
pénétrantes comme celles qui
réveillèrent Psyché dans le palais de
l'Amour, chantait l'hymne que voici :
|
L'HYMNE D'EROS |
Quand le chant eut cessé, l'Egyptien saisit la main
d'Apaecidès, et le conduisit, éperdu et
chancelant, quoique malgré lui, vers le rideau qui
était au fond de l'appartement. Mille étoiles
étincelaient derrière ce rideau ; le voile
lui-même, sombre jusque-là, se trouva
éclairé par mille feux cachés, et brilla
de la couleur bleue des cieux. Il représentait les
cieux mêmes, tels que, dans les nuits de juin, on les
voit briller sur les sources de Castalie. çà et
là se déployaient des nuages roses et
légers, du sein desquels souriaient, peintes avec un
art charmant, des figures d'une beauté divine, des
corps dont la forme aurait pu être rêvée
par Phidias ou par Apelles ; et les étoiles qui
resplendis-saient dans l'azur transparent roulaient
rapidement, tandis que la musique, qui recommença sur
un ton plus vif et plus gai, semblait imiter la joyeuse
mélodie des sphères.
«Oh ! quel est ce prodige, Arbacès ? dit
Apaecidès d'une voix émue. Après avoir
nié qu'il est des dieux, voulez-vous me
révéler...
- Leurs plaisirs»,
interrompit Arbacès d'un ton si différent de sa
froide et habituelle tranquillité, qu'Apaecidès
tressaillit et pensa que l'Egyptien lui-même
éprouvait une transformation. Au moment où ils
s'approchaient du rideau, une mélodie étrange,
puissante, exaltée, se fit entendre derrière,
et le rideau se déchira en deux, et s'évanouit
pour ainsi dire dans les airs. Une scène, dont la
séduction n'a jamais été
surpassée chez aucun sybarite, se montra alors aux
yeux éblouis du jeune prêtre : une vaste salle
de banquet s'étendait au loin, avec d'innombrables
lumières qui remplissaient l'air d'une douce chaleur,
et des parfums d'encens, de jasmin, de violette et de myrrhe,
tout ce que les fleurs les plus odorantes et les plus
précieux aromates pouvaient distiller de suave,
paraissaient se confondre dans une essence ineffable qui
donnait l'idée de l'ambroisie ; aux
légères colonnes élancées vers le
plafond aérien étaient suspendues des draperies
blanches parsemées d'étoiles d'or ; vers les
extrémités de la chambre, deux fontaines
lançaient leurs jets dont les gouttes,
pénétrées par les reflets roses de la
lumière, semblaient autant de diamants. Autour de la
salle où ils entraient s'éleva lentement
à leurs pieds, au son d'une musique invisible, une
table couverte des mets les plus délicats que la
fantaisie ait jamais pu rechercher pour flatter les sens, et
sur laquelle des vases de cette fabrique myrrhine dont le
secret est perdu (3) et
dont les couleurs étaient si vives et la
matière si transparente, se dressaient, chargés
de produits exotiques de l'Orient. Les lits dont cette table
formait le centre étaient recouverts de tapisseries
d'azur et d'or ; d'une foule de tuyaux invisibles dans le
plafond cintré, coulait une eau parfumée qui
rafraîchissait l'air délicieux, et rivalisait
avec les lampes, comme si les esprits des eaux et du feu se
disputaient à qui répandrait les plus
agréables senteurs. Alors, écartant de blanches
draperies, s'avancèrent de jeunes beautés
pareilles à celles que voyait Adonis lorsqu'il
était couché sur le sein de Vénus. Les
unes portaient des guirlandes, les autres des lyres. Elles
entourèrent le jeune homme, elles le conduisirent au
banquet en l'enchaînant dans leurs fleurs. Toute
pensée de la terre s'effaça de son âme ; il se crut le jouet d'un songe, et retint son haleine, de
peur de se réveiller trop tôt. Le plaisir des
sens, qu'il n'avait jamais encore goûté, fit
battre son pouls brûlant et voila sa vue ; un frisson
parcourut tout son être. Pendant qu'il était
ainsi émerveillé, égaré, les voix
mystérieuses attaquèrent une mesure vive et
bachique.
|
ODE ANACREONTIQUE |
Le chant expiré, un groupe de très jeunes filles, enlacées d'une chaîne de fleurs étoilées, et qui surpassaient les Grâces en les imitant, s'avança vers lui en dansant des pas ioniens, semblables aux pas des Néréides lorsqu'elles jouaient au clair de la lune sur les sables de la mer Egée, ou à ceux que Cythérée enseignait à ses nymphes au mariage de Psyché et de son fils. Tantôt en s'approchant, elles couronnaient son front de leurs guirlandes ; tantôt la plus jeune des trois, s'agenouillant, lui présentait la coupe où étincelait et bouillonnait le vin de Lesbos. Le jeune homme ne résista plus ; il saisit le breuvage enchanté. Le sang coulait impétueusement dans ses veines. Il laissa tomber son front sur le sein de la nymphe auprès de laquelle il était assis ; et tournant ses yeux humides vers Arbacès qu'il cherchait, et auquel il n'avait plus songé dans l'excès de ses émotions, il l'aperçut assis sous un dais au bout de la table ; Arbacès le regardait avec un air souriant, qui l'invitait à s'abandonner au plaisir. Il l'aperçut, non pas comme il avait coutume de le voir, vêtu d'une robe noire, le front soucieux et austère : une robe qui éblouissait la vue, blanche et tout étincelante de pierreries et d'or, enveloppait sa taille majestueuse ; des roses blanches aussi, et entremêlées d'émeraudes et de rubis, formaient une espèce de tiare qui surmontait ses cheveux noirs. Il semblait, comme Ulysse, avoir obtenu la faveur d'une seconde jeunesse. Ses traits paraissaient avoir échangé la méditation contre la beauté. Il possédait, au milieu de tout le charme dont il était entouré, la douceur suprême et rayonnante du maître de l'Olympe.
|
«Bois, prends part au banquet, aime, ô
mon disciple, dit-il ; ne rougis pas d'être jeune
et passionné. Ce que tu es, l'ardeur de ton sang
te le dit. Ce que tu seras, ceci te le
dira.» |
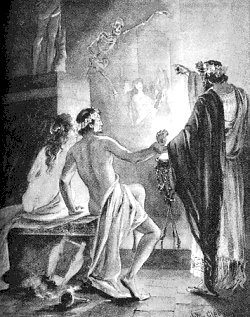
Joseph M. Gleeson, 1891 |
|
HYMNE BACHIQUE A L'IMAGE DE LA MORT |
Ici un nouveau groupe s'avança, et la musique prit un ton plus vif et plus joyeux.
|
II |
Après un léger repos, la musique recommença avec une mesure plus vive et plus brillante encore.
|
Puisque la vie est si rapide |
Un troisième groupe s'approcha avec des coupes pleines jusqu'au bord, qu'on répandit en libations sur cet étrange autel. La musique changea encore sa mélodie, et reprit d'un ton lent et solennel :
|
III |
En ce moment, la jeune fille assise près d'Apaecidès continua soudain la chanson :
|
IV |
|
|||||||||