- ACTEURS GRECS
L'acteur s'appelait en grec upokritês, son art upokrisis et upokrinesthai. D'après les grammairiens anciens, le terme upokritês signifiait primitivement le répondant : nom qui exprimerait bien la fonction essentielle du plus ancien acteur, c'est-à-dire de l'acteur unique du temps de Thespis, laquelle était en effet de répondre aux questions du coryphée. Cependant plusieurs savants modernes rejettent cette explication. Pour Sommerbrodt, entre autres, le mot upokritês signifierait l'interprète, le truchement d'un rôle. Et il est de fait que le verbe upokrinesthaia eu, du moins à l'origine, le sens de interpretari à côté de celui de respondere : on trouve des exemples de ce double sens chez Homère et même encore chez Hérodote. Il est malaisé de se prononcer entre ces deux étymologies : la première, plus simple et moins abstraite, paraît cependant préférable.
C'est Thespis qui du choeur dithyrambique dégagea l'acteur. Avant lui le dithyrambe se composait de deux éléments : 1° un coryphée, qui narrait les aventures et les souffrances d'un héros ou d'un dieu ; 2° un choeur, dont les cris de joie ou d'angoisse, les questions passionnées coupaient ces récits et en provoquaient de nouveaux [Cyclicus chorus, Dithyrambus]. Le coryphée du dithyrambe, voilà l'ancêtre direct de l'acteur tragique. A ce récitant, impersonnel et anonyme, Thespis eut l'idée heureuse de substituer un personnage véritable qu'on vît parler et agir sous le nom et sous la figure du héros lui-même. Jusqu'à Eschyle, les tragiques n'eurent à leur disposition que cet acteur. C'est Eschyle qui introduisit sur la scène le second tragédien : trois de ses pièces subsistantes, les Suppliantes, les Perses, les Sept contre Thèbes (peut-être y aurait-il lieu d'y joindre aussi le Prométhée, mais il n'y a pas accord sur ce point entre les savants) n'exigent que deux interprètes. Quant au troisième acteur, c'est Sophocle qui le premier y eut recours ; et Eschyle, dans les trois drames de l'Orestie, a suivi l'exemple donné par son jeune rival. Aucune des tragédies de Sophocle et d'Euripide ne réclame plus de trois acteurs ; et il est à croire que ce nombre ne fut jamais dépassé.
Toutefois il importe de préciser par quelques restrictions la portée de cette loi. Ne doivent pas être comptés comme acteurs les comparses, souvent nombreux, auxquels on donnait le nom technique de parachorêgêmata. Ce nom s'applique d'abord aux personnages muets (kôpha prosôpa) : ainsi, les rois de théâtre paraissaient toujours avec une troupe de gardes du corps (doruphoroi, doruphorêmata) ; les reines avaient une suite de dames d'honneur ; tout héros était escorté au moins d'un esclave. D'autres personnages muets sont : Bia dans le Prométhée d'Eschyle, Hermès dans les Euménides, Pylade dans l'Electre de Sophocle et dans celle d'Euripide. En second lieu, on rangeait aussi parmi les parachorêgêmata les personnages insignifiants qui n'avaient qu'un bout de rôle. Exemples : Pylade qui ne dit que trois vers dans les Choéphores (v. 900-902), le petit Eumélos dans Alceste (v. 393-415), les deux enfants dans Médée (v. 1271-1278), le petit Molossos dans Andromaque (v. 504-514). Il n'était pas besoin pour ces petits rôles d'un acteur proprement dit : un choreute ou un simple figurant s'en acquittait.
Tout porte à croire que ce que nous venons de dire de la tragédie est applicable au drame satyrique. Dans le seul spécimen qui nous en reste, le Cyclope, il faut trois acteurs : protagoniste, Ulysse ; deutéragoniste, Silène ; tritagoniste, le Cyclope.

De même, sur le vase du musée de Naples qui représente les apprêts d'une représentation satyrique, on voit, outre le choeur, trois acteurs proprement dits : Héraclès, Silène, et un roi. Il se peut toutefois que dans ce genre l'ancienne simplicité de moyens ait persisté plus longtemps que dans la tragédie : ainsi l'Alceste, pièce héroïcomique qu'Euripide fit jouer en 438, en guise de drame satyrique, ne demande que deux interprètes : le protagoniste y joue vraisemblablement les rôles d'Apollon, d'Alceste, d'Héraclès et de Phérès, tandis que le deutéragoniste fait Thanatos, une servante, Admète et un serviteur. Il y a bien, à la fin de la pièce, une scène à trois personnages, celle où Héraclès présente Admète sa femme ramenée des Enfers : mais comme celle-ci y paraît muette et voilée, nul doute que cette partie du rôle ne fût confiée à un figurant.
On ne savait plus déjà du temps d'Aristote qui avait fixé définitivement à trois dans la comédie le nombre des acteurs. Peu digne de foi est l'assertion d'un anonyme qui attribue cette mesure à Cratinos. Tout ce qu'on peut affirmer, en l'absence de témoignages, c'est que, sur ce point comme en tant d'autres, la comédie a pris pour modèle son aîné, le drame sérieux. Mais à quelle époque eut lieu cet emprunt ? Probablement il date du jour où la comédie, jusque-là simple divertissement laissé à l'initiative privée, prit place officiellement à côté de la tragédie dans le cadre des fêtes Dionysiaques. Or on s'accorde à placer les premiers concours comiques dans les années qui suivirent immédiatement les guerres Médiques (vers 470). Quoi qu'il en soit, Aristophane se conforme strictement à la règle des trois acteurs. Des recherches précises ont prouvé que, malgré la multiplicité des personnages que ce poète met en scène, aucun de ses drames n'en exige davantage : seulement il faut dans chaque pièce compter à part un assez grand nombre d'utilités (parachorêgêmata). Citons par exemple dans la Paix, les deux petites filles de Trygée et trois personnages allégoriques, l'Abondance, la Paix, et Théoriao. Rien ne permet de supposer que la loi des trois acteurs n'ait pas persisté dans la comédie nouvelle. Tout le temps que la tragédie se contenta d'un acteur, cet acteur fut le poète lui-même. Ce n'est que du jour où Eschyle fit dialoguer sur la scène deux personnages que naquit la profession de tragédien. Dès lors, tout en gardant ordinairement les premiers emplois, l'auteur dut confier à un auxiliaire les seconds rôles. Ce fut, dit-on, Sophocle qui renonça le premier, à cause de la faiblesse de sa voix, à paraître dans ses propres pièces : cependant on le vit encore sur la scène dans son Thamyris, où il personnifiait l'aède, et dans ses Laveuses (Pluntriai), où il tenait le rôle de Nausicaa. On connaît quelques-uns des interprètes d'Eschyle et de Sophocle : nous savons par exemple qu'Eschyle employa tour à tour à son service Cléandros et Mynniscos : Cléidémides et Tlépolémos sont cités, d'autre part, comme acteurs attitrés de Sophocle. Il faut donc admettre qu'à l'origine les poètes avaient toute liberté dans le choix de leurs interprètes. Sans quoi, du reste, on ne saurait comprendre la tradition d'après laquelle Sophocle se préoccupait déjà d'accommoder ses rôles au talent de ses acteurs. Cette tradition, cependant, ne peut guère se rapporter qu'à la première partie de la carrière du poète. D'une glose d'Hésychius, de Photius et de Suidas, il résulte en effet que l'Etat, à partir d'une certaine époque, se réserva le choix des protagonistes tragiques ; d'un autre côté, les inscriptions didascaliques nous apprennent qu'un prix d'interprétation fut institué pour ces derniers aux Grandes Dionysies, vers 432. Rien de plus naturel que de rapprocher ces deux mesures : probablement elles sont contemporaines, et la première a été prise en vue de la seconde. N'oublions pas, à ce propos, de remarquer que seul le protagoniste était nommé par l'Etat, et que celui-ci n'intervint jamais dans la désignation des deux acteurs inférieurs. C'est que le protagoniste n'était pas seulement acteur principal; c'était en même temps un chef de troupe, ayant sous ses ordres et à sa solde un deutéragoniste et un tritagoniste qu'il recrutait à son gré. Et par suite, attribuer à chaque poète un protagoniste, c'était mettre à sa disposition une troupe.
Dans la comédie, nous observons les mêmes phases. A l'origine les poètes étaient en même temps acteurs, ce que prouve notamment le nom d'orchêstai, ou «danseurs», donné aux plus anciens. Plus tard, ayant renoncé à paraître eux-mêmes sur la scène, ils choisirent, du moins, librement leurs interprètes : Cratinos, par exemple, garda pendant de longues années à son service Cratès, qui se forma ainsi, dit-on, à son futur métier de poète. Enfin l'Etat enleva aux auteurs comiques le choix de leurs acteurs. Quand fut prise cette mesure ? Ce qui paraît certain, c'est qu'elle n'est pas postérieure à l'année 422, l'existence d'un concours entre les protagonistes étant attestée à partir de cette date.
La désignation officielle des protagonistes, tant tragiques que comiques, avait lieu à la suite d'une épreuve imposée aux candidats. Dans la glose d'Hésychius, Photius et Suidas, dont nous avons déjà parlé, il est dit en effet que tout acteur couronné dans un concours était admis «sans examen» (akritos) à celui de l'année suivante : d'où l'on doit conclure que, ce seul cas excepté, l'examen était le mode normal de recrutement des protagonistes. On n'a aucun renseignement sur la nature de cette épreuve : il est vraisemblable qu'elle consistait, comme de nos jours, en une récitation de scènes ou de tirades isolées prises dans le répertoire. Selon toute apparence, c'est à un examen du même genre que fait allusion un passage malheureusement très obscur du Pseudo-Plutarque. Au témoignage de cet auteur, un décret de l'orateur athénien Lycurgue, rendu vers 330, aurait remis en vigueur un ancien concours de comédiens (kômôdoi), qui s'était tenu antérieurement au théâtre le troisième jour des Anthestéries, et qui était tombé peu à peu en désuétude. En ressuscitant ce concours, Lycurgue y aurait introduit une innovation d'après laquelle le protagoniste proclamé vainqueur devait être inscrit de droit pour les Grandes Dionysies suivantes. Telle est l'interprétation qui nous paraît la plus probable ; mais il faut bien avouer qu'elle est loin d'être sûre, presque tous les mots de ce texte offrant matière à discussion ; le terme kômôdoi, entre autres, que nous avons traduit par «comédiens» peut signifier aussi bien «poètes comiques».
Une fois les protagonistes désignés par l'Etat, il restait à les répartir entre les poètes concurrents. Pour cette opération deux systèmes ont été en usage tour à tour :
1° Dans le plus ancien on choisissait un total égal de protagonistes et de poètes, et c'était le sort qui à chaque poète attribuait son protagoniste. Voici, d'abord, comment les choses se passaient dans les concours comiques. Tant que ces concours admirent trois poètes (ce qui fut la règle pendant tout le Ve siècle, aussi bien aux Grandes Dionysies qu'aux Lénéennes), l'archonte eut également à désigner trois protagonistes. Mais à partir du commencement du IVe siècle il dut en désigner cinq, parce qu'on avait porté à cinq le chiffre des poètes. Cette procédure persista sans changement jusqu'aux derniers temps dans la comédie. Nous la trouvons aussi en vigueur, mais seulement au Ve siècle, dans les concours tragiques. A cette époque les trois rivaux tragiques des Grandes Dionysies recevaient chacun un protagoniste distinct, qui jouait l'oeuvre entière (en règle générale, une tétralogie) présentée par le poète, auquel le sort l'avait associé. Aux Lénéennes, si du moins l'on en juge par les procès-verbaux didascaliques des années 419 et 418 av. J.-C., le nombre des protagonistes, comme celui des poètes, n'était que de deux, et chaque protagoniste jouait la trilogie de l'un des deux poètes.
2° Mais les procès-verbaux relatifs aux concours tragiques des années 341 et 340 nous révèlent un système tout nouveau. Nous y voyons qu'à cette date le chiffre des protagonistes ne dépend plus de celui des poètes, mais du nombre de drames que chacun d'eux apporte au concours, et que tout protagoniste, au lieu d'être, comme par le passé, assigné en propre à l'un des poètes, doit paraître tour à tour dans une tragédie de chaque concurrent. L'analyse du procès-verbal de 310 fera mieux saisir ce système. Cette année-là, le poète Astydamas remporta le prix de tragédie avec deux pièces intitulées Parthénopaeos et Lycaon ; le second rang fut donné à un autre poète, dont le nom s'est perdu, auteur d'un Phryxos et d'un Oedipe ; Evarétos fut classé dernier avec un Alcméon et une autre tragédie inconnue. Trois poètes, comme on voit, avaient pris part à ce concours : mais comme chacun ne présentait que deux tragédies, on n'avait eu besoin que de deux protagonistes : l'un, Thettalos, joua successivement le Parthénopaeos, le Phryxos et l'Alcméon, c'est-à-dire la première tragédie de chaque concurrent ; la seconde fut interprétée par l'autre acteur, Néoptolémos. L'année précédente, chaque poète ayant apporté au concours trois tragédies, il avait fallu trois protagonistes. On voit immédiatement les avantages de ce nouveau système. D'abord il eut pour effet d'alléger, en la divisant, la lourde tâche des tragédiens. Nous avons dit qu'au Ve siècle les poètes présentaient, chacun, aux Grandes Dionysies une tétralogie, c'est-à-dire trois tragédies suivies d'un drame satyrique : dans ces conditions, chaque protagoniste avait à jouer quatre drames de suite dans la même journée. C'était une besogne écrasante, et qui ne fit que s'aggraver encore, à mesure que le dialogue s'étendit au détriment des chants choraux : une tétralogie de Sophocle ou d'Euripide exigeait du protagoniste huit à dix heures de présence en scène et d'activité presque continues. La distribution inaugurée au IVe siècle remédia à cet état de choses : grâce à elle, la tâche totale de chaque tragédien se trouva désormais répartie sur autant de journées qu'il avait de drames à jouer, en d'autres termes il ne joua plus qu'un drame par jour. Un second avantage de ce système, c'est qu'il mit les poètes sur un pied de rigoureuse égalité, au point de vue de l'interprétation. Or on sait quelle était au IVe siècle l'importance de celle-ci : «De nos jours, dit Aristote, l'acteur fait plus que l'auteur pour le succès d'un drame». Tandis que la procédure précédente, fondée sur le hasard, attribuait forcément aux divers concurrents des acteurs de valeur inégale, la nouvelle au contraire faisait des talents et des défauts de tous les interprètes comme un total, qu'elle répartissait ensuite à dose égale entre les poètes. A l'arbitraire du sort elle substituait ainsi l'absolue équité.
Nous avons vu qu'à côté du prix de poésie, l'Etat institua dès le Ve siècle dans les concours dramatiques un prix d'interprétation pour le plus habile acteur. Jusque-là les honneurs et les récompenses décernés dans ces concours étaient restés le privilège exclusif du poète et du chorège : l'acteur n'y avait point part. Ce fait tient sans doute à ce que, au moment où le drame avait été reconnu comme spectacle officiel, il n'y avait pas encore d'acteurs proprement dits, l'auteur étant lui-même l'interprète de ses oeuvres. Mais cette situation subalterne de l'acteur ne pouvait durer. Dès qu'il y eut séparation complète entre l'auteur et l'interprète, il apparut que celui-ci avait une grande part, parfois même une part prépondérante, dans le succès des drames. C'est pourquoi un concours spécial fut créé pour les protagonistes tragiques et comiques. Le peu que nous savons de ce concours nous a été révélé par les inscriptions agonistiques, récemment découvertes. On remarquera d'abord que le protagoniste y figure seul, à l'exclusion du deutéragoniste et du tritagoniste : ce qui veut dire évidemment qu'il triomphait comme directeur, au nom de sa troupe. Un autre point à noter, c'est que de tout temps, et quel que fût le mode de distribution des acteurs, ce concours demeura indépendant de celui des poètes. Dans la tragédie, par exemple, le poète Callistratos et l'acteur Callipidès, en l'an 418 av. J.-C., se trouvaient associés ; l'acteur remporta le prix, tandis que le poète n'eut que le second rang. Et de même dans la comédie : nous voyons vers 180 le poète Paramonos classé second, et son protagoniste Onésimos proclamé vainqueur. Sur la nature du prix décerné dans ce concours nous n'avons aucun renseignement : il est à présumer toutefois qu'il consistait, pour l'acteur comme pour le poète, en une couronne de lierre, reçue solennellement des mains de l'archonte en plein théâtre. Avec le prix, privilège du vainqueur, il ne faut pas confondre les honoraires : ceux-ci étaient touchés par tous les protagonistes ayant pris part au concours, et paraissent avoir été proportionnels au rang obtenu.
Les noms techniques par lesquels on désignait les trois acteurs dont se composait le personnel de chaque troupe, prôtagônistês, deuteragônistês, tritagônistês, expriment leur hiérarchie professionnelle. Le protagoniste, c'est l'acteur auquel reviennent les premiers emplois, c'est-à-dire les plus pathétiques, et par cela même, en général, les plus étendus et les plus difficiles.
Comme premier rôles, les anciens citent ceux d'Oedipe dans Oedipe-Roi et dans Oedipe à Colone, d'Antigone et d'Electre dans les pièces de Sophocle qui portent les noms de ces personnages, d'Oreste et d'Hécube dans l'Oreste et les Troyennes d'Euripide. En général, est protagoniste le personnage qui donne son nom à la pièce ; mais il n'y a pas là une règle absolue. Il semble bien, par exemple, que le protagoniste dans l'Agamemnon d'Eschyle soit Clytemnestre, dans Iphigénie à Aulis Agamemnon, dans Héraclès furieux Amphitryon, dans le Cyclope Ulysse. Aux deutéragonistes appartiennent les rôles de valeur intermédiaire. Ou bien ils servent à éclairer par contraste les premiers rôles ; exemple : Jason en opposition avec Médée, Phèdre en regard d'Hippolyte chez Euripide. Ou bien au contraire ils nous en offrent une image un peu affaiblie et incomplète, et par là ils aident à mieux mesurer l'intensité d'héroïsme ou de passion de leurs modèles. On trouve déjà une figure de ce genre chez Eschyle : c'est celle d'Electre, à côté d'Oreste, dans les Choéphores. Et tel est le caractère commun des deutéragonistes chez Sophocle. Il est à remarquer, du reste, que presque tous sont des personnages féminins : Tecmesse dans Ajax, Ismène dans Antigone, Oreste dans Electre, Jocaste dans Oedipe-Roi, Antigone dans Oedipe à Colone. Les allusions malignes de Démosthène nous font connaître, en partie, la liste des emplois tenus par Eschine dans sa carrière de troisième acteur. Ce sont d'abord des rôles de tyran (Créon dans l'Antigone de Sophocle, Thyeste dans les Crétoises d'Euripide, Cresphonte et Oenomaos dans les tragédies de ce nom), un rôle de héraut (Thaltybios dans les Troyennes), enfin un rôle de spectre (l'Ombre de Polydore dans Hécube). Cette liste confirme le mot ironique de Démosthène, que «c'est dans toutes les tragédies le privilège éminent du troisième acteur de représenter les tyrans et les personnages qui portent sceptre». Juba de Mauritanie, auteur d'une histoire du théâtre (Theatrikê istoria), donnait ainsi la raison de ce fait : «Ces rôles comportent peu de pathétique et beaucoup de pompe (êtton esti pathêtika kai uperogka)». Et c'est là un criterium qui nous permet d'attribuer d'une manière à peu près sûre au tritagoniste, outre les emplois déjà nommés, tous ceux qui répondent à cette caractéristique : divinités qui descendent tout exprès du ciel pour expliquer d'avance l'intrigue ou pour la dénouer, devins solennels, pédagogues sentencieux, nourrices, hérauts, messagers, etc.
Le nombre des rôles dans une pièce grecque dépassait toujours celui des interprètes. Dans les quatre premières pièces d'Eschyle, jouées par deux acteurs, ce nombre est respectivement de trois (Suppliantes), de quatre (Perses, Sept contre Thèbes), et de six(Prométhée). Dans toutes les autres tragédies conservées les trois acteurs ont à se partager au minimum cinq rôles (Euménides, Philoctète), au maximum onze (Phéniciennes, Rhésos). Dans la comédie la disproportion est plus considérable encore : les Acharniens d'Aristophane, par exemple, comptent jusqu'à vingt et un personnages. C'était un des principaux avantages du masque que de permettre à chaque acteur de remplir plusieurs rôles : en changeant de visage, il devenait du même coup un personnage nouveau. Une modification du costume devait être rarement nécessaire, l'équipement scénique étant, comme on le verra plus bas, en grande partie impersonnel. Tout au plus l'acteur jetait-il sur ses épaules un autre épibléma : c'était l'affaire d'un instant. L'occasion la plus favorable pour ces transformations, c'étaient naturellement les intervalles laissés dans l'action par les chants du choeur. Mais il suffisait au besoin d'un temps plus court. Ainsi nous voyons dans les Choéphores un serviteur s'élancer du palais, criant l'assassinat d'Egisthe ; à ses cris Clytemnestre sort à son tour, bientôt suivie d'Oreste ; l'épée levée, celui-ci saisit sa mère, qui se débat en vain et supplie ; sur ces entrefaites paraît Pylade, et Oreste hésitant lui demande conseil. Entre les derniers mots du serviteur et les premiers de Pylade il y a en tout treize vers (v. 887-599). Or le scoliaste nous apprend que c'était le même acteur qui jouait ces deux rôles. De même, au début des Phéniciennes d'Euripide : après un monologue de Jocaste, vient une scène où Antigone et son pédagogue montent sur la terrasse du palais pour contempler l'armée ennemie campée dans la plaine. Mais les deux personnages n'apparaissent pas à la fois : le pédagogue sort d'abord seul, et inspecte les alentours, afin de s'assurer, dit-il, qu'aucun oeil indiscret ne les observe. D'après le scoliaste, ces apprêts ne seraient qu'un artifice du poète pour ménager au protagoniste, qu'on vient de voir dans le rôle de Jocaste, le temps de changer de masque et de reparaître sous les traits d'Antigone. Nécessairement les divers rôles joués par un même acteur s'enchevêtraient les uns dans les autres, les moins importants, qui souvent n'ont qu'une scène, occupant les pauses du rôle principal. Dans ces conditions, c'était un art délicat et compliqué que la construction d'une pièce grecque : car le poète devait toujours avoir présentes à l'esprit les nécessités matérielles de la représentation, il lui fallait régler d'avance avec la plus minutieuse précision les entrées et les sorties de ses personnages et le tour de parole de chacun. Tous les poètes n'y réussissaient pas également. C'est avec une adresse et uue aisance incomparables que le souple génie de Sophocle se joue de ces difficultés. Eschyle et Euripide se montrent moins habiles : chez le premier, c'est gaucherie de primitif ; chez le second, c'est souvent désinvolture et dédain du métier. On peut voir dans les Suppliantes, par exemple, à quel point Eschyle a été gêné par l'obligation de confier à un même acteur les emplois de Danaos et du héraut égyptien : ces deux personnages étant condamnés à ne jamais se rencontrer, on les voit fuir l'un devant l'autre, alors même qu'ils ont les meilleures raisons de s'attendre. C'est ainsi qu'à l'approche des vaisseaux égyptiens Danaos abandonne ses filles en plein danger, alléguant la nécessité d'aller chercher du secours à la ville. Or ce motif est d'autant moins acceptable que le secours en question arrive de lui-même en son absence. En réalité le départ des Danaos n'a qu'un but, c'est de permettre au protagoniste de jouer pendant ce temps le rôle du héraut. Dans les Perses l'éloignement d'Atossa, au moment du retour de Xerxès, n'est pas mieux justifié. Le spectre de Darios ayant annoncé que Xerxès va revenir couvert de haillons, la reine rentre dans le palais, afin, dit-elle, d'y aller chercher pour son fils des vêtements plus convenables. Prétexte bien peu adroit : car pourquoi ne pas confier ce soin à un serviteur ? La vérité, c'est que, les rôles d'Atossa et de Xerxès appartenant tous les deux au protagoniste, force était au poète d'écarter la mère dès que paraît le fils. La loi des trois acteurs a mis aussi plus d'une fois Euripide dans l'embarras. La scène finale de son Electre en est un exemple frappant. Exilé d'Argos par l'ordre des dieux, Oreste, avant de s'éloigner, engage son ami Pylade à devenir l'époux de sa soeur Electre. Or, à cette offre Pylade ne répond rien : ce sont les Dioscures qui l'acceptent en son nom (v. 1312). Pour comprendre une si étrange attitude, il faut se souvenir qu'il y a déjà en scène trois personnages parlants : Electre, Oreste, et l'un des Dioscures, et que dès lors Pylade, et tous les autres personnages de cette scène, sont condamnés au silence. Ailleurs, pour mettre en présence deux personnages joués par le même acteur, Euripide a recours à un expédient bizarre : il fait suppléer momentanément cet acteur, dans l'un des deux rôles, par un figurant ; mais celui-ci est nécessairement muet, et de là d'assez fortes invraisemblances. Tel est le cas dans l'Oreste, où Hélène et Hermione, bien que jouées l'une et l'autre par le tritagoniste, paraissent ensemble sur la scène (v. 110-125) : à sa mère qui lui commande d'aller porter les libations sur le tombeau d'Agamemnon, Hermione obéit sans mot dire. La raison de ce silence, c'est qu'Hermione est ici représentée par un figurant muet, qui porte le masque du rôle. Nous venons d'indiquer quelques-uns des inconvénients de la règle des trois acteurs. Il en est un autre qui, sans doute, choquerait plus vivement encore tout spectateur moderne. Avec si peu de personnages il fallait, naturellement, renoncer aux effets de foule, de mouvement, d'apparent désordre, bref à tout ce qui donne au théâtre l'impression de la réalité. Mais ce défaut, il faut bien le dire, les Grecs le sentaient beaucoup moins que nous. Jamais leur art n'a recherché les effets de ce genre. Qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, ou de mise en scène, partout on observe chez eux le même parti pris : peu de figures, de larges intervalles entre elles, une ordonnance lucide, en un mot une simplification résolue des conditions de la vie. En ce qui concerne le drame, on a la preuve que cette simplication est préméditée : bien loin en effet de tirer tout le parti possible des moyens mis à leur disposition, les dramatiques grecs usent fort peu des scènes à trois interlocuteurs. Celles qu'on serait tenté d'appeler ainsi se décomposent, pour la plupart, en une série de dialogues à deux, où chacun des trois personnages reste muet à tour de rôles. En regard de ces inconvénients, il est juste toutefois de signaler un sérieux avantage. C'est qu'en Grèce tous les emplois, quelle qu'en fût la brièveté ou même l'insignifiance, étaient tenus par des acteurs exercés. Le protagoniste ne rougissait pas de jouer, dans les intervalles de son rôle principal, un rôle de deux vers. Point de doublures, et par suite pas d'emplois sacrifiés, pas de ces défaillances individuelles, qui chez nous déparent presque toujours la représentation la plus soignée.
Jusqu'à ces dernières années on avait cru sans dissidence, sur la foi de Vitruve et de Pollux, que les acteurs grecs jouaient sur le logeion, tandis que le choeur évoluait séparément, au-dessous d'eux, dans l'orchestre. Dans ce logeion, sorte d'estrade fort longue (21 mètres à Athènes, par exemple), large en moyenne de 8 à 10 pieds, et haute de 10 à 12, on s'accordait à reconnaître le développement naturel de la table primitive (eleos), sur laquelle Thespis, au témoignage de Pollux, avait fait monter son acteur unique. Pour les communications entre les acteurs et le choeur, on admettait l'existence d'un escalier en bois reliant la scène à l'orchestre : Pollux et Athénée font, du reste, formellement allusion à un escalier de ce genre. Mais ces idées traditionnelles sont, à l'heure actuelle, très attaquées par tout un groupe d'archéologues, et en particulier par le savant architecte allemand M. Dörpfeld. Se fondant sur les résultats des fouilles qu'il a exécutées à Athènes, à Epidaure et dans plusieurs autres théâtres grecs, il conclut que les acteurs jouaient en réalité dans l'orchestre comme le choeur, par conséquent devant et non pas sur l'estrade. Dans la patrie de l'auteur, cette théorie révolutionnaire a rencontré une adhésion presque générale. Ailleurs, et particulièrement en France, elle a été l'objet de vives protestations. Nous n'avons pas ici à reprendre en détail la théorie de M. Dörpfeld, à exposer les arguments dont il l'appuie et les graves objections qu'elle soulève [Theatrum]. Bornons-nous à en dégager deux points que les récentes controverses nous paraissent avoir mis hors de doute, et qui se rattachent à notre sujet. L'un des arguments les plus forts contre le logeion, c'est son excessive hauteur qui eût rendu les communications avec l'orchestre à peu près impossibles. A l'appui de cet argument, plusieurs savants se sont appliqués successivement à dresser l'inventaire complet des scènes qui, dans les drames conservés, supposent un rapprochement et pour ainsi dire un contact des acteurs et du choeur. Or il ressort de leurs statistiques qu'il n'est presque aucun drame grec où ces rencontres ne se produisent plusieurs fois. Voilà un premier fait intéressant : car on les avait jusqu'alors regardées comme très rares et même exceptionnelles. Et ce premier point posé, un second en découle nécessairement. Sans doute, c'est aller trop vite que de conclure du même coup, comme le font les partisans de M. Dörpfeld, que les acteurs grecs se tenaient dans l'orchestre. Mais, si on leur refuse cette conclusion, force est du moins d'accorder que la scène de l'époque classique a dû être notablement différente de celle que décrit Vitruve et que nous connaissons par les ruines du IIIe siècle av. J.-C., qu'elle était beaucoup plus basse, assez basse en un mot pour permettre des relations aisées et rapides entre les deux groupes.
Chez les Grecs, les entrées et les sorties de l'acteur étaient soumises à des règles fixes et conventionnelles. En ce qui concerne le décor tragique, Vitruve et Pollux nous apprennent que l'arrière-plan représentait généralement un palais avec trois portes, que l'entrée du milieu indiquait la demeure royale (valvae regiae, basileion, celle de droite l'appartement des hôtes (hospitalia, xenôn), celle de gauche l'ergastule, ou lieu de correction des esclaves (eirktê), D'où il suit, comme on voit, que chacune des portes du fond avait sa destination propre, en rapport avec le rang social des personnages. Vitruve et Pollux signalent encore une autre convention, relative aux couloirs latéraux (parodoi) de la scène et de l'orchestre. Par la droite entrent et sortent toutes les personnes arrivant du dehors (exô poleôs, a peregre), par la gauche celles qui viennent de quelque quartier de la ville (ek poleôs, a foro), et en particulier du port (ek limenos). Sur l'origine de cette signification locale, il n'y a pas de doute. Evidemment elle dérive de l'orientation particulière du théâtre de Dionysos à Athènes. Lorsqu'il faisait face au public, l'acteur athénien avait à sa gauche la majeure partie de la ville ainsi que le port du Pirée, à sa droite les faubourgs et la campagne. Par une conséquence toute naturelle de ce fait, il fut convenu, à Athènes d'abord, mais ensuite dans tous les théâtres grecs et romains, que le côté gauche (par rapport aux acteurs) serait affecté exclusivement aux citoyens de la ville où se passait l'action et aux étrangers venus par mer, tandis que le côté opposé appartiendrait aux habitants de la campagne et aux étrangers venus par la voie de terre. Les peintures de chaque périacte [Periactos] rendaient, du reste, sensible aux yeux cette convention. Mais à quelle époque avait-elle pris naissance ? C'est ce qu'il est impossible de dire. Comme elle s'accorde avec l'orientation du plus ancien théâtre d'Athènes, dont M. Dörpfeld a rendu au jour quelques ruines en 1886, rien au premier abord n'empêcherait de croire qu'elle ait été en vigueur dès les premiers temps. Toutefois des recherches récentes ont établi qu'elle s'applique mal à la plupart des tragédies grecques, tandis que les comédies de Plaute et Térence, imitées ou traduites du grec, s'y conforment à peu près rigoureusement. Et de là on a conclu avec assez de vraisemblance que ce symbolisme ne s'était introduit au théâtre qu'au temps de la comédie nouvelle.
Les sources pour l'étude du costume scénique sont : 1° les textes ; 2° les monuments figurés. Parmi les textes il faut citer surtout : quatre chapitres de l'Onomasticon de Pollux, Sur l'habillement des acteurs, Sur les masques tragiques, satyriques, comiques ; les indications matérielles éparses dans les drames conservés ; les allusions qu'on peut recueillir dans les écrivains anciens, en particulier chez Aristote, Plutarque, Lucien. Quant aux monuments, les principaux sont : pour la tragédie, la mosaïque du Vatican qui représente une série de personnages groupés par couples ; une fresque de la nécropole de Cyrène, où l'on voit des jeux donnés en l'honneur d'un mort ; une élégante statuette en ivoire, découverte il y a une vingtaine d'années à Rieti ; plusieurs peintures murales de Pompéi, rendues à la lumière depuis 1879 ; pour le drame satyrique, une dizaine de vases peints dont le plus important, trouvé autrefois à Ruvo, représente la répétition générale d'un drame satyrique ; pour la comédie ancienne et moyenne, une série de figurines en terre cuite, la plupart du IVe siècle, qui représentent des acteurs, et un vase peint attique du même temps, trouvé en Crimée, qui figure les apprêts d'un spectacle comique ; enfin, pour la comédie nouvelle, ainsi que pour son héritière la comoedia palliata des Romains, plusieurs fresques de Pompéi, les miniatures des manuscrits de Térence, et nombre de statuettes.
Le costume tragique se composait des parties suivantes :
1° Le masque (prosôpon) : ce n'est pas ici le lieu de décrire cet accessoire, qui vu son importance sera l'objet d'un article spécial [Persona]. Rappelons seulement que dans la tragédie le masque était pourvu à son sommet d'un appendice (ogkos), destiné à augmenter la hauteur du front, et qui grandissait d'autant la taille des personnages.
2° La haute chaussure, appelée par les Latins cothurnus, par les Grecs embatês ; elle a été étudiée en détail à l'article Cothurnus.
3° Divers accessoires servant à rembourrer la personne de l'acteur. Comme le cothurne et l'oncos allongeaient celui-ci par les deux bouts, il fallait bien, pour rétablir les proportions normales du corps, lui donner artificiellement plus d'ampleur. C'est à quoi servaient les faux-ventres (progastridion) et les fausses-poitrines (prosternidion), dont se moque Lucien. Pour assujettir ces coussins les tragédiens portaient, en dessus, un maillot collant, qui se nommait peut-être sômation.
4° Enfin le costume proprement dit. Il se composait comme dans la vie réelle de deux pièces : un vêtement de dessous (chitôn) et un manteau (epiblêma). Par sa forme le chiton tragique ou poikilon n'est autre que celui que portaient encore au temps d'Eschyle les Athéniens des deux sexes : c'est la longue robe ionienne tombant jusqu'aux talons. Mais peu de temps après les guerres Médiques, les hommes avaient adopté le type dorien, qui ne dépassait point le genou : par l'effet de cette révolution de la mode, le poikilon devint de bonne heure archaïque. Et comme, d'autre part, les Athéniennes, pour des raisons de décence, avaient continué à porter la robe talaire, il prit cet aspect féminin qui nous frappe sur les monuments. La longueur du chiton avait, du reste, l'avantage de faire paraître plus grands les personnages : illusion à laquelle les tragédiens aidaient encore en remontant leur ceinture (maschalistêr) jusqu'à la hauteur des seins, au lieu de la serrer autour des hanches, comme cela se faisait dans la vie ordinaire.

Toutefois le chiton n'avait pas une longueur uniforme chez tous les personnages : c'est ce qu'on voit notamment sur le fragment de la mosaïque du Vatican que reproduit la figure ci-dessus, et mieux encore sur une peinture campanienne qui représente un maître accompagné de son serviteur (ci-dessous).
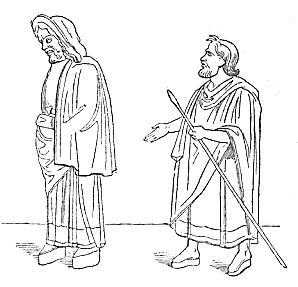
La robe de celui-ci tombe sensiblement moins bas que celle du maître ; et il n'est pas impossible que ce soit là un détail intentionnel, destiné à signaler dès son entrée en scène l'infériorité sociale du personnage. Une autre particularité du chiton tragique, c'étaient les longues manches couvrant tout le bras (cheirides) mode orientale et non grecque, car le chiton usuel des Grecs n'avait que de simples ouvertures pour le passage des bras. Mais ce qui faisait avant tout l'originalité du poikilon, c'était l'éclat de son ornementation. Son nom même indique une étoffe bariolée. La mosaïque du Vaticane nous le montre rayé de bandes horizontales et verticales, ordinairement d'une même couleur, parfois multicolores.

Sur le vase de Ruvo (ci-dessus) et sur la fresque de Cyrène (ci-dessous) les personnages portent des robes plus riches encore, ornées d'un semis de broderies très diverses, fleurs, palmes, étoiles, figures animales ou humaines, arabesques de tout genre.

Passons maintenant à la seconde pièce du costume tragique, au manteau. Pollux en énumère un assez grand nombre de variétés : la xustis, batrachis, chlanis, chlamus diachrusos, chlamus chrusopastos, phoinikis. Toutes peuvent se ranger en deux classes : ce sont ou des manteaux amples que l'on drape autour du corps (imatia), ou des manteaux courts qui s'attachent sur l'épaule au moyen d'une agrafe (chlamudes). Il n'est pas possible de donner une description précise de chacun d'eux ; mais leurs noms témoignent du moins de leur richesse et de leur éclat. La batrachis, par exemple, était un manteau vert-grenouille, couleur qui, à en juger par un passage d'Aristophane, ne se portait pas en dehors du théâtre. La phoenikis était de couleur pourpre. Les manteaux auxquels Pollux donne les épithèthes de diachrusos et de chrusopastos étaient rehaussés de broderies et de brocarts d'or.

Une fresque, découverte en 1879 à Pompéi, nous met sous les yeux la scène d'Euripide (Médée, 1002) où Médée se dispose à tuer ses enfants que lui amène le pédagogue. Sur cette peinture, Médée est vêtue d'un chiton vert clair (toute trace de manteau a disparu) ; le pédagogue porte un manteau jaune sur un chiton violet ; les deux enfants ont un chiton et un manteau jaunes.
D'autres formes de vêtements appartenaient en propre à certains personnages. Dionysos portait, comme les jeunes femmes d'Athènes, une longue robe jaune safran (krokôtos). Pollux attribue aux Atrée et aux Agamemnon (kai osoi toioutoi) un vêtement nominé kolpôma, qu'il néglige de décrire. L'insigne ordinaire des rois était la xustis, himation de couleur pourpre. Quant aux reines, elles portaient un chiton traînant (surtos ou surma) de couleur pourpre, et en dessus un himation blanc bordé de pourpre (paraêchu). Le costume des devins était l'Agrenon, tricot de laine enveloppant tout le corps. Ce tricot semble avoir été le symbole du don prophétique ; car plusieurs monuments nous montrent l'omphalos de Delphes, ainsi enveloppé d'un tissu à mailles. Pollux l'attribue en particulier à Tirésias, et c'est aussi sans doute le «vêtement prophétique» de Cassandre (mantikê esthês), dont il est question dans l'Agamemnon d'Eschyle. Les guerriers et les chasseurs portaient une chlamyde pourpre (Ephaptis), roulée autour de leur bras gauche pour se défendre.
Certaines nuances convenaient à des situations particulières : exil, deuil, malheur. Les bannis avaient des vêtements de couleur blanche, mais salis et souillés par la poussière et les intempéries. C'est dans cet état lamentable que paraissait, chez Sophocle, Oedipe fugitif. Le noir exprimait surtout le deuil : dans Eschyle, Electre et ses compagnes, lorsqu'elles vont porter des libations sur le tombeau d'Agamemnon, sont vêtues de noir. De même, dans Euripide, Hélène, voulant accréditer la fausse nouvelle de la mort de Ménélas, change ses vêtements blancs pour des vêtements noirs. Mais le noir symbolisait encore d'une manière plus générale l'infortune. Et Pollux attribue la même signification aux nuances foncées, gris (phaios), vert (mêlinos), bleu (gaukinos). Enfin les haillons étaient, comme de juste, une manifestation de la pauvreté et de la misère.
Les personnages qui figurent dans le drame satyrique se rangent en deux classes bien distinctes : d'abord les héros, tels qu'Héraclès et Ulysse, puis les compagnons de Dionysos, Silène et les Satyres. Du costume des premiers, Pollux ne dit mot. Mais nous voyons sur le vase de Ruvo Héraclès et un roi : en somme, ces deux personnages y portent le costume qu'ils auraient dans la tragédie ; on doit remarquer seulement que leur chiton est plus court, ainsi qu'il convenait dans un genre où les acteurs devaient se livrer à une action très vive, parfois même à des sauts et à des gambades. Quant aux compagnons de Dionysos, leur mise est toute autre. Rien de plus sommaire que celle des Satyres : un caleçon de fourrure, ceignant les reins, en fait tous les frais. Par derrière ce caleçon est pourvu d'une queue de cheval, et par devant d'un phallos relevé, attributs ordinaires des Satyres dans l'art grec. Tout le reste du corps paraît nu , mais la nudité était probablement simulée au moyen d'un maillot couleur chair. Sur le vase de Ruvo, le Père Silène (Papposeilênos) apparaît enveloppé des pieds jusqu'au cou d'un maillot collant à longs poils.
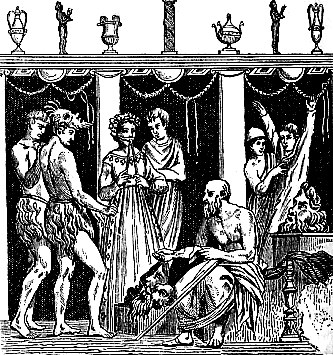

Mais sur d'autres monuments son accoutrement, en la même étoffe pelucheuse, est un peu différent : il est fait de deux pièces, d'un chiton court semblable à une blouse et descendant à peine au genou (chortaios), et d'une sorte de pantalon qui ne laisse à nu que les pieds. En dessus de cet accoutrement, qui vise à rendre l'aspect velu d'un animal, Silène porte souvent un manteau. Sa garde-robe se compose, d'après Pollux, d'un himation rouge (phoinikoun imation), d'un manteau brodé (thêraion) et d'une chlanis bariolée (chlanis anthikê). Nommons encore les peaux de faon, de chèvre, de boue, de panthère (nebris, aigê, tragê, pardalê), que Silène et ses fils portaient généralement sur l'épaule.
Sur la chaussure des acteurs satyriques, nous ne savons rien de certain. Les deux personnages héroïques portent, sur le vase de Ruvo, des chaussures à semelles très basses. Silène et les Satyres, au contraire, y sont figurés pieds-nus ; comme il en est de même sur les autres monuments, il est difficile d'admettre partout une négligence de l'artiste : nous croyons donc que c'est là un détail réel. Pour les masques satyriques nous renvoyons de nouveau à l'article Persona.
Pollux, à qui nous devons quelques renseignements sur les masques des acteurs de la comédie ancienne, ne dit rien de leur costume. Pour trouver quelques indications sur ce sujet, c'est aux drames mêmes d'Aristophane qu'il nous faut recourir. Nous y voyons mentionnés, comme chitons à l'usage des hommes amphimaschalos et l'exômis, comme manteaux l'imation, la chlamus et le tribônion ou tribôn. Quant à l'habillement féminin, les différentes pièces en sont détaillées très exactement dans la scène des Thesmophoriazuses, où Mnésiloque se travestit en femme. Il passe d'abord un krokôtos, c'est-à-dire un chiton jaune safran, puis serre son chiton au moyen d'une ceinture (strophion), et drape en dessus un himation bordé de pourpre (egkuklon). Le strophion et l'enkyclon font partie également de la toilette de Myrrhine dans Lysistrata. Quant au chiton jaune, il est cité en nombre d'endroits comme le vêtement ordinaire des femmes. Tous ces noms sont ceux de vêtements usuels ; on pourrait donc croire au premier abord que le costume de la comédie ancienne ne se distinguait en rien de celui de la vie quotidienne. Mais d'autres passages d'Aristophane font allusion à certains enlaidissements bouffons, propres à la comédie : 1° Dans une scène des Grenouilles, le nocher des enfers Charon traite Dionysos de «gros ventru» (gastrôn). Et le scoliaste explique cette épithète irrespectueuse par le ventre énorme et grotesque dont on affublait ce dieu au théâtre. Nombre d'allusions obscènes prouvent que le phallos «en cuir, pendant, rouge par le bout, énorme», faisait partie intégrante de l'accoutrement du sexe masculin. Les détails que nous venons de recueillir chez Aristophane sont autant de points de repère, grâce auxquels il devient facile de reconnaître l'accoutrement comique sur les monuments figurés. Ceux-ci ont été rassemblés tout récemment par M. Körte.


Ce qui frappe d'abord dans ces représentations, c'est l'aspect grotesque des personnages : tous sont de vrais magots. Les deux sexes exhibent à l'envi des bedaines et des croupes extravagantes, façonnées à grand renfort de coussins (progastridia et prosternidia), en dessus desquels est passé un maillot couleur chair. Ce maillot colle étroitement, sans faire de plis, en sorte que sa présence ne se révèle que par un simple trait aux extrémités, c'est-à-dire à l'encolure, aux poignets et aux chevilles. Les hommes portent, presque sans exception, le phallos postiche, énorme et pendant (katheimenos). Quant aux chitons et aux manteaux, ce sont exactement ceux dont nous avons trouvé les noms dans Aristophane. Mais, là même, l'intention bouffonne est visible : c'est elle en particulier qui explique la rigidité de l'étoffe (on a supposé que ces vêtements étaient en cuir) et l'indécente brièveté du chiton au-dessous duquel apparait le phallos.
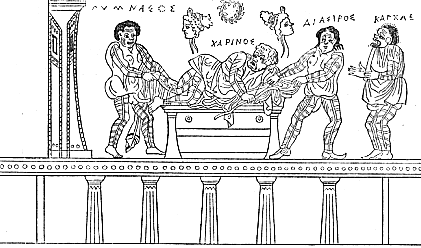
L'origine de cet accoutrement, c'est encore aux monuments figurés qu'il faut la demander. Il est remarquable en effet que les mêmes enlaidissements caractéristiques, à savoir le phallos monstrueux et la matelassure grotesque du ventre et des fesses, se retrouvent non seulement sur des vases peints du III siècle av. J.-C., découverts depuis de longues années déjà en Grande Grèce, qui représentent des phlyakes (ci-dessus), mais aussi, comme l'ont fait tout récemment remarquer MM. Körte et Löschcke, sur des vases corinthiens du VIe siècle (ci-contre) et béotiens du IVe siècle (ci-dessous).
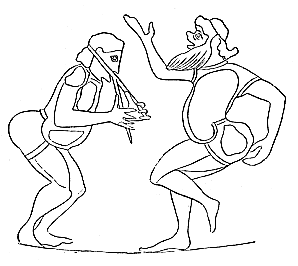
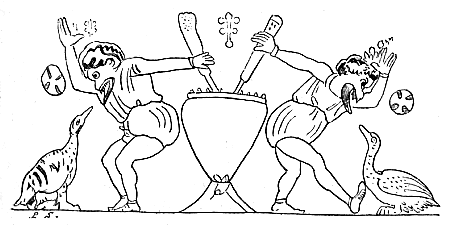
Or, sur les plus anciennes de ces peintures, il n'est pas douteux que les personnages ainsi accoutrés soient de nature divine : ce sont les suivants de Dionysos, tels non seulement qu'on se les imaginait, mais tels aussi qu'on les figurait en chair et en os dans les fêtes du dieu. Mais il n'en est plus de même sur les représentations plus récentes : là ces personnages ont dépouillé leur nature divine, et nous avons affaire à des êtres humains, à des bouffons ou même à de véritables acteurs. Les phases intermédiaires de cette évolution nous échappent ; les vases peints ne nous en font connaître que les deux termes extrêmes. Quoi qu'il en soit, nous saisissons là directement la filiation authentique des comédiens de Cratinos, d'Aristophane et de Platon ; les compagnons divins de Dionysos qu'on voit sur les vases de Corinthe sont leurs lointains ancêtres ; les bouffons que nous montrent les vases de la Grande Grèce et de Béotie sont leurs frères. C'est probablement dans le Péloponnèse, patrie des dikélistai, des phallophoroi, des autokabdaloi, que s'est accomplie l'évolution d'où est sorti l'acteur comique. C'est de là qu'il s'est introduit à Athènes, peut-être par l'intermédiaire de la comédie mégarienne.
Il sera parlé à l'article Mimus des phlyakes, dikélistai et autres bouffons de l'Italie méridionale et du Péloponnèse.

Il y a peu de choses à dire sur le costume de la comédie nouvelle. Du témoignage des monuments aussi bien que de la nomenclature de chitons et de manteaux donnée par Pollux, il ressort qu'il ne différait point par sa forme de celui que portaient les contemporains de Philémon et de Ménandre On peut affirmer d'autre part que les accessoires indécents ou burlesques, que nous avons signalés chez les acteurs d'Aristophane, n'y étaient plus en usage. En somme, ce qui faisait l'originalité de ce costume, c'était presque uniquement l'emploi conventionnel des couleurs. Chaque nuance avait sa signification propre, en accord avec celle du masque [Persona]. Par elle le public était immédiatement instruit de l'âge, de la condition sociale et jusqu'à un certain point de l'état d'âme des personnages. Pollux explique avec quelque détail cette symbolique. Les jeunes hommes, dit-il, étaient vêtus de pourpre, les esclaves de blanc, les parasites de noir et de gris. Les vieilles se paraient de vert et de bleu, les prêtresses de blanc, les jeunes femmes de blanc ou de jaune. Les filles à héritage (epiklêroi) portaient comme signe distinctif un vêtement blanc bordé de franges. Le prostitueur (pornoboskos) était affublé d'un chiton et d'un manteau bigarrés.
Au costume il convient de rattacher la coiffure et les attributs. Chez les anciens l'usage du chapeau étant fort rare dans la vie réelle, il en était de même au théâtre. Dans Oedipe à Colone cependant, Ismène qui arrive de Corinthe à cheval abrite sa tête d'une kunê. Cette coiffure est également portée par Strepsiade dans les Nuées et par les vieux esclaves dans les Guêpes. D'une façon générale on peut donc dire que portaient un couvre-chef les voyageurs et les vieillards. Pour sortir, les femmes s'enveloppaient généralement la tête dans un pan de leur himation, ramené en avant (krêdemnon) : ainsi fait Antigone dans les Phéniciennes d'Euripide. Mentionnons encore comme ornements de tête, à l'usage du sexe féminin, le kekruphalos, sorte de résille ou de foulard enveloppant le chignon, la mitra, qui était un large bandeau frontal (dans les Fêtes de Déméter Mnésilochos, pour se déguiser en femme, demande ces deux accessoires, la kaluptra, sorte de voile couvrant le visage jusqu'aux yeux et retombant en arrière. Les courtisanes chargeaient d'or et de bijoux leur chevelure. Les entremetteuses portaient un bandeau de pourpre, comme insigne de leur métier.
Naturellement dieux et héros conservaient sur la scène les attributs propres qu'ils ont dans l'art grec. Tels sont l'arc et le carquois d'Apollon, l'égide d'Athéna, le pétase et le caducée d'Hermès, la peau de lion et la massue d'Héraclès, le thyrse, la nébride et le tambourin de Dionysos et de ses suivants, les torches des Erinnyes, le bonnet de feutre (pileus) d'Ulysse. Les guerriers portaient une armure complète (panteuchia), ou du moins une épée, ou un arc. Le sceptre était à la fois l'insigne des rois et des devins. Les rois de Perse portaient, en outre, la tiare. Les vieillards s'appuyaient sur des bâtons ordinairement droits dans la tragédie, recourbés en forme de crosse dans la comédie. Les suppliants élevaient dans leurs mains des rameaux, chargés de bandelettes de laine blanche. Les couronnes étaient un signe de joie : elles signalaient en particulier les messagers, porteurs d'une bonne nouvelle ou d'un oracle heureux, les convives allant au festin ou rentrant chez eux. Le paysan avait comme attributs dans la comédie nouvelle un gourdin (baktêria), une blouse de cuir (diphthera), et un sac (pêra). Le parasite portait les instruments de son métier, la fiole d'huile (lêkuthos) et l'étrille (stleggis), pour frotter le patron au sortir du bain.
Ce serait ici le lieu de parler des aptitudes exigées de l'acteur ; mais, comme elles étaient à peu près les mêmes à Rome qu'en Grèce, nous traiterons de ce sujet dans la seconde partie de cet article.
L'extrême réserve que la morale hellénique imposait au sexe féminin lui interdisait de paraître sur la scène : il n'y a jamais eu d'actrices en Grèce. Quant aux hommes, le métier d'acteur n'emportait pour eux aucune mésestime. Cela tient surtout à ce que les spectacles dramatiques étaient considérés comme des actes du culte public. Toute personne qui y contribuait, poètes, chorèges, choreutes, acteurs, participait au caractère sacré de la cérémonie. A titre de ministres de Dionysos, les acteurs athéniens jouissaient du double privilège de l'inviolabilité et de l'exemption du service militaire. Non seulement ils étaient de naissance libre et en général citoyens, mais quelques-uns même ont été des personnages considérables, des orateurs politiques, des ambassadeurs. Les tragédiens Aristodémos et Néoptolémos, par exemple, négocièrent officiellement de la paix avec Philippe. Leur contemporain Thessalos fut chargé par Alexandre d'une mission politique en Carie. L'orateur Eschine avait été longtemps tritagoniste avant de devenir homme d'Etat. Néanmoins, la réputation des acteurs était mauvaise et leurs moeurs suspectes. Aristote les représente débauchés et prodigues, passant sans transition de l'opulence à l'extrême misère. Il convient du reste de distinguer deux classes d'acteurs. Les uns, qui paraissaient aux concours de la ville dans les deux grandes fêtes dionysiaques, étaient fort considérés et largement rémunérés. Bien qu'on ne sache pas au juste le montant de la rétribution qu'ils recevaient de l'Etat, il y a lieu de croire qu'elle était considérable. Et pourtant elle ne formait que la moindre partie de leurs revenus. A partir du IVe siècle, nous voyons les dynastes de Thessalie, les rois de Macédoine, tous les princes grecs appeler à leurs cours les acteurs athéniens : Philippe et surtout Alexandre les comblèrent de libéralités. Mais au-dessous de ces importants personnages il y avait les comédiens de province, ceux qui à l'époque des Dionysies champêtres faisaient des tournées dans les dèmes, colportant à travers l'Attique les pièces qui avaient réussi précédemment sur le théâtre de la ville. Ils étaient d'ordinaire organisés en troupe, sous la direction d'un protagoniste faisant fonctions d'impresario : c'est celui-ci qui passait marché avec les magistrats municipaux. Certaines de ces troupes ambulantes jouaient le répertoire tragique, d'autres le comique. Au nombre des premières était la troupe de Simylos et de Socratès, dont Eschine fit partie. L'existence de ces comédiens en voyage était misérable : Démosthène nous les montre «soutenant contre les spectateurs une guerre sauvage recueillant plus de sifflets et de projectiles que d'argent, réduits souvent à vivre de pillage et de maraude dans les champs». Au temps d'Alexandre se formèrent des compagnies réunissant sous le patronage de Dionysos tous les artistes, poètes épiques, dramatiques et lyriques, acteurs, choreutes et musiciens (oi peri ton Dionuson technitai). Pour l'organisation de ces troupes, voy. Dionysiaci artifices.
Sur l'attitude du public grec au théâtre et sur ses manifestations à l'égard des acteurs, voy. Comoedia. Les acteurs athéniens n'échappaient pas plus que ceux de nos jours à la manie d'altérer les textes qu'ils étaient chargés de jouer. C'est surtout dans les reprises, lorsque le poète n'était plus là pour défendre l'intégrité de son oeuvre, qu'ils se permettaient ces libertés. Un bon nombre de variantes et d'interpolations, dues à cette cause, nous sont signalées par les scolies. Dès le IVe siècle on fit une loi pour empêcher ces altérations : un décret de l'orateur Lycurgue, rendu vers 330, portait qu'une copie officielle des oeuvres d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, serait faite aux frais de l'Etat et déposée aux archives, et que désormais les acteurs seraient tenus dans les représentations de s'y conformer. Cet exemplaire officiel fut en effet exécuté ; et on le conservait encore précieusement un siècle plus tard.
Les noms des acteurs qui avaient pris part aux concours étaient conservés dans les procès-verbaux officiels. Il nous est parvenu quelques débris de ces documents. Ils peuvent se ranger en trois classes.
1° Chaque année, à la suite des Grandes Dionysies, on rédigeait la liste générale des poètes, des chorèges et (à partir d'une certaine date) des acteurs, couronnés dans les quatre concours dithyrambiques et dramatiques (choeurs d'enfants, choeurs d'hommes, comédies, tragédies) qui composaient le programme de cette fête. Nul doute que pour les Lénéennes le même usage n'existât : on sait en effet qu'Aristote avait publié un recueil intitulé Nikai Dionusiakai astikai kai Lênaikai, dont les éléments n'avaient pu être puisés que dans des listes de ce genre.
2° Outre ce procès-verbal d'ensemble, l'Etat faisait dresser pour chaque concours spécial un compte rendu plus circonstancié. Dans ceux de ces comptes rendus qui se rapportent à la tragédie et à la comédie, on trouve, à côté des noms des poètes et des titres de leurs drames, les noms des acteurs qui les ont joués et la mention particulière de l'acteur couronné.
3° Enfin pour chacune des deux grandes fêtes dionysiaques il existait deux catalogues, l'un de tragédiens, l'autre de comédiens vainqueurs : ce sont de simples listes de noms, avec un chiffre indiquant le total des victoires remportées. Tous ces documents avaient dû être déposés au Métrôon. A une époque qu'on ne saurait préciser, l'Etat (ou peut-être un particulier généreux et lettré) les fit transcrire sur des stèles de marbre, qu'on dressa sur l'Acropole et surtout dans le téménos du théâtre de Dionysos. C'est là que d'importants fragments en ont été retrouvés. - ACTEURS ROMAINS
A Rome, les acteurs furent d'abord appelés ludiones (ou ludii) terme général qui désignait tous les bateleurs et amuseurs publics. Mais le nom spécial de l'acteur dramatique, c'est histrio. Ce mot fut importé d'Etrurie dans des circonstances racontées par Tite-Live. En 364 av. J.-C., à l'occasion d'une peste qui ravageait la ville, on essaya d'apaiser les dieux par des jeux scéniques, spectacle jusqu'alors inconnu à Rome. On fit venir d'Etrurie des artistes qui exécutaient sur la scène, avec l'accompagnement d'un joueur de flûte, des gestes mimiques sans paroles. Ces baladins s'appelaient en leur pays istri, c'est-à-dire danseurs. Les Romains leur empruntèrent la chose et le nom. A côté de histrio, on rencontre également le terme actor (cf. agere fabulamm, agere partes) pour désigner les tragédiens et les comédiens. Ceux-ci en outre portaient, comme en Grèce, les noms distincts de tragoedi et comoedi (tragici, comici histriones). En ce qui concerne le mot comoedus, il y a lieu de remarquer que, comme notre mot comédien au XVIIe siècle, il a pris dans la langue de Quintilien le sens tout à fait général d'acteur. On rencontre encore l'expression artifices scaenici (ou simplement artifices, ou scaenici), évidemment calquée sur le grec oi peri Dionuson technitai.
Enfin, comme le chant et la mimique étaient deux parties essentielles de l'art de l'acteur romain, on l'appelait parfois cantor et saltator, selon qu'on envisageait spécialement l'une ou l'autre de ces parties.
En 240 av. J.-C. furent représentées à Rome la première tragédie et la première comédie imitées du grec. L'auteur Livius Andronicus dut, pour la circonstance, improviser une troupe : il la constitua vraisemblablement sur le modèle des sociétés d'artistes dionysiaques qui, à cette époque, parcouraient la Grande Grèce. Comme leurs prédécesseurs en Grèce, les dramatiques romains cumulèrent, à l'origine, les fonctions d'auteur, d'instructeur et d'acteur principal. Mais d'assez bonne heure le chef de troupe hérita de ces deux dernières fonctions, ne laissant au poète que le soin de distribuer les rôles. Une troupe d'acteurs se nommait en latin grex (ou caterva), ses membres gregales. Les femmes en étaient exclues, ou plutôt elles n'y furent admises qu'à une très basse époque : le premier écrivain qui fasse mention des comédiennes est le grammairien Donat, qui vivait au IVe siècle ap. J.-C.. Nous n'avons aucun détail précis sur l'organisation de ces troupes, sur le nombre des gregales, sur leur hiérarchie. Outre les acteurs proprement dits, chaque compagnie avait besoin d'un chanteur (cantor), d'un flûtiste (tibicen) et de figurants (operarii). Au nombre des acteurs on doit aussi compter à Rome les membres du choeur, lesquels n'étaient point, comme en Grèce, des amateurs volontaires, mais de véritables professionnels. Tout ce personnel se recrutait parmi les esclaves et les affranchis. Dès le temps de Cicéron, c'était une industrie lucrative que de faire instruire en vue du théâtre certains esclaves, particulièrement doués. On les confiait pour cela à quelque acteur en renom : nous lisons, par exemple, dans le Pro Roscio comoedo que le grand tragédien Roscius avait passé contrat avec Fannius Chaerea pour l'instruction d'un esclave nommé Panurgus, avec stipulation que les honoraires éventuels de ce Panurgus reviendraient par moitié au professeur et au propriétaire.
A la tête de chaque troupe il y avait un directeur (dominus gregis), le plus souvent un affranchi. C'est à lui seul qu'avaient affaire les donateurs des jeux, avec lui qu'ils traitaient pour la livraison, l'étude et la représentation d'une ou de plusieurs pièces. Le choix de celles-ci était laissé généralement à son expérience et à son goûte : il les achetait lui-même, directement, à l'auteur. Les poètes, par suite, n'avaient d'ordinaire aucun rapport immédiat avec les organisateurs des jeux. Et Ribbeck a raison de dire que «de la confiance, du goût, de la bonne volonté, de l'énergie d'un directeur dépendait en grande partie, dès ce temps-là, l'avenir d'un poète dramatique». En cas d'échec le chef de troupe était responsable envers les donateurs des jeux, et tenu de leur restituer la somme avancée. En revanche il semble bien que les pièces, une fois achetées, restassent sa propriété, et qu'il eût le droit de les représenter à nouveau autant de fois qu'il lui plaisait. Lorsqu'il s'agissait d'un drame ancien qu'on remettait à la scène, le choix de l'ouvrage appartenait encore au dominus gregis. Et Cicéron nous apprend que celui-ci, étant en même temps acteur du premier rôle, se souciait d'ordinaire assez peu de la valeur de la pièce, pourvu qu'elle lui fournît un emploi approprié à son talent. Nous avons conservé les noms de quelques-uns de ces entrepreneurs de spectacles : T. Publilius Pellio qui joua les pièces de Plaute, T. Ambivius Turpio et L. Hatilius de Praeneste qui mirent à la scène celles de Térence, Minucius Prothymus et Cincius Faliscus qui introduisirent sur le théâtre romain l'usage des masques, enfin Démétrius et Stratoclès, comédiens très admirés au temps de Quintilien.
De ces compagnies il y a lieu de distinguer les collegia et sodalitales des artifices scaenici, associations religieuses analogues aux sunodoi grecs [Dionysiaci artifices]. La plus ancienne de ces corporations remontait jusqu'au temps de Livius Andronicus. Festus, en effet, rapporte que, pendant la seconde guerre Punique, ce poète fut chargé officiellement de composer un hymne pour appeler la faveur du ciel sur les armes romaines. Les dieux ayant exaucé ces prières, l'Etat témoigna sa reconnaissance à l'auteur et à ses confrères, c'est-à-dire aux poètes et aux acteurs (scribis histrionibusque), car Andronicus était à la fois l'un et l'autre, en leur accordant le droit de se réunir dans le temple de Minerve sur l'Aventin pour y délibérer sur leurs intérêts communs, et d'y exposer en ex-voto les récompenses qu'ils avaient obtenues. C'est probablement cette très ancienne association des poètes et histrions qu'il faut reconnaître dans le collegium poetarum mentionné par Valère Maxime : il résulte en outre de ce texte que le collège des poètes était devenu, au Ier siècle av. J.-C., une sorte d'académie ou de tribunal critique en matière de poésie. Les inscriptions nous révèlent l'existence, au temps de l'Empire, d'un certain nombre de ces corporations d'acteurs, notamment d'un corpus scaenicorum latinorum, d'un commune mimorum, et des parasiti Apollinis. Comme toutes les autres corporations, celles des scaenici avaient leur culte, leurs cérémonies religieuses, leurs prêtres et leurs autorités.
Nous sommes très peu renseignés sur l'organisation des concours dramatiques à Rome. Il n'est même pas sûr qu'il y ait jamais eu de compétition officielle entre les poètes.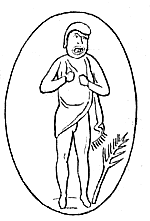
Quant aux concours d'acteurs, c'est dans les prologues de Plaute qu'il en est question pour la première fois : les allusions précises, contenues notamment dans les prologues du Poenulus et de l'Amphitryon, prouvent qu'à l'époque où ces morceaux furent composés il existait des concours réguliers entre les chefs de troupes, que le prix du vainqueur y consistait, comme dans les jeux du Cirque, en une palme (palma), et que ce prix était décerné par le président même des jeux, sans l'assistance d'un jury. La figure ci-jointe, où l'on voit un comédien avec une palme à ses pieds, représente probablement un de ces vainqueurs. Mais les prologues actuels des comédies de Plaute sont, comme on sait, l'ouvre des directeurs de troupes qui, depuis le milieu du IIe siècle ap. J.-C., remirent ses pièces à la scène. Impossible de dire si antérieurement, et dès le temps de Plante lui-même, ces concours existaient. Ce qui en tout cas est hors de doute, c'est qu'ils n'eurent jamais la même importance qu'en Grèce.
La solde des acteurs (lucar) était versée par l'Etat entre les mains du directeur, qui se chargeait de rétribuer lui-même son personnel. Ces honoraires furent sans doute assez modestes à l'origine ; mais plus tard, au temps des grands acteurs Roscius et Aesopus, ils atteignirent des chiffres énormes. D'après Pline, Roscius recevait 1000 denarii par jour de représentation et gagnait par an 500 000 sesterces. Son collègue Aesopus, en dépit de ses prodigalités, laissa une succession montant à 20 millions de sesterces. Ce sont là, à vrai dire, des chiffres exceptionnels. Mais le salaire moyen d'un acteur, même de second rang, ne laissait pas que d'être très élevé, si l'on en juge par la somme de 100 000 sesterces à laquelle avait été évalué, dans le contrat passé entre Fannius Chaerea et Roscius, le produit annuel de l'esclave Panurgus. A plusieurs reprises on dut fixer un maximum légal pour les honoraires des acteurs : cela eut lieu notamment sous Tibère.
Outre la solde proprement dite, les acteurs recevaient d'ordinaire du donateur des jeux des gratifications (corollaria) proportionnées à leur mérite : c'étaient des couronnes d'or et d'argent, et, au temps de l'Empire, des dons en argent ou en nature. Ces gratifications n'avaient rien d'obligatoire ; mais elles étaient tellement passées dans l'usage que ceux qui, comme Caton, s'en abstenaient, étaient taxés de ladrerie.
Chez les Romains le choeur, considérablement réduit, n'évoluait plus dans l'orchestre. On l'avait fait monter sur la scène à côté des acteurs, et dans le demi-cercle de l'orchestre, devenu ainsi libre, on avait installé des sièges d'honneur pour les membres du Sénat. De là résultèrent des modifications profondes dans la configuration du logeion. Pour que le choeur y trouvât place, on dut l'élargir ; et pour que, d'autre part, les spectateurs de l'orchestre prissent bien voir le jeu des acteurs, il fallut l'abaisser. Aussi constatons-nous sur le plan de Vitruve que le logeion romain a une profondeur presque double de celle du logeion grec, tandis que sa hauteur est réduite d'une bonne moitié (5 pieds au plus). Sur cette scène ainsi élargie le déploiement de personnages était beaucoup plus considérable que chez les Grecs. Nous venons de voir, d'abord, que les deux groupes d'exécutants s'y trouvaient réunis. Ajoutons que la règle grecque limitant à trois le nombre des acteurs avait été rejetée dès l'origine par les Romains : chez eux (c'était, d'ailleurs, une suite nécessaire de l'absence de masques), chaque rôle avait son interprète. C'est ainsi que dans le théâtre de Plaute deux pièces seulement, la Cistellaria et le Stichus, pourraient à la rigueur être jouées par trois acteurs ; mais toutes les autres en exigent quatre, cinq, six, et même sept (Trinummus). Chez Térence l'Héautontimorouménos et l'Hécyre veulent cinq acteurs, les Adelphes et le Phormion six, l'Andrienne et l'Eunuque davantage encore. Mais c'est surtout par la masse énorme des figurants que les directeurs s'efforçaient de flatter le goût naturel du public romain pour le mouvement, l'agitation matérielle, et le luxe de la mise en scène. Il nous est parvenu à ce sujet quelques indications curieuses. A l'occasion des jeux donnés par un préteur, le riche Lucullus fournit un jour jusqu'à cent chlamydes de pourpre pour un choeur de guerriers. Dans une reprise de la Clytemnestre d'Accius offerte par Pompée (55 av. J.-C.) on vit défiler six cents mulets portant le butin d'Agamemnon : ce qui suppose également un nombre considérable de muletiers. Dans une praetextata on assista à une véritable bataille rangée sur la scène, avec cavalerie et infanterie. Naturellement ces exhibitions, en absorbant l'attention des spectateurs, étouffaient presque complètement l'intérêt dramatique. Cicéron et Horace sont parmi les rares personnes de goût qui se scandalisent de ces excès de la mise en scène.
Les variétés du drame étaient plus nombreuses à Rome qu'à Athènes. C'est qu'à côté des formes dramatiques directement importées de l'étranger, tragédie et comédie, avaient survécu ou se développèrent plusieurs genres indigènes, atellane, mime, pantomime, plus ou moins transformés, d'ailleurs, par l'influence grecque. De là plus de diversité aussi dans le costume des histrions romains. La tragédie latine s'était, presque dès l'origine, dédoublée en deux genres : la tragoedia et la praetextata.Les tragoediae, qui étaient des traductions ou des adaptations du grec, reproduisaient fidèlement le costume de leurs modèles. La seule différence, c'est qu'à Rome on avait d'abord adopté, comme équivalent du manteau grec, la laena (ou toga duplex), robe d'apparat des anciens rois, portée aussi par les flamines pendant la cérémonie du sacrifice. Encore la laena fit-elle place de bonne heure à la palla, plus voisine par sa forme du manteau grec. Les tragoediae étaient aussi appelées quelquefois crepidatae, du mot crepida (grec krêpis) qui désignait la chaussure tragique : c'était un brodequin à haute semelle, de bois ou de cuir, analogue au cothurne des tragédiens grecs. Dans les praetextatae, au contraire, le costume, comme les sujets, était national. Les rois, les généraux et les grands personnages de Rome mis en scène y portaient la toge bordée de pourpre (toga praetexta), insigne des magistratures supérieures. A une certaine époque s'introduisit, en outre, l'usage de la tunique de pourpre. Mais c'est là sans doute un trait de ce faste grossier qui commença à s'étaler sur la scène dans les derniers temps de la République. C'est ainsi qu'en 57 av. J.-C. le consul P. Lentulus Spinther équipa, dit-on, tout son personnel d'étoffes brodées d'argent (argentalis choragiis). Et l'année suivante, au milieu des prodigalités déployées par M. Aemilius Scaurus dans les jeux qu'il donna comme édile, on remarqua les vêtements tissés d'or de ses acteurs (attalica vestis).


La comédie, chez les Latins, se subdivisa également en deux genres : la palliata (ou simplement comoedia) imitée des Grecs, et la togata dont la fable était romaine. Dans le premier de ces genres le costume était entièrement grec : c'était celui de la comédie nouvelle. «Les vieillards de comédie, dit Donat, ont un habit blanc, parce que tel fut jadis l'usage. Aux jeunes gens on donne un costume multicolore. Les esclaves sont court vêtus, soit en souvenir de la pauvreté d'autrefois, soit afin d'être plus alertes. Les parasites se présentent en scène avec le pallium roulé. Les personnages heureux portent le blanc, les malheureux des haillons, les riches la pourpre, les pauvres le rouge commun. Les soldats ont la chlamyde de pourpre. Les jeunes filles sont vêtues à la mode étrangère. Le prostitueur a un pallium bariolé. La courtisane est habillée de jaune, en signe de sa cupidité».

Ajoutons que le personnage chargé de débiter le prologue, et que pour cette raison on nommait lui-même Prologus, se présentait avec un costume spécial et un rameau en main. Quant à la chaussure, c'était la demi-bottine grecque appelée soccus.

La figure ci-dessus est une illustration de la première scène de l'acte II de l'Eunuque de Térence les personnages qu'on y voit sont le jeune Athénien Phaedria et l'esclave Parménon. Dans la togata, dont l'action se passait le plus souvent dans les boutiques (tabernae) des épiciers, artisans, et petits marchands d'Italie (de là le nom de tabernaria qu'on lui donnait aussi), le costume était la toge blanche, sans bordure, telle que la portait le peuple. Mentionnons, comme une variété, passagère, du reste, et peu importante de la comédie nationale, la trabeata, ainsi appelée parce qu'elle mettait en scène l'ordre des chevaliers, dont l'insigne était la toge blanche ornée de bandes de pourpre horizontales, ou Trabea.
Pour les acteurs d'atellanes, de mimes et de pantomimes, voyez Atellanae fabulae, Mimus, Pantomimus.
Dans la tragédie ainsi que dans la comédie latines le masque ne fut adopté qu'assez tard. Le fait s'explique, non par des raisons d'art, mais par un préjugé de caste. Comme la jeunesse romaine qui, bien longtemps avant l'introduction du drame grec, se divertissait à jouer l'atellane sous des masques, entendait ne pas être confondue avec les histrions de métier, défense officielle fut faite à ceux-ci de paraître masqués. Ils durent se tirer d'affaire, tant bien que mal, avec des perruques (galeri, galearia), dont les nuances variées, blanc, noir, roux, correspondaient aux trois principaux âges de la vie. Par imitation de l'ogkos grec, la perruque des tragédiens romains étaient munie au-dessus du front d'une sorte de toupet (superficies). Pour donner plus de relief aux traits, les acteurs se peignaient le visage, tout comme chez nous. Dans les rôles féminins ils se blanchissaient les mains et le visage à la craie. En dépit des résistances aristocratiques, le masque finit cependant par s'imposer sur la scène romaine ; mais il est malaisé de fixer exactement la date de cette innovation. Selon le grammairien Diomède, dont le témoignage est confirmé implicitement par Cicéron, le premier tragédien latin qui parut masqué fut Roscius, lequel ayant les yeux bigles cherchait par là à dissimuler ce défaut. Ce témoignage, il est vrai, semble de prime abord démenti par une assertion de Donat, qui attribue l'introduction du masque dans la tragédie à un chef de troupe du nom de Cincius Faliscus. Mais Ribbeck concilie d'une façon très plausible ces deux notices, en supposant que Roscius était premier acteur dans la troupe que Cincius Faliscus dirigeait. Même incertitude en ce qui concerne l'adoption du masque dans la comédie. Une seule chose paraît sûre, c'est qu'elle n'eut lieu qu'après Térence : car on trouve chez ce poète maintes allusions à des jeux de physionomie qui impliquent la mobilité du visage. Pourtant Donat affirme expressément, dans ses préfaces des Adelphes et de l'Eunuque, que ces deux comédies furent jouées par des acteurs masqués. Mais on a supposé avec vraisemblance que Donat avait été induit en erreur sur ce point par les miniatures dont était illustré son manuscrit, et qu'il a crues à tort contemporaines de Térence. Le plus probable, en somme, c'est que le masque a été adopté simultanément dans la tragédie et dans la comédie, et cela à l'époque de Roscius, vers 640-630 de Rome. A en croire Cicéron, l'innovation de Roscius aurait été d'abord assez mal accueillie du public, qui regrettait toutes les nuances délicates de mimique auxquelles il était habitué. Mais il y a apparence que Cicéron n'exprime là que l'opinion des spectateurs privilégiés, sénateurs et chevaliers assis dans l'orchestre ou sur les gradins les plus proches de la scène. Quant à la multitude, reléguée sur les bancs supérieurs, comme toutes ces finesses lui échappaient forcément, elle n'avait qu'à gagner à l'emploi du masque ; et sans doute elle s'en félicita.
L'art de l'acteur antique comprenait deux parties essentielles : le débit (pronuntiatio), et la mimique (gestus, actio). Dans le drame grec trois variétés de débit étaient en usage : la déclamation (katalogê), le chant (melos, ôdê), et le récitatif (parakatalogê). Les Latins au contraire ne reconnaissaient que deux genres d'exécution : le deverbium, qui correspond à la kalalogê des Grecs, et le canticum. Mais ii n'y a là qu'une différence de terminologie : car par le mot canticum les Latins entendaient toute exécution accompagnée de musique, par conséquent le récitatif aussi bien que le chant.
A quelles parties du texte s'appliquait chacun de ces modes ? On a pu l'établir de façon à peu près sûre, grâce surtout aux signes marginaux contenus dans deux manuscrits de Plaute. A la déclamation simple semblent avoir appartenu tous les morceaux versifiés en trimètres iambiques ; au récitatif, les systèmes et les tétramètres catalectiques (octonaires et septénaires des Latins) ; au chant, les morceaux proprement lyriques écrits en mètres mêlés, ainsi que les péons, crétiques et bacchiaques. Mais l'importance relative de ces modes n'était pas la même sur les deux scènes. Chez les Grecs la déclamation tenait la première place, parce que le dialogue presque tout entier y est écrit en trimètres ïambiques ; la parakalalogé, au contraire, y a peu d'importance. C'était l'inverse chez Plaute et chez Térence, qui usent beaucoup plus des octonaires et septénaires.
La déclamation n'était pas, chez les anciens, un simple parlé. Même à Rome, c'était quelque chose de modulé et de chantant : modulatio scaenica, dit Quintilien. Et cet écrivain ajoute que le débit comique lui-même s'élevait au-dessus du ton quotidien par une sorte de noblesse théâtrale (decor scaenicus). A plus forte raison cela est-il vrai de la récitation tragique. Celle-ci était non seulement grave, pompeuse même, mais aussi en grande partie conventionnelle. «L'art des acteurs grecs, dit M. Maurice Croiset interprétant ingénieusement un passage d'Aristote, se développa autour de certaines formes typiques d'intonation, qui furent de bonne heure reconnues et fixées : telles que le commandement (entolê), la prière (euchê), le récit (diêgêsis), la menace (apeilê), l'interrogation (erôtêsis), la réponse (apokrisis)».Quant au chant, c'était aussi une partie importante de l'art des acteurs : soit qu'ils exécutassent des soli (monôdiai), ou des duos lyriques (amoibaia) avec un autre acteur, ou avec le coryphée (kommoi). Ces morceaux étaient toujours accompagnés de la flûte. Enfin la paracatalogé (selon l'étymologie du mot, quasi-déclamation) était un mode intermédiaire entre les deux autres : c'était une récitation rythmée par les sons de la flûte, quelque chose d'analogue, par suite, à ce qu'on appelle de nos jours le débit mélodramatique. On prétend qu'elle avait été inventée par Archiloque pour l'exécution de ses poésies iambiques, et que de là elle s'était introduite plus tard au théâtre.

Pour les cantica des Latins, il suffit de rappeler ce qui en a été dit ailleurs, en faisant remarquer que ce que rapporte Tite-Live de la disjonction de la parole et du geste, ne saurait s'appliquer aux dialogues en septénaires ou octonaires à trois et quatre personnages, comme on en rencontre chez Plaute et Térence ; car il eût fallu, dans ce cas, ou bien que chaque acteur fût doublé de son cantor, ou que le même cantor leur servît tour à tour de truchement à chacun : deux hypothèses qui sont également invraisemblables. Il convient donc de prendre ici le terme canticum, non dans son acception générale, mais au sens étroit de monodies, lequel est, d'ailleurs, attesté par les grammairiens, entre autres par Diomède. Les monodies étant des morceaux savants et d'exécution difficile, à rythmes et à mélodies changeantes (mutatis modis cantica), on conçoit qu'il fût d'usage de les confier à un artiste spécial. Pourtant cela même n'était pas une règle absolue : car nous savons pertinemment par Cicéron que la monodie de Teucer dans l'Eurysacés d'Ennius fut chantée par Roscius lui-même.
Avant de parler de l'action, essayons de résumer, d'après ce qui vient d'être dit, les qualités que le débit oral exigeait de l'acteur antique : nous verrons combien elles sont déjà multiples et complexes. La première de toutes, c'était un organe ample et sonore : il fallait en effet se faire entendre dans des édifices immenses et à ciel ouvert. Ce don était plus indispensable encore aux acteurs romains, tant que l'usage du masque leur fut interdit ; car le masque, selon le témoignage formel d'Aulu-Gelle, faisait office de porte-voix [Persona]. Pour la même raison on exigeait des acteurs grecs et romains une articulation nette et précise, et le public était sans pitié pour la moindre faute de prononciation et d'accent. Il leur fallait également une extrême souplesse de voix, non seulement pour passer à tout moment de la récitation au chant ou au récitatif, mais surtout pour représenter tour à tour dans la même pièce les personnages les plus divers, hommes, femmes, enfants, vieillards. A toutes ces qualités, ajoutons enfin une mémoire fidèle et, sûre, car les anciens paraissent avoir ignoré l'usage du souffleur.
A l'exemple de l'action oratoire, minutieusement décrite par Quintilien, on peut ramener l'action scénique à trois éléments : les signes du visage, les gestes des mains, les mouvements et attitudes du corps. Naturellement l'emploi du masque réduisait les premiers à fort peu de chose. Il est prouvé toutefois que l'une des parties du visage, et la plus expressive, l'oeil, gardait sa mobilité. Au IVe siècle av. J.-C., Théophraste reprochait plaisamment à l'acteur grec Tauriscos de jouer de dos, entendant par là que son regard restait fixe et sans nuances. Et Cicéron, de son côté, atteste que les acteurs de son temps savaient faire briller le feu du regard à travers le masque. Comment, étant donnée l'extrême petitesse de la cavité réservée pour l'oeil, pouvaient-ils produire ces effets ? C'est ce qu'il n'est pas facile de décider, et ce qu'il ne nous appartient pas, du reste, de rechercher ici. Rien de plus expressif que la mimique des mains. Et ce que dit, à ce propos, Quintilien de l'orateur est plus vrai encore du comédien : «Le nombre des mouvements dont les mains sont susceptibles est infini, et égale presque celui des mots : car si les autres parties du corps viennent en aide à la parole, les mains font plus, elles parlent, ou peu s'en faut. Elles demandent, elles promettent, elles appellent, elles congédient, elles menacent, elles supplient, elles expriment l'horreur, la crainte, la joie, la tristesse, l'hésitation, l'aveu, le repentir, la mesure, l'abondance, le nombre, le temps. N'ont-elles pas le pouvoir d'exciter, de calrner, de supplier, d'approuver, de témoigner l'admiration et la pudeur? Ne tiennent-elles pas lieu d'adverbes et de pronoms pour désigner les lieux et les personnes ?» Tous ces gestes, on voit clairement par maintes remarques de Quintilien, comme aussi par le Commentaire de Donat sur Térence, qu'ils avaient été, à Rome, catalogués et classés et qu'ils étaient devenus dans les écoles de déclamation objet d'enseignement. Quant aux mouvements du corps, il va de soi qu'ils devaient avoir dans la tragédie plus de lenteur et de dignité que dans le genre comique. Et dans celui-ci, à son tour, il y avait, à ce point de vue, des différences marquées entre les divers personnages : les gens de guerre, les matrones, les vieillards, les fils de famille se distinguaient par une démarche plus posée et plus calme des esclaves, des parasites, des pêcheurs, des prostitueurs.
A ces détails il convient d'ajouter quelques observations plus générales sur les caractères propres, et en quelque sorte sur le style de l'action scénique comparée à l'action oratoire : nous les emprunterons à Cicéron et à Quintilien. Selon ces deux auteurs, le geste de l'orateur était d'un dessin large et ample, et ne visait qu'à exprimer le sens général de la pensée. Infiniment plus nuancée et plus minutieuse, la gesticulation de l'acteur s'efforçait de traduire aux yeux chaque détail, et pour ainsi dire chaque mot de la phrase. Cette différence essentielle, Quintilien a pris soin de la mettre lui-même en lumière au moyen d'un exemple : «C'est un orateur que je veux former, dit-il, non un comédien. Par conséquent le geste ne devra pas exprimer par le menu toutes les nuances, pas plus que le débit ne marquera toutes les pauses, tous les intervalles, toutes les affections de l'âme. Supposons qu'on ait à réciter sur la scène ces vers : «Que faire ? Puis-je n'y pas aller, à présent que c'est elle-même, la première, qui m'en prie ? Mais plutôt, si une bonne fois je me décidais à ne plus endurer les outrages de pareilles femmes !» Ici l'acteur, pour exprimer son hésitation, fera des pauses, il variera les tons, les gestes, les signes de tête. Mais le débit oratoire est d'un tout autre goût, il ne veut pas tant d'assaisonnements». Ailleurs, Quintilien nous apprend que le geste scénique dégénérait parfois en une vraie pantomime : ainsi, pour exprimer qu'une personne était malade, l'acteur contrefaisait le médecin qui tâte le pouls ; ou bien, pour faire entendre qu'elle savait la musique, il composait ses doigts à la façon d'un joueur de lyre. Cette imitation matérielle, le rhéteur l'interdit absolument à ses disciples : elle ne convient, déclare-t-il, qu'aux histrions, et non pas même à tous, mais à ceux-là seuls qui mettent peu de gravité dans leur jeu.Signalons, pour finir, un dernier caractère de l'action théâtrale, qu'on eût considéré comme un vice, ou du moins comme une affectation déplacée, chez l'orateur : l'auteur de la Rhétorique à Hérennius l'appelle venustas, et Quintilien elegantia ; c'est ce qu'on nommerait de nos jours la beauté plastique. La statuette de Riéti, dont le buste ramené en arrière, le bras droit replié sur la poitrine, et tout le corps rejeté de côté expriment d'une façon si saisissante un sentiment d'horreur, peut nous donner quelque idée de la manière dont les tragédiens antiques savaient allier la noblesse à la vérité des attitudes.

Il est regrettable qu'on ne puisse faire l'histoire de l'art scénique en Grèce, puis à Rome, et le suivre dans ses transformations successives. Malheureusement nous manquons des données nécessaires. Toutefois on peut affirmer a priori que, même à Athènes, la déclamation et le geste ne sont pas restés immuables. Il est évident, par exemple, que les drames d'Euripide ont été joués d'une façon plus humaine et plus vivante que ceux d'Eschyle. Et cette évolution a dû commencer de fort bonne heure, puisque dans sa vieillesse Mynniscos de Chalcis, qui avait été le protagoniste d'Eschyle, traitait déjà de singe son successeur Callipidès. Et les grands acteurs du IVe siècle, les Aristodémos, les Théodoros, les Polos ont sans doute apporté plus de vérité et de pathétique encore dans leurs créations. Mais il faut bien se garder d'exagération : même lorsque la tragédie grecque s'est rapprochée de la vie, il est certain que l'interprétation ne l'a suivie que de loin, et timidement, dans cette voie ; c'est que le costume même de l'acteur, surtout le masque et le cothurne, le condamnaient pour toujours à l'emphase et à la pompe. A Rome il y a un fait sur lequel il faut insister, parce qu'il domine tout : c'est le développement excessif pris par la mimique. Au lieu de rester, comme en Grèce, au service de la déclamation, elle prend le pas sur celle-ci, et parfois même, nous l'avons dit à propos des cantica, elle s'en rend indépendante. On verra à l'article Pantomimus comment elle finit par se constituer à l'état de genre distinct. L'âge classique de l'interprétation à Rome, c'est le temps de Roscius et d'Aesopus. Plus tard, elle a gagné peut-être en finesse et en réalisme, mais elle perdit incontestablement en correction, en harmonie et en perfection de l'ensemble. C'est ce qu'on voit par la curieuse description que nous a laissée Quintilien de la manière de deux comédiens, Démétrius et Stratoclès, ses contemporains. C'étaient deux artistes de grand talent : mais, ce que n'eût fait sans doute ni un Roscius ni un Aesopus, ils n'hésitaient pas, au besoin, à jouer à contresens pour forcer les applaudissements. Stratoclès, notamment, avait une certaine façon de rire qui mettait le public en joie : aussi en abusait-il et l'introduisait-il, même hors de propos, dans tous ses rôles.
La variété d'aptitudes nécessaire à l'acteur grec et romain exigeait un apprentissage des plus laborieux et des plus longs. Avant d'aborder la scène, les acteurs grecs se soumettaient, dit Cicéron, à un entraînement qui durait plusieurs années. En outre, chaque fois qu'ils devaient jouer, ils déclamaient d'abord à domicile, couchés sur le dos, animant peu à peu leur organe et l'élevant par degrés ; après la représentation, ils déclamaient de nouveau, assis, faisant redescendre la voix du ton le plus aigu au plus grave, comme pour la recueillir et la faire rentrer en eux-mêmes. Un autre de leurs exercices consistait à réciter, la poitrine chargée d'une lame de plomb : cela nourrissait, disait-on, la voix et lui donnait plus d'ampleur. Ils s'astreignaient aussi à des règles d'hygiène très strictes. Ils tenaient leurs répétitions de préférence le matin, et à jeun. Une très grande modération dans le boire, le manger et les plaisirs leur était prescrite : ils devaient en particulier s'abstenir de fruits et de mets indigestes. En revanche les purgatifs et les vomitifs leur étaient recommandés.
Dès le temps de Cicéron il y eut à Rome des écoles, des sortes de conservatoires, tenus par les acteurs renommés.
Les Romains considéraient la profession d'acteur comme déshonorante : la loi frappait de dégradation civile (infamia) tous ceux qui s'y livraient. Selon la définition rigoureuse du jurisconsulte Antistius Labeo, contemporain de Cicéron, était infamis tout citoyen qui se montrait sur les planches, que ce fût en public ou même dans un local privé. Plus libéraux, cependant, les juristes de l'époque suivante plaçaient le critérium de l'infamie dans la recherche d'un lucre (qui quaestus causa in certamina descenderent). L'influence croissante des moeurs grecques releva peu à peu la condition des histrions romains. A l'exemple des princes grecs, Sylla s'entoura d'acteurs, de mimes et de bouffons ; c'est lui qui gratifia Roscius de l'anneau de chevalier. Le grand talent de certains artistes tels que Roscius et Aesopus, les sommes énormes qu'ils gagnaient, leur honorabilité reconnue, les rapports d'amitié qu'ils entretinrent avec les grands personnages du temps, Sylla, Crassus, Cicéron, tout cela aussi contribua à effacer l'ancien préjugé. A partir du temps de César, on vit nombre de fois des personnages de l'aristocratie se produire sur la scène. Vainement une série de sénatus-consultes (le plus ancien est de l'an 38 av. J.-C.) le leur interdit : ces décrets ne furent appliqués que mollement et par intermittence. Du reste, plusieurs empereurs eux-mêmes mirent leur vanité à disputer les prix au théâtre ou dans le cirque. Sous l'Empire la passion pour les histrions (histrionalis favor) était devenue, selon le mot de Tacite, un de ces vices que le Romain contractait dans le sein de sa mère : c'était une véritable maladie (morbus), dit Sénèque. Presque chaque famille riche entretenait sa troupe particulière, qui jouait à domicile pour le plaisir du maître et de ses invités : la plus nombreuse et la meilleure était, naturellement, celle de la maison impériale. Les premiers personnages de Rome passaient leurs journées dans la compagnie des histrions, surtout des pantomimes, les accompagnant chez eux, leur faisant escorte dans la rue comme d'humbles clients. Un sénatus-consulte de l'an 15 av. J.-C. dut rappeler sénateurs et chevaliers à leur dignité en leur interdisant ces pratiques. Chez les femmes l'engouement n'était pas moindre : des matrones, des impératrices même se compromirent publiquement dans des liaisons ou dans des aventures scandaleuses avec les histrions. Ceux-ci faisaient des gains énormes : Vespasien gratifia le tragédien Apollinaris de 400 000 sesterces pour une seule représentation. Le pantomime Pylade fut assez riche dans sa vieillesse pour offrir de sa bourse des jeux au peuple. Naturellement leur insolence et leurs prétentions dépassaient toute mesure : sous Tibère, un pantomime ayant refusé de jouer au taux fixé par la loi, la multitude prit parti pour lui, et il fallut convoquer d'urgence le Sénat pour résoudre le conflit. Mais, par un étrange contraste, tandis que la condition sociale des histrions avait complètement changé, leur état juridique ne se modifiait pas. La seule amélioration qui y fut apportée est un édit d'Auguste, interdisant aux magistrats de les frapper de verges en dehors du temps des spectacles. Mais lui-même fit fouetter publiquement pour leur insolence les histrions les plus aimés du public, l'acteur Stéphanion et le pantomime Hylas.
La passion dont les acteurs étaient l'objet se traduisait souvent par des manifestations au théâtre. Ces manifestations étaient, du reste, les mêmes que chez nous, plus violentes cependant et plus tumultueuses. Le public ne se contentait pas d'applaudir et de siffler : il allait parfois jusqu'aux injures. Quand un acteur déplaisait trop, on l'expulsait du théâtre, non sans l'avoir obligé parfois de quitter son masque pour redoubler son humiliation. La claque fut de bonne heure une institution organisée sur le modèle de la brigue électorale. Nous trouvons sur ce point de curieux détails dans le prologue de l'Amphitryon. On y voit que dès ce temps les chefs de troupes et les principaux acteurs convoquaient par lettre ou par émissaire leurs partisans, qu'ils avaient des claqueurs à gages (fautores) postés en divers endroits de la cavea pour donner le signal des applaudissements ou des huées. Tacite nomme un certain Percennius qui était, de son métier, dux theatralium operarum, c'est-à-dire chef de claque. La rivalité entre les partis était très vive, au point de dégénérer souvent en des querelles ou même en des rixes sanglantes. On se jetait à la tête des pierres et des débris de bancs : et il en résultait parfois mort d'homme. Néron prenait part volontiers à ces batailles ; un jour il blessa de sa main un préteur. Il fallut installer au théâtre une garde de soldats, chargée de maintenir l'ordre. A la suite d'un meurtre, commis pendant une représentation, Tibère frappa de bannissement les chefs des factions rivales, ainsi que les acteurs, cause de ces troubles.
Souvent aussi les acteurs provoquaient volontairement des manifestations par des allusions politiques. Un geste, un simple regard jeté sur quelque spectateur de marque, suffisaient à donner à un vers inoffensif la portée d'une louange ou d'une satire personnelle. Chez les mimes, surtout, les allusions malignes étaient une tradition à peu près assurée de l'impunité. Mais les tragédiens se permettaient souvent, eux aussi, ces libertés. Une année, aux jeux Apollinaires, le tragédien Diphilus, en récitant ce vers : «Tu n'es grand que pour notre malheur», et cet autre : «Tu te repentiras un jour d'avoir été trop puissant», désigna clairement Pompée, aux applaudissements du public qui lui fit répéter plusieurs fois ces passages. Au besoin même, les acteurs ne craignaient point d'altérer les textes et d'y ajouter. Ainsi fit en l'an 697 Aesopus. Il jouait l'Eurysacès d'Accius, pièce contenant un canticum très pathétique où étaient rappelés les services rendus par Télamon aux Achéens, l'ingratitude de ceux-ci, et l'exil infligé par eux à leur bienfaiteur. Ces vers trouvaient leur application si naturelle dans la condition présente de Cicéron, alors exilé, et Aesopus les prononça avec tant de passion, tantôt tourné vers le Sénat et les chevaliers, tantôt lançant ses reproches droit à la face du peuple, que toute l'assistance fondit en larmes. Mais il ne s'en tint pas là : au beau milieu des vers d'Accius il intercala un fragment de l'Andromaque d'Ennius, où l'héroïne gémit sur la ruine et l'incendie du palais paternel : allusion transparente à la maison de Cicéron livrée aux flammes. Enfin il alla jusqu'à insérer dans son rôle un vers de sa façon à la louange de son ami : Summum amicum, summum in bello, summo ingenio praeditum. Il ne s'agit là toutefois que d'altérations passagères, et qui n'ont point pris place dans les textes. D'autres, au contraire, qui sont également l'oeuvre des acteurs, ont persisté et sont parvenues jusqu'à nous. Sans parler de maints remaniements de détail, nous avons déjà dit que les prologues, qu'on lit actuellement en tête des comédies de Plaute, ne sont pas son oeuvre, mais celle des chefs de troupes qui plus tard ont remis ses pièces au théâtre. Parfois même des scènes entières ont été refaites, pour mieux s'accommoder au goût du jour : les dénouements du Poenulus de Plaute et de l'Andrienne de Térence, par exemple, nous sont arrivées en deux rédactions différentes.
Dans les didascalies latines le chef de troupe est nommé à côté du poète, des donateurs des jeux, et du compositeur. Nous possédons encore celles des pièces de Térence : elles paraissent empruntées au livre qu'avait publié Varron De scaenicis actionibus [Didascalia].
Article d'Octave Navarre